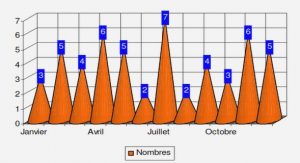Les seuils de pauvreté
Au niveau international, il existe certains seuils qui permettent une comparaison de pauvreté entre les pays. La Banque Mondiale définit l’un d’entre eux et fixe un indice de capital humain (ICH), un seuil de pauvreté absolue fixé à minimum 1.25 dollars par jour et par personne. Celles qui se trouvent en dessous de ce seuil sont « pauvres ». Ce minimum, ne tenant pas compte du contexte économique de chaque pays, rend difficile l’estimation du nombre de personne en situation de pauvreté. En Suisse par exemple, nous ne pouvons pas survivre avec moins de deux dollars par jour (Schuwery et Knopfel, 2014). Un autre seuil tient compte quant à lui du contexte économique de chaque pays au niveau international. Le « revenu médian » du pays concerne un revenu par rapport auquel la moitié de la population gagne davantage et l’autre moitié moins. Le seuil de pauvreté, fixé en pourcentage, est de 60% du revenu médian pour l’union européenne. Les ménages qui n’atteignent pas le pourcentage du revenu médian sont considérés comme « pauvres » au niveau international (Reuse, 2013). L’écart de pauvreté défini l’intensité de la pauvreté.
Le calcul se base sur la différence entre le revenu disponible et le seuil de pauvreté. Plus le pourcentage est grand, plus l’écart de pauvreté l’est également. L’aide sociale publique en Suisse se base sur cet écart pour définir le besoin financier (Schuwery et Knopfel, 2014). L’Office fédéral de la statistique (OFS) se base sur le minimum vital de l’aide sociale publique pour mesurer la pauvreté en Suisse. Les personnes qui n’ont pas les moyens d’obtenir certains biens et services jugés nécessaires à une vie sociale intégrée sont considérées comme « pauvres ». Le minimum vital est définit par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et est composé d’un montant forfaitaire. Ce dernier comprend l’entretien de base comme la nourriture et les vêtements, les frais de logement, les primes de base ainsi que 100 francs supplémentaire par personne de plus de 16 ans. Les ménages qui voient leur revenu inférieur au seuil de pauvreté sont considérés comme pauvres. En Suisse, en 2012, le seuil de pauvreté se basait pour une personne seule sur 2’200 francs par mois et pour un ménage avec deux enfants sur 4’050 francs en moyenne4.
Des facteurs de risques
Les personnes risquant de basculer dans la pauvreté sont celles qui doivent s’en sortir avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté relative ou seuil de risque de pauvreté. Au commencement de l’Etat social, les personnes touchées principalement par la pauvreté étaient les malades chroniques, les personnes âgés, les sans-abris et d’autres groupes marginaux. La « nouvelle pauvreté » est liée aujourd’hui aux évolutions économiques et politiques telles qu’un bas niveau de formation, un emploi précaire, le chômage de longue durée, la composition d’un ménage combinée à une restriction financière, le lieu de domicile ainsi qu’une absence d’assurance lors de maladie. D’autres facteurs individuels tels que le sexe, l’âge et la nationalité peuvent aggraver le risque de pauvreté lorsqu’ils sont cumulés aux paramètres mentionnés ci-dessus. En effet, les femmes sont plus souvent touchées par la pauvreté que les hommes malgré l’idéal visé de l’égalité. Les jeunes adultes, peu voire pas formés, les retraités ainsi que les chômeurs de plus de 50 ans font également partie des groupes à risque de la pauvreté. Nombreux sont les travailleurs âgés qui perdent leur emploi et bénéficient du chômage de longue durée.
La difficulté de trouver un emploi s’accentue de nos jours pour cette population, d’autant plus que la génération du baby-boom arrive gentiment à l’âge de 50 ans et se trouvent en concurrence avec les plus jeunes, mais nous y reviendrons plus tard. Enfin, les personnes étrangères et plus particulièrement les « sans-papiers » se retrouvent souvent dans une situation précaire (Schuwery et Knopfel, 2014). Selon l’OFS, les ménages monoparentaux, les adultes vivant seuls, les personnes non formées, non occupées et les personnes vivant dans un ménage à faible participation au travail sont les personnes les plus touchées par la pauvreté5. La pauvreté individuelle apparaît souvent lors d’interactions de plusieurs facteurs en lien avec des circonstances individuelles, sociales et professionnelles. Toute personne ayant un faible bagage ne se retrouve cependant pas touchée par la pauvreté. Pour évaluer le risque de pauvreté d’une personne, tous les facteurs l’influençant et sa situation globale doivent être pris en compte (Schuwery et Knopfel, 2014).
Les conséquences de la pauvreté
Chaque personne vit différemment sa situation de pauvreté mais plusieurs conséquences se retrouvent souvent dans les discours. Les personnes concernées sont souvent touchées par une certaine pression financière où l’économie permet d’éviter l’endettement. Elles calculent toutes les dépenses prévisibles (les évènements imprévisibles sont difficilement gérables) et doivent tenir un budget très serré. Les personnes touchées par la pauvreté se retrouvent parfois en situation de surendettement où des emprunts créant de nouvelles dette permettent d’en payer d’autres. Elles risquent également de tomber malade, voire de mourir plus vite que les personnes financièrement stables. En effet, les conditions de vie et la position sociale occupée ont une influence sur l’utilisation des « comportements bénéfiques pour la santé », tels que ne pas fumer, ne pas consommer de stupéfiants, manger sainement et pratiquer régulièrement des activités physiques. Plus le salaire et le statut social sont élevés, moins il est probable d’être atteint par une maladie chronique et plus l’espérance de vie augmente.
Les enfants vivant dans un ménage en situation de pauvreté ont davantage de risque d’être en surpoids, d’avoir une mauvaise hygiène dentaire et d’être atteints par des troubles psychiques. Le paiement du loyer peut s’avérer compliqué pour les personnes en situation de pauvreté, d’autant plus qu’il représente une grande partie du budget. Les évènements imprévus engendrent souvent des retards de paiement qui risquent de mettre les personnes dans une situation d’expulsion. Les loyers abordables deviennent de plus en plus rares et il est difficile pour une personne ayant un revenu modeste d’en trouver. Elles se dirigent donc vers les régions périphériques car les centres villes deviennent inabordables. Au vu de la situation financière, la qualité des logements est souvent médiocre et le bruit ainsi que la pollution font partie des désavantages. En Suisse, peu de personnes dorment dans la rue mais les personnes sans domiciles fixes existent et logent chez des connaissances ou dans des abris d’urgence. Les personnes touchées par la pauvreté sont prétéritées dans l’accès à la formation qualifiée, ce qui engendre un cercle vicieux leur empêchant de sortir de cette situation précaire. De plus, elles doivent souvent faire appel aux prestations d’assurances sociales qui font l’objet de réductions dans le but d’économiser et où les personnes sont activées voire sanctionnées.
Les assurances se durcissent donc et possèdent des mesures sévères. L’intégration sociale est influencée par la situation financière. En effet, les personnes en situation de pauvreté se sentent souvent seules et entretiennent moins de relations sociales. L’isolement social peut provenir de la stigmatisation envers ces personnes qui sont considérées comme responsables de leur situation de pauvreté. Un problème se pose pour les ménages précaires, car les enfants ont besoin de contacts sociaux pour se construire, ce que l’isolement ne leur permet pas. La pauvreté a non seulement des conséquences pour les personnes concernées mais également pour la société. Les personnes touchées par la pauvreté engendrent des coûts, ce qui risque de créer des tensions sociales voire même des conflits politiques (Schuwery et Knopfel, 2014). Ces situations de pauvreté amèneront certaines personnes vers l’aide sociale ce qui comblera leur manque de moyens selon leurs droits (nous y reviendrons plus tard).
Types de population à l’aide sociale
En Suisse, 250’333 personnes ont bénéficié de l’aide sociale en 2012, ce qui signifie 3,1% de la population, face au 7,6% de pauvreté observé la même année. Ces chiffres démontrent que toutes les personnes en situation de pauvreté ne bénéficient pas forcément de l’aide sociale. En 2012, les personnes ayant une basse formation voire aucune, les ménages composés d’enfants et plus particulièrement les familles monoparentales ainsi que les jeunes adultes ont été les populations bénéficiant le plus de l’aide sociale. Les personnes étrangères et celles vivant seules font également partie des groupes à risque (Schuwery et Knopfel, 2014). La population la plus touchée en Suisse est celles des enfants âgés de 0 à 17 ans et viennent ensuite les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans (OFS, 2013). En Valais, 66,5% des jeunes âgés de 18 à 25 ans n’ont pas achevé de formation professionnelle. Plus l’âge augmente et moins la population est touchée par l’assistance (OFS, 2009).
Le nombre de personnes âgées de 46 à 64 ans au bénéficie de l’aide sociale augmente de plus en plus mais peu de personnes retraitées ne s’y retrouvent car en principe les prestations complémentaires couvrent les besoins de cette tranche d’âge (Schuwery et Knopfel, 2014). Une assistante sociale de Neuchâtel par exemple observe également d’autres catégories de personnes bénéficiant de l’aide sociale. Les chômeurs de longue durée, les personnes attendant des prestations d’assurances et les personnes célibataires de plus de cinquante ans se retrouvent très souvent dans le panier de l’assistance. Les jeunes et les marginaux se comptent également parmi la population type. Les étapes de la vie, l’état de santé et le divorce sont des caractéristiques pouvant également mener à l’assistance selon elle (Tabin, 2008). En effet, selon l’office fédéral de la statistique, les personnes divorcées courent un plus haut risque de bénéficier de l’aide sociale par rapport aux personnes célibataires alors que les personnes mariées ou veuves n’ont quasiment aucun risque d’en dépendre car d’autres prestations sont prévues à leur effet comme les rentes de veufs ou de veuve, les prestations complémentaires, l’assurance invalidité et l’assurance vieillesse (OFS, 2009).
|
Table des matières
REMERCIEMENTS
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES ILLUSTRATIONS
LISTE DES ABRÉVIATIONS
I. L’INTRODUCTION
1.1 LES MOTIVATIONS ET LIENS AVEC L’EXPERIENCE PRATIQUE
1.2 LES LIENS AVEC LE TRAVAIL SOCIAL
II. LA PRESENTATION DU SUJET
2.1 LA QUESTION DE DEPART
2.2 LES OBJECTIFS DE RECHERCHE
2.2.1 Les objectifs théoriques
2.2.2 Les objectifs de terrain
2.2.3 Les objectifs personnels
III. LE CADRE THEORIQUE
3.1 LA PAUVRETE
3.1.1 Trois différentes approches
3.1.2 Les seuils de pauvreté
3.1.3 Des facteurs de risques
3.1.4 Les conséquences de la pauvreté
3.2 L’AIDE SOCIALE DANS LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE EN SUISSE
3.2.1 Un bref historique de l’assistance
3.2.2 La Constitution Suisse
3.3.3 La CSIAS
3.2.3 La Loi sur l’intégration et l’aide sociale en Valais
3.2.4 Les mesures d’insertion en Valais
3.2.5 L’évolution des bases légales cantonales
3.2.6 Les centres médico-sociaux
3.2.6 Types de population à l’aide sociale
3.3 LE TRAVAIL
3.3.2 Les fonctions et satisfactions du travail
3.3.3 Les diverses formes d’intégration professionnelle
3.3.4 La précarisation de l’emploi
3.3.5 La précarisation du travail
3.3.6 Les conséquences de la précarisation
3.3.7 L’exclusion professionnelle
3.4 LA RE-INSERTION PROFESSIONNELLE
3.4.2 Méthodes et outils en vue d’une insertion
3.4.4 Lieux d’insertion
3.5 LES TRAVAILLEURS « AGES »
3.5.1 L’âge et la vieillesse
3.5.2 Les généralités et les statistiques
3.5.4 Les stéréotypes liés à l’âge
3.5.5 La discrimination des séniors
3.5.6 Le mélange générationnel
3.5.7 Le ressenti des seniors
3.5.8 Des possibilités de formation à tout âge
IV. LES HYPOTHÈSES DE RECHERCHE
4.1 HYPOTHESES DESTINEES AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX DES CMS
4.2 HYPOTHESES DESTINEES AUX BENEFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE
V. LA MÉTHODOLOGIE
5.1 LA POPULATION RETENUE ET LE TERRAIN D’ENQUETE
5.2 LES OUTILS DE RECUEIL DE DONNEES
VI. L’ANALYSE DES DONNÉES
6.1 LES PROPOS DES PROFESSIONNELLES
6.1.1 Le profil des bénéficiaires « âgés » de l’aide sociale
6.1.2 Les limites de la prise en charge des bénéficiaires « âgés »
6.1.3 L’organisation et le fonctionnement de la ré-insertion en CMS
6.1.4 Les mesures de la LIAS
6.1.5 Le manque de moyens
6.1.6 Une pression en faveur des jeunes
6.1.7 Les portes de sortie de l’aide sociale
6.1.8 Des solutions envisageables
6.2 LES PROPOS DES BENEFICIAIRES
6.2.1 Le profil des personnes rencontrées
6.2.2 La demande d’aide sociale
6.2.3 Les recherches d’emplois
6.2.4 Le suivi de l’assistant social et les mesures mises en place
6.2.5 Le suivi du conseiller ORP
6.2.6 Les stratégies mises en place
6.2.7 La porte de sortie de l’aide sociale
6.2.7 Un idéal
6.3 VERIFICATION DES HYPOTHESES CONCERNANT LES PROFESSIONNELS
6.4 VERIFICATION DES HYPOTHESES CONCERNANT LES BENEFICIAIRES HES SO // Valais Bachelor of Arts in Travail Social
6.5 LA CONCLUSION DE L’ANALYSE
6.5.1 Retour sur la méthodologie
6.5.2 Retour sur la question de recherche
VII. LA CONCLUSION
7.1 LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
7.2 LES LIMITES DE LA RECHERCHE
7.3 LES NOUVEAUX QUESTIONNEMENTS
7.4 LE BILAN PERSONNEL
VIII. LA BIBLIOGRAPHIE
8.1 LES OUVRAGES
8.2 LES ARTICLES ET RAPPORTS
8.3 LES BASES LEGALES ET CODES DEONTOLOGIQUES
8.4 LES SITES INTERNET
8.5 LE TRAVAIL DE FIN D’ETUDE
8.6 LES COURS HETS
IX. LES ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet