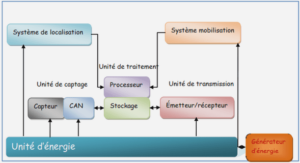Les mouvements (sociaux) urbains et le « droit à la ville »
A partir du tournant politique et théorique représenté par les mobilisations de la fin des années 1960, les chercheur.e.s ont commencé à prendre en compte la dimension spécifiquement urbaine de certains mouvements sociaux.
Manuel Castells a été parmi les premiers à avoir abordé la question de « l’économie politique du développement urbain et les conflits d’intérêts » qui en découlent (Pruijt, 2007) et à proposer une définition des mouvements qui s’y opposent. Dans son ouvrage The urban Question (1972), il reste attaché à une vision assez ‘orthodoxe’, affirmant que « l’impact social » de ces mouvements dépendrait de leur affiliation avec des « organisations dans le conflit de classe inhérent à la sphère productive » (Pruijt, 2007, p. 5117). Dans son ouvrage majeur, The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements (1983), il se rapproche au contraire, de la ligne théorique des « Nouveaux Mouvements Sociaux », et de l’oeuvre d’auteurs comme Foucault, Touraine et Melucci (Brun, 1986; Castells & Kumar, 2014). C’est ainsi que sa définition classique des « Mouvements Sociaux Urbain », se caractérise par une mise en avant du caractère « culturel » et « identitaire » de ces mouvements (Mayer, 2006a). Si l’utilisation de l’adjectif « social » parait superflue pour certains auteurs, comme par exemple Pickvance (Pruijt, 2007), Castells, de son côté, a défini spécifiquement quelles conditions devaient remplir les « mouvements urbains » pour être qualifié en tant que MSU. En effet, le sociologue réserve la qualification de « sociaux », exclusivement à ces mouvements urbains « qui combinent des luttes pour un usage collectif amélioré avec des luttes pour la culture de la communauté ainsi que pour l’autodétermination politique3» (Mayer, 2006b, p. 202). Pour lui, il est donc possible de définir « sociaux », exclusivement ces mouvements urbains qui seraient « multi-dimensionnels » (multi-issue) et qui poursuivraient donc ces trois enjeux qui, encore aujourd’hui, se révèlent particulièrement représentatifs de ce type de mobilisation (Mayer, 2006a; Pruijt, 2007), y compris celle de mon cas d’étude.
Effectivement, les enjeux individués par Castells, même à l’épreuve de « la globalisation et de la restructuration capitaliste », se révèlent assez « prophétiques ». Cela est vrai notamment concernant l’enjeu de « l’usage collectif » des ressources, des biens et des services – revendication centrale dans un contexte contemporain marqué par la privatisation du « secteur public » – ou la « contestation du pouvoir de l’état », par rapport à son rôle dans l’application des politiques (néo)libérales mais aussi par rapport à la captation édulcorée des instances des mouvements à travers « la mode des discours sur l’engagement citoyen » (Mayer, 2006b, p. 204).
Si la nature « locale » de ces mouvements, qui ressort de la définition de Castells, semble décrire des mouvements incapables à transformer radicalement la société – et notamment les sphères productives, de la communication et du gouvernement – ils seraient capables, cependant, à transformer les « signifiés urbains » (urban meanings). Par cela, Castells entend la possibilité de « produire une résistance à la domination », capable de produire des « utopies réactives » (Pruijt, 2007), qui viserait à miner les bases hiérarchiques de l’organisation sociale de la vie urbaine revendiquant, à l’opposé, « une ville organisée sur la base de la valeur d’usage, les cultures locales autonomes et la démocratie participative décentralisée » (Mayer, 2006a).
Le débat autour de « l’impact » de ces mobilisations sur le « changement social », par rapport à leurs enjeux et, surtout, à leur « échelle », caractérise une bonne partie des travaux qui, depuis, ont été mené dans les sciences sociales et particulièrement en sociologie (Pruijt, 2007; Purcell, 2009). Les rapports entre les MSU et les institutions (locales), peu pris en compte par Castells, méritent aujourd’hui une plus grande attention selon Mayer (2006), à la lumière du fait que leur perte de pouvoir en a mitigé le « caractère d’antagonistes directs pour les mouvements urbains » (p.205).
D’autres auteurs, tout en reconnaissant la valeur du travail de Castells en tant « qu’outil conceptuel » dans la compréhension du fonctionnement et des enjeux de ces mouvements, en soulignent le manque d’attention envers le contexte. Nombreuses études ont donc été menées en cherchant à comprendre les autres facteurs qui ont un rôle dans l’émergence, le déroulement et les impacts des mouvements urbains, mobilisant d’autres approches issus de la théorie générale des mouvements sociaux. Ainsi le facteur de « l’état de privation » (state of deprivation), de la « mobilisation des ressources », et, surtout de la « political opportunity structure » ont été adoptés au fil des années, dans l’étude des mobilisations urbaines (Pruijt, 2007).
L’extraordinaire popularité acquise, notamment à partir des années 1990, par le concept de « Droit à la Ville » (DaV) en tant que paradigme fédérateur capable de sortir ces mouvement de leur « localisation », remet aujourd’hui au centre du débat la question de « l’échelle » (Purcell, 2009). Effectivement, le concept DaV, élaboré originairement par le philosophe Henri Lefebvre (1968), a connu une diffusion très importante, tant dans le champ académique (Harvey, 2011; Lopes De Souza, 2010; Mitchel, 2003; Sugranyes & Mathivet, 2011) quant dans le champ de la politique – radicale et institutionnelle (Lopes De Souza, 2010; Purcell, 2009). Cette commodification de l’élaboration théorique de Lefebvre, qui a eu lieu souvent au prix d’une dénaturation de sa valeur révolutionnaire, l’a transformé en outil pour humaniser la gouvernance capitaliste, au sein d’institutions locales, nationales et supranationales (Lopes De Souza, 2010; Purcell, 2009) . En contrepartie, à cette cooptation par les pouvoirs politiques institutionnels, correspond aussi une diffusion au sein des mouvements contestataires, qui trouvent, souvent, dans ce terme un paradigme pour sortir du « piège du local » (Purcell, 2006) et défier la « multi-scalarité » des processus néolibéraux. Le débat sur l’échelle des mouvements urbains – revendiquant ou pas un Droit à la Ville – a donc aujourd’hui, une toute nouvelle centralité.
La dimension spatiale des mouvements sociaux
La dimension spatiale des mouvements sociaux, longtemps négligée, a acquis, dans les dernières décennies, une nouvelle centralité (Leitner et al., 2008; Risanger, 2012; Smith, 2004). Plusieurs théoriciens se sont penchés sur la question de comprendre le rôle de l’espace dans les mobilisations, tant urbaines que « générales ».
La dimension spatiale des politiques contestataires a été étudiée notamment en contexte anglophone, par des auteurs comme Byron Miller (2000) et William H. Sewell Jr (2001) ou, en contexte francophone, par Fabrice Ripoll (2005, 2008) ou Choukri Hmed (2009).
De manière générale, il faut tout d’abord préciser que « l’espace », a longtemps été considéré comme un « contexte assumé et non problématisé, et non comme un aspect constitutif des politiques contestataires qui doit être conceptualisé explicitement et prouvé systématiquement 5 » (Sewell, 2001, p. 52). A regarder les travaux de chercheur.e.s on dirait presque, selon Byron Miller (2000), que les mouvements se dérouleraient « sur un tête d’épingle » (Hmed, 2009).
« Concept sémantiquement complexe », tant dans le langage ordinaire que dans le langage scientifique (Sewell, 2001), l’espace est « une des dimensions de la société, correspondant à l’ensemble des relations que la distance établit entre différentes réalités », et comme « objet social défini par sa dimension spatiale » (Lévy & Lussault, 2003 cité dans Hmed, 2009). L’espace dont on parle, est « l’espace concret (…), défini en relation à l’occupation humaine, à son usage et son regard (…) c’est un espace qui est utilisé, vu et expériencé6 » (Sewell, 2001, p. 53).
Pour William H. Sewell Jr, même la conception la plus traditionnelle au sein des sciences sociales, qui voit l’espace en tant que « conteneur », et donc en tant « structure » (sociale), se révèle pertinente si bien conceptualisé (2001, p.54). En effet, la structure géographique ou spatiale peut être vue comme parallèle aux structures économiques, occupationnelle, politique ou démographique – et donc comme des faits sociaux enracinés qui ont leur logiques autonomes (ou au moins relativement autonomes) et détermine ou au moins conditionnent fortement l’action sociale7 (Sewell, 2001, p. 54).
En s’appuyant notamment sur Anthony Giddens (1976, 1979, 1984, cité dans Sewell, 2001), Sewell soutient l’idée que la structure doit être considérée « duale », et donc en tant que « moyen et résultat de l’action sociale (…) les structures conditionnent l’action des personnes, mais ce sont aussi les actions des personnes qui constituent et reproduisent les structures8 » (Sewell, 2001, p. 55). De ce constat dérive un concept fondamental de l’élaboration théorique de Sewell : « l’agencement spatial » (spatial agency), entendu comme « les manières par lesquelles les conditionnements spatiaux (spatial constraints) sont transformés en avantage politique et en lutte sociale et les manières par lesquelles ces types de luttes peuvent restructurer les signifiés, usages et valeurs stratégiques de l’espace 9» (Sewell, 2001). L’auteur, qui renvoie à l’idée lefevbrienne de la “production de l’espace” insiste donc sur le fait que l’action contestataire n’est pas seulement façonnée par « l’environnement spatial » mais qu’elle est « un agent significatif dans la production de nouvelles structures et relations spatiales » (Sewell, 2001).
En dernier point, j’ai trouvé particulièrement pertinente par rapport à mon travail, l’approche d’Helga Leitner, Eric Sheppard et Kristin M Sziartot (2008). Les trois géographes américains insistent sur le cloisonnement théorique qu’on peut rencontrer dans la plupart des travaux produit par des recherches visant à « incorporer la spatialité dans leur conceptualisation des mouvements sociaux » (Leitner et al., 2008). En effet, ils dénoncent la « forte tendance à privilégier [dans l’étude des politiques contestataires] une spatialité particulière – seulement pour l’abandonner au profit d’une autre » (p.158). Ainsi, ils voient se succéder, dans l’histoire de ce champ, différentes modes de compréhension de la spatialité de ces phénomènes : d’abord à travers l’approche par « échelle » (politique scalaire, scale jumping, stratégies multi-scalaires), suivies par les « réseaux » et enfin la mobilité (p.158).
Plutôt que prendre un compte seulement la spatialité du moment, ils proposent donc une approche qui puisse prendre en compte la « co-implication et la multi-valence » des spatialités des politiques contestataires. Ils soulignent la proximité de cette approche avec « la notion d’intersectionnalité dans la théorie féministe » et revendiquent l’importance de différencier et considérer l’imbrication des différentes spatialités des mouvements sociaux, comme cela a déjà lieu sur le plan empirique (Leitner et al., 2008). En effet, selon les auteurs,
les participants aux politiques contestataires sont énormément créatifs à bricoler différents imaginaires spatiaux et stratégies on the fly, sans une profonde réflexion sur les implications philosophiques. Pragmatiquement, nous cherchons à capturer cette pratique empirique dans notre conceptualisation (Leitner et al., 2008).
Un terrain « militant » : méthodologie et réflexivité
Dans ce chapitre je vais présenter le déroulement du terrain de recherche et les questionnements que cette expérience m’a poussé à me poser. Par la suite, je proposerai un rapide panoramique des techniques par lesquelles cette recherche a pu être réalisée.
En dernière instance, ce sera la question du rapport à l’objet de recherche, de mon positionnement épistémologique et politique, afin de présenter les éléments nécessaires à la compréhension de l’analyse ici présentée.
Spécificités du terrain
Le terrain de recherche a eu lieu entre février et août 2016. Le choix a été le fruit d’une série de contingences qui m’ont amené à participer, en observant, à la naissance et au développement de la mobilisation Decide Roma, Decide la Città .
Mon idée initiale était de faire une recherche sur les centri sociali (centres/espaces sociaux)14, ces lieux occupés qui en Italie, et à Rome en particulier, sont très nombreux et très actifs dans les territoires et dans la scène culturelle. J’ai milité pendant quelques années avant d’arriver à Paris, dans l’un d’entre eux, Communia dans le quartier de San Lorenzo. La conviction que ces espaces constituent une sorte de « contre-pouvoir » politique et culturel dans la planification et production de la ville me poussait à vouloir enquêté sur cette réalité depuis désormais assez longtemps.
Sauf que, en arrivant à Rome et en recommençant à fréquenter Communia, je me suis trouvé devant quelque chose qui n’existait pas au moment où j’avais quitté Rome pour Paris. C’était la Rete per il Diritto alla Città (DaC – réseau pour le droit à la ville). Considérant le fait que je voulais étudier le rapport entre les espaces sociaux et la ville je me suis dit que je devais suivre les réunions de ce groupe.
La sensation que j’ai eue quand j’ai commencé à bien comprendre de quoi traitait le DaC, a été de surprise. Les espaces-mêmes étaient en train de produire collectivement la réflexion que je voulais produire singulièrement à travers ma recherche. A travers le Réseau pour le Droit à la Ville, en effet, chaque espace mirait à aller au-delà de sa propre situation spécifique pour sortir de ses propres murs afin de réfléchir et agir ensemble sur la ville.
J’ai donc décidé de suivre toutes les réunions de ce réseau inter-espaces et j’ai commencé à connaitre aussi les activistes des autres espaces sociaux que je connaissais seulement de vue ou que je ne connaissais pas du tout. Outre ces réunions, je suivais aussi toutes les autres internes à Communia, devenant ainsi – même pour ceux qui ne me connaissaient pas – « Simone di Communia », donc une des personnes qui suivait le DaC pour mon collectif/espace, Communia.
Avec le passage à Roma Non Si Vende (RNSV) et par la suite à Decide Roma Decide la Città (DR), la mobilisation autour des thèmes qui étaient d’abord soulevés exclusivement par le DaC a atteint une ampleur et une ambition inattendue. A ce moment-là, il était devenu clair pour moi que cette mobilisation n’était pas seulement un des nombreux projets menés par les espaces sociaux, mais quelque chose qui, si bien conduit, aurait pu véritablement marquer une étape historique pour les expériences de l’autogestion à Rome. Le fait que ce processus s’était accéléré sous mes yeux, pendant mon terrain, et qui avait tout d’un coup acquis beaucoup de centralité dans l’activité de tout le monde – même des autres de Communia – m’a de facto convaincu que je devais profiter de ce moment et regarder de près, sinon de l’intérieur, le déroulement d’une métamorphose historique du monde de l’autogestion romaine.
Et cela a produit un changement de perspective : il ne s’agissait plus d’étudier des lieux qui existaient déjà et d’en comprendre l’impact sur la ville au statut actuel, mais d’étudier ce que les personnes qui animent ces espaces voulaient faire pour accroitre leur impact sur la ville, au travers même de sa propre remise en cause, à travers un travail sur soi-même. En d’autres mots, mon terrain a été bouleversé par la prise de conscience de m’être trouvé dans une temporalité privilégiée pour comprendre l’évolution des expériences autogérées romaines, impliquant cependant un changement d’objet, une nouvelle entrée par laquelle affronter ma problématique.
Pour ce qui concerne l’accès au terrain, mes prévisions n’ont pas été très efficaces. En effet, il n’a pas été facile ni de réaliser les entretiens, ni, surtout, de vivre bien ma position d’activiste-chercheur. Mais je me rends compte a posteriori que j’aurais dû attribuer cette difficulté plus à moi-même qu’aux autres, qui au contraire, aux moments de mon coming-out d’infiltré d’une université française, se sont toujours révélés très contents et disponibles. Dans tous les cas, je me suis senti en devoir de construire ma légitimité avec une participation constante à toutes les activités, devenant une sorte d’activiste stakhanoviste. Je n’ai pas dit tout de suite quelles étaient mes intentions – ou au moins pas à tout le monde – et à « observer » je me sentais un peu mal à l’aise. Je me rappelle que, si les autres notaient dans leurs carnets quelques lignes pour se rappeler des points principaux de leur interventions, moi je notais des pages et des pages, rendant évidente la différence qui nous séparait.
A posteriori, je peux identifier deux aspects principaux qui m’ont permis de me débloquer et d’être plus en confiance envers mon statut particulier d’activiste-chercheur. Le premier a été le passage même à DR. En effet, si jusque-là, le DaC était une coordination entre différents espaces et collectifs, ouverte mais quand même interne à un monde politique et relationnel bien défini, avec le passage à DR je me suis rendu compte que la vocation de la chose était bien plus large et que, malgré l’illégalité formelle de certaines pratiques, il n’y avait absolument rien à cacher pour les activistes. Au contraire, la volonté d’ouverture, constamment affichée par DR se traduisait par une constante « traduisibilité à l’extérieur 15», et par une « publicité maximale 16» de ce qui se passait dans les réunions et dans les assemblées. Si tout le monde pouvait savoir ce qu’on se disait (bien sûr, les actions médiatiques étaient organisées en secret pour éviter que la police en empêche le déroulement) moi aussi je me sentais légitimé à enquêter, prendre des notes et poser des questions.
L’autre aspect, bien plus banal, était tout simplement le fait que je m’étais familiarisé avec les autres activistes, et, surtout j’avais plus de confiance en moi, notamment après avoir rendu des services à la mobilisation (spécifiquement, j’ai organisé, sans grand succès d’ailleurs, les contacts avec la presse, pour organiser la couverture médiatique de certaines actions qu’on a menées).
Techniques d’enquête
Les techniques d’enquête que j’ai choisi ont été essentiellement celle de la « participation observante », avec notation constante sur le carnet de terrain, et la réalisation de 13 entretiens semi-directifs, en plus d’une importante recherche bibliographique. Dans cette sous-partie je présenterai brièvement les doutes auxquels je me suis confronté pour définir mon approche au terrain. Par la suite, j’exposerai les deux formes principales par lesquelles ont été produits les matériaux empiriques sur lesquels se base ce travail d’analyse.
Observation Participante ou Participation Observante ?
Lionel Groulx fait part de ses perplexités par rapport à l’incohérence épistémologique et méthodologique qui découlerait, dans l’étude des mouvements sociaux, tant dans une approche qui privilégierait l’observation tant dans une qui, au contraire, opterait plutôt pour une approche axée sur la participation (Groulx, 1985).
En reconnaissant les dangers qu’un chercheur peut rencontrer en se dédiant à une étude de quelque chose de situé et engagé par définition, comme les mouvements sociaux, j’ai pourtant décidé de me lancer dans cette tâche sans beaucoup de scrupules. En effet, après avoir certes lu des textes sur les différentes techniques, sur le positionnement du chercheur etc, je dois avouer que je pensais être en équilibre entre observation et participation de manière très empirique et concrète. Cela malgré le fait que pour toute la première période de mon terrain j’ai vécu avec beaucoup de timidité, au moins publiquement, mon rôle d’observateur. J’ai presque automatiquement encadré mon approche en tant que participation observante (PO), plutôt que d’observation participante (OP). Le choix de cette technique s’est fait initialement dans une logique très spontanée, comme à revendiquer la primauté de mon implication dans la cause sur la visée scientifique du travail.
La participation observante a eu comme résultat matériel une grande quantité de notes, rassemblées dans le document « CR Suivi de la mobilisation, février-août 2016 ». En outre, j’ai plusieurs enregistrements des événements auxquels j’ai participé, qui – vu leur ampleur – n’ont été que partiellement retranscrits.
Au-delà, cette participation m’a permis d’accéder à un grand nombre de textes académiques et autoproduits par les collectifs, associations et espaces ou produits lors des mobilisations. Les mails des listes de communication, de DR et de Communia, plus les groupes de WhatsApp et Telegram ont été à la fois des sources d’information et de clarification, et des outils de participation. La même chose est vraie pour les très nombreux tracts et communications, sur les médias, les réseaux sociaux ou en format papier diffusés par et sur le DaC, Roma Non Si Vende, Decide Roma et les acteurs singuliers comme les espaces, associations, collectifs internes ou externes à la mobilisation.
Les entretiens : un travail pour (au moins) deux points de vue
L’autre source principale, sont les entretiens réalisés entre juillet et août 2016. Les personnes que j’ai interviewées sont des interlocuteurs privilégiés, choisis parmi les participants les plus actifs aux réunions plénières et des différents groupes de travail de RNSV/DR. L’échantillon choisi a cherché à couvrir la totalité des typologies des adhérents, espaces/collectifs/associations, avec une attention particulière pour ceux et celles qui sont activement et constamment impliqués dans la mobilisation. A l’appel manquent cependant des personnes issues notamment d’Acrobax, un espace social qui joue un rôle clé dans la mobilisation. Les acteurs qui adhèrent mais qui sont moins impliqués dans les réunions etc, n’ont pas été contactés faute de temps, malgré le fait que cela aurait été particulièrement intéressant pour comprendre, directement par leur témoignage, les raisons de leur manque d’assiduité.
Les politiques (urbaines) à Rome : l’espace urbain comme marchandise
Rome est une ville très complexe. Il suffit de regarder un plan pour s’en rendre compte. Sa particularité est évidente, déjà dans sa morphologie urbaine qui relève à un oeil attentif les dynamiques de pouvoir qui l’ont façonnée et qui, encore aujourd’hui, en conditionnent l’identité et le développement.
Ville très étendue, bien plus que Paris, la surface de la ville de Rome pourrait contenir en son intérieur toutes les cinq premières villes italiennes. A cette étendue gigantesque ne correspond pas une population aussi grande19. En effet, ni le nombre de ses habitants ni son dynamisme culturel et économique en font une métropole de premier rang.
La caractéristique plus évidente de la morphologie de Rome est son extraordinaire fragmentation, l’irrationalité qui parait, regardant un plan de la ville, caractériser sa forme et son développement. Tant fragmenté de paraitre un archipel aux formes sinueuses : des îles de béton dans une mer qui – une fois – était une campagne constellée de ruines archéologiques et qui désormais, s’est réduite peu à peu d’une série infinie de friches, chantiers et campagne polluée.
Comme nombreux auteurs ont souligné (Erbani & De Lucia, 2016; Guareschi & Rahola, 2015; Pasquinelli D’Allegra, 2006), la forme de la ville parle. Dans le cas de Rome, elle raconte une histoire de pouvoir bien précise. Une histoire qui voit primer, avec beaucoup de désinvolture, une structure économique et entrepreneuriale basée sur le bâtiment, et pour laquelle donc, l’espace constitue une véritable marchandise, une ressource sur laquelle faire du profit (Fig.1).
|
Table des matières
Sommaire
Introduction générale
1 – Les sciences sociales, l’espace et les mouvements sociaux : un état des savoirs
1.1 – La théorie des mouvements sociaux
1.2 – Les mouvements (sociaux) urbains et le « droit à la ville »
1.3 – La dimension spatiale des mouvements sociaux
2 – Un terrain « militant » : méthodologie et réflexivité
2.1 – Spécificités du terrain
2.2 – Techniques d’enquête
2.3 – Posture et positionnement : une recherche (géographique) « engagée »
3 – L’espace et la politique à Rome : éléments de mise en contexte
3.1 – Les politiques (urbaines) à Rome : l’espace urbain comme marchandise
3.2 – Le monde de l’autogestion à Rome : l’espace urbain comme ressource collective
4 – Decide Roma, une plateforme collective pour la construction une alternative urbaine d’autogouvernement métropolitain
4.1 – Composition et fonctionnement de la mobilisation
4.2 – Histoire de la mobilisation
4.3 – Thèmes et perspectives de la mobilisation
4.4 – Les multiples spatialités de Decide Roma
Conclusion
Glossaire
Bibliographie
Matériaux produits sur le terrain
Table des matières
Table des illustrations
Annexes
Annexe 1: Entretien avec Alessandro “Esc”
Annexe 2: Retranscription V assemblée d’autogouvernement
Résumé / Abstract
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet