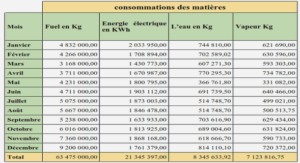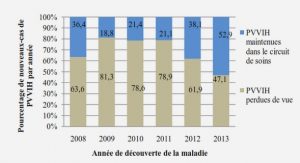Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les prémices de la coopération : une idée ancienne liée aux spécificités du monde maritime
Des spécificités du transport maritime. La coopération dans le domaine maritime n’a rien de nouveau. En raison des spécificités de ce domaine, de tout temps a eu lieu des formes diverses de coopération que ce soit entre individus ou compagnies.
En effet, le coût des expéditions maritime a toujours été élevé. Pour mener à bien une telle expédition, il faut construire un navire ou l’acheter, ce qui nécessite un fort investissement. De plus, avant, les navires voguaient grâce à la voile, ou de manière subsidiaire des rameurs, ce qui nécessite un équipage nombreux pour son fonctionnement, et donc des frais liés à cet équipage (alimentation et salaire). Auparavant, les expéditions maritimes étaient considérées dangereuses car les navires plus fragiles que maintenant face aux risques de la mer, et il y avait moins de sécurité & de moyens de secours efficaces. En cas de naufrage ou d’avarie sévère, les pertes pour l’amateur étaient lourdes voir totales. C’est la raison pour laquelle être à plusieurs permettait de partager les risques.
Monsieur le Professeur Philippe DELEBECQUE le rappelle15 d’ailleurs à ce titre les écrits de Savary de 1675 dans le Parfait Négociant16 : « Tous les commerces qui se font par des voyages de long cours ne peuvent se faire utilement par des particuliers et il n’y a que les grandes compagnies qui y puissent bien réussir. ».
Ainsi J. Savary met en avant l’aspect « taille » que doit avoir celui qui veut faire du commerce maritime. Un individu est bien trop faible pour faire efficacement du commerce maritime seul, il est donc préférable d’avoir des compagnies de grande taille.
En 1937, F. Ruellan allait dans le même sens que J. Savary et même plus loin en écrivant à propos des compagnies maritimes : « La fondation de ces sociétés et leur tendance à une concentration de plus en plus marquée s’expliquent par les immobilisations considérables de capitaux que supposent l’achat des navires modernes, leur entretien, leur ravitaillement en combustible, sans parler des installations faites à terre dans les ports et des agences commerciales qui doivent attirer les passagers par la publicité et assurer le fret. »17
L’idée de F. Ruellan est la suivante : il est naturel que les compagnies maritimes aient une tendance à la concentration dans la mesure où beaucoup de capitaux sont nécessaire à leurs activités. De plus, à travers les concentrations, il y a également un partage des risques, ce qui présente donc un avantage non négligeable.
L’émergence de grandes compagnies maritimes par les Etats colonisateurs : l’Angleterre et la Hollande. En 1602 en Hollande fut créée la Compagnie néerlandaise des Indes Orientale (Verenigde Oost Indische Compagnie). Cette société est remarquable dans le sens où elle est en réalité la fusion de huit compagnies maritimes privées hollandaises18. Cela est similaire à ce qu’on pourrait qualifier aujourd’hui de concentration d’entreprise par la technique de la fusion absorption. Déjà, à l’époque, on commence à voir d’une manière similaire à celle aujourd’hui, les intérêts d’une concentration. De plus, c’est la première grande société anonyme créée et dont les actions sont cotée en bourse19. L’intérêt d’une telle fusion est d’avoir un plus gros capital, et une meilleure capacité d’investissement, ce qui est nécessaire pour pouvoir lancer des expéditions maritimes et faire du commerce. Mais également, l’intérêt est d’avoir d’une manière générale un plus grand pouvoir commercial que ce qu’auraient eu les compagnies maritimes individuellement. Leur union faisant ainsi leur force. Son fonctionnement à divers égard est intéressant, car il était très moderne par rapport à son temps. Sa structure était globale. Il était séparé la fonction technique, propre à chaque chambre (équivalent aux entreprises privées de base), du domaine financier (la gestion des dépenses et recettes).
En 1600 en Angleterre avait déjà été créée la Compagnie Britannique des Indes Orientales (East India Company) par Charte Royale. Celle-ci, dans les années suivant sa création, s’est inspirée du modèle de réussite hollandais.
Comme cela est mis en avant dans un article du journal en ligne Les Echos20, les Compagnies des Indes hollandaise et britannique sont des structures globales et puissantes leur assurant une autonomie et une maîtrise du transport à travers notamment la maîtrise l’armement, de la chaîne de transport et de la distribution des marchandises : « Hollandais et Anglais ont ainsi fait le choix de structures importantes dotées de puissants moyens financiers, seules à même d’assurer la construction de vaisseaux et d’infrastructures commerciales locales, mais aussi la sécurité des transports. »
Les premières grandes compagnies maritimes françaises. Au XVIIème siècle, de grandes compagnies maritimes ont été créées ; on en trouve trois types21 :
Les sociétés créées avec privilège royal à vocation de colonisation et subsidiairement de commerce et navigation.
Les sociétés créées avec privilège royal à vocation de de commerce et de navigation.
Les sociétés privées entre particuliers à vocation commerciale.
Ainsi, parmi les sociétés du premier type, on retrouve la célèbre Compagnie des Indes Orientales. Celle-ci a été créée par une déclaration signée par le Roi Louis XIV le 27 août 1664 grâce à une initiative de Colbert22. A cette même date fut également créé la Compagnie des Indes Occidentales. Quelques années plus tard, en 1670, fut créé la Compagnie du Levant.
Sur toutes ces Compagnies des Indes, on peut en tirer une caractéristique commune qui est le montant élevé de leur capital. De plus, ces compagnies avaient des monopoles pour des durées déterminées renouvelable.
Progressivement cependant, les Compagnies des Indes seront dissoute. En 1793, après moult rebondissements23, la Compagnie des Indes françaises Orientale disparaîtra24. Puis, en 1799, ce fut au tour de la Compagnie Hollandaise d’être dissoute par l’Etat, en raison des crises répétées, et aggravées par la guerre hollando-anglaise de 1780 à 178425. La dissolution de la Compagnie des Indes britannique n’interviendra que plus tard par décret, en 1874, en raison du contexte26.
Régime juridique de base applicable
« Le caractère national des compagnies de navigation a développé entre elles une lutte de prestige qui s’est traduite par la construction de navires toujours plus grands et plus rapides et une guerre de tarifs qu’elles ont heureusement arrêtée par des accords internationaux. »72
Les conférences maritimes ont permis une certaine stabilité des prix, et ainsi mis entre parenthèse la « guerre de tarifs ».
Normes états-uniennes. L’US Merchant Shipping Act de 1916 a permis aux Conférences maritimes d’être exemptées de l’application de la loi anti-trust américaine. C’était la première loi à le faire. Ce système est similaire à celui actuel. Le Shipping Act de 1984 et l’Ocean Shipping reform act de 1998 sont allés dans le même sens en explicitant plus73. La Commission Maritime Fédérale avait « des pouvoirs d’investigation et de contrôle des accords de conférence » grâce à l’amendement dit Loi Bonner de 10/1961 (modifiant l’US Shipping Act de 1960)74 afin d’éviter tout abus liés au régime favorable dont les Conférence bénéficiaient75.
Normes de l’Union Européenne. L’Union européenne a exemptée les Conférences maritimes de la législation contre les restrictions à la concurrence et les abus de position dominante, ainsi que les accords techniques ne restreignant pas la concurrence. Cela a été fait grâce au règlement n°4056/86 (CE) du 31/12/1986. Jusqu’alors, les Conférences n’étaient pas explicitement prises en compte dans le droit communautaire, mais malgré qu’elles soient des ententes, elles n’avaient pas non plus fait l’objet de remise en cause. Les Etats européens, l’Union européenne et les autres pays faisaient preuve d’une certaine souplesse envers les Conférences maritimes, bien que cette souplesse ne soit pas toujours réellement justifiée par leur législation respective. Comme l’explique Messieurs BONASSIES et SCAPEL dans leur ouvrage : « Les conférences maritimes constituant des ententes, comme des entités susceptibles de commettre des abus de position dominante, il y avait peu de doute qu’elles ne ressortissaient à ces textes. Concrètement cependant, la légalité communautaire des actions d’une conférence maritime n’a jamais été mise en cause avant 1987, ni devant la Commission, ni devant les tribunaux des Etats communautaires. »76.
Cependant, l’exemption des Conférences a pris fin. Envisagé depuis 2003 par la Commission, l’abrogation du règlement d’exemption a été faite par le règlement n°1419/2006 du 25/09/2006 et est entrée en application le 18/10/2008. En 2004, la Commission européenne adoptait un livre blanc. Celui-ci traduisait sa volonté d’abroger le règlement d’exemption des Conférences maritimes, ce qui dans l’ensemble, allait dans le sens de la volonté de l’European Shippers’ council et des chargeurs en général77. Cette abrogation a été justifiée par le fait que pour la Commission le bilan de l’examen de leur effet positif/négatif penchait en faveur de l’abrogation de l’exemption. D’autant que cela ne présentait pas une contribution suffisante au progrès économique78, ni n’apportait de réel profit à l’utilisateur79. De plus la restriction opérée par ce système n’apparaissait plus indispensable ou nécessaire, et n’était donc pas proportionnée. Enfin, le système de conférence pouvait avoir pour effet une élimination de la concurrence par son caractère de concentration, ou encore les barrières à l’entrée du marché80. Ce système présentait des restrictions à la concurrence qui n’étaient pas proportionnelles aux bénéfices qu’elles apportaient. De ce fait, elles n’étaient pas indispensables, et ne présentaient guère de différences par rapport aux autres types d’ententes possibles mais non-exemptés81. Ainsi, l’abrogation de l’exemption paraît justifier par ces raisons de libre concurrence et d’égalité de traitement entre les opérateurs économiques de différents secteurs. L’idéal poursuivi de longue date par l’Union européen, et encore ici par l’abrogation de ce règlement d’exemption est celui de la concurrence pure et parfaite82. Même si l’atteindre est une utopie, c’est l’objectif.
La fin du régime des Conférences maritimes et ses subsistances
Aspects positifs et négatifs des Conférences
Le régime des conférences maritimes a fait l’objet de nombreuses critiques, ce qui a terme a mené à leur fin. Les petits chargeurs leurs étaient plutôt favorable contrairement aux puissants chargeurs90. Les Conférences ont eu leur lot d’avantages et inconvénients.
Une première approche positive. Les Conférences sont apparues à la fois comme des ententes stricto sensus, mais également par les maritimistes comme une réponse à la concurrence destructive91 en ce qu’elles permettaient une certaine stabilité dans les prix notamment, et d’autre part une stabilisation de l’offre maritime, & une qualité des services plus élevée92. D’une certaine manière, on peut penser que ce système permettait aux plus petits transporteurs d’accéder aux marchés s’ils faisaient partie de la Conférence.
Position dominante. Concernant le caractère d’entente des Conférence, celles-ci avaient un fort pouvoir sur le marché car elles réunissaient de nombreux acteurs de celui-ci. Cela constituait dès lors une forme de barrière à l’entrée d’autres transporteurs sur le marché car l’accès y était plus difficile. De plus, des études réalisées par Fox en 1992 ont permises de démontrer le lien entre les taux de fret et le nombre de membre dans la Conférence (plus il y a de membres, plus les taux diminuent)93. Le fait qu’au final les Conférences forment des sortes d’oligopole qu’on ne nomme pas, sur le marché fut vivement critiqué.
Les arguments en faveur des Conférences pour éviter la concurrence destructrice étaient le manque d’élasticité du marché, ainsi que le manque de stabilité des prix qu’au contraire garantissait la Conférence d’où une diminution des risques prit pour les acteurs du marché94.
Au final, les Conférences qui avaient un rôle de stabilisation des prix n’ont pas dans leur abrogation eut trop de conséquences sur ceux-ci95. Il n’y a pas eu de gros bouleversement. D’autant que lorsque le règlement d’exemption des conférences a été abrogé, les consortiums et alliances, autres formes de coopérations, étaient déjà largement répandu, bien que ne portant pas sur les taux de fret. A l’appui de cela, une étude de la FMC démontrer le peu d’impact sur les tarifs (entre 2006 et 2010) qu’a eu la suppression du système des Conférences maritimes sur les trafics Asie-Europe et Asie-Etats-Unis. Un rapport du Lloyd va dans le même sens, en indiquant même parfois des baisses de tarifs. On est donc bien loin de la dérégulation tarifaire crainte avec la fin des Conférences96. De plus, Vincent CALABRESE rappelle même l’avis de la FMC sur les FMC en ce que les Conférences « représentent en outre des frais de fonctionnement inutile ».
Une critique profonde. La critique malgré tout était profonde, et contredisait les arguments positifs à propos des conférences. Outre le fait qu’elles soient considérées dans leur principe contraire au principe de libre concurrence, a été mis en avant leur trop grande rigidité dans les taux de fret ce qui n’avait pas que des aspects positifs, bien au contraire. Ainsi, certains l’ont vue comme une gêne dans les négociations contractuelles entre les armateurs et chargeurs97, car cela ne prenait pas en compte les frais annexes au transport stricto sensu. De plus, à cela s’ajoutait des pratiques abusives telles que celles des prix prédateurs explicité ci-dessus. Il est à noter que la législation de l’Union européenne combat clairement la pratique des prix prédateur en général et a une jurisprudence bien établie sur le sujet.
Les chargeurs étaient donc les principaux opposant au régime des Conférences maritimes car ils étaient en ligne directe face aux problèmes ou défaut de concurrence suscités. Mais ce n’était pas les seuls à avoir une opinion négative des ententes. Ce fut également le cas des autorités portuaires ayant eu à traiter avec des Conférences n’ayant pas des pratiques toujours licites98. Laurent FEDI, dans un article, fait le bilan des avantages/inconvénients de la fin des Conférences Maritimes99. Selon lui, les effets positifs ont consistés en une libéralisation du fret maritime du fait de l’ouverture à la concurrence, de la transparence accrue et la fin des taux de fret uniforme; mais également en un renforcement de la contractualisation de la relation chargeur-transporteur. La relation chargeur-transporteur est moins rigide, et n’est plus déterminée par les accords de la Conférence, il y a une plus grande liberté de négociation et dans leurs relations en général. Laurent FEDI va même plus loin dans l’analyse, pour lui cela aurait également permis « aux transporteurs de proposer des services plus complets aux chargeurs […] La diversification des transporteurs sur ces modes de transport complémentaires ainsi que sur des services logistiques annexes, apporte une valeur ajoutée au segment maritime et contribue à fidéliser les chargeurs.». Quant aux effets négatifs, il met en avant les incertitudes liées à la variabilité des taux de fret notamment et à la concurrence féroce régnante, et les critiques sur la qualité des services (les avis n’étant pas unanimes à ce propos, et très partagés) d’une manière générale.
Régime juridique applicable133
Les dispositions des traités communautaires
En effet, selon l’article 101 du TFUE, les ententes sont interdites de plein droit : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur […]. »134.
De même sont interdit les abus de position dominante à l’article 102 du TFUE : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. »135. Théoriquement, les consortiums devraient entrer dans le champ d’application de ces normes communautaires et donc faire l’objet d’une interdiction. Néanmoins, comme il est prévu par le point 3 de l’article 101 du TFUE, il est possible de se voir exempter de l’application de cet article si certaines conditions sont remplies. Les dispositions sont les suivantes :
« (3) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises.
à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises .
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées.
Faiblesse relative du système
Le système des alliances mieux adapté. Le système des consortiums n’apparaît pas autant adapté que celui des alliances qui est plus dans l’air du temps et adapté aux problématiques actuelles liées tant au droit de la concurrence qu’aux problématiques économiques.
Une compétitivité artificielle. De plus, à cet égard, dans leur article Antoine FRÉMONT et Martin SOPPÉ font une remarque intéressante : « L’ordre européen et américain des consortiums et des conférences maritimes qui permettait aux armements de ces continents de rester artificiellement compétitifs par la pratique du cartel a été remplacé par un ordre asiatique fondé sur les alliances qui permet de masquer la faiblesse relative et le caractère profondément national des compagnies […]. »145.
Cela sous-tendrait l’idée suivant laquelle la concurrence issues des consortiums et conférences était totalement artificielle et bloquait la concurrence des armements asiatiques146, ce à quoi les alliances ont permises de remédier en apportant un meilleur équilibre entre les armements des différents continents.
Les alliances et méga-alliance : Définition des contours de la notion
Philippe DELEBECQUE donne une définition très pertinente de la notion d’alliance tout en l’associant à celle des consortiums de la manière suivante : « Les alliances sont une forme de consortium constitué entre des entreprises concurrentes en vue de maximiser les parts de marché tout en étendant la couverture géographique des services proposés. »147. Le Professeur DELEBECQUE en profite alors pour détailler la notion : « Deux ou plusieurs compagnies maritimes vont ainsi mettre en commun leurs ressources pour exploiter telle ou telle ligne maritime ou un ensemble de lignes maritimes dans les meilleures conditions économiques possibles. L’objectif est la rentabilité du service et passe par des accords avant tout opérationnels articulés auteur de structures souples laissant à chaque allié une grande indépendance d’action. ».
Ce qui ressort de cette définition est l’idée de mise en commun des ressources et des moyens. Les buts qui ressortent sont la volonté d’optimisation de l’exploitation, de la maximisation des parts de marché, et de l’extension des services offerts.
Ce système permet aux alliances d’être flexible à la demande. Si il y a plus de ligne couvertes, et à plus de fréquence, ses membres seront en mesure d’apporter de meilleures solutions et options de transport.
|
Table des matières
TITRE 1 : COOPERATION STRATEGIQUE ENTRE COMPAGNIES MARITIMES. ENTRE RENOUVEAU ET CONTINUITE
CHAPITRE 1 : LES RELATIONS DE COOPERATION ENTRE LES COMPAGNIES MARITIMES
Section 1 : Les premières formes de coopération
1§. Les prémices de la coopération : une idée ancienne liée aux spécificités du monde maritime
2§. Les Conférences maritimes
A/ Apparition et contexte historique
B/ Définition et notion
C/ Fonctionnement et régime juridique applicable
1/ Forme et structure
2/ Régime juridique de base applicable
3/ Code de conduite de Genève de 1974
D/ La fin du régime des Conférences maritimes et ses subsistances
1/ Aspects positifs et négatifs des Conférences
2/ Phase de déclin
Section 2 : Aux formes actuelles
1§ Les consortiums
A/ Apparition et contexte historique
B/ Définition et notion
C/ Les modes et modalités de fonctionnement
1/ Objet des consortiums
2/ Structure
3/ But
4/ Intégration
5/ Exemples
D/ Régime juridique applicable
1/ Les dispositions des traités communautaires
2/ Les règlements d’exemption
F/ Faiblesse relative du système
2§ Les alliances et méga-alliance : Définition des contours de la notion
CHAPITRE 2 : ALLIANCES, UN ELEMENT CLEF DE LA STRATEGIE DES COMPAGNIES MARITIMES
Section 1 : Diverses considérations juridiques
1§ Application aux alliances du régime d’exemption applicable aux consortiums
2§ Avenir de l’exemption
3§ Matérialisation de l’alliance sur le plan juridique
Section 2 : Aspects concurrentiels : Contrôle des alliances
1§ Les justifications à l’exemption et les raisons du contrôle
A/ La justification légale de l’exemption
B/ La position de l’Union européenne
2§ Les autorités de contrôle de la concurrence
A/ Dans l’Union Européenne
B/ Aux Etats-Unis
C/ En Chine
D/ Des autorités de la concurrence parfois en désaccord
3§ Le contrôle de concurrence et la procédure
A/ Base légale du contrôle
B/ La prise en compte des critères économiques et concurrentiels
C/ L’application de la doctrine de l’effet par les autorités de la concurrence
D/ Le contrôle
TITRE 2 : SYSTEME D’ALLIANCE INCONTOURNABLE ET OMNIPRESENT
CHAPITRE 1 : LES ALLIANCES COMME PILIER DE LA STRATEGIE DES COMPAGNIES MARITIMES
Section 1 : Incontournable : avantage concurrentiel ou nécessité ? L’intérêt des réseaux maritimes
1§ Les stratégies d’alliance des compagnies maritimes : élément clef constitutif d’avantages concurrentiels indéniables
A/ La forte présence des alliances sur les routes maritimes principales
B/ La réalisation des buts des alliances
C/ Autre : L’impact prétendument positif de la course au gigantisme
2§ Les réseaux maritimes : Une nécessité
A/ Un domaine ultra-compétitif
1/ Une concurrence féroce
2/ Une meilleure compétitivité
B/ Une nécessité pour entrer et se maintenir sur les marchés mais aussi un « avantage ultime »
Section 2 : Quelques enjeux pratiques
1§ Les gains en pratique imputables aux alliances
2§ Le projet d’alliance P3
A/ Description de l’alliance prévue
B/ Les réactions suscités par le réseau P3 de la part de la concurrence et des chargeurs
C/ Examen de conformité à la concurrence et échec
1/ Propos généraux
2/ Décision de la FMC
3/ Décision implicite de la Commission européenne
4/ Décision du MofCOM
5/ Bilan
D/ La nécessité de coopération entre les autorités de la concurrence
3§ L’impact des alliances sur les ports : la création d’hubs & spokes, et des ports aux flux massifiés
CHAPITRE 2 : EVOLUTIONS ET AVENIR DE LA COOPERATION STRATEGIQUE ENTRE LES COMPAGNIES MARITIMES.
Section 1 : Avenir des alliances
1§ Capture d’image des flux maritimes captés par les alliances : Comparaison entre 2002 et 2015
A/ La situation en 2002
B/ La situation en 2015
C/ Conclusion et comparaison
2§ L’exemple du secteur du transport aérien : entres avantages certains et à modérer
A/ L’apprentissage des alliances aériennes et le problème de la double marginalisation
B/ Survol des alliances aériennes à travers leur composition
3§ La prise en compte des spécificités maritimes
4§ Un avenir pour le moment favorable : la domination des alliances sur les parts de marché du transport de marchandise conteneurisée
Section 2 : Autres formes de coopération stratégique
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet