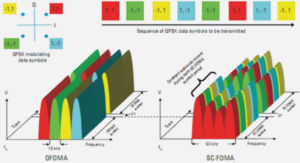DES ÉCRITS PERSONNELS EN DEHORS DE L’ÉCOLE, QUI INTERROGENT LA DIDACTIQUE
La volonté de mettre de l’ordre « dans une matière à la fois surabondante et insaisissable » (J.-P. Albert, 1993 : 38), a amené de nombreux auteurs à tenter de relever et de classer des types d’écrits et de pratiques d’écriture. C’est ainsi que tout un paradigme de termes est apparu, parmi lesquels se trouvent ceux d’écriture « ordinaire » et « domestique », que nous confrontons les uns aux autres pour mieux les définir.
L’écriture domestique dans sa diversité
Nous présentons d’abord des types d’écrits et les termes qui leur sont associés, puis des écrits eux-mêmes.
Le classement des types d’écrits
D’une manière générale, une première opposition taxinomiste se joue entre les écrits « littéraires » et les écrits appelés « ordinaires », notion introduite par M. Dabène (1990) et à laquelle D. Fabre a consacré un ouvrage en 1993 :
« [Les écritures ordinaires] s’opposent nettement à l’univers prestigieux des écrits que distinguent la volonté de faire œuvre, la signature authentifiante de l’auteur, la consécration de l’imprimé. Elles n’aspirent ni à l’exercice scrupuleux du « bon usage » ni à la sacralisation qui, peu ou prou, accompagne depuis deux siècle la mise à distance littéraire. Et puis, surtout, la plupart de ces écritures-là, associées à des moments collectifs ou personnels intense ou bien à la routine des occupations quotidiennes, semblent vouées à une unique fonction qui les absorbe et les uniformise : laisser trace. » (Fabre, 1993 : 11) .
Les écrits sont dits « ordinaires » au sens d’« habituels » ou de « communs », dès lors qu’ils jalonnent le quotidien scriptural, passé ou présent, intime ou professionnel, de « monsieur Tout-le-monde » et n’ont pas de vocation prestigieuse à être publiés. Une telle terminologie a cependant l’inconvénient de nier la complexité de l’activité d’écriture, au sens de production. Quelle qu’elle soit, celle-ci n’est pas naturelle, mais risquée : elle impose une ritualisation de la langue qui génère des tensions chez le scripteur et que celuici doit gérer. Ainsi, M. Dabène lui-même (1990 : 6) explique que l’activité d’écriture n’a rien d’ordinaire, mais qu’elle est au contraire « extraordinaire », « hors du commun ».
À l’intérieur de cette catégorie des écrits « ordinaires », les auteurs procèdent à une autre distinction, qui oppose les écrits scolaires et professionnels aux autres, plus « personnels » et appelés « domestiques » par J.-P. Albert (1993). Dans un article de l’ouvrage précité de D. Fabre, l’auteur caractérise les écrits scolaires et professionnels par le fait qu’ils répondent à un ensemble indéfini de situations en relation étroite avec la diversité des métiers (l’écriture d’une facture, d’un cours ou d’une ordonnance) et les exigences d’une formation (les prises de notes ou les dissertations). L’écriture « domestique » est quant à elle définie de la manière suivante :
« Ce que j’appelle l’écriture domestique désigne l’ensemble des recours à l’écrit qu’imposent à la fois notre vie privée et notre existence sociale de membre d’une famille et d’un réseau de relations amicales ou confraternelles, de contribuable, titulaire d’un compte en banque, adhérent d’associations etc. » .
Retenons que si elle est d’ordre pratique, elle véhicule aussi et surtout une dimension affective, étant destinée aux proches ou aux générations futures. Cette sous-catégorie admet à son tour une autre division : entre d’une part les écrits destinés explicitement aux autres (la correspondance privée ou administrative), et d’autre part les écrits réservés à l’usage du seul scripteur ou de l’entourage immédiat (les aide-mémoire et les écrits intimes essentiellement).
En parallèle à cette dénomination d’écriture « domestique » se rencontre le terme « vernaculaire », utilisé dans les travaux sur la « littéracie » et qui nous paraît renvoyer à une même réalité que le premier. C’est du moins ce que suggère la liste non exhaustive des pratiques vernaculaires, de l’écriture et de la lecture, fournie par D. Barton et M. Hamilton (2010 : 55-58). Les auteurs classent celles-ci selon six sphères de la vie quotidienne qui engagent la littéracie : 1. l’organisation pratique du quotidien et de la vie (calendriers, livres, listes, activités administratives etc.), 2. la communication personnelle (cartes, lettres, notes), 3. le loisir privé (magazines, livres, écriture de poésie), 4. la documentation de sa vie (bulletins, annonces, journal intime, autobiographie, carnets d’adresse etc.), 5. le fait de donner du sens (lecture de manuels d’instruction, de livres religieux pour apprendre) et enfin, 6. les formes d’engagement (lecture de brochures d’un club, pétitions, création d’affiches, graffitis). Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (Cnrtl) propose à son tour un rapprochement entre les termes « vernaculaire » et « domestique » en les présentant comme synonymes.
Or, D. Barton et M. Hamilton (2010 : 54) ajoutent que les pratiques vernaculaires ne sont pas « [encadrées] par des règles et des procédures formelles d’institutions sociales dominantes ». On suppose ainsi que l’écriture administrative, considérée par J.-P. Albert (1993) comme relevant de l’écriture et de l’administration domestique (celle des papiers et archives ou des imprimés et questionnaires) n’est pas prise en compte. On peut questionner par ailleurs la place de la poésie dans les pratiques vernaculaires : n’exige-t-elle pas le respect de règles formelles?
Nous abordons là les limites d’une telle tentative de classement, dont les catégories regroupent des pratiques d’une grande diversité. En outre, elles ont la faiblesse de ne proposer, la plupart du temps, qu’une définition par la négative : les pratiques domestiques ne pas sont littéraires, etc. Ce qu’il nous semble finalement important de saisir, c’est la volonté des auteurs de rendre compte de deux différences : des situations de production d’une part et, d’autre part, de la nature qualitative des écrits, qui correspond à des considérations idéologiques. Ainsi, on assiste à la confrontation entre des écrits plus ou moins légitimés, plus ou moins contrôlés et qui relèvent de traditions plus ou moins étudiées. Les pratiques littéraires, puis professionnelles et scolaires sont considérées comme plus surveillées et normées que les autres, et sont ainsi socialement valorisées.
Le classement des écrits eux-mêmes
À l’intérieur même de ces catégories que nous venons de présenter se pose la question du classement des écrits eux-mêmes, distingués par leur support (Blanc, 1996), plus ou moins porteur d’une invitation à écrire, par leur genre (David, 2001 ; Penloup, 1999) ou encore par leur fonction, c’est-à-dire selon les valeurs qui sont à l’œuvre dans l’activité d’écriture (J.-P. Albert, 1993). Nous présentons brièvement les deux premiers critères de distinction des écrits et insistons sur le troisième.
Les supports et genres de l’écriture
Tout peut faire support pour qui veut écrire : s’apposent ainsi sur les murs des graffiti, que sont les « tags », les « graffs » ou les « pochoirs » (Bouyer S., 1996). Il n’est pas question pour nous de proposer la liste la plus exhaustive des supports d’écriture, mais d’en présenter quelques-uns des plus classiques décrits. Si l’on aborde les écrits extrascolaires par ce biais, on pense bien sûr aux cahiers : « de cinéma », « d’amitié », « d’amour » et aux cahiers de textes, dans lesquels les élèves recouvrent de leurs productions les inscriptions des semaines passées imposées par l’école (Blanc, 1993 : 106-107). On songe également aux lettres et aux petits mots, dont la pratique commencerait avec la maitrise la plus élémentaire de l’écrit (Blanc, 1996 : 108). Un des supports propres aux adolescents et surtout aux filles (effet du conditionnement historique et d’une culture de groupe) est le journal intime, pratique reconnue depuis le milieu du 20ème siècle et à laquelle P. Lejeune a consacré de larges explorations anthropologiques (1989, 1997, 2000 et 2006). Activité passagère ou intermittente, elle débute vers 10-11 ans, voire plus tôt, profite de la période d’intense écriture de l’adolescence, sorte de « sas » entre l’enfance et l’âge adulte (2006 : 163), puis décroit souvent avec l’âge. Les auteurs (2006 : 21-22) expliquent également que sa pratique est corrélée avec le taux de scolarisation et plus fréquente chez les jeunes qui vivent en ville, alors qu’elle serait incomprise et perçue comme hypocrite par les personnes à faible capital culturel. En revanche, le journal ne serait pas l’activité d’un profil psychologique en particulier, au-delà de rassembler ceux qui possèdent un goût de l’écriture et le souci du temps. Pour revenir au support lui-même, le journal intime est caractérisé par la date, la trace, la forme et la destination : il est une série de traces datées, souvent manuscrites et individualisantes, d’une personne qui écrit dans l’authenticité de l’instant sur un support plus ou moins privé et dont le contenu dépend de sa fonction. M. Leleu (1952, cité par Bonnet, 1990 : 100) relève trois types de contenu : des acta (des faits), des cogitata (des pensées) et des sentita (des sentiments). En ligne, la pratique du journal intime, désignée par les expressions « cyberjournal » ou « blog intime », s’est développée dans le milieu des années 90. P. Lejeune, qui lui consacre en 2000 un ouvrage intitulé « Cher écran … » la rapproche plutôt de la correspondance (: 226) dès lors que la solitude de l’intimité y est très relative (Lejeune, Bogaert, 2006 : 227). Le terme de « blog intime » n’a ainsi d’intérêt que de l’en distinguer du blog d’information ou d’opinion.
La question du journal en ligne nous rappelle surtout que le numérique offre aujourd’hui un ensemble varié de nouveaux supports et vient redéfinir les contours des genres scripturaux existants, voire en créer d’autres. Le journal intime prend une autre forme en ligne, des pratiques d’ordre littéraire se logent dans les blogs, les caractéristiques du SMS et du mail nous semblent à rapprocher de celles des petits mots et de la lettre. L’analyse à venir de notre corpus envisage si la pratique du numérique concurrence les pratiques manuscrites et nous présentons plus après, au moment de décrire l’écriture électronique, les supports et les genres du numérique. Pour ce qui concerne les genres textuels distingués avant le numérique, nous renvoyons à l’ouvrage de M.-C. Penloup (1999). Cette dernière en propose une liste exhaustive pour l’époque. J. David (2001 : 40) en évoque à son tour : notamment les récits d’expérience personnelle, la fiction, les textes poétiques, humoristiques et ludiques, ou encore les textes à valeur informative. L’auteur (2001 : 41) distingue enfin les textes selon qu’ils relèvent d’une activité de création ou de copie (de reproduction de textes), cette dernière activité pouvant néanmoins faire l’objet d’un travail de réécriture et d’appropriation. M.-C. Penloup propose quant à elle le terme d’« invention » pour distinguer une écriture créative d’une écriture de copie.
Les fonctions de l’écriture personnelle
L’écriture peut aussi être abordée sous l’angle de ses fonctions et potentialités, des besoins qu’elle satisfait, que J. Goody (1978) envisage à travers la notion de « raison graphique ». D. Barton et M. Hamilton (2010 : 46) expliquent quant à eux très largement que dans la mesure où les pratiques sont inscrites dans des objectifs sociaux et des pratiques culturelles, elles sont des « moyens pour une autre fin » plutôt qu’un but en soi. Pour autant, ces fonctions de l’écriture ou des écrits sont difficiles à classifier, parce qu’elles sont nombreuses et peuvent s’entremêler. Pour les approcher, nous nous appuyons principalement sur les travaux de J.- P. Albert (1993), qui nous semblent aussi bien correspondre à l’écriture manuscrite qu’aux pratiques d’écriture numérique. L’auteur distingue quatre fonctions de l’écriture : la communication, la mise en ordre, la prise d’identité et la constitution de soi.
L’écriture est d’abord utile à la communication, ce qu’illustre tout particulièrement le numérique. Aux courriers administratifs et échanges épistolaires s’ajoute une correspondance qui a pris de nouvelles formes, de nouveaux sens. Quand elle est amoureuse, amicale ou familiale, l’écriture permet notamment d’écrire ce qu’on ne dit pas pour faire exister et maintenir le lien, exprimer et témoigner son affection. Quand elle est confraternelle, elle manifeste de la proximité tout en conservant une distance, dans la mesure où le scripteur ne s’impose pas comme il le ferait par téléphone. Cette écriture tournée vers la communication est distinguée par F. Calame-Gippet et Penloup M.-C. (2003) d’une écriture à dominante « expression personnelle ». Cette dernière sert à se souvenir, « laisser trace » (Fabre, 1993) ou à éprouver et s’éprouver (Blanc, 1993 : 113). C’est notamment le cas, nous l’avons vu, du journal intime qui retient les événements et leur date, possédant ainsi une fonction de « registre », de « trace » ou « d’épargne » (Bonnet, Gardes Tamine, 1990 : 107).
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE 1. CADRE THÉORIQUE
Chapitre 1. Les pratiques extrascolaires de l’écriture électronique. Objet d’étude
Des écrits personnels en dehors de l’école, qui interrogent la didactique
De nouveaux écrits personnels : les écrits électroniques et la notion d’écriture électronique
Conclusion du chapitre 1. De nouvelles questions posées à la didactique par l’écriture électronique
Chapitre 2. Deux approches de la langue : sociolinguistique versus normative. Choix d’un cadre théorique
L’approche normative
La perspective variationniste
Conclusion du chapitre 2. L’émergence d’une sociodidactique
Chapitre 3. Une approche sociodidactique de l’écriture électronique
Problématique
La coexistence de plusieurs variétés d’écrit dans le répertoire de nombre de scripteurs adolescents
Une menace pour la maitrise de l’orthographe ?
Conclusion problématique du chapitre 3. L’écriture électronique extrascolaire : un objet de recherche pour la sociodidactique
PARTIE 2. MÉTHODOLOGIE DE CONSTITUTION ET D’ANALYSE DU CORPUS
Chapitre 1. Recueil de données : les choix méthodologiques
Présentation du terrain
Un corpus de questionnaires auprès de 479 élèves
Un corpus de copies d’examen
Chapitre 2. Méthodologie d’analyse
Une démarche pluridisciplinaire d’analyse des questionnaires
Des choix au fondement de la construction d’une grille d’analyse des copies de Brevet
PARTIE 3. ANALYSE DES DONNÉES
Chapitre 1. Discours des adolescents de 2012 sur leurs pratiques extrascolaires et les variétés du français
Quelles modifications des pratiques spontanées d’écriture d’adolescents à l’ère du numérique ?
Quel rapport à la norme à l’ère du numérique. Le discours des jeunes face à la question de l’orthographe
Quelle modification de la langue écrite à l’ère du numérique ? Le discours des jeunes face à la question de la variation électronique
Conclusion du chapitre 1
Chapitre 2. Les indices d’une influence de la pratique de l’écriture
électronique dans des copies d’examen
Retour sur notre grille d’analyse : les données complémentaires fournies par
l’analyse de 279 copies de Brevet
L’évolution des erreurs entre 1996 et 2011
Conclusion du chapitre 2
CONCLUSION
ÉLÉMENTS POUR UNE SOCIODIDACTIQUE DE LA VARIATION ÉLECTRONIQUE
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
Annexes I. Cadre théorique
Annexes II. Analyse des questionnaires
Annexes III. Analyse des copies de brevet
INDEX DES NOMS CITÉS