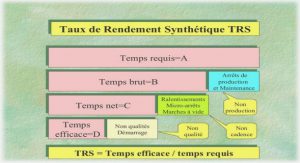Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Anatomie du bois
Fonctions et formation du bois dans l’arbre
Le bois (Figure I- 1) est un ensemble de tissus d’origine secondaire à parois lignifiées résultant du fonctionnement vers l’intérieur de l’assise cambiale libéro-ligneuse (Keller 1991, Perré 2015). Il remplit différentes fonctions :
Fonction de conduction ascendante de la sève brute depuis les racines jusqu’à la cime de l’arbre. Cette fonction est assurée par les vaisseaux longitudinaux chez les feuillus et par les trachéides longitudinales chez les résineux.
Fonction de soutien mécanique, assurée principalement par les trachéides chez les résineux et les fibres et fibres trachéides chez les feuillus.
Adaptation de la forme à l’environnement de l’arbre, assurée par le bois de réaction (bois de compression chez les résineux et bois de tension chez les feuillus).
Fonction de stockage assurée par les cellules de parenchyme.
Fonction de résistance aux agressions biologiques.
Ces tissus sont constitués de cellules issues des divisions de l’assise cambiale libéro-ligneuse qui forme l’aubier vers l’intérieur de l’arbre, tissu constitué de cellules fonctionnelles dans lesquelles circule la sève brute. La plupart des cellules ne vivent que quelques semaines et meurent lors de leur lignification (formation de la paroi secondaire). Après quelques années de fonctionnement, les cellules de parenchyme qui étaient restées vivantes meurent et l’aubier se transforme pour former le duramen (ou bois de coeur) c’est le processus de duraminisation. C’est lors de ce processus que se forme la plupart des métabolites secondaires, qui ont un rôle primordial dans la durabilité de bois de coeur. Le duramen, qui pour certaines essences peut présenter une couleur plus foncée, assure une fonction de soutien et constitue la masse principale de la tige des arbres âgés. Associés à la moelle présente au coeur de l’arbre, l’aubier et le duramen constitue le bois. Bien entendu, le duramen n’existe pas encore sur les jeunes tiges.
Notons également la présence de l’écorce en périphérie de l’arbre qui assure la circulation de la sève élaborée et jour un rôle de protection. Elle est composée du liber, issus des divisions de l’assise cambiale libéro-ligneuse vers l’extérieur ainsi que du suber (ou liège) et du phelloderme issu des divisions de l’assise cambiale subéro-phéllodermique.
Dans les régions tempérées, l’assise cambiale libéro-ligneuse cesse de fonctionner en hiver et reprend son activité lors de la reprise de l’activité de végétation en mettant en place une nouvelle couche de cellules distincte de la couche précédente. Ces couches successives sont des « cernes d’accroissement annuels ». Les saisons influencent l’activité cambiale et il est souvent possible de distinguer le bois de printemps (bois initial) du bois d’été (bois final) (Figure I- 1). La distinction est très facile chez les conifères car le bois d’été, constitué de trachéides à faible extension radiale et à parois épaisses, a une couleur brune alors que le bois de printemps est plutôt jaune. La largeur de cerne n’est pas constante dans un même arbre, elle varie en fonction des conditions de croissance d’une année sur l’autre, de la nature des sols, du statut social de l’arbre…
Figure I- 1. Les différentes parties du tronc d’un arbre : la moelle, le bois de coeur, l’aubier et l’écorce (cambium, écorce externe et écorce interne) avec ses tissus principaux (D’après Grosser 1977).
Le plan ligneux
Les caractéristiques morphologiques des cellules du bois et leurs dispositions constituent le plan ligneux. Il nous permet d’étudier le bois selon trois directions orthogonales :
La direction longitudinale (L) parallèle au sens des fibres.
La direction radiale (R) perpendiculaire à la tige et passant par la moelle.
La direction tangentielle (T) tangente aux cernes d’accroissement annuels.
Ces trois directions expliquent l’anisotropie du bois et constituent les trois plans perpendiculaires de référence du bois (Figure I- 2) :
Le plan transversal (plan Tr) : perpendiculaire à la tige de l’arbre.
Le plan radial (plan Ra) : parallèle à la tige de l’arbre et passant par son centre.
Le plan tangentiel (plan Tg) : parallèle à la tige de l’arbre et tangent aux cernes annuels.
Figure I- 2. Les trois plans de référence du tronc d’arbre : le plan transversal (Tr), le plan radial (Ra) et le plan tangentiel (Tg) (Keller 1991).
Le plan ligneux est héréditaire, constant pour tous les arbres d’une même espèce et indépendant de l’environnement. Il permet d’identifier et de décrire les essences de bois et de connaître leur structure.
Eléments anatomiques
Chez les conifères (gymnospermes, d’après Keller 1991)
Les conifères (Figure I- 3) sont apparus il y a 270 millions d’années, donc bien avant les feuillus apparus il y a environ 10 millions d’années. Ils possèdent une structure moins évoluée donc plus simple que les feuillus. En général, les conifères sont composés de deux principaux types de cellules : les trachéides (environ 90% du volume total du bois) et les cellules de parenchyme. Figure I- 3. Schéma d’un bloc de bois de pin.
Plan tranversal : 1-1a rayons (coupe) ; B trachéide transversale ; 2 canal résinifère ; C parenchyme longitudinal à paroi mince ; E cellule épithéliale ; 3-3a trachéides de bois de printemps ; F ponctuation aréolée radiale coupée au niveau du torus ; G ponctuation aréolée coupée en-dessous de l’ouverture de la ponctuation ; H ponctuation aréolée tangentielle ; 4-4a trachéides de bois final
Plan radial : 5-5a rayons ligneux hétérogène (coupe) ; J trachéide transversale ; K parenchyme à paroi mince ; L cellule épithéliale ; M trachéide transversale non coupée ; N parenchyme à paroi épaisse ; O ponctuation aréolée radiale de trachéide de bois final ; O’ ponctuation aréolée radiale de bois initial ; P ponctuation aréolée tangentielle ; Q épaississement callitroïdes ; R épaississement spiralé ; S ponctuation aréolée radiale ; 6-6a rayon ligneux hétérogène (coupe)
Plan tangentiel : 7-7a trachéide cloisonnée mixte ; 8-8a parenchyme longitudinal à paroi mince ; T parenchyme à paroi épaisse ; 9-9a canal résinifère longitudinal ; 10 rayon ligneux hétérogène ; U trachéide radiale ; V parenchyme de rayon ligneux ; W cellules épithéliales horizontales ; X canal résinifères horizontal ; Y anastomose entre canaux résinifères radial et longitudinal ; 11 rayon unisérié hétérogène ; 12 rayon unisérié homogène ; Z petite ponctuation aréolée tangentielle de bois final ; Z’ grosse ponctuation aréolée de bois final (D’après Howard et Manwiller 1969 repris dans Siau 1984).
Les trachéides longitudinales (Figure I- 3): les trachéides sont des cellules fusiformes de section souvent rectangulaire (dimensions entre 25 μm et 75 μm). Elles sont allongées longitudinalement avec une longueur allant de 1 à 8 mm et sont effilés aux extrémités. Elles servent à la fois aux fonctions de soutien mécanique et de conduction de la sève. Sur les extrémités et les faces radiales des trachéides se trouvent des ponctuations aréolées permettant les échanges de cellule à cellule. Elles existent également sur les faces tangentielles mais sont moins abondantes. Notons qu’il existe également des ponctuations dites à champ de croisement entre les trachéides et les cellules de parenchyme des rayons ligneux.
Les rayons ligneux (Figure I- 3): les rayons ligneux sont les cellules de parenchyme radiales sur le plan transversal. Ils sont issus de la division des îlots de cellules initiales des rayons du cambium.
ls sont composés de parenchymes radiaux ou de trachéides radiales. Ils ont un rôle de conduction et de stockage de réserves.
Le parenchyme radial : le parenchyme radial est la cellule sécrétrice transversale. Il est métaboliquement actif et peut se former à la suite d’une blessure. Il a un rôle de stockage des réserves ou des déchets, de restitution des réserves, l’élaboration de substances. La largeur du parenchyme est de même ordre d’une trachéide. Sa hauteur peut varier d’une cellule à plusieurs dizaines.
Les trachéides radiales : les trachéides radiales sont des trachéides disposées dans le plan transversal. Ces trachéides sont lignifiées juste après leur formation et sont donc mortes dans le bois. Elles portent des ponctuations aréolées sur leurs parois cellulaires. Elles accompagnent les parenchymes radiaux et leur forme peut être irrégulière.
Les canaux résinifères radiaux : les canaux résinifères radiaux sont issus des initiales des rayons. Ils sont toujours inclus à l’intérieur d’un rayon ligneux qui s’élargit pour englober ces formations sécrétrices.
Le parenchyme longitudinal : le parenchyme longitudinal est issu des initiales fusiformes et se présente sous forme de files de cellules cloisonnées. Il a un rôle de stockage et peut conférer au bois une odeur caractéristique.
Les canaux résinifères longitudinaux : les canaux résinifères longitudinaux sont issus des initiales fusiformes et ils sont des cavités tubulaires ayant un rôle sécréteur.
Chez les feuillus (angiospermes dicotylédones, d’après Keller 1991)
Les feuillus (Figure I- 4) ont une structure plus évoluée et complexe que les résineux. A la différence des résineux, les rôles de conduction de la sève et de soutien mécanique sont assurés séparément, respectivement par les vaisseaux et les fibres. Comme chez les résineux, les cellules de parenchyme assurent la fonction de réserve de substances nutritives. En général, les feuillus sont notamment composés de vaisseaux, de trachéides, de fibres et de cellules de parenchyme.
Les vaisseaux des feuillus sont des cellules allongées ayant un rôle de conduction de la sève brute. La longueur des éléments de vaisseau peut varier de 150 à 1900 μm et le diamètre peut varier de 50 à 500 μm. Les éléments de vaisseau sont caractérisés par deux ouvertures situées à leurs extrémités, appelée les perforations. La perforation peut être du type scalariforme (la cloison sous forme de barres qui dessinent une sorte d’échelle) ou de type simple (la cloison est sous forme d’un bourrelet périphérique). La communication entre deux rangées d’éléments de vaisseaux se fait grâce aux ponctuations aréolées.
Les rayons ligneux des feuillus sont plus variés que ceux des résineux en termes de dispositions et de dimensions. Les cellules sont plutôt allongées dans la direction radiale et leurs sections sont carrées ou allongées. La hauteur des rayons peut atteindre plusieurs centimètres et leur largeur une cinquantaine de cellules.
Les fibres sont des cellules allongées, aux parois généralement épaisses et portent peu de ponctuations simples. Elles sont issues des cellules initiales fusiformes et constituent environ 50 à 60% de la masse du bois. Elles sont lignifiées et jouent un rôle de soutien mécanique. La longueur de la fibre dépasse rarement 2,5 mm et son diamètre varie de 20 à 40 μm.
Les trachéides de feuillus sont présentes chez certaines espèces. Elles sont plus irrégulières que chez les résineux.
Le parenchyme longitudinal est constitué de cellules plus larges et à parois moins épaisses que les fibres. Il a une fonction d’accumulation, de restitution et de transformation des réserves et il joue un rôle essentiel durant la duraminisation qui fait passer le bois de son rôle fonctionnel (aubier) à son état inerte de bois de coeur (duramen). Il existe deux types de parenchymes en fonction de leurs dispositions : le parenchyme apotrachéal et le parenchyme paratrachéal.
le parenchyme apotrachéal est le parenchyme longitudinal se dispose de façon indépendante des vaisseaux. Il peut se diffuse en chaînettes, en lignes ou en bandes tangentielles parmi les éléments fibreux.
le parenchyme paratrachéal est le parenchyme longitudinal associé aux vaisseaux qu’il entoure partiellement ou complètement avec des prolongements tangentiels aliforme (il forme des prolongements comme les ailes de part et d’autre du vaisseau) ou confluent (les parenchymes aliformes entourent les vaisseaux se rejoignent d’un vaisseau à l’autre).
La paroi cellulaire
Les cellules ligneuses présentent une paroi cellulaire qui joue un rôle capital pour de nombreuses propriétés physiques du bois. Elle possède une microstructure très hiérarchisée constituée d’une paroi primaire et d’une paroi secondaire, formée durant la lignification, elle-même composée par trois sous-couches (S1, S2 et S3). Les cellules sont reliées entre elles par une lamelle moyenne (Figure I- 5).
La lamelle moyenne
La lamelle moyenne (appelée aussi la couche intercellulaire) apparaît après la division des noyaux et réunit les cellules les unes aux autres. Elle contient des substances pectiques et se charge de lignine au cours de sa différenciation. Son épaisseur varie de 0,5 à 1,5 μm.
La paroi primaire
La paroi primaire se forme et s’appuie sur la lamelle moyenne à la fin de la division cellulaire. Elle contient de la lignine et est constituée de plusieurs couches de micro-fibrilles de cellulose enchevêtrées formant un réseau lâche. L’épaisseur de la paroi primaire varie en fonction de quantité d’eau qu’elle contient. Dans la plante vivante, elle est de l’ordre de 0,1 μm alors que dans le bois sec elle se réduit jusqu’à 0,03 μm.
La paroi secondaire
Lorsque la cellule atteint sa dimension définitive, elle dépose sur la paroi primaire une nouvelle couche rigide qui constitue la partie de la cellule la plus résistante mécaniquement. C’est l’étape de lignification, qui induit la mort de la cellule. Cette nouvelle couche est appelée paroi secondaire. Elle est très riche en cellulose et contient trois sous-couches S1, S2 et S3 qui se déposent successivement. Chaque sous-couche est constituée de micro-fibrilles de cellulose à l’orientation variable. L’angle des micro-fibrilles agit sur les propriétés physico-mécaniques du bois.
La sous-couche externe S1 :
Elle se trouve en position la plus externe entre la paroi primaire et la sous-couche S2. Elle a une paroi fine qui varie entre 0,1 et 0,35 μm d’épaisseur représentant de 5 à 10% de l’épaisseur totale de la paroi cellulaire. Les micro-fibrilles de cellulose sont disposées en hélices d’orientations variables et alternées. L’angle des micro-fibrilles par rapport à la direction longitudinale (l’axe de la cellule) varie de 60 à 80°.
La sous-couche intermédiaire S2 :
Elle se trouve en position entre les sous-couches S1 et S3 et constitue la partie de la paroi la plus volumineuse puisque son épaisseur varie de 1 à 10 μm ce qui représente entre 75 et 85% de l’épaisseur totale de la paroi cellulaire. Les micro-fibrilles y sont disposées parallèlement et présentent un angle faible par rapport à la direction longitudinale (typiquement de 5 à 30°).
La sous-couche interne S3 :
Elle se trouve en position la plus interne de la paroi cellulaire, donc en contact avec le lumen (vide) de la cellule. Elle a une paroi d’une épaisseur intermédiaire variant de 0,5 à 1,10 μm. Les micro-fibrilles de cellulose sont disposées parallèlement et présentent un angle par rapport à la direction longitudinale de 60 à 90°.
Les ponctuations et perforations des parois cellulaires
Les ponctuations sont des zones de communication entre les cellules adjacentes. Elles sont ouvertes dans la paroi cellulaire et servent aux mouvements des substances nutritives ou de sève brute de cellule à cellule. Seule la paroi secondaire est interrompue, la lamelle moyenne et la paroi primaire subsistent plus ou moins. Basé sur la forme des ouvertures, il existe deux grands types de ponctuations assurant les échanges intercellulaires : les ponctuations simples et les ponctuations aréolées.
Les ponctuations simples
Les ponctuations simples (Figure I- 6) sont fréquentes dans les cellules de parenchymes et dans les fibres libriformes. Elles possèdent des ouvertures de différentes formes :
Ouverture cylindrique, la plus fréquente parmi les ponctuations simples.
Ouverture circulaire avec des diamètres différents sur la face interne et externe de la paroi (parenchyme, fibres libriformes).
Ouverture elliptique, à axes plus ou moins allongés, dont les axes des deux ouvertures ne sont pas forcément dans le même plan.
Ouverture en forme de simples fentes dont les orientations sont différentes dans deux cellules adjacentes.
|
Table des matières
Introduction générale
I. Revue de littérature
1. Introduction
2. Anatomie du bois
2.1. Fonctions et formation du bois dans l’arbre
2.2. Le plan ligneux
2.3. Eléments anatomiques
2.4. La paroi cellulaire
2.5. Les ponctuations et perforations des parois cellulaires
2.6. Masse volumique et infra-densité
3. Perméabilité
3.1. La loi de Darcy
3.2. Relation avec la porosité
3.3. Glissement moléculaire
3.4. Modèles de glissement moléculaire
4. Perméabilité du bois
4.1. Mesure de perméabilité aux gaz
4.2. Variabilité et anisotropie du bois
4.3. Effet de l’humidité
4.4. Effet de la longueur
4.5. Modèles morphologiques simples de perméabilité du bois
5. Conclusion
II. Matériels et Méthodes
1. Introduction
2. Echantillonnage
2.1. Le bois
2.2. Les panneaux de fibres de bois
2.3. Le béton cellulaire
2.4. La membrane
3. Dispositif expérimental de mesure de la perméabilité apparente
3.1. Le support échantillon, étanche et adapté aux matériaux étudiés
3.2. Mesure de la pression
3.3. La régulation thermique
3.4. Le protocole de mesure
4. Calcul de la perméabilité
4.1. En régime isotherme
4.2. En régime réel
4.3. Détermination des coefficients de transfert thermique ???? et ????
4.4. Comportement du dispositif expérimental dans les régimes isotherme, adiabatique et réel
4.5. Fiabilité du dispositif expérimental
5. Modèles théoriques du bois : modèle en séries de pores non identiques
5.1. Modèle du cylindre
5.2. Modèle de fente
5.3. Modèle de l’orifice
6. Conclusion
III. Un nouveau dispositif pour mesurer la perméabilité gazeuse sur une large plage de pression :caractérisation de glissement moléculaire sur les différentes espèces du bois et les matériaux à base de bois
1. Introduction
2. A Novel Device to Measure Gaseous Permeability over a Wide Range of Pressure: Characterization of Slip Flow for Various Wood Species and Wood-Based Materials
IV. Identification de paramètres morphologiques du bois à partir de mesures de perméabilité au gaz
1. Introduction
2. Identification of wood’s morphological parameters from gas permeability measurements
V. Conclusion et perspectives
VI. Annexe
VII. Références
Télécharger le rapport complet