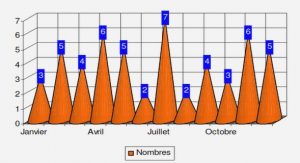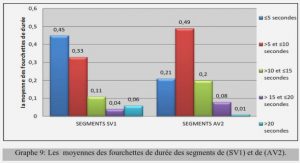D’UNE PROTECTION SOCIALE A FINALITE ESSENTIELLEMENT REDISTRIBUTIVE PENDANT LES TRENTE GLORIEUSES
La bonne santé économique de la France et des Etats-Unis au cours des Trente Glorieuses (1945-1975) permettait à ces deux pays de concilier impératifs de productivité et mesures de lutte contre la pauvreté. La protection sociale n’a donc pas connu véritablement de crise durant cette période de prospérité économique, notamment parce que, du fait d’un chômage peu élevé, les faibles dépenses consacrées à son indemnisation n’étaient pas à même d’alourdir considérablement le coût du système. Dès lors, l’emploi et la protection sociale ne s’excluaient pas mais, au contraire, venaient en complément l’un de l’autre.
D’un côté, en France, le modèle d’emploi fordiste, qui dans un contexte de plein-emploi assurait à la fois progrès économique et social, véhiculait alors l’idée d’un haut niveau de protection sociale compatible avec les exigences du marché du travail. De l’autre, aux Etats-Unis, la forte progression de l’activité économique à cette époque a servi à légitimer le fait que l’emploi devait rester, plus que jamais, la notion centrale du système américain de protection sociale et qu’à ce titre, les prestations sociales devaient être attribuées en priorité aux individus qui en avaient réellement besoin.
Bien que l’objet des modèles respectifs de protection sociale était le même, à savoir assurer un minimum de ressources garanti aux plus démunis, il est à noter toutefois que les moyens et les instruments mis en œuvre pour atteindre les résultats souhaités différaient sensiblement et s’inscrivaient dans des perspectives diamétralement opposées. Aux Etats-Unis, par exemple, où la situation des individus pauvres et/ou exclus de l’emploi a toujours été considéré comme étant de leur ressort, l’aide apportée s’est ainsi focalisée sur des mesures d’assistance. En France, par contre, la lutte contre la pauvreté s’est orientée, dès le départ, vers des mesures assurancielles, lesquelles permettaient, dans une période de plein-emploi permettant de fournir une protection sociale à la majeure partie de la population, de garantir un minimum de revenus aux personnes exclues du marché du travail.
Si les systèmes de protection sociale français et américains ont, à cette époque, un objectif commun – celui de lutter contre la pauvreté – la différence entre les deux pays réside donc dans le fait que la France a opté pour une protection sociale développée à dominante assurancielle, fondée sur l’idée de solidarité professionnelle, alors que les Etats-Unis ont fait le choix d’avoir un système de protection sociale minimaliste, en phase avec l’idée libérale d’une assistance curative. Ainsi, alors que le système de protection sociale français repose sur un modèle généreux de type bismarkien (Section 1), le modèle de protection sociale américain est, quant à lui, surtout orienté vers l’assistance sociale (Section 2).
Le système de protection sociale français repose sur un modèle généreux de type bismarkien
Le modèle français de protection sociale est d’inspiration bismarkienne. C’est-à-dire que le droit à la protection sociale est fondé sur la solidarité professionnelle : l’ouverture du droit à indemnisation chômage, par exemple, fait explicitement référence à la situation antérieure en emploi de l’assuré. Pendant une période de vingt-cinq ans environ (de 1953 à 1979), ce modèle s’est donné pour objectif principal, au moyen du régime d’assurance surtout, de réduire la pauvreté et de limiter les inégalités sociales. Et le chômage n’était perçu, à cette époque, que comme une période transitoire entre le moment de sortie du marché du travail d’un individu et le moment de son retour à l’emploi ; la protection sociale n’avait donc pas pour but de favoriser la réinsertion dans l’emploi, mais simplement d’aider financièrement le chômeur pendant la durée de son chômage.
La logique défendue était ainsi celle d’un maintien du niveau de vie des chômeurs par le biais d’une garantie de revenu élevée, donc d’un revenu de remplacement sensiblement équivalent au revenu du travail. Ce modèle était alors fortement orienté vers l’assurance sociale et visait à permettre aux chômeurs, au travers de la redistribution horizontale, de percevoir des allocations d’un niveau suffisamment proche de celui de leur salaire antérieur.
On peut alors noter qu’il y avait, à l’origine de ce choix d’une protection sociale développée ayant pour but de lutter contre la pauvreté et les inégalités (§ 2), l’influence manifeste de la pensée keynésienne dans le système de protection sociale français (§ 1).
L’influence de la pensée keynésienne dans le système de protection sociale français
L’intervention de l’Etat dans le domaine économique est, dans la théorie de Keynes, jugée nécessaire pour soutenir la demande des ménages. Pour ce faire, l’Etat a le moyen très concret d’augmenter les prestations chômage et d’aide sociale. Dès lors, dans une perspective de stimulation de la demande, cette revalorisation va être de nature à encourager l’offre de travail et, in fine, à agir favorablement sur l’emploi. L’approche keynésienne prend donc le contre-pied de l’idéologie libérale en affirmant que l’Etat doit intervenir dans le système économique pour soutenir la demande. En affirmant que le maintien de l’activité économique dépend du niveau de la consommation des ménages, la pensée keynésienne opère ainsi un revirement paradigmatique par rapport à la théorie néoclassique puisque, désormais, c’est le niveau de la demande effective adressée aux entreprises (et non plus l’offre) qui est vu comme déterminant la croissance du revenu national.
Transposé dans le domaine de la protection sociale, cette approche revient à admettre qu’un système de protection sociale est indispensable pour assurer un minimum de revenu aux chômeurs afin de résorber la crise économique et, à terme, le chômage. La pensée keynésienne a alors été utilisée en partie comme fondement théorique du système de protection sociale français. Tout d’abord, pour justifier l’existence d’un système d’indemnisation du chômage, ce dernier étant de nature à soutenir l’activité économique et donc à éviter une aggravation de la crise (A). Ensuite, une fois l’existence du système justifiée, en vue de légitimer une protection sociale généreuse (B).
Le système d’indemnisation du chômage soutient l’activité économique et évite une aggravation de la crise
En période de crise ou de mauvaise conjoncture économique, le risque de chômage s’accroît et incite les ménages à augmenter leur épargne de précaution, ce qui peut, d’après Keynes, contribuer à aggraver la crise. L’assurance chômage est de nature à limiter cette réaction des ménages du fait même que, selon Holcman (1997), « la certitude d’être indemnisés en cas de chômage rassure l’ensemble des travailleurs et les dispense d’épargner en prévision d’une éventuelle baisse de leur revenu consécutive à une période de chômage ».
Dès lors, l’existence d’un système d’indemnisation peut avoir des effets bénéfiques sur la consommation de l’ensemble des ménages et permet donc de soutenir l’activité économique. En effet, l’existence d’un mécanisme d’indemnisation modifie le partage entre consommation et épargne au profit de la consommation, et donc les sommes non épargnées sont intégralement consommées. Ainsi, dans une logique de relance de l’activité économique par la demande, « la modification de l’arbitrage entre épargne et consommation au bénéfice de cette dernière contribue à maintenir l’activité économique et évite une aggravation du chômage ».
En maintenant à un niveau proportionnel au revenu salarial antérieur le montant du revenu de remplacement (allocations chômage), l’indemnisation permet donc de stabiliser la consommation des chômeurs. De fait, si la croissance ralentit et que le chômage augmente, les prestations chômage vont alors venir compenser en partie la perte de revenu subie par les ménages et, finalement, soutenir leur demande. L’idée est alors, dans une perspective keynésienne, de faire en sorte que le budget de l’Etat prenne en charge le manque à gagner (surcroît de dépenses) consécutif d’une hausse des prestations qui ne sera pas intégralement compensée par un accroissement équivalent des cotisations (recettes). Ce choix de mettre en place un système d’indemnisation des chômeurs est donc perçu comme indispensable dans la mesure où, « si les chômeurs n’étaient pas indemnisés, la baisse générale de la consommation qu’entraînerait le chômage conduirait à ralentir de façon encore plus significative l’activité économique et aurait pour conséquence l’apparition de nouveaux chômeurs – puisque, rappelons-le, dans la vision keynésienne, c’est le niveau de la demande effective qui conditionne l’état du marché du travail »
La légitimité d’une protection sociale généreuse
Une protection sociale généreuse se caractérise par des prestations de chômage et/ou d’aide sociale élevées, lesquelles sont généralement revalorisées afin d’aligner la hausse des allocations sur celle de l’inflation. Si vouloir augmenter les minima sociaux ou encore l’indemnisation du chômage est considéré de façon positive par l’opinion publique, notamment parce que ces revalorisations permettent d’accroître le revenu disponible et donc le pouvoir d’achat des personnes les plus en difficulté, il s’agit pourtant surtout de mesures à caractère social. Ces dernières ont-elles toutefois une réelle efficacité et une efficience économique ?
Autrement dit, ces revalorisations se justifient-elles en regard des conséquences qu’elles induisent sur l’emploi ? A cette interrogation, il est possible d’énumérer, dans la perspective d’une logique keynésienne, deux catégories d’effets : tout d’abord, un effet favorable à la croissance économique et à la reprise de l’emploi ; ensuite, un effet positif probable sur l’offre de travail.
Un effet favorable à la croissance économique et à la reprise de l’emploi
Dans l’approche keynésienne, le maintien et le soutien de la croissance économique passe par l’octroi d’allocations d’un montant tel qu’il permet de stabiliser la consommation des ménages et donc d’agir favorablement sur l’emploi. Pour ce faire, il apparaît alors nécessaire d’augmenter les prestations en vue d’éviter une perte de pouvoir d’achat des ménages, source de ralentissement de la demande. Dès lors, la revalorisation des minima sociaux et de l’indemnisation du chômage permet d’accroître le revenu des bénéficiaires et, par le fait, leur pouvoir d’achat.
Or, toute hausse du pouvoir d’achat des ménages les plus défavorisés est à même de stimuler leur consommation. Il est en effet bien connu que la propension marginale à consommer des personnes à bas revenu est plus élevée que celle des catégories sociales à revenu plus important. De fait, pour toute augmentation de leur rémunération, les bénéficiaires d’allocations chômage ou de minima sociaux vont consacrer la majeure partie de cette augmentation à la consommation. Ainsi, la demande de cette catégorie va s’accroître et, par le fait, stimuler la croissance économique. Au bout du compte, c’est toute l’économie nationale qui profite des effets induits par ces revalorisations et notamment l’emploi. En effet, l’accroissement de la demande va aboutir à augmenter l’offre des entreprises. Celle-ci va permettre la relance (ou plutôt la reprise) de l’activité économique qui va se traduire par une croissance du PIB.
Finalement, cette croissance aura des répercussions inévitables sur l’emploi, dans la mesure où les entreprises, plus compétitives et ayant davantage de besoins en main d’œuvre, vont être incitées à embaucher. Evidemment, ce cercle vertueux ne peut exister que sous certaines conditions restrictives : l’économie est en situation de sous-emploi généralisé, il y a une substitution effective du travail au capital, les débouchés sont suffisants pour espérer maintenir constant le volume de l’emploi, le niveau de qualification des demandeurs d’emploi est suffisamment élevé pour qu’ils soient recrutés en tant que main d’œuvre qualifiée dans les entreprises,…Néanmoins, en général, une élévation du pouvoir d’achat des chômeurs et des bénéficiaires de minima sociaux entraîne, à terme, des effets bénéfiques sur l’économie, ce qui ne peut qu’aboutir à relancer l’emploi.
Un effet positif probable sur l’offre de travail
La théorie libérale, en se fondant sur une analyse microéconomique des effets induits par la hausse des minima et des allocations chômage sur l’offre de travail, précise que ces mesures sont de nature à décourager au travail. Autrement dit, toute augmentation des prestations de protection sociale entraîne une désincitation au travail. Néanmoins, cette théorie n’est, dans la réalité, pas véritablement démontrée . Si la théorie néoclassique conclut à la supériorité de l’effet revenu sur l’effet de substitution, il n’est donc pas certain que cela soit réellement le cas empiriquement. D’autant plus que celle-ci ne tient compte que de « l’incitation monétaire immédiate à exercer une activité, alors que d’autres éléments peuvent intervenir en matière de comportement d’offre de travail, comme par exemple les perspectives ultérieures d’emploi ou la recherche d’un statut social ».
On pourrait affirmer, au contraire, que ces revalorisations, en permettant d’augmenter le revenu des allocataires, induisent des effets incitatifs à la reprise d’un emploi. En effet, si le revenu des bénéficiaires d’allocations chômage ou de minima sociaux s’accroît, cela est de nature à améliorer leur situation, tant financière que matérielle. Si, grâce à ces revalorisations, le niveau de vie des allocataires s’accroît, leur bien-être s’élève et, finalement, ils sont davantage portés à entrer sur le marché du travail. En bénéficiant de ressources suffisantes – ou tout du moins accrues – ils sont alors plus à même d’offrir leur force de travail.
Toute augmentation du niveau de vie peut en effet aboutir à ce que l’individu ressente cette amélioration comme la manifestation d’une volonté politique de l’inciter à entrer sur le marché du travail ou, en tous cas, à rechercher activement un emploi et donc à lui faire comprendre la nécessité d’une obligation de réciprocité ; dès lors, l’amélioration du bien-être est de nature à faire prendre conscience aux personnes des efforts consentis par la société pour améliorer leur sort et les pousse à se responsabiliser en acceptant de se porter sur le marché du travail plutôt que de continuer à bénéficier des allocations perçues sans aucune contrepartie.
Ainsi, une élévation du niveau de vie des catégories les plus défavorisées aboutit parfois à stimuler leur recherche d’emploi du fait d’une amélioration de leur situation personnelle.
L’influence de la pensée keynésienne est fortement présente dans le système français de protection sociale. Elle se concrétise alors par un niveau élevé de protection contre les risques sociaux et c’est la raison pour laquelle nous avons, en France, une protection sociale développée, dont l’un des objectifs fondamentaux est de lutter contre la pauvreté et les inégalités.
Le modèle de protection sociale américain est surtout orienté vers l’assistance sociale
Si le modèle français est fondé sur une logique solidariste qui lui vaut de privilégier une approche keynésienne de la protection sociale, le modèle américain, pour sa part, est basé sur une logique utilitariste et financière qui met en avant le primat de l’individualité et de la maîtrise budgétaire. Dès lors, le modèle de protection sociale américain, même s’il conserve une visée redistributive, n’en demeure pas moins construit autour de l’aide sociale. Autrement dit, aux Etats-Unis, c’est l’assistance sociale, plus que l’assurance sociale comme en France, qui sert de fondement à l’orientation générale de la protection sociale.
L’assistance américaine est donc profondément marquée par la philosophie libérale, voire néolibérale. Dès lors, il est naturel que la conception libérale sous-tende la rhétorique de l’ensemble des politiques d’assistance et qu’elle prenne place dans les fondements de l’aide sociale. A ce titre, il est à noter la prégnance de la théorie libérale dans l’aide sociale américaine (§ 1). Cette prépondérance du libéralisme économique a alors des conséquences sur le niveau de protection sociale américain, dans la mesure où cette théorie véhicule l’idée d’une protection sociale minimaliste et peu généreuse (§ 2).
La prégnance de la théorie libérale dans l’aide sociale américaine
Les fondements théoriques de l’assistance américaine sont profondément influencés par l’approche microéconomique de la théorie néoclassique. Or, l’approche néoclassique de la relation protection sociale – offre de travail fonde son analyse à partir de l’hypothèse suivante : les choix collectifs résultent de l’agrégation des choix individuels. Dès lors, les comportements individuels sont à la base de toute la théorie néoclassique et le cadre commun de réflexion et d’étude est alors celui du marché (considéré comme cadre pertinent d’analyse des liens existants entre la protection sociale et l’incitation au travail) sur lequel s’observent ces comportements. De fait, cette approche privilégie une analyse microéconomique de l’offre de travail, c’est-à-dire à l’échelle de l’individu.
Or, dans l’analyse néoclassique, les individus sont considérés comme des êtres rationnels dont les choix sont guidés par un objectif de maximisation de l’intérêt personnel ; l’analyse microéconomique du lien existant entre la protection sociale et l’offre de travail repose alors sur une approche marginaliste des comportements au travail. Si l’on considère l’activité rémunéré comme le travail et l’inactivité (ou chômage) comme le loisir, alors le choix d’offrir ou non son travail sur le marché s’analyse à partir d’un arbitrage à effectuer entre ces deux arguments.
Dès lors, les individus ont à faire un arbitrage entre deux biens et décider, sous une contrainte budgétaire donnée, la quantité maximale de chaque bien qui maximisera son utilité personnelle. De fait, la relation entre protection sociale et offre de travail est analysée sous l’angle de l’arbitrage travail-loisir (A). Cet arbitrage va alors mettre en avant le fait que la protection sociale est jugée désincitative au travail (B).
Une relation protection sociale – offre de travail analysée sous l’angle de l’arbitrage travail-loisir
La théorie néoclassique raisonne en terme d’utilité. A ce titre, l’objectif du consommateur est de maximiser sa satisfaction jusqu’à un seuil de satiété par la maximisation d’une fonction à deux arguments. Cette fonction est représentée par une courbe concave (du type « fonction inverse »). Or, étant donnée une droite de contrainte budgétaire, pour chaque point de la droite, la consommation d’un argument (ou bien) vient diminuer celle du second.
Autrement dit, le consommateur doit effectuer un choix entre ces deux biens afin de déterminer la quantité maximale de chaque bien qui lui permettra de maximiser sa satisfaction.
Cet arbitrage, transposé dans le cadre de l’offre de travail, aboutit à considérer deux biens distincts : le bien « travail », d’un côté, auquel s’oppose, de l’autre, le bien « loisir ».
Dans la théorie néoclassique, le travail est perçu comme une désutilité. Ainsi le loisir est préféré à l’activité, laquelle n’est exercée que parce qu’elle permet à l’individu de se procurer un revenu qui va lui servir à satisfaire ses besoins : la théorie néoclassique fonde donc son analyse uniquement sur l’avantage financier (ou gain monétaire) procuré par le travail. Le niveau de l’offre de travail relève alors d’un arbitrage entre consommation et loisir, lequel « dépend (ici) de la désutilité marginale du travail et des revenus associés à une transition entre deux états sur le marché du travail » (en l’occurrence ou occuper un emploi ou être au chômage). Le choix s’effectue ainsi entre deux options : soit l’individu préfère rester inactif (ou plutôt « inoccupé » pour éviter les risques de confusion avec les situations d’inactivité entendues au sens de l’INSEE ) et continuer à bénéficier des indemnités chômage ou de l’aide sociale, soit il est encouragé à entrer sur le marché du travail pour accroître son revenu.
La transition d’un état à l’autre dépend dès lors du taux de salaire proposé sur le marché du travail ainsi que du montant des prestations sociales attribuées.
Selon les néoclassiques, l’offre de travail est élastique aux revenus et toute variation du salaire et/ou des allocations sociales entraîne alors deux effets contraires : un effet revenu et un effet de substitution. Par exemple, « une hausse du taux de salaire horaire net (ou une baisse du taux d’imposition) aboutit à ce que l’offre de travail soit incitée à croître du fait que le travail est mieux rémunéré (c’est l’effet de substitution travail/loisir) et, dans le même temps, entraîne une incitation à réduire l’offre de travail parce que la hausse du salaire procure une augmentation du revenu (c’est l’effet revenu) »
Vers une radicalisation de l’assistance : un durcissement de l’aide sociale aux Etats-Unis
Pour des raisons essentiellement budgétaires, l’assistance américaine s’est radicalisée en renforçant désormais les conditions d’ouverture des droits à l’aide sociale et en imposant de nouvelles contraintes aux allocataires (une obligation de travail pour toucher l’aide sociale, en l’occurrence). Il y a à la base de cette attitude politique deux raisons principales : tout d’abord, l’idée que la charge financière croissante que représente le régime d’assistance finit par miner les fondements même du système de protection sociale qui, de ce fait, doivent être totalement repensés ; ensuite, un retour en force de la notion de contrepartie dans les politiques d’assistance.
A l’origine de cette radicalisation de l’assistance sociale, il y a donc l’empreinte théorique de la pensée libérale, à laquelle viennent s’ajouter des considérations d’ordre philosophique et moral au sujet des nouveaux devoirs des allocataires de l’aide sociale. Ainsi, au-delà d’une vive critique libérale de l’inadaptation des systèmes de protection sociale traditionnels (§ 1), il y a aussi la volonté de faire évoluer le système américain vers plus d’obligations pour les allocataires. Dès lors, la mutation des politiques d’assistance peut s’analyser comme le passage d’une relation d’assistance à une relation d’obligations réciproques (§ 2).
Une vive critique libérale de l’inadaptation des systèmes de protection sociale traditionnels
Même si la redistribution est admise très largement dans son principe, elle donne cependant lieu à de vifs débats quant à son ampleur. De nombreux arguments libéraux critiquant l’inefficacité d’une redistribution excessive ont été mis à jour . Au-delà de considérations de justice sociale, les libéraux focalisent leur pensée sur l’aspect antiéconomique de la protection sociale en insistant sur son manque de réalisme et de pragmatisme par rapport aux exigences actuelles en matière de protection respectueuses des impératifs d’équilibre financier du système.
Ainsi, la théorie libérale émet une vive critique de l’inefficacité et de l’inadaptation du système de protection sociale qui remet en cause sa légitimité et donc, en quelque sorte, son existence (en tous cas, telle qu’elle est conçue actuellement). Elle fait, les libéraux font principalement état de deux objections vis-à-vis d’un système de couverture des risques qui n’est pas soumis aux lois du marché. Tout d’abord, la protection sociale est peu efficace dans la mesure où elle induit des comportements de « passager clandestin » (A). De plus, cette efficacité est également mise à mal du fait même du financement du système de protection sociale qui pèse trop lourdement sur les salariés et les entreprises (B).
La protection sociale induit des comportements de « passager clandestin »
Dans la théorie économique, la protection sociale est assimilée à un bien public (ou bien collectif). En fait, un bien collectif est un bien qui peut être consommé simultanément par plusieurs consommateurs sans que ces derniers soient dans une relation d’exclusion. Un bien public est donc caractérisé par deux principes : l’indivisibilité (chacun consomme le bien tout entier sans diminuer la consommation par une autre personne de ce même bien) et par la nonexclusion ou non-rivalité des consommateurs (on ne peut pas exclure de la consommation d’un bien collectif un consommateur qui n’en supporte pas les coûts). De par ses caractéristiques intrinsèques, la protection sociale – et plus particulièrement l’aide sociale – est donc un exemple manifeste de bien public.
Or, dans le cas général, un individu agissant de manière rationnelle ne révélera pas sa disposition à payer pour obtenir ce bien et il adoptera alors un comportement de « passagerclandestin » (ou free rider) en espérant bénéficier de l’usage du bien sans le financer.
Finalement, tous les individus agiront de la même manière et, à l’équilibre, personne ne financera le bien, même si la collectivité aurait pu tirer bénéfice de sa fourniture. Chaque individu va alors chercher à profiter de la couverture de la protection sociale sans en supporter le coût. Au bout du compte, chaque individu faisant de même, personne ne financera le système. L’allocation d’équilibre est alors inefficace au sens de Pareto.
De plus, la thèse du hasard moral met en évidence le fait qu’une fois le contrat souscrit entre l’assureur et l’assuré, celui-ci modifie son comportement. Il agit donc sur la probabilité de voir l’événement contre lequel il est assuré survenir ou encore sur le montant des pertes supportées dans ce cas. La probabilité de réalisation de l’événement chômage va alors augmenter car tout individu, se sachant couvert par le système, va modifier son comportement et accroître ses risques. Dès lors, la couverture du risque engendre le risque et, à ce titre, « l’indemnisation du chômage serait donc une source de chômage, car elle donnerait lieu à des abus et allonge la durée du chômage ».
La théorie du free rider met donc à jour l’idée que la protection sociale, en tant que bien collectif, ne peut être financée que par les prélèvements obligatoires institués par l’Etat.
L’existence d’un système de protection sociale serait donc à l’origine d’inefficiences puisqu’elle permet de « profiter » du système sans en supporter directement le coût. En effet, les chômeurs indemnisés bénéficient de prestations sociales financées par des cotisations et impôts payés par les salariés en activité. De même pour l’aide sociale, puisque ce système est financé par des aides publiques prélevées sur le produit des recettes fiscales, lesquelles sont perçues sur les actifs occupés. Ainsi, pour les libéraux, la protection sociale forme un système incapable de révéler les préférences individuelles et, en induisant des comportements de « passager clandestin », donc d’assistés, serait alors source d’irresponsabilités.
|
Table des matières
1 ère Partie : Un changement de paradigme de la protection sociale
Chapitre I : D’une protection sociale à finalité essentiellement redistributive pendant les Trente Glorieuses
Section 1 : Le système de protection sociale français repose sur un modèle généreux de type bismarkien
§ 1 : L’influence de la pensée keynésienne dans le système de protection sociale français
§ 2 : Une protection sociale développée visant à lutter contre les inégalités
Section 2 : Le modèle de protection sociale américain est surtout orienté vers l’assistance sociale
§ 1 : La prégnance des idées libérales dans l’aide sociale américaine
§ 2 : Une protection sociale minimaliste et peu généreuse
Chapitre II : …à une protection sociale à double vocation redistributive et intégrative à partir des années 1990
Section 1 : Vers une radicalisation de l’assistance : un durcissement de l’aide sociale aux Etats-Unis
§ 1 : Une vive critique libérale de l’inadaptation des systèmes de protection sociale traditionnels
§ 2 : Les mutations des politiques d’assistance : de la relation assistancielle à la relation d’obligations réciproques
Section 2 : Un certain alignement vers le bas du modèle français de protection sociale
§ 1 : La crise de l’emploi a remis en cause le modèle français de protection sociale
§ 2 : L’influence de la morale sociale américaine sur l’instrumentalisation de la protection sociale française
2 ème Partie : Les politiques de réintégration dans l’emploi : workfare versus insertion
Chapitre I : Le workfare américain, une approche contraignante et peu efficace
Section 1 : Le workfare vise à remettre au travail les allocataires de l’aide sociale
§ 1 : De l’incitation à la reprise d’un emploi à l’obligation de travailler
§ 2 : Le cas-type du workfare américain : l’AFDC-TANF
Section 2 : Les limites des politiques de workfare
§ 1 : Les impasses du workfare américain
§ 2 : Les dangers suscités par le recours aux politiques de workfare
Chapitre II : L’insertion française, une formule plus intéressante
Section 1 : Les politiques mises en œuvre ont pour but de favoriser la réinsertion socio professionnelle des « exclus »
§ 1 : Des politiques d’insertion qui se sont adaptées au nouveau contexte de l’emploi
§ 2 : Le cas-type de l’insertion à la française : le RMI
Section 2 : Vers un perfectionnement des politiques d’insertion : les compléments à mettre en place
§ 1 : La nécessité de rendre le travail davantage rémunérateur
§ 2 : Les mesures de soutien aux chômeurs et d’amélioration de leur employabilité