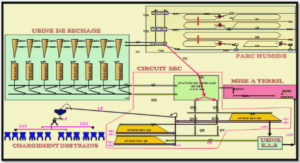Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les districts industriels
Le concept de district s’inspire des travaux de l’économiste Alfred Marshall qui, à la fin du 19ème siècle, parle de « localisation de l’industrie » lorsqu’il aborde la « concentration d’un grand nombre de petites entreprises dans certaines localités » (Marshall, 1890 : 467- 468). Pour cet auteur, l’organisation industrielle des districts à travers la proximité géographique doit permettre des économies externes.
Ainsi, lorsqu’il analyse le phénomène de « localisation de l’industrie », la structure économique qu’il décrit présente un ensemble de traits étroitement articulés : l’agglomération de l’industrie sur un territoire géographiquement délimité, la spécialisation de l’industrie dans une seule production, le rassemblement d’un grand nombre d’entreprises de petite taille spécialisées dans une phase (ou un petit nombre de phases) de fabrication du produit, le développement d’activités industrielles et commerciales auxiliaires, une atmosphère industrielle favorable à l’apprentissage et à l’innovation et un réservoir de main d’œuvre qualifiée et mobile. Son originalité réside dans la distinction qu’il fait des économies internes « qui tiennent aux ressources des entreprises individuelles, à leur organisation et à l’excellence de leur direction », des économies externes qui « tiennent au développement général de l’industrie ». La dynamique du district marshallien repose moins sur les avantages initialement donnés que sur ceux créés au fil du temps. Zeitlin (1992 : 283) le définit par : « un système de production localisé géographiquement et fondé sur une intense division du travail entre petites et moyennes entreprises spécialisées dans des phases distinctes d’un même secteur industriel ».
Beccatini (1992) va redécouvrir le concept marshallien de district industriel et va unifier ce champ de recherche pluridisciplinaire entre l’économie, la sociologie et l’économie régionale en l’appliquant à l’Italie. Les districts industriels italiens reposent sur des petites entreprises caractérisées par une faible intensité en capital, une productivité du travail assez basse et une main d’œuvre moins chère que dans le nord ouest de l’Italie (Bagnasco 1977, Daumas, 2007). Pour Marshall (1890) la notion « d’atmosphère industrielle » désignait exclusivement l’accumulation locale de savoir-faire, Beccatini (1992) y ajoute un contenu social avec, premièrement, l’ensemble des conditions qui fondent la cohésion sociale et la communauté de valeurs de la population locale et deuxièmement, l’ensemble des relations entre tous les acteurs du territoire qui rendent possible l’apprentissage collectif.
Beccatini (1992 : 36) définit le district industriel comme : « une entité socio-territoriale caractérisée par la présence active d’une communauté de personnes et d’une population d’entreprises dans un espace géographique et historique donné ». Le point important pour cet auteur est le lien qu’entretiennent les entreprises entre elles.
De plus, dans le district, à la différence des autres dispositifs, la communauté sociale et les entreprises tendent à s’interpénétrer (Granovetter, 1985). Garofoli (1994) l’exprime pour appréhender le concept de district industriel à travers une agglomération de PME entretenant des rapports de concurrence et de coopération entre elles sur un territoire organisé autour d’une petite ville. La spécialisation de ces PME autour d’un savoir-faire particulier (homogénéité socio-culturelle) et accumulé localement (proximité géographique) doit engendrer des économies externes. De surcroît, ces dernières découlent d’une atmosphère qui doit être favorable à l’apprentissage et à l’innovation avec un marché du travail segmenté et très flexible (Piore et Sabel, 1984), l’implication des institutions collectives et un fort sentiment d’appartenance à la communauté locale. Par conséquent, pour Garofoli (1994), les facteurs clés de succès de ce système économique sont : l’existence d’un contexte favorable, l’encastrement historique, relationnel et social, ce qui va permettre de faciliter la circulation des connaissances (souvent) tacites entre les PME spécialisées. Les avantages liés à l’existence d’un district industriel les plus souvent cités sont de manière générale sa capacité d’adaptation aux évolutions du marché, le faible taux de chômage, son ancrage historique ainsi qu’une forte collaboration. l’importance de la redondance des informations.
Le modèle des districts industriels est souvent idéalisé comme un modèle productif alternatif opposé radicalement à la production de masse, hiérarchisée et standardisée. Cependant, il faut relativiser les avantages de ce modèle. Pour aller dans ce sens, Daumas (2007) montre que le fonctionnement des districts industriels ne dépend pas que de la confiance et de la coopération entre les entreprises mais également des mécanismes de marché car il est « hautement concurrentiel dans le sens néoclassique du terme ».
Par conséquent, les entreprises peuvent arrêter leur collaboration et, par le mécanisme de « desserrement des liens » entre ces dernières présentes sur le territoire, conduire à sa disparition.
Les clusters
C’est avec Marshall (1890, 1919) que la notion de collaboration apparaît dans les transactions économiques. A sa suite, Porter (1990, 1998) reprend cette notion de collaboration dans le principe de clusterisation. Il définit les clusters comme un « geographic concentrations of interconnected companies, specialised suppliers, service providers, firms in related industries, and associated institutions (for example, universities, standards agencies, and trade associations) in particular fields that complete but also co-operate » (Porter, 1998 : 199). Un intérêt grandissant de la part des universitaires ainsi que des décideurs politiques pour les regroupements localisés d’entreprises est né de cette approche.
Torre (2006) explique le succès lié à ce concept dans la littérature car il fait référence à quatre fondements théoriques majeurs : l’économie de la connaissance, l’externalité des réseaux, l’intégration verticale des firmes et le fait que ce concept se centre sur les relations entretenues avec l’extérieur. Ce concept pose tout d’abord la question de la diffusion des connaissances au niveau local en se centrant sur les interactions entre membres d’un même réseau. La notion d’externalités des réseaux exprime les avantages associés aux autres membres du réseau avec notamment le partage d’intérêts communs. Le concept d’intégration verticale des firmes renvoie à la mise en commun de certaines infrastructures et à la diminution des coûts de transaction entre participants d’un même processus de production. Enfin, le cluster n’est pas un système clos. Il est, au contraire, un système ouvert et accorde une grande importance aux relations entretenues avec l’extérieur et se situe dans les problématiques de la mondialisation.
Le cluster renvoie donc aux processus et politiques d’innovation et aux avantages en termes de performances ou de compétitivité des systèmes locaux ou des réseaux d’acteurs.
Cependant, le modèle de cluster comprenant un réseau d’entreprises et d’institutions proches géographiquement, interdépendantes et liées par des métiers, des technologies et des savoir-faire communs, n’est pas un courant homogène. En effet, nombreux sont les auteurs du courant institutionnaliste ou en géographie économique qui mobilisent ce concept dans diverses acceptions. De plus, sa mise en œuvre dans le cadre de politiques qui lui sont dédiées est aussi diverse. Cependant, tous s’accordent à montrer l’importance de la proximité géographique ainsi que de la collaboration. Santos Cruz et Teixeira (2007) insistent sur les trois dimensions du concept de cluster qui sont la proximité géographique, les réseaux sociaux et l’importance de la culture. Pour ces auteurs, la proximité géographique engendre des avantages technologiques par le biais d’économies d’agglomération. Les réseaux sociaux permettent, quant à eux, la transmission de connaissances et d’apprentissages collectifs et l’importance de la culture à travers le climat d’affaires va inciter la création ou le développement de nouvelles entreprises. Ces trois dimensions permettent l’évolution du cluster.
La théorie des avantages concurrentiels permet, pour Porter (1998), d’expliquer les comportements stratégiques mêlant concurrence et coopération pour stimuler le processus d’innovation et justifie l’intérêt du cluster. La source d’avantage concurrentiel réside non pas au sein d’une organisation donnée ou même d’une industrie mais dans la localisation de ses unités de production. Le regroupement, en développant les réseaux de relations personnelles, crée des synergies entre les acteurs. Ces synergies favorisent l’augmentation de la productivité, encouragent l’innovation et stimulent la création ou l’implantation de nouvelles entreprises qui viennent en retour renforcer le cluster (Porter, 1998).
Les travaux inspirés de Porter insistent sur les relations formelles liant les entreprises ainsi que sur la dynamique des clusters. Des critiques ont cependant été émises sur ce modèle notamment sur l’idée selon laquelle les relations formelles doivent engendrer de la coopération. En effet, les organisations peuvent entretenir à distance les avantages de la proximité dans la réalisation d’activités innovantes (Torre, 2006 ; Martin et Sunley, 2003), la proximité géographique est alors remise en cause.
Le pôle de compétitivité : un réseau de développement scientifique et industriel
La mise en réseau des entreprises et plus largement des organisations (universités, hôpitaux…) est une idée très en vogue actuellement. En effet, l’effacement des frontières des entreprises, la mondialisation et l’apparition des nouvelles technologies incitent à s’intéresser à la notion de réseau (Assens, 2003). Pour certains, le réseau peut être défini lorsque la coopération devient durable et réciproque au point de fidéliser les partenaires en se fondant sur la confiance (Assens et Jacob, 2008). D’autres auteurs définissent le réseau comme un mode d’organisation qui coordonne des acteurs hétérogènes (Edouard et al., 2004) indépendants juridiquement et financièrement (Fréry, 1997 ; Jameux, 2004). Les acteurs sont alors qualifiés de partenaires et la coopération est l’élément central du réseau. La logique de coopération d’acteurs de profils différents au sein d’un territoire est commune aux formes d’organisation telles que les clusters, les SPL ou bien les districts industriels (Carluer, 2006).
Dans un environnement fortement concurrentiel, les entreprises font souvent le choix de stratégies collectives avec des membres partenaires. Qu’est-ce qui explique ce choix ? Les pôles de compétitivité, réseaux formels regroupant des acteurs hétérogènes, sont souvent perçus comme un outil de politique scientifique et industrielle ainsi que de développement économique du territoire. Ferrary et Pesqueux (2004) distinguent quatre types de réseau : les réseaux inter-firmes, les organisations en réseau, les réseaux sociaux et les réseaux de communication. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux réseaux inter-firmes et aux motivations inhérentes aux entreprises puis, dans un deuxième temps nous aborderons la notion d’organisation en réseau ce qui nous permettra de caractériser les pôles de compétitivité.
Les réseaux : socle de la coopération industrielle
Le réseau pris dans son sens le plus général constitue une forme d’organisation hybride au marché et à la hiérarchie (Williamson, 1975). La coopération inter-entreprises peut être entendue ici comme : « l’interaction plus ou moins étendue avec les activités de deux entreprises juridiquement distinctes » (Douard et Heitz, 2004 : 189). Douard (2005) considère le réseau comme un lieu de transformation permanente et créateur de valeur.
Bejean et Gadreau (1997) expliquent la naissance des réseaux par la recherche de complémentarité, la réduction de l’incertitude et la diffusion d’informations et de connaissances.
Certains auteurs se sont intéressés depuis aux motivations liées à la coopération, à la mise en réseau des entreprises (Douard et Heitz, 2003). Ainsi, selon ces auteurs, les motivations de la coopération peuvent avoir trois critères distinctifs : la logique additive de réseau, la logique d’intégration de réseau et la spécificité des actifs de réseau.
Tout d’abord, la logique additive représente la mise en œuvre d’une activité nouvelle rendue possible par la réunion de moyens émanant des partenaires du réseau, et permettant un nouveau processus de valeur ajoutée. Le résultat de cette mise en commun de moyens est profitable à chacun des partenaires.
Ensuite, la logique d’intégration vise les différentes phases d’un processus de production de valeur ajoutée, phases qui concourent de façon spécifique à l’obtention d’un résultat donné. Elle se fonde sur le recours au marché comme moyen de constitution ou de renforcement de la chaîne de valeur de l’entreprise. C’est de la coordination d’activités individualisées que dépend le résultat final.
Pour Richardson (1972), les coopérations peuvent être envisagées comme des formes d’organisations à part entière, mode de coordination ex ante des activités complémentaires ou concurrentes et relevant donc de logiques d’intégration ou additives. Néanmoins pour lui, l’additivité est envisagée par la coordination d’activités dites « semblables ». Or, il existe des activités similaires et complémentaires. A cette première distinction des réseaux en logiques additives ou d’intégration, une troisième dimension peut être ajoutée : la spécificité des actifs.
Le réseau permet l’émergence d’un actif matériel ou immatériel nouveau, résultant de l’interaction de ses membres. Cet actif peut être mis en correspondance avec une structure formelle, il peut être fort ou faible, son importance conditionne l’évolution du réseau et le degré de réversibilité des coopérations.
Les combinaisons obtenues à partir de ces trois dimensions permettent de définir quatre familles types de réseau : les réseaux d’adjonction, les réseaux heuristiques, les réseaux transactionnels et les réseaux d’orchestration (Douard et Heitz, 2003).
Les réseaux d’adjonction sont caractérisés par le résultat de la collaboration qui consiste en une réalisation conjointe spécifique rendue possible par la mise en commun de moyens (nouvelles ressources ou capacités), qu’elle soit matérielle ou immatérielle, et à laquelle aucun des partenaires pris isolément ne serait parvenu. Il existe généralement dans ce cas un cloisonnement suffisant des partenaires pour protéger leurs savoir-faire spécifiques individuels. Ces savoir-faire majeurs peuvent être à forte spécificité individuelle alors que la spécificité des actifs du réseau reste faible. Le niveau d’engagement demeure contrôlé et la réversibilité du processus est possible pour chaque partenaire à quelques coûts irrécouvrables près. Ces partenariats peuvent avoir un statut provisoire : une phase test ou d’observation pour l’entreprise ou bien pour réduire les incertitudes.
Les réseaux heuristiques ont un degré d’engagement et d’influences réciproques des partenaires fort. Le réseau engendre et développe un apprentissage spécifique important, source d’une spécificité propre des actifs mêmes du réseau. Pour Bressand et Distler (1995), la mise en relation de ces actifs individuels suscite la création d’un actif nouveau en dehors de la simple compétence de coordination en vigueur dans les réseaux d’intégration (transactionnels ou d’orchestration). Ce sont finalement des accords dans lesquels la coopération est le but et non un simple moyen. Ils renvoient à un travail en commun, un processus de production de valeur et non de simple échange (Delapierre, 1991).
Les réseaux transactionnels privilégient des relations d’échange entre partenaires à partir du recours au marché, permettant de prendre en charge ou de renforcer une part de la chaîne de valeur de la firme qu’elle soit actuelle ou visée. Ce sont des coopérations où la réversibilité des engagements reste forte (retrait aisé du réseau sans en altérer par ailleurs la spécificité). A la différence des réseaux d’adjonction, ils ne s’intéressent pas à la gestion commune d’activités mais à la gestion d’activités complémentaires au sens de Richardson (1972). De tels réseaux se présentent comme une gamme de savoir-faire ou de ressources mobilisables plus ou moins individuelle suivant la nature du problème à résoudre ou de l’activité à produire. Enfin, la spécificité des actifs propres au réseau dans sa dimension collective reste faible.
Le réseau d’orchestration a un niveau de stabilité significatif. Le partenariat est lui-même générateur d’un actif spécifique plus fort, propre au réseau, avec des possibilités d’appropriation faibles de cet actif pour l’un ou l’autre des partenaires. Souvent l’existence de barrières à l’entrée ou à la sortie du réseau est présente. Ce savoir-faire spécifique relève d’un savoir-faire d’orchestration, de mise en musique fructueuse, de la gamme des actifs individuels des partenaires du réseau. Ce type de réseau a une incidence sur la structure elle-même du ou des secteurs concernés et favorise la logique de spécialisation. La coordination peut être en amont, au cœur ou en aval de la chaîne de valeur. Les liens établis sont de type étroits (serrés) parce que l’orchestration même des complémentarités requiert un savoir-faire spécifique, devenant un actif spécifique du réseau.
Le niveau de confiance, les modes de contrôle pour éviter les comportements opportunistes, le niveau de contractualisation, sont autant de dimensions qui vont permettre la qualité de retour sur investissement des engagements dans le réseau pour chacun des partenaires. Toute sortie du réseau provoque une remise en cause de la nature même de ce dernier.
Les pôles de compétitivité : une structure en réseau
Le réseau est une alternative à la hiérarchie et au marché (Williamson, 1975). Ces réseaux peuvent être formels ou informels ainsi que construits ou spontanés. Assens et Jacob (2008) complètent cette caractérisation par l’autonomie et l’indépendance de ces membres. L’organisation en réseau peut se définir comme l’interaction d’au moins deux entreprises juridiquement distinctes (Heitz, 2000). Fulconis (2000 : 118) fait une synthèse de la définition des structures en réseau qu’il interprète comme « la mise en œuvre des stratégies collaboratives entre des parties prenantes (entreprises, organismes de formation, de recherche…) impliquées sur une même chaîne de valeur. Ces parties prenantes sont juridiquement et financièrement indépendantes les unes des autres, mais « organisationnellement » interdépendantes. Qualifiées de partenaires, elles sont à distinguer de sous traitants ou de simples fournisseurs. Les multiples relations qu’elles entretiennent s’appuient sur une forte réciprocité d’intérêt et nécessitent un effort permanent de coordination pour éviter leur désagrégation. Les structures en réseau représentent donc un modèle d’organisation économique spécifique situé entre le marché et la hiérarchie ». En management stratégique, ces structures en réseau sont souvent considérées comme des vecteurs de compétitivité (Snow et al., 1992 ; Voisin et al., 2004 ; Suire et Vincente, 2008 ; Fulconis et Joubert, 2009).
Fulconis et Joubert (2009) utilisent la grille d’analyse élaborée par Fulconis (2000, 2004) pour appréhender le pôle de compétitivité comme une structure en réseau. Selon cette grille, la structure possède quatre composantes : l’hétérogénéité, le partenariat, l’autonomie et la cohésion. Cette grille d’analyse est nommée HPAC qui reprend les initiales de chacune des dimensions (Fulconis, 2000 ; Fulconis, 2004).
L’hétérogénéité renvoie à deux principes. Le premier correspond à l’hétérogénéité de la structuration même des membres au sein du réseau. Assens (1996) définit ainsi deux types de réseaux : le réseau centré et le réseau fédéré. Les réseaux centrés sont organisés autour d’une unité centrale tandis que le réseau fédéré est non centré. Miles et Snow (1992) distinguent trois formes de réseaux centrés : le réseau bureaucratique, le réseau semi-bureaucratique et le réseau semi-organique. Le réseau bureaucratique forme une étoile entre une entreprise et ses sous-traitants. Le réseau semi-bureaucratique représente une organisation articulée autour d’une firme focale. Celle-ci centralise le pouvoir et exerce une influence importante sur les autres membres du réseau. A la différence du réseau bureaucratique, les relations entre l’entreprise-pilote et les entreprises-satellites s’exercent à double sens. Les connexions ne sont plus unilatérales, elles deviennent réciproques. Une troisième forme est identifiée par le réseau semi-organique. Le réseau semi-organique se compose d’un pilote autour duquel gravitent les autres membres du réseau: les firmes satellites. Le pilote centralise une partie des informations qui circulent dans la structure. De cette manière, il parvient à coordonner une partie des relations. Dans ce modèle, le pilote délègue une partie de son pouvoir auprès des firmes satellites. Celles-ci peuvent arbitrer entre différentes connexions et différents chemins sans l’intermédiaire du pilote. Cet arbitrage s’effectue directement de firme satellite à firme satellite, par la négociation ou la transaction. Assens (1996) ajoute à ce modèle le réseau organique, qu’il appelle aussi réseau fédéré. Ces derniers n’ont pas d’autorité centrale. Ce type de réseau est auto-organisé. De ce fait, tous les acteurs sont en charge de la coordination, on parle alors de réseau autorégulé ou organique. Le second principe renvoie à la diversité des entreprises qui composent les structures en réseau que ce soit par leur secteur d’activité, les métiers ou bien encore leur taille.
Le partenariat comprend l’ensemble des liens de coopérations, qu’ils soient formels ou informels, susceptibles d’être noués entre deux ou plusieurs entreprises. Les points forts de la coopération sont le transfert de savoir-faire, une confiance grandissante, une synergie et une complémentarité. Cependant, il existe une importante instabilité liée à la notion de coopération (Culié et al., 2006).
L’autonomie entre les entreprises partenaires peut revêtir une dimension juridique, financière et de décision.
Enfin, la dernière dimension de cette grille d’analyse de la structure en réseau est la cohésion. Joubert et Fulconis (2009 : 188) la définissent comme : « la force permettant aux entreprises constitutives de structures en réseau de rester unies autour d’un projet commun. Elle repose sur le respect d’un principe- volonté commune pour demeurer et évoluer ensemble – s’appuyant sur un systèmes de valeurs partagées dont la préoccupation principale est la recherche de mutualité ».
Selon Fulconis et Joubert, les pôles de compétitivité sont des structures en réseau qui peuvent être analysés grâce à cette grille. Grâce aux propriétés d’hétérogénéité, de partenariat, d’autonomie et de cohésion, les pôles, en mettant en réseau des acteurs de la triple hélice (entreprises, recherche et formation), sont en capacité d’accroître le rythme et le niveau des innovations et partant, la valeur ajoutée pour l’ensemble (Fulconis et Joubert, 2009).
Le pôle de compétitivité : territoire et développement économique
L’innovation a plus de chances de réussir si elle s’insère dans des réseaux hétérogènes (Cohen et Levinthal, 1990). La dynamique d’un cluster d’innovation repose donc sur la capacité des acteurs à coopérer autour de projets innovants. Mais, la coordination entre des acteurs aussi différents que les entreprises, les laboratoires de recherche et les institutionnels au sein d’une structure en réseau pose un certain nombre de questions. Il est par exemple difficile de préciser comment circulent les connaissances au sein d’un pôle de compétitivité, d’en délimiter avec rigueur les frontières géographiques ou bien encore de préconiser le type de technologies pertinentes.
L’analyse par la proximité nous offre une clé d’entrée intéressante pour appréhender de manière plus précise les raisons de l’émergence et les conditions de mise en œuvre d’un pôle de compétitivité. En effet, le concept de proximité selon Gilly et Torre (2000) propose une analyse relationnelle et des interactions, et intègre la dimension du lien social entre acteurs dans l’analyse. Ce concept renvoie à l’hypothèse d’une séparation économique, géographique, entre agents (individuels ou collectifs) et donc à leur éloignement plus ou moins fort. L’idée dans les pôles de compétitivité est donc de rapprocher les différentes organisations pour accroître leur compétitivité. Le territoire n’est donc plus seulement analysé en termes de contenant (les ressources) mais doit l’être aussi en termes d’interactions potentielles.
Nous présentons dans un premier temps les termes de l’analyse de la proximité pour ensuite montrer comment elle s’applique avec pertinence aux pôles de compétitivité.
La coopération sur un territoire : une analyse par la proximité
Les typologies de la proximité sont multiples. En effet, certains auteurs prennent en compte la proximité organisée et géographique (Gilly et Torre, 2000 ; Pecqueur et Zimmermann, 2004 ; Torre, 2006) d’autres y ajoutent la proximité institutionnelle (Colletis-Whal et Pecqueur, 2001), certains prennent aussi en compte la proximité technologique (Zimmermann, 2008).
Tous s’accordent à dire que, seule, la proximité géographique ne peut fonctionner pour créer une dynamique d’innovation (Rallet et Torre, 2004; Zimmermann, 2008). Cette dernière doit être couplée avec la ou les autres dimensions, mais dans le même temps, la proximité géographique est supposée faciliter la proximité organisée. Le potentiel des pôles de compétitivité réside donc dans la combinaison de ces deux proximités.
Plus précisément, la proximité géographique renvoie aux dimensions spatiales du processus productif ainsi qu’au périmètre géographique du territoire. Elle mesure la distance kilométrique entre deux entités (individus, organisations, villes) pondérée par le coût temporel et monétaire de son affranchissement (Rallet et Torre, 2004).
La localisation des activités questionne les entreprises car leur performance est partiellement expliquée par la pertinence de leur lieu d’implantation : qualité de la demande locale, des infrastructures et des fournisseurs régionaux ainsi que la proximité des marchés (Gosse et Sprimont, 2010). La proximité géographique des entreprises constitue donc un moyen de faciliter les interactions. Or, si la proximité géographique constitue un moyen de faciliter les interactions, elle ne constitue évidemment pas une condition suffisante à l’émergence d’innovation à travers la coordination entre les différents acteurs territoriaux et la diffusion de connaissances (Breschi et Lissoni, 2001). Ainsi, l’efficacité de la mise en réseau des acteurs ne peut pas être seulement liée
à la proximité géographique mais d’autres dimensions doivent être partagées. Rallet et Torre (2001) soulignent dans ce sens que le partage d’un certain nombre de valeurs et de règles est sans doute une condition plus essentielle à la coordination des agents que leur seule localisation les uns à côté des autres. Ainsi à côté de la proximité géographique doit être souligné l’intérêt d’une proximité organisée.
Autant, la proximité géographique est relative à la distance kilométrique entre deux entités, autant la proximité organisée est par essence relationnelle (Torre, 2006). Pour cet auteur, on entend par proximité organisée la capacité qu’offre une organisation à faire interagir ses membres. Elle renvoie donc à l’ensemble des routines implicites et explicites facilitant la coordination entre les acteurs. Boschma (2005) la décompose en proximité organisationnelle, cognitive, institutionnelle et sociale. La proximité organisationnelle permet une activation des liens révélant une proximité organisationnelle d’essence relationnelle (Boshma, 2005). Pour Gosse et Sprimont (2010), la proximité organisationnelle est plus particulièrement liée aux logiques de coordination technico-productive. Elle caractérise, par exemple la relation entre un ensemble de fournisseurs et son donneur d’ordres. La proximité cognitive fait, quant à elle, référence aux bases de connaissances et d’expertises « tacites » partagées entre deux acteurs. La proximité institutionnelle souligne l’intériorisation de normes, routines, règles, contrats, valeurs et langages communs. Elle se manifeste lorsque les acteurs produisent et partagent des représentations et des valeurs communes. Elle régule les interactions (niveau macro) entre les acteurs.
Enfin, la proximité sociale mesure l’encastrement relationnel des acteurs (niveau micro) basé sur la confiance, l’amitié, les relations familiales.
Pour Gilly et Torre, deux types de logiques entrent en jeu dans la proximité organisée : la logique d’appartenance et la logique de similitude (Gilly et Torre, 2000 : 12). La logique de similitude renvoie à l’idée que les membres d’une même organisation sont réputés partager un même système de représentations, de croyances et même de savoirs. La logique d’appartenance, quant à elle, permet à des agents d’un même réseau d’entretenir des relations interactives et de fonctionner ensemble, y compris à distance par le biais de routines de comportement communes (Boschma, 2005 ; Torre, 2006). La difficulté pour des dispositifs tels que les pôles de compétitivité est d’appréhender la logique de similitude car elle est à l’inverse de l’esprit de ce dispositif puisqu’ils doivent faire collaborer des acteurs hétérogènes pour engendrer de l’innovation. Par conséquent, si l’on suit cette grille d’analyse, l’élaboration de la logique d’appartenance représente un enjeu important pour les pôles.
La proximité organisée est susceptible d’engendrer une dynamique importante. D’une part, elle peut stimuler ou créer une dynamique d’innovation entre les acteurs situés sur un même territoire. Cela va permettre de garantir au-delà des effets purement géographiques, la base de coopération, à l’image des « milieux innovateurs » (Aydalot, 1986; Calmé et Chabault, 2007). D’autre part, elle peut permettre le développement et la croissance d’un réseau de communication et d’information dont la nature et l’intensité seront fonction de l’histoire des interactions précédentes entre les acteurs mais aussi des interactions quotidiennes de face à face (Bathelt et al., 2004). Ce réseau de relations multi-niveaux liant les acteurs entre eux (partenaires de business, amis…) s’avère donc un socle indispensable, car cela signifie qu’une confiance minimale peut déjà exister auparavant entre un certain nombre d’acteurs du cluster et peut se renforcer progressivement au travers de relations fréquentes et répétées pour donner lieu à l’émergence d’un capital social potentiellement bénéfique pour tous les acteurs (Gulati, 1995 ; Gulati et al. 2000 ).
Cependant, la proximité ne présente pas que des avantages pour les acteurs qui l’expérimentent. De nombreuses critiques en font état. D’une part, la proximité géographique peut conduire à un phénomène de lock in spatial, un enfermement des membres entre eux selon le degré d’ouverture ou de fermeture des frontières du réseau. De plus, pour Bathelt et al., (2004), les liens faibles entretenus par les membres d’un réseau peuvent rendre l’apprentissage long et coûteux. Les liens externes entretenus par les membres peuvent concurrencer les liens internes mettant en péril la viabilité du pôle de compétitivité. Par conséquent, les externalités positives liées à la proximité géographique peuvent être annulées (Maskell et Lorenzen, 2004). Les coopérations doivent alors être encouragées et stimulées par un support institutionnel, d’où le rôle primordial de la gouvernance au sein des pôles.
Les pôles de compétitivité : un réseau territorialisé d’organisation
L’objectif des réseaux territorialisés d’organisation (RTO) est de promouvoir des points d’appui du développement économique contemporain grâce au rapprochement géographique de compétences et de capacités d’innovation convergentes. Cela doit conduire à un renforcement des liens entre les entreprises et les organisations en présence sur le territoire. Cooke (1992) insiste sur la dimension relationnelle qui se noue entre les entreprises, les instances d’intermédiation et la société locale au sein de ces réseaux. Il parle alors de système régional d’innovation comme une conceptualisation du territoire dans sa dimension économique. Loubès et Bories-Azeau (2010) insistent quant à eux sur l’incitation des pouvoirs publics dans la mise en place des pôles de compétitivité pour que les organisations, principalement les PME, développent des projets communs à finalité économique et fortement liés au territoire et à l’environnement socio-économique d’où l’expression « réseaux territorialisés » (Ehlinger et al., 2007 : 164).
Un réseau territorial, selon Pecqueur (2003), représente une diversité d’acteurs et d’interactions possibles. Il prend position, non pas sur des réseaux territoriaux, mais sur des réseaux inter-organisationnels avec un ancrage territorial (Edouard et al., 2004 : 10).
Pour Calmé et Chabault (2007) ainsi que Mendez (2008), les pôles s’inscrivent dans la continuité des systèmes territorialisés déjà existants (Lagendijk, 2006 ; Moulaert et Sekia, 2003 ; Chabaud et al., 2006) ce qui rejoint l’idée de la territorialisation des activités productives innovantes, par conséquent, de la « localisation de l’industrie ».
Les pôles de compétitivité sont un dispositif qui a pour objectif de créer une dynamique d’innovation entre les acteurs situés sur un même territoire. Au-delà des effets purement géographiques (externalités), l’objectif est aussi la création d’une dynamique d’apprentissage et d’innovation sur la base des coopérations. Si l’on considère ce dispositif comme un réseau territorial d’organisation, l’objectif est donc d’identifier les compétences distinctives territoriales ainsi que les jeux d’acteurs et les dynamiques qui s’y déroulent. La proximité géographique doit engendrer des coopérations. Pour que ces coopérations puissent exister, un important partage d’identité et de culture est nécessaire (proximité organisée).
Les pôles de compétitivité s’inscrivent donc dans une double logique : une logique de rapprochement entre système d’enseignement supérieur et de recherche d’un côté, et industrie de l’autre ; une logique spatiale ou territoriale à l’instar des clusters étrangers souvent pris en exemple et abondamment analysés depuis quelques années. Cet engouement pour ces effets d’agglomération se fonde sur l’idée selon laquelle la proximité géographique joue un rôle important dans la diffusion des savoirs tacites et la réalisation d’apprentissages. Au-delà de la proximité géographique, l’ambition des pôles de compétitivité est d’instituer de la proximité organisationnelle entre des acteurs économiques et institutionnels. Cette proximité organisationnelle recherchée repose en fait sur deux types de logiques (évoquées dans le paragraphe précédent) qui peuvent être articulées (Gilly et Torre, 2000). Une logique d’appartenance qui qualifie les acteurs appartenant au même espace de rapport (firmes, réseaux…) ; une logique de similitude qui qualifie les acteurs qui partagent des représentations et des savoirs. Pour les PME, l’innovation et la coopération sont souvent considérées comme un couple inséparable (Fréchet, 2004).
Par le biais de partenariats et des multiples interactions qu’ils rendent possibles, les PME peuvent espérer trouver les moyens et les compétences techniques qui leur manquent, accroître leur capacité d’absorption de connaissances, c’est-à-dire leur « capacité à valoriser une nouvelle information externe, à l’assimiler et à l’appliquer dans des buts commerciaux » (Cohen et Levinthal, 1990) et améliorer ainsi leur propre capacité d’innovation.
|
Table des matières
PARTIE 1. LES PÔLES DE COMPETITIVITE : DE L’ÉMERGENCE À LA MISE EN DÉBATS
CHAPITRE 1. LES PÔLES DE COMPETITIVITE EN FRANCE EMERGENCE ET MISE EN OEUVRE
CHAPITRE 2. NATURE, REGULATION ET PERFORMANCE DES PÔLES DE COMPETITIVITE
PARTIE 2. METHODOLOGIE ET PRESENTATION DES TERRAINS
CHAPITRE 3. PERSPECTIVES EPISTEMOLOGIQUE ET METHODOLOGIQUE
CHAPITRE 4. LES CAS : PÔLES PASS ET MER
PARTIE 3. RESULTATS ET DISCUSSION
CHAPITRE 5. L’INSERTION DANS LES PÔLES A TRAVERS LES RESSOURCES RECHERCHEES
CHAPITRE 6. L’IMPORTANCE DES LIENS DANS LA CONSTRUCTION DES LOGIQUES D’INSERTION DES ACTEURS AU SEIN DES PÔLES DE
COMPETITIVITE
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Télécharger le rapport complet