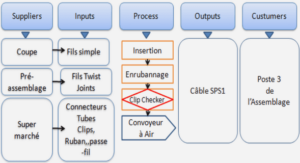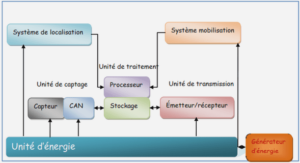Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’alimentation parmi les déterminants du cancer
La connexion entre nutrition et cancer a pris une dimension institutionnelle en 1982 avec la World Cancer Research Fund (WCRF) et l’American Institute for Cancer Research (AICR) au travers d’actions de recherches visant à identifier les facteurs de risque de la maladie. Ils ont permis la mise en place de programmes d’éducation centrés sur les styles de vie. Plusieurs organismes nationaux34 se sont penchés sur cette thématique Alimentation-Cancer avec pour objectif de promouvoir une alimentation susceptible de lutter contre la survenue de cancers dits évitables, c’est-à-dire en lien direct ou indirect avec les modes de vie des individus (Doll, Peto, 1981). Une expertise collective coordonnée par l’INCa et le réseau NACRe (Réseau national Alimentation Cancer Recherche), et étant basée sur le rapport publié en 2007 par la WCRF et l’AICR, actualisé en septembre 2015 (cf. Annexe 2), détermine la corrélation entre dix facteurs nutritionnels pertinents dans le contexte français et le risque de survenue d’un cancer (INCa, 2015). A des niveaux de preuves convaincants ou probables, cinq facteurs sont identifiés comme étant des facteurs de risque et cinq autres comme étant des facteurs protecteurs. Ainsi les boissons alcoolisées, le surpoids et l’obésité, les viandes rouges et les charcuteries, le sel les aliments salés et les compléments alimentaires à base de bêta-carotène à forte dose (notamment pour les fumeurs et les personnes exposées à l’amiante), sont identifiés comme étant des facteurs de risque. Alors que l’activité physique, les fruits et les légumes, les fibres alimentaires, les produits laitiers et l’allaitement sont désignés comme étant des facteurs protecteurs.
L’identification de ces dix facteurs nutritionnels vient confirmer les recommandations préventives de santé publique notamment définies dans le Plan-cancer 2014-2019 et repris au sens large dans le PNNS :
. diminuer la consommation des boissons alcoolisées ;
. privilégier une alimentation équilibrée et diversifiée ;
. pratiquer une activité physique régulière ;
. privilégier l’allaitement.
Ces recommandations rendent compte du processus de médicalisation de l’alimentation. Certains comportements alimentaires se retrouvent ainsi valorisés, alors que d’autres seront diabolisés et stigmatisés. Comme nous l’exposerons plus loin, les individus connaissent ces messages, mais un décalage encore trop important s’observe entre les connaissances et les pratiques alimentaires (Escalon et al., 2009a). Le dernier Baromètre Cancer publié en 2010 (Beck et Gautier, 2010) précise que 87 % des français interrogés établissent une relation directe entre les comportements alimentaires et la survenue d’un cancer. Cependant, les connaissances relatives sur l’influence des facteurs de risques ou des facteurs protecteurs restent encore floues (Ansellem et al., 2012). Près d’une personne sur cinq ne connaît pas l’influence de l’activité physique, de la consommation de fruits et légumes et de la surcharge pondérale, elles sont près d’une sur deux à ne pas connaître l’incidence de la consommation de charcuterie, de sel ou d’aliments salés et de viande rouge sur la survenue d’un cancer. De même près d’une femme sur deux ne connaît pas le caractère protecteur de l’allaitement sur le cancer sein. Il est important de noter ici que le sexe n’est pas un déterminant de la perception du rôle de l’alimentation sur l’incidence de cancer. Par contre, l’âge, les connaissances nutritionnelles, le niveau de diplôme et de revenu y sont directement corrélés. Ce rapport montre que les messages diffusés sur le cancer et l’alimentation manquent de clarté, et vient confirmer les conclusions du Baromètre Santé Nutrition de 2008 (Escalon et al., 2009b) relatives au cancer35. Cependant, même si les individus ne connaissent pas concrètement les relations « scientifiques » entre certains comportements et la survenue de certains cancers, ces recommandations restent fortement proches des recommandations largement diffusées par le PNNS prônant l’équilibre et la variété alimentaire.
Les mises à jour des rapports de santé publique montrent bien l’incidence des modes de vie, dont les pratiques alimentaires, dans la survenue des cancers. Ces informations fortement médiatisées marquent les questionnements relatifs aux risques engendrés par notre alimentation pour notre santé. Bien que l’alimentation soit seulement associée à l’incidence de 1,6 % des cancers en France, la pression des pouvoirs publics via les campagnes de préventions marque les représentations de la population et accentue la médiatisation de ce phénomène. Les dernières mises à jour du rapport de la WCRF et de l’AICR concernant l’impact de la consommation de viande et de charcuterie sur l’incidence des cancers colorectaux ont suscité, en France, de nombreuses retombées médiatiques au cours du mois d’octobre 2015, alors que ces données étaient connues depuis 200736 et avaient été actualisées en 2011 (cf. Annexe 2). Il en est de même pour l’obésité et le surpoids. Le rapport publié en 2007 montrait, à un niveau de preuve convaincant, que l’obésité et le surpoids étaient des facteurs de risques pour les cancers de l’œsophage, du pancréas, du colon-rectum, du sein post-ménopausal, de l’endomètre et du rein. Les mises à jour du rapport de 2015 confirment ces données37 et montrent seulement une nouvelle association, avec un niveau de preuve convaincant, pour les cancers de l’estomac. La consommation de viande rouge et de charcuterie, l’obésité et le surpoids sont donc, pour certains cancers, directement identifiés comme facteur de risque. Ces données, axées sur les seuls facteurs de risques nutritionnels de l’alimentation, semblent complètement délaisser les risques toxicologiques de notre alimentation sur notre santé.
Un autre problème : les perturbations sensorielles
Une littérature conséquente en sciences sensorielles rend compte des perturbations sensorielles engendrées par les chimiothérapies. Ces recherches montrent que les troubles du goût se perçoivent entre 46 à 75 % des malades interrogés, et 35 à 87 % présentent des troubles de l’odorat (Bernhardon et al., 2008). Ces perturbations sensorielles sont reliées d’une part aux facteurs médicaux comme la localisation et les caractéristiques de la tumeur, le stade du cancer, le type et la durée du traitement anticancéreux (Comeau et al., 2001 ; Doty et Bromley, 2004 ; INCa, 2006; Bernhardon et al., 2008 ; Bernhardon et al., 2009 ; Steinbach et al., 2010 ; Epstein et Barasch, 2010). Et d’autre part, elles sont mises en corrélation avec les caractéristiques sociales du malade telles que le sexe, l’âge, la profession, le niveau d’étude, la situation familiale, mais également le rapport à l’alcool et au tabac (INCa, 2006 ; Bernhardon et al., 2007 ; Bernhardon et al., 2008 ; Bernhardon et al., 2009 ; Steinbach et al., 2010). Les perturbations sensorielles sont directement mises en relation avec les aversions alimentaires développées par les malades au cours des traitements, pouvant générer des dégoûts. Ces aversions alimentaires chimio-induites sont de trois ordres. Elles peuvent tout d’abord relever d’effets gastro-intestinaux négatifs survenant après l’ingestion d’un aliment (Jocobsen, 1993). Les malades atteints de vomissements, nausées et/ou troubles digestifs sont plus sujets à développer des aversions alimentaires après le traitement anticancéreux. Elles sont ensuite mises en relation avec un conditionnement psychologique de l’ingestion décrit comme étant indépendant du cognitif et de la raison (Bernstein, 1991). Ici, les aliments consommés avant les traitements ou sur les lieux de traitements peuvent devenir une source d’aversion pour le malade. Enfin, les aversions alimentaires relèvent d’une perturbation même de l’identification et de la perception sensorielle (Gamper et al., 2012). L’ensemble de ces perturbations s’observent pendant les phases de traitement, mais sont également présentes en phase de rémission (Angellin et al., 2014). Les personnes atteintes d’un cancer bronchique sont fortement affectées par ces perturbations sensorielles (Belqaid et al., 2014 ; Belqaid et al., 2015). Une des principales raisons reste les chimiothérapies à base de sel de platine (Cisplatine et Carboplatine), principalement utilisées pour ce type de cancer. Les sels de platine font partie des cytotoxiques provoquant le plus de perturbations sensorielles (Comeau et al., 2001 ; Ravasco, 2005 ; Bernhardon et al., 2008 ; Rehwald M., 2009). Les perturbations sensorielles observées dans le cas des cancers bronchiques sont directement corrélées aux pertes d’appétit et à la diminution de la qualité de vie (Belqaid et al., 2014 ; Belqaid et al., 2015).
La prise en charge la perte de poids : entre recommandations et réalité
En touchant la plus grande majorité des malades cancéreux, et en étant directement associée à l’augmentation de risques de complications postopératoires et de toxicités de la chimiothérapie et de la radiothérapie, à la diminution de la survie et à l’altération de la qualité de vie des malades (Ravasco et al., 2004 ; Senesse et al., 2012), la lutte contre la perte de poids et la dénutrition est aujourd’hui le principal objectif de la prise en charge diététique des malades en cancérologie. Les recommandations nutritionnelles délivrées par le personnel soignant sont présentées comme un levier d’action visant à lutter contre cet état contraignant pour l’action thérapeutique et pour les malades eux-mêmes. L’arrivée des soins de support en cancérologie, avec le lancement du Plan-Cancer (2003-2007), a engendrée une nette évolution de la prise en charge diététique. Cependant, en raison des politiques organisationnelles et de financements des structures de soins, ces derniers restaient un des points faibles du premier Plan-Cancer (HCSP, 2009) et leur accès est encore aujourd’hui à améliorer (Rapport final du Plan-cancer 2009-2013, 2013 ; AFSOS, 2014 ; Cohen et al., 2015). Le Plan Cancer 2009-2013 revendiquait l’importance d’une prise en charge diététique pour les malades, qu’elles soient diagnostiques, préventives ou thérapeutiques (AFDN, 2006). En ce sens, la mesure 11.4 de l’axe Prévention-Dépistage propose d’ « Améliorer la connaissance sur le risque nutritionnel et la prise en charge diététique des personnes atteintes de cancer » (Plan Cancer 2009-2013). Ceci engendre une redéfinition du travail du diététicien basé sur les recommandations de bonnes pratiques de la consultation diététique (AFDN, 2006). Cependant, bien que les Plans Cancer revendiquent que les malades devraient lors de leur prise en charge médicale avoir accès aux consultations diététiques, aucune mesure concrète n’est proposée par les instances de santé publique. Plusieurs groupes de travail internes aux structures médicales ont élaboré des supports permettant d’évaluer l’état nutritionnel des malades, de proposer des recommandations alimentaires adaptées à la toxicité des traitements, d’évaluer la nécessité de prescription de CNO ou d’un recours aux modes d’alimentation artificielle. Hormis quelques études prônant l’impact positif d’une prise en charge diététique sur le statut nutritionnel, sur la diminution des toxicités des traitements (nausées, vomissements, etc.), et sur l’amélioration de la qualité de vie des malades (Meuric et Besnard, 2012), aucune évaluation concrète au niveau national de l’utilisation de ces outils et conseils dans la prise en charge des malades n’est faite à ce jour. Une forte avancée peut se constater au travers de la revue Nutrition clinique et métabolisme qui consacre son numéro de décembre 2012 à la « Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer » (Senesse et al., 2012). Ce numéro propose des recommandations de prise en charge de la dénutrition des malades depuis le dépistage jusqu’au stade palliatif avancé, en exposant les indications et les différentes formes de support nutritionnel de prise en charge. Cependant, le principal problème de l’accessibilité aux soins de support en cancérologie, dont la prise en charge diététique, réside dans le nombre, le statut et l’affectation non systématique des personnels spécialisés (Cohen et al., 2015). Selon les cas, ces personnels sont soit absents du service soit affectés sur plusieurs services simultanément. Concernant la prise en charge diététique, lorsque le diététicien est présent, son rôle est souvent réduit à l’évaluation rapide et souvent non adaptée de l’état nutritionnel des malades cancéreux (Spiro et al., 2006 ; Senesse et al., 2012). De plus, la prise en charge diététique ferait l’objet d’une légitimité variable auprès des personnels soignants en cancérologie. Pour certains, la prévention par l’alimentation n’est une préoccupation que si le tube digestif est directement atteint ; d’autres accordent une importance à la prescription de CNO et à l’information lorsque certains aliments ou types de consommation peuvent interférer avec le traitement administré ; pour d’autres encore, le rôle du diététicien est reconnu et un contact avec les malades sera systématique quelle que soit la pathologie cancéreuse ; enfin, quelques personnels peuvent guider les malades vers des recours moins ou non conventionnels. Dans ce contexte, les formes de la prise en charge diététique, quand celle-ci a lieu, sont extrêmement variables. Pour pallier l’ensemble de ces contraintes, de nouvelles structures telles que les Unités Transversales de Nutrition Clinique, ayant des missions de dépistage, de prise en charge des troubles nutritionnels des malades, de formations du personnel et d’activités de recherche en nutrition, se mettent progressivement en place.
La socialisation et la sociabilisation alimentaire
La surdétermination culturelle et sociale et l’espace de liberté de choix laissé au mangeur s’inscrit dans la double dimension de la socialisation alimentaire présentée par Corbeau (1997). « Manger peut se concevoir au sein de formes de sociabilité qui confèrent à l’aliment et aux rituels de son partage leurs dimensions culturelles et symboliques. Mais manger peut aussi recouper un autre comportement de l’acteur social qui cherche à fuir ponctuellement jusqu’à son identité en s’isolant, en refusant dans « l’ici et maintenant » de l’acte alimentaire toute forme de communication » (Corbeau et Poulain 2002 : 18). La distinction entre la « socialité » et la « sociabilité » prend alors tout son sens dans le fait alimentaire. La « socialité » inscrit le mangeur dans des formes de socialisation façonnées culturellement et marquées par des trajectoires plurielles rendant compte d’une certaine hiérarchie sociale agissant ainsi comme de véritables surdéterminismes. Elle représente et modèle le statut de l’individu au sein de la société. Corbeau la présente comme un tatouage, « un marqueur accepté, valorisé, sublimé, refoulé, caché ou renié mais dont on ne pourra jamais se défaire » (Corbeau, 1997 : 150). Le processus de socialisation alimentaire s’inscrit comme des formes d’apprentissages longuement étudiées en psychologie de l’enfance (Dupuy et Watiez, 2012). Inversement, la « sociabilité » place l’individu au centre d’un processus d’interaction. Il en choisi les formes de communication et d’échange avec les autres, marquant ainsi le poids de certaines influences sociales suivant des contextes particuliers. Le choix du mangeur pourra ainsi s’inscrire dans soit une volonté de reproduction sociale, c’est-à-dire comme étant le produit de la socialité, soit au contraire, une mise en place des stratégies d’adaptation pouvant aller jusqu’à la transgression de normes identifiées comme étant insatisfaisantes. L’évolution des choix et stratégies des mangeurs, vacillant entre acceptation et rejet, caractérisent des dynamiques créatives (Corbeau, 1997) façonnant ainsi de nouvelles formes de sociabilités. Pour mieux rendre compte de la pluralité des comportements des mangeurs, et afin de réellement caractériser le fait alimentaire en tant que tel, Corbeau (1997) utilise la notion d’ethos. L’ethos s’inscrit
l’articulation des déterminismes socioculturels et des dynamiques individuelles caractérisant « des formes centrifuges – les pulsions, les passions, l’imaginaire et l’invention résultant des interactions de l’ego – et des forces centripètes, civilité, normalisation des images corporelles, contraintes diététiques, économiques ou commerciales, socialité, etc. Cette forme correspond au « bricolage » de ces forces de natures différentes par le sujet qui donne ainsi sens à sa vie en inventant des trajectoires originales mais que le socio-analyste impliqué dans une démarche compréhensive peut rapprocher, comparer, superposer à d’autres pour que l’ethos, toujours significatif, se transforme en type représentatif » (Corbeau, 1997 : 151). Un mangeur ne saurait se résoudre à répondre à un seul type de pratique, mais bien à plusieurs. Les ethos de Corbeau (1997) sont donc plus à appréhender dans cette dynamique que comme des « étiquettes cristallisées ». Dans cette même perspective, où le mangeur est à la fois défini comme surdéterminé par des contraintes biologiques, psychologiques, sociales, culturelles et écologiques, et par un espace de liberté dans lequel il est un être de raison, Poulain (2001, 2003, 2012b) propose un outil pour l’étude des modèles alimentaires, directement déployé pour analyser la décision alimentaire des mangeurs.
L’espace social alimentaire
Le concept « d’espace social alimentaire » (Poulain 2001, 2003, 2012b) (cf. Annexe 5) s’est construit à partir des travaux de Condominas (1980) sur la notion d’ « espace social »49. Il permet de penser l’organisation alimentaire d’une société. L’alimentation humaine est régie par un jeu de double contraintes. Les premières sont des contraintes biologiques, et résultent du statut d’omnivore de l’espèce humaine. Elles imposent la nécessité de trouver dans le biotope les ressources énergétiques nécessaires pour assurer la croissance et le maintien en l’état de l’organisme. Les secondes sont des contraintes écologiques liées au milieu dans lequel vit la communauté humaine. Elles rendent compte des caractéristiques matérielles (climat, faune, flore, etc.) et des conditions d’exploitation des nourritures au sein des sociétés. Ces contraintes relatives au milieu ne se réduisent pas des questions de disponibilité, mais inclues également des dimensions économiques d’accessibilité. Toutefois, bien que s’imposant aux hommes ces contraintes se retrouvent façonnées par des processus sociaux et culturels caractérisant un espace de liberté dans lequel se forge des formes de socialités et d’identités sociales. L’alimentation est ainsi définie comme un fait social total (au sens maussien) relevant de dimensions pluridimensionnelles présentées sous formes de strates, de paliers (Gurvitch, 2007 [1958])50, interagissant entre eux. Sans reprendre entièrement les « paliers » décrit par Gurvitch, Poulain (2001, 2003, 2012b) propose de définir « l’espace social alimentaire » au travers de différentes dimensions.
Le registre du mangeable correspond à « l’ensemble des choix qu’opère, dans un milieu naturel, un groupe humain pour sélectionner, acquérir (au sens anthropologique, c’est-à-dire l’ensemble des actions qui vont de la cueillette à la production) ou conserver ses aliments » (Poulain, 2002 : 228). Il renvoie à la catégorisation dans un espace du comestible ou du non comestible des substances nutritives disponibles dans le biotope. Cette catégorisation marque les particularismes sociaux et culturels puisque, à biotope identique, elle peut différer d’une société à l’autre voire au sein des divers groupes sociaux d’une même société. L’espace du mangeable rend ainsi compte du processus de construction sociale de l’identité alimentaire, c’est-à-dire d’un ensemble de règles permettant à un produit disposant d’une charge nutritionnelle d’être inclus ou exclu des systèmes de classification lui donnant un sens, et étant propres à chaque culture. Ces systèmes façonnent les qualités symboliques des aliments en connectant le naturel au culturel. Ils permettent ainsi la définition de l’ordre du mangeable, des modalités de mise en œuvre du « meurtre alimentaire », et de celles relatives à la préparation et à la consommation des aliments.
Le système alimentaire d’une société renvoie à l’ensemble des interactions sociales construisant la décision alimentaire du mangeur. Lewin (1959) définit ce mécanisme de décision comme résultant non pas d’un choix individuel mais d’une série d’interactions sociales. Pour arriver jusqu’au mangeur, l’aliment doit traverser différents canaux renvoyant à ce que les économistes nomment de « filière ». La perspective sociologique élargit cette notion de filière en prenant en compte, en aval, le mangeur qui de l’acquisition jusqu’à la consommation finale va contribuer au transit du produit alimentaire. Une représentation « complète » de cette filière est notamment proposée par Corbeau (1997) au travers du concept de « filière du manger » où, outre l’ajout en aval du mangeur, l’auteur propose d’ajouter en amont de la filière l’ensemble des décideurs contribuant à orienter les cultures.
La cuisine correspond à « un langage dans lequel chaque société code des messages qui lui permettent de signifier au moins une partie de ce qu’elle est » (Levi-Strauss, 1968). L’espace du culinaire regroupe l’ensemble des actions techniques, opératoires, symboliques et rituelles, participant à la construction de l’identité alimentaire d’un produit d’ordre naturel, afin de le rendre consommable. Il est à la fois un espace au sens géographique du terme, c’est-à-dire au niveau de la distribution des lieux du culinaire comme la position de la cuisine dans un foyer ou dans un espace extérieur ; un espace au sens social, prenant en compte la répartition sexuelle et sociale des différentes tâches inscrites dans le culinaire ; puis un espace au sens logique du terme, relevant des relations formelles et structurelles du culinaire.
L’espace des habitudes de consommation désigne l’ensemble des pratiques et des rituels entourant l’acte alimentaire au sens strict. La définition structurelle et organisationnelle du repas ; la progression de la journée alimentaire structurée par le nombre de prise, les différentes formes, horaires et contextes sociaux du repas ; les modalités de consommation alimentaire définies par le rapport qu’entretient le mangeur avec la nourriture relatif notamment aux modes de consommation ; la localisation des prises, les règles de placements des mangeurs, etc.
La temporalité alimentaire renvoie aux différents cycles temporels socialement déterminés. Il s’agit tout d’abord des régimes et styles alimentaires adaptés à chacun des cycles de la vie (naissance, enfance, adolescence, âge adulte, vieillissement). Puis des temps cycliques contribuant au développement du biotope (rythme des saisons, des travaux dans les champs, les migrations des gibiers, les périodes d’abondance ou de pénurie, etc.). Enfin, le rythme journalier de prise alimentaire gravitant autour des moments d’activité ou d’inactivité.
L’espace des différenciations sociales marque les frontières identitaires entre les différentes cultures et les divers groupes sociaux présents dans une même culture. Il correspond aux modes de différenciations et distanciations sociales et géographiques agissant sur les particularismes des choix alimentaires.
La compréhension de l’observance nutritionnelle
Dès les années 1970, de nombreux chercheurs se sont intéressés aux comportements des malades face à la prescription médicale. Rapidement le concept d’observance57 s’impose pour décrire les comportements normatifs d’un malade suivant une prescription ou une recommandation médicale. Haynes la décrit comme étant « l’importance avec laquelle les comportements (en termes de médicaments, de suivi des régimes, ou de changements des habitudes de vie) d’un individu coïncident avec les conseils médicaux ou de santé » (Haynes, 1979 : 2). Inversement, le comportement d’un individu est qualifié de non-observant, voire de déviant, lorsqu’il ne respecte pas l’autorité médicale. Les sciences humaines et sociales, dont les études portent principalement sur la consommation médicamenteuse (Ankri et al., 1995), se sont attachées à porter un regard critique sur cette relation médico-centrée façonnant les interactions entre les médecins et les malades (Sarradon-Eck, 2007). Bien qu’un manque d’observance des discours nutritionnels de santé publique soit identifié en France (Escalon et al., 2009b), la thématique de l’observance nutritionnelle reste aujourd’hui peu étudiée. Certains auteurs se sont cependant intéressés aux déterminants de la non-observance nutritionnelle afin de rendre compte des difficultés des changements de comportements alimentaires au vu d’améliorer l’état de santé. En ce sens, des déterminants culturels et de différenciations sociales ont été mis en relation avec les comportements des individus. Dans leur enquête réalisée auprès de six pays occidentaux58, Fischler et Masson (2008) identifient des différenciations culturelles marquant chez le mangeur français un engouement plus prononcé pour les dimensions hédoniques, gustatives et de convivialité de l’acte alimentaire au détriment des caractéristiques nutritionnelles et de santé, alors plus recherchées chez les mangeurs américains. Fournier (2011, 2012a, 2014) présente ces mêmes conclusions concernant les mangeurs souffrant d’hypercholestérolémie dans un contexte français. De même, une surdétermination sociale du rapport à l’alimentation et à la santé semble se dégager. D’une manière générale, les études portant sur les différences genrées en matières de choix alimentaires accordent aux femmes un alimentation composée principalement de fruits, de légumes, de céréales et de produits céréaliers, de lait et de produits laitiers (Wardle et al., 2004 ; Sobal, 2005 ; de Saint Pol, 2008 ; Arganini et al., 2012) ; et aux hommes un goût plus affirmé pour les viandes rouges, la charcuterie (Poulain, 1998 ; Sobal, 2005 ; de Saint Pol, 2008 ; Rozin & al, 2012), d’aliments hautement énergétiques, d’alcool et de boissons sucrées (Beardsworth et al., 2002 ; Sobal, 2005 ; Arganini et al., 2012). Gough B. (2007) n’hésite pas à qualifier les femmes d’« experts » et les hommes de « naïfs et vulnérables » concernant la relation faite entre l’alimentation et la santé. De même, les niveaux d’éducation et de revenu restent des facteurs déterminants de l’état de santé puisqu’ils influencent l’accès à l’information et surtout la capacité de l’individu à interpréter cette information et à agir en fonction (Inserm, 2014). Les personnes ayant un statut socio-économique faible ont un risque plus élevé de développer des maladies chroniques en lien avec les modes de vie, du fait d’une plus grande exposition aux facteurs de risques tels que le tabagisme, l’alcoolisme, l’inactivité physique et l’alimentation déséquilibrée (Shankar et al., 2010). En bref, l’attention portée à la relation entre l’alimentation et la santé est socialement déterminée. Outre ces aspects de différenciation sociale de l’acte alimentaire, l’approche interactionniste a étudié l’acte alimentaire dans sa dimension plurielle en insistant sur l’interaction présente entre à la fois des facteurs individuels, des déterminants sociaux et un cadre contextuel. Cette conception dynamique de la décision alimentaire a notamment été illustrée par Corbeau (1997) au travers du « triangle du manger » (cf. Annexe 6). L’interaction entre un mangeur, un aliment et une situation, tout trois socialement identifiés, évoluant tant dans le temps que dans l’espace59, permet de concevoir les adaptations et actualisations des expériences sociales et des contextes d’interaction dans lesquels le mangeur évolue. En ce sens, Corbeau parle de « mangeur pluriel ». S’intéresser à l’observance nutritionnelle des individus semble indissociable à cette approche. En effet, « le suivi des conseils nutritionnels semble dépendre non seulement du contexte social dans lequel le mangeur se situe à un instant « t », mais aussi de l’étape de vie à laquelle le régime lui est prescrit » (Fournier, 2012b : 958). Ainsi les interactions sociales façonnant la décision alimentaire du mangeur doivent impérativement être prises en compte dans l’étude des comportements alimentaires soumis à une prescription ou à une recommandation médicale. Ceci passe par l’intégration du contexte familial et social dans lequel se dessine une distribution de rôles sociaux amenant le mangeur, sous le poids de certaines influences sociales, à observer ou non le régime auquel il est soumis. Ainsi, les contextes sociaux de consommation alimentaire sont identifiés comme des déterminants de la non-observance nutritionnelle (Fournier, 2011, 2012a, 2014).
De plus, s’intéresser à l’observance nutritionnelle renvoie à la conception que l’individu a se sentir acteur de sa santé. Ceci nous renvoie aux travaux en psychologie de la santé portant sur la notion de « Lieu de contrôle relatif à la santé » (Nuissier, 1994)60, consistant identifier les croyances que l’individu a sur la gestion de sa propre santé. Trois types de lieux de contrôle sont identifiés : 1) le lieu de contrôle interne par lequel l’individu se perçoit comme étant un acteur de santé ; 2) le lieu de contrôle externe de type personnage puissant où la gestion de la santé est déléguée à un élément extérieur à l’individu et ayant une forte influence (par exemple l’autorité médicale) ; et 3) le lieu de contrôle externe de type chance ou fatalité par lequel l’individu ne se conçoit pas comme un acteur de sa propre santé, et s’en remet au destin, à la fatalité. Le processus de médicalisation de l’alimentation, s’inscrivant aujourd’hui dans une forme de discours de santé publique axée sur « l’éducation pour la santé », tendrait à internaliser le lieu de contrôle des individus afin qu’ils soient en mesure de modifier leurs comportements au vu d’être acteur de leur santé (Fournier, 2011). En effet, comme le précisent Consoli et Bruckert : « Les individus possédant un lieu de contrôle interne perçoivent plus volontiers que les individus ayant un lieu de contrôle externe une situation stressante comme contrôlable, évaluent mieux leurs capacités à l’affronter et mobilisent plus efficacement leurs ressources personnelles » (Consoli et Bruckert, 2004 : 332). Or, comme nous venons de le montrer, la décision alimentaire n’est pas l’œuvre du seul choix individuel, mais se construit dans une interaction constante avec l’environnement dans lequel évolue le mangeur. En mettant l’accent sur les effets de la commensalité sur la décision alimentaire dans un contexte d’hypercholestérolémie, Fournier (2011) montre qu’un lieu de contrôle externe déléguant la décision à l’entourage social peut être efficace pour l’observance des prescriptions nutritionnelles et de ce fait être un marqueur de la régulation des maladies chroniques alimentaires. L’auteur précise : « tenter d’internaliser le lieu de contrôle (par des conseils alimentaires diffusés de manière individuelle) d’un individu ayant aucune prise sur son alimentation est inefficace voire contre-productif. L’internalisation du lieu de contrôle est donc une stratégie intéressante mais faisant fi des processus sociaux particulièrement prégnants dans les domaines de l’alimentation et de la santé » (Fournier, 2011 : 434-435). Le positionnement du mangeur à l’égard de cette décision d’observance ou de non-observance du régime auquel il est soumis nous amène à ainsi interroger les concepts gravitant autour du concept de la « rationalité alimentaire ».
Un soutien informel : l’aide des proches et des associations de malades
Comme le précise Hubert (2006), la proximité est un terme fortement ambigu qui varie selon une dimension spatiale79. Les personnes peuvent être géographiquement éloignées mais liées d’un point de vue affectif, intellectuel voire même philosophique. Et inversement, elles peuvent être rapprochées spatialement mais éloignées au niveau affectif et intellectuel. La pathologie redessine les liens entre les individus, et d’autant plus dans le contexte actuel français où les pouvoirs publics favorisent les soins et le maintien au domicile des personnes malades mais également des personnes âgées (Adam, Herzlich, 2007 [1994]). La dégradation de l’autonomie de la personne malade, ou vieillissante, nécessite une aide matérielle, informationnelle et psychologique dans la vie quotidienne, apportée notamment par la famille (Risk, 2006 ; Stillmunkés et al., 2015). La charte européenne de l’aidant familial le définit comme étant « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes : nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques, etc. » (Coface Handicap, 2009 : 2). Dans leur article « Mobiliser et soutenir les proches tout au long de la maladie », Dauchy et al. (2006) posent deux questionnements : 1) « Comment repérer les ressources disponibles et favoriser leur mobilisation ? », 2) « Jusqu’où mobiliser les proches ? ». Ces deux questions mettent en évidence la place des proches au cours d’une pathologie. Dès lors que le malade est maintenu à son domicile, le personnel soignant, mais également le malade, seront en attente d’un investissement de la part des proches. Ceci vennant marquer la définition sociale et juridique de leur rôle (Hubert, 2006 ; Mermilliod, Mouquet, 2008). Il convient, de ce fait, de prendre en compte les ressources disponibles pour le malade, que lui seul peut désigner (Stenberg et al., 2010). Ces ressources sont à distinguer de la personne de confiance dont le rôle est de prendre une décision concernant le malade lorsque celui-ci n’est plus en mesure de le faire80.
L’aide apportée par les proches diffère selon leur proximité géographique et le temps qu’ils passent auprès de l’individu malade (Stenberg et al., 2010). Les connaissances et expériences, qu’elles soient personnelles ou professionnelles, que les proches entretiennent avec la pathologie sont également à prendre en compte. Defossez (2014a) identifie trois types de proches : 1) les proches travaillant dans le milieu de la santé en relation directe ou indirecte avec la pathologie concernée ; 2) les proches « initiés » qui de part leur expérience ou leur comportement actif en matière de recherche d’information de santé ont des connaissances particulières sur la pathologie ; 3) les pairs correspondant aux malades présents dans les mêmes structures de soins. Concernant la pathologie cancéreuse, l’aide apportée par les proches dans les actes de la vie quotidienne concerne principalement les courses, la préparation des repas, le ménage, le linge, les transports (Risk, 2006 ; Lorcy, 2014 ; Ben Diane et Peretti-Watel, 2014). Les proches peuvent également être sollicités financièrement pour subvenir aux besoins quotidiens des malades se retrouvant dans une certaine détresse financière due à leur arrêt d’activité professionnelle (Dilhuydy et al., 2006 ; Stenberg et al., 2010 ; Altmeyer et al., 2014). Les proches sont une ressource considérable dans la recherche d’information (Dauchy et al., 2006 ; Risk, 2006 ; Ben Diane et Peretti-Watel, 2014). Ils pourront être amenés à sélectionner et à reléguer l’information recherchée au malade, mais aurons également un rôle dans la retranscription et la reformulation de l’information transmise par le personnel soignant.
|
Table des matières
PARTIE 1 : L’alimentation : de nouveaux enjeux pour la cancérologie
Chapitre 1 – Les places de l’alimentation en cancérologie
Chapitre 2- Les dimensions sociales de l’alimentation
Chapitre 3 – L’expérience de la maladie chronique : donner du sens à son cancer
Chapitre 4 – Pour une socio-anthropologie des mangeurs atteints de cancer
Conclusion de la Partie 1 : Penser la réorganisation alimentaire des mangeurs-malades
PARTIE 2 : La méthodologie de la recherche
Chapitre 5 – Les critères d’inclusion
Chapitre 6 – Les méthodes d’observations
Chapitre 7 – Description de l’échantillon de la Phase 2 : Enquête quantitative (P2)
Conclusion de la Partie 2 : Etudier un processus alimentaire
PARTIE 3 : La réorganisation du rapport à l’alimentation des mangeurs-malades
Chapitre 8 – Les conceptions profanes des cancers bronchiques
Chapitre 9 – Le réseau informationnel des mangeurs-malades
Chapitre 10 – L’organisation de l’alimentation des mangeurs-malades
Conclusion de la Partie 3 : L’alimentation comme un élément du processus thérapeutique
Conclusion Générale
Bibliographie
Télécharger le rapport complet