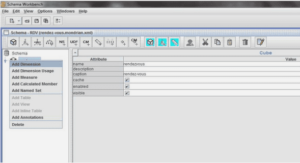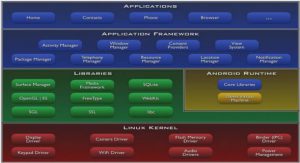Les outils d’apprentissage à la recherche dans un catalogue en ligne
Le rôle de formation d’une bibliothèque scolaire selon diverses normes
Pour connaître le rôle de formation qu’elles devraient jouer, les bibliothèques scolaires peuvent se reposer sur diverses normes édictées par des organismes associatifs de leur domaine. Nous nous sommes donc basée sur les quatre normes les plus importantes selon nous dans le monde des bibliothèques scolaires : la troisième édition des Normes pour bibliothèques scolaires de la SAB/CLP (2014b), le Manifeste UNESCO/IFLA de la bibliothèque scolaire (1999), les Normes IFLA/UNESCO pour les bibliothèques scolaires (2004) et le premier volume de l’Euroréférentiel I&D de l’European Council of Information Associations (ECIA 2004). Dans ces quatre documents, il a été constaté que le métier de bibliothécaire a rapidement évolué ces dernières années suite à l’arrivée des nouvelles technologies et à l’augmentation considérable du volume d’information. La formation fait donc partie intégrante des métiers de l’information actuels.
Selon le Manifeste de l’UNESCO/IFLA : « La bibliothèque scolaire est une composante essentielle de toute stratégie à long terme d’alphabétisation, d’éducation, d’information et de développement économique, social et culturel. » (1999). De ce fait, les Normes de la SAB/CLP, les Normes de l’IFLA/UNESCO et le Manifeste de l’UNESCO/IFLA, sont tous trois d’accord sur le fait que la bibliothèque scolaire fournit aux élèves les outils pour pouvoir vivre et évoluer dans la société d’aujourd’hui. Pour parvenir à cela, les SID doivent donc transmettre des compétences et des savoirs. Chacun de ces textes émet une idée précise et complémentaire concernant les notions et les publics visés par ces points. De fait, les Normes de la SAB/CLP mettent en avant que les bibliothécaires scolaires : « sont des professionnels de l’information, connaissent le monde des médias (électroniques), savent les utiliser et par conséquent aussi apprendre aux autres à s’en servir. » (2014, p.27).
Pour sa part, le Manifeste UNESCO/IFLA dit que ces professionnels doivent « former enseignants et élèves aux différentes techniques de traitement de l’information » (1999). Les Normes IFLA/UNESCO, quant à elles, considèrent même comme un devoir des bibliothécaires de former à la recherche documentaire et aux outils de l’information ainsi que d’assister les usagers dans l’usage « des ressources de la bibliothèque et des technologies de l’information » (2004, p.11). De son côté, l’Euroréférentiel I&D de l’ECIA cite, dans le deuxième niveau de la compétence Formation et actions pédagogiques, la capacité d’« assurer un tutorat ou transférer des avoirs ou savoir-faire aux utilisateurs et collègues avec des supports existants. » (2004, p.82). Ce sont donc là des descriptions variées sur les diverses fonctions pédagogiques que doivent assumer les bibliothécaires. Certaines normes, en plus de désigner les rôles de formation que devraient remplir les bibliothèques scolaires, donnent des précisions sur la façon dont devraient être faites ces formations. En effet, les Normes de la SAB/CLP proposent un tableau de progression spiralée des apprentissages en bibliothèque tout au long de la scolarité (2014b, p.33) (Annexe 1).
Nous retrouvons donc les trois objectifs de formation de ce travail dans quatre modules différents, enseignés à divers degrés de scolarité, tous situés dans le primaire. Le premier module concerne la « [l]ecture, exploration et orientation dans la bibliothèque » (2014b, p.33) et le cinquième reprend le « [s]ystème de classement de la bibliothèque, […] » (2014b, p.33). Ces deux enseignements font donc écho à notre objectif d’orientation en bibliothèque. Le troisième module concerne la « [t]ypologie des documents et leur désignation » (2014b, p.33) et pour finir le sixième et dernier module du degré primaire, concerne la « [r]echerche I : stratégie de recherche, catalogue en ligne » (2014b, p.33). Pour que ce modèle de formation fonctionne, la SAB/CLP précise qu’il faut que chaque classe vienne à la bibliothèque au moins deux fois par an pendant deux périodes de cours chacune (2014b). De plus, elle précise que pour que cette offre soit favorable aux élèves, il faut qu’une collaboration constructive soit présente entre les enseignants et les bibliothécaires (2014b). L’importance de cette collaboration est également de l’avis des Normes IFLA/UNESCO, qui sont cependant moins précises que celles de la SAB/CLP concernant la durée et les modules de formation. Néanmoins, elles mettent en avant que les « connaissances et les ressources doivent être introduites progressivement au fur et à mesure des étapes et des niveaux. » (2004, p.15). Ces normes enjoignent à viser l’autonomie de l’élève. Il doit donc acquérir « les capacités de situer et de collecter l’information, afin d’aborder la recherche d’information en bibliothèque de manière indépendante. » (2004, p.17). En conclusion, ces divers écrits nous donnent une image plus ou moins précise de ce qu’un bibliothécaire scolaire se devrait d’enseigner à ses usagers selon eux.
Les principes d’apprentissage de la recherche documentaire aux enfants Pour mettre en place une formation à la recherche documentaire, il existe divers concepts et éléments que le bibliothécaire peut prendre en compte en plus des normes citées précédemment. D’une part, Sandra Marcus et Sheila Beck (2003) citent le modèle théorique introduit en 1981 par James Rice. Celui-ci « a divisé les programmes d’éducation en bibliothèque en trois niveaux : l’orientation en bibliothèque, l’instruction en bibliothèque et l’instruction bibliographique » (notre traduction, p.25). Le premier, donne aux étudiants une vue du lieu physique bibliothèque, ainsi que de ses employés. Le deuxième niveau présente davantage d’informations sur les documents de la bibliothèque et pour finir le dernier degré offre « le plus haut niveau d’entrainement aux capacités de recherches » (notre traduction, p.26). Concernant notre formation, le premier niveau s’applique déjà à la BJ avec les visites et c’est surtout le second niveau que nous aimerions développer.
D’autre part, une connaissance théorique sur laquelle les bibliothécaires peuvent s’appuyer pour imaginer l’importance de leur service dans un dispositif d’apprentissage est le triangle didactique. Ce dernier montre la relation qui relie le savoir, l’enseignant et l’apprenant. Frédérique Marcillet, qui en fait une mise en abîme dans son livre (2000, p.25) (Annexe 2), nous révèle que le CDI3 se trouve sur chaque lien entre ces trois entités. De ce fait, il se positionne au centre de cette triade et rassemble en son coeur les documents, qui contiennent les outils qui réunissent les informations. Cela nous montre que c’est par le CDI que doivent passer les enseignants et les élèves pour espérer maîtriser ces trois objets. Puis, pour Ngoungoulou, il faut prendre en compte que toute instruction doit remplir deux buts essentiels : « Le but premier de l’apprentissage documentaire doit, […], permettre aux élèves de développer des aptitudes à la recherche et au traitement de l’information ; Les élèves doivent apprendre non seulement à utiliser leur CDI mais surtout à acquérir une culture en information et documentation. Le deuxième objectif est d’aider les élèves. Dans ce sens, le CDI doit jouer un rôle très important d’aide et de conseil, en allant au-delà d’un simple « mode d’emploi » de son utilisation. ». (2012, pp. 122-123)
Les pratiques dans quelques pays Malgré tous les concepts évoqués précédemment, comment la formation à la recherche documentaire se passe-t-elle et est-elle considérée dans plusieurs pays du monde ? Au Québec, la bibliothèque joue un rôle pédagogique important qui remonte au moins jusqu’aux années 1960 (Léveillé 1998c). Yves Léveillé (1994) nous apprend que c’est au début de ces années-là que le Service des bibliothèques scolaires du Département de l’Instruction publique a proposé des cours d’été aux enseignants des niveaux élémentaires et secondaires pour leur apprendre l’organisation et l’utilisation d’un SID. C’est aussi dans cette période qu’Alvine Bélisie, directrice du Service des bibliothèques scolaires, publie plusieurs articles concernant, entre autres, le rôle d’une bibliothèque dans une école (Léveillé 1994). Selon Yves Léveillé, la recherche et le traitement de l’information visent à ce que les élèves obtiennent une méthode de travail efficace, deviennent autonomes dans leurs apprentissages et soient familiers d’une démarche de résolution de problème (Léveillé 1998a).
La recherche documentaire s’inclut donc dans une perspective plus large du travail et du développement des compétences dans ce domaine. Elle n’est donc pas cantonnée qu’aux seules bibliothèques. C’est dans ce même pays, en 2010, que Martine Mottet (Mottet, Gagné 2015) a développé un projet de formation à la recherche documentaire. Le but de ce programme était de former les enseignants du primaire aux compétences informationnelles pour qu’ils puissent ensuite former leurs propres élèves. En 2012, elle a lancé la seconde phase de ce projet qui s’adresse cette fois aux enseignants du premier cycle du secondaire en classe de français. Pour développer leurs outils, elle et ses collègues se sont basés sur le modèle Big6 de Michael Eisenberg, cité précédemment, et sur le site Infoshpère5. Par la suite, le matériel créé a été testé en 2012 dans quatre classes afin de l’améliorer. Le site Faire une recherche, ça s’apprend !6 (Mottet 2017) propose ainsi plusieurs ressources pour enseigner la recherche documentaire aux enfants.
|
Table des matières
Déclaration
Remerciements
Résumé
1. Introduction
2. Présentation de la bibliothèque jeunesse de Peseux
2.1 Contexte
2.2 Etat des lieux de la formation aux usagers
2.3 Besoins en formation des usagers
3. Etat de l’art sur la formation à la recherche documentaire en bibliothèque scolaire
3.1 Méthodologie
3.2 Le rôle de formation d’une bibliothèque scolaire selon diverses normes
3.3 Les principes d’apprentissage de la recherche documentaire aux enfants
3.4 Les pratiques dans quelques pays
3.5 Les pratiques en Suisse romande
3.5.1 Les bibliothèques et la recherche d’information dans le Plan d’études romand.
3.5.2 Les pratiques de quelques bibliothèques scolaires
4. Etat de l’art sur les outils utilisés pour la formation à la recherche documentaire en bibliothèque scolaire
4.1 Méthodologie
4.2 Les outils d’orientation et de différenciation des documents
4.3 Les outils d’apprentissage à la recherche dans un catalogue en ligne
5. Deux outils créés pour la bibliothèque de Peseux
5.1 Le premier outil : localisation dans la bibliothèque et différenciation des documents
5.1.1 Le choix de l’outil
5.1.2 Méthodologie
5.1.3 Les exercices créés
5.1.3.1 La chasse aux livres
5.1.3.2 Le questionnaire
5.1.3.3 La discussion autour des types de documents
5.2 Le second outil : recherches de base dans le catalogue en ligne NetBiblio
5.2.1 Le choix de l’outil
5.2.2 Méthodologie
5.2.3 Les exercices créés
5.2.3.1 La vidéo
5.2.3.2 L’aide-mémoire et le lexique
6. Test des deux outils créés
6.1 Méthodologie
6.2 Les modalités du test
6.3 La sélection des élèves
6.3.1 Le questionnaire
6.3.2 L’exploitation des résultats
6.3.3 Le choix des dix enfants
6.4 Le déroulement du test
6.4.1 Pour le premier outil
6.4.2 Pour le second outil
6.4.3 Observations générales
7. Entretiens avec les élèves après le test des outils
7.1 Le choix de la méthode d’entretien
7.2 Méthodologie
7.3 La mise en place du guide d’entretien
7.4 Remarques sur la méthode de l’entretien
8. Analyse des résultats des entretiens
8.1 Méthodologie
8.2 L’attitude de l’élève
8.3 L’attitude de la formatrice
8.4 Le niveau des outils
8.5 Le temps accordé
8.6 La forme du premier outil
8.6.1 La chasse aux livres
8.6.2 Le questionnaire
8.6.3 La discussion autour des types de documents
8.6.4 Le travail en équipe et une autre forme d’exercice
8.7 La forme du second outil
8.7.1 Le tutoriel et les questions
8.7.2 L’aide-mémoire et le lexique
8.7.3 Le travail en équipe et une autre forme d’exercice
8.8 Le sentiment dans la bibliothèque après l’utilisation du premier outil
8.9 Le sentiment face au catalogue après l’utilisation du second outil
8.10 Le sentiment général face à la bibliothèque après l’utilisation des deux outils.
8.11 Remarques concernant les résultats des entretiens
9. Propositions de modification des outils créés
9.1 Pour le premier outil
9.2 Pour le second outil
10. Recommandations pour une future formation à la recherche documentaire à la BJ de Peseux
11. Conclusion
Bibliographie
Références citées
Références consultées
Références utilisées pour la création des supports pédagogiques
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet