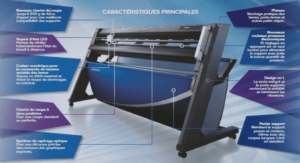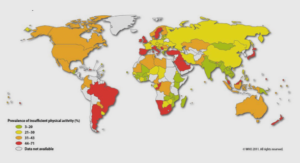Le travail comme preuve de l’assujettissement
C’est Veblen qui est le premier à mettre des mots précis sur ces divers phénomènes sociaux et pour la plupart assimilés inconsciemment. Pour lui « dans la mentalité rapace, travailler, c’est être faible et assujetti à un maître ; c’est donc une marque d’infériorité ; par conséquent, on tient le travail pour indigne d’un homme accompli ». L’homme est presque « réduit au travail » comme on dit être « réduit en esclavage », c’est une situation sociale qui apparaît comme déshonorable voire disqualifiante dans l’espace social. Un nœud problématique social crucial apparaît alors puisque si le travail, permet de tirer l’usure fruit de son travail par la conversion financière, il est aussi pour d’autre le témoignage de la médiocrité sociale, puisqu’il apparait comme le moyen de survie. Or, la survie est tout ce qui est de l’ordre de l’humain dans son acception animale ; l’animal survit alors que l’homme doit vivre, ce qui sous entend tirer produit de sa vie, de son passage sur terre. Ainsi, en toile de fond se trame un rejet pour tout ce qui ramènerait l’homme à sa condition d’homme dans son animalité. De ce fait il est intéressant de s’arrêter sur les considérations de Veblen affirmant que l’exigence qui s’impose aux hommes et qui a le plus de portée est « la nécessité de s’abstenir de tout travail productif ». La présence sur Terre, autrement dit la vie, doit être dans l’opposition à la vie animale. Les notions instinctives de survie, de reproduction ou toutes autres appartenant au domaine de l’animalité sont purement méprisées et rejetées. Le travail dans sa dimension d’activité permettant de subvenir à ses besoins mais aussi de production utile pour le collectif, est purement et simplement rejeté. En soi le travail est vecteur de notion de besoin, un besoin appartenant aux nécessités primaires partagées avec les espèces animales. Un homme digne doit alors exprimer une consommation, donc une attitude, « improductive du temps, qui 1° tient à un sentiment de l’indignité du travail productif ; 2° témoigne de la possibilité pécuniaire de s’offrir une vie d’oisiveté ».
Réduction de la femme à l’inaptitude totale
Cette réduction en mineure imposée à la femme la met dans une position où elle est assujettie à l’homme et apparaît comme un être ou même peut-être une « chose » comme le dit Veblen, donc sans défense, sans force et déchargée de toute capacité de réalisation de taches productives. Elle est inapte à toute activité et n’a comme prérogative de ne se tenir qu’à son rôle d’ornement. Pour Veblen, la toilette est l’exemple le plus parlant pour donner à voir « les détails qui certifient l’exemption du travail vulgairement productif ou l’incapacité de s’y livrer ». Mais selon lui l’enjeu va au-delà puisque certains des vêtements féminins vont jusqu’à signifier le fait d’ôter à la femme « de la vitalité [de la] rendre en permanence et de tout évidence inapte au travail ». Pour que la femme reste à cette place qu’on lui a assigné, il faut qu’elle soit totalement inapte et dépendante. Son rôle ne se résumerait qu’à de la figuration de ce que l’homme souhaite, non pas montrer d’elle, mais plutôt montrer de lui. Cette inaptitude est garante de la docilité de la femme envers les prérogatives et les interdictions qui lui sont imposées. A la lumière de l’analyse sémiologique que nous avons réalisée sur le film publicitaire de la Maison Chanel en 2004 pour son parfum N°5 avec Nicole Kidman, nous avons pu capter à un moment précis la libéralisation du corps de l’actrice. En effet, elle brandit fièrement la robe dans laquelle elle se trouvait et qui symbolisait l’entrave faite à ce corps – ce vêtement par ses dimensions ne correspondait absolument pas au besoin de liberté de mouvement dont elle avait besoin66. On perçoit alors que cette femme admirée, désirée, valorisée, tente de fuir cette vie dans laquelle elle étouffe. Dans sa fuite, elle se perd et manque de se faire renverser. Son vêtement entrave sa fuite et est en soi un danger pour elle. Ce film met en exergue une femme entravée et oppressée qui doit symboliquement s’affranchir de cette entrave faite à son corps et à sa vie.
La femme construite dans l’exact contraire de l’homme fort et dominateur
Pour Le Breton « la gestualité humaine est un fait de société et de culture, et non une nature congénitale ou biologique destinée à s’imposer aux acteurs » ; ainsi donc si le rôle des corps est sexuellement différent c’est qu’il s’agit bien d’un fait collectif à l’échelle sociale. Goffman dans ses travaux Les Rites d’interaction, donne à voir la mise en scène de la différence sexuelle telle qu’elle est présentée dans les publicités. Le Breton commente les travaux de Goffman et conclut : « Ainsi la femme est-elle souvent dans la position subalterne ou assistée, tandis que l’homme, de taille plus élevée, la veille dans une attitude protectrice qui embrasse aussi bien la sphère professionnelle, familiale ou amoureuse »79. Comme évoqué précédemment la femme est protégée par l’homme, elle est dans une position attentiste mais aussi d’admiration : « Entre les mains de l’homme, la femme peut être rituellement docile et amoureuse : l’homme nourrit la femme qui tend avidement la bouche vers l’aliment, elle est son enfant capricieuse ou son jouet ». On perçoit donc la totale opposition entre les deux personnages dont un se retrouve presqu’avec un enfant « sur les bras ». Totalement dans un lien de dépendance comparable à un lien infantile, la femme n’est pas sujet mais devient l’objet de l’homme sur lequel il a le droit de vie ou de mort. Cette opposition est ancrée dans les mentalités et se retrouve ainsi scellée dans les publicités qui nous sont contemporaines et que Goffman met en lumière. Pour lui se dresse l’un en face de l’autre « ‘éternel féminin’ et un homme ’protecteur et viril ’ ». La domination est confirmée, la femme est à l’embouchure de se renier elle-même tant elle est subordonnée à l’homme. La délicatesse dont elle fait preuve envers l’homme témoignée dans ces publicités nous donne à voir l’aboutissement d’un rituel de docilité intégré par la femme elle-même alors au service de l’homme. Notre analyse du film publicitaire de la Maison Chanel avec Nicole Kidman évoqué précedemment, nous donne à voir une libéralisation du corps certes, mais nous ne pouvons néanmoins pas nier l’intervention du symbolique masculin. En effet, Nicole Kidman brandit sa robe dont elle s’est affranchie mais porte en échange ce que son complice de fuite lui a donné, c’est-à-dire une tailleur masculin, certes retroussé et féminisé, mais il n’en reste pas moins un vêtement d’homme. A la lumière de cet exemple, on peut dire que la définition de la femme, sa féminité ne se confond pas avec les codes masculins qui lui sont étrangers. Elle est presque recueillie dans cette scène, l’homme la protège et l’emporte loin du tumulte de la ville. On a donc pu percevoir que le corps de la femme n’est pas exempt de multiples représentations sociales et culturelles. Comme l’affirme Mauss « Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l’homme » et à Le Breton d’ajouter « Modelé selon l’habitus culturel, il produit des efficacités pratiques ». Si la théorie de Veblen nous a permis d’appréhender les notions de propriété et de loisir s’enchevêtrant l’une dans l’autre au moyen de la femme, elle nous a notamment permis de percevoir le rôle attribué à la femme de représentante « officielle » de la réussite de l’homme en tant que trophée. Entre docilité et fragilité la femme est réduite en mineure en contrepartie de quoi elle obtient la protection masculine dont elle aurait supposément besoin dans un environnement qui pourrait lui être hostile mais contre lequel elle ne pourrait pas se défendre. Par ailleurs, le corps de la femme étant réduit à l’état de figuration inapte à toute activité décisionnaire ou physique, elle serait un lieu d’investissement vivant pertinent pour un prestige social porté par la notion de loisir. Ainsi le corps de la femme serait symbole d’improductivité, véritable privilège dans nos sociétés ultra-productivistes. C’est ce que nous allons éprouver dans notre seconde partie sous un angle différent. Si les femmes, on a pu le percevoir, affaiblies voire désarmées socialement par les hommes pouvaient être utilisées comme faire-valoir, elles ont pris un nouveau visage dans nos sociétés contemporaines de consommation de masse. En effet, le marketing notamment, et c’est ce qui nous intéresse ici, des marques de luxe, met en place un véritable jeu de rôle où les égéries et mannequins qu’elles choisissent sont dans une problématique également fondée sur ce paradoxe car pour la plupart les mannequins sont des personnalités de grande notoriété. Par grande notoriété on comprend la dimension marketing de « grand populaire » et la notion sociale de « populaire ».
L’Oscar ennoblissant
Nous avons décidé de nous intéresser à l’actrice Marion Cotillard. Actrice française de rôles remarqués mais sans notoriété internationale, Marion Cotillard est surtout connue pour des seconds rôles et des films français. En 2008 elle décroche entre autres un Oscar pour son rôle dans le film La Môme dans lequel elle incarne la chanteuse française Edith Piaf. Elle connaît alors une notoriété internationale puisque reconnue aux Etats-Unis et devient aussi une véritable célébrité nationale en France. De la modeste actrice de second rôle, elle apparaît alors aux yeux des spectateurs comme une nouvelle figure du cinéma français. Comparée à Simone Signoret, autre actrice française à avoir décroché un oscar, la carrière de Marion Cotillard connaît alors une croissance de notoriété exponentielle. C’est à ce moment que sa carrière prend un tournant de « star » du cinéma. La marque de luxe Dior voit alors en Marion Cotillard l’incarnation la plus authentique de la méritocratie. Par son Oscar, l’actrice accède à un monde particulièrement privé et privilégié. L’obtention de l’Oscar fait figure d’ennoblissement de l’actrice. C’est toute cette symbolique que la marque de luxe tache de se réapproprier. Par son talent exceptionnel et rare, Marion Cotillard s’est elle-même offert cette ascension qui s’avère avoir une symbolique particulièrement sociale ; ce n’est pas un privilège acquis de naissance. C’est ici que réside toute la force symbolique de cette association puisque l’actrice vient, par son histoire personnelle entre autres, confirmer l’identité d’un certain luxe qui serait alors tout à fait conforme aux exigences démocratiques. Dans les analyses que nous avons faites de deux campagnes de la marque avec l’actrice on perçoit deux points d’ancrage : la contemplation de l’actrice dans le miroir qui tache de se reconnaître dans sa robe rouge « de princesse » et l’ascension de celle-ci qui gravit les étages de la Tour Eiffel. Si l’identité de l’actrice est en recomposition – elle nécessite un temps d’adaptation pour se ressaisir et percevoir sa nouvelle identité (sociale) – elle est en parfaite adéquation avec la redéfinition de l’identité de la marque de luxe elle aussi. Les deux entités symboliques se contemplent pour appréhender le nouveau paradigme qui structure leur identité. Ces deux mutations identitaires sont présentées comme particulièrement positives et honorables car le succès de l’actrice et son ennoblissement répondent en tout point aux aspirations démocratiques de nos sociétés – son talent rare et travaillé mérite la reconnaissance – mais également la démarche de redéfinition de la marque de luxe donne à voir une tentative réussie de légitimation d’un luxe par essence anti-démocratique mais qui, grâce à une valeur chère aux sociétés contemporaines, la méritocratie, a su réaliser l’exploit de s’afficher comme potentiellement accessible, en théorie. On constate donc que l’Oscar est au cœur de ce rapprochement entre la marque et l’actrice, car au-delà de la très grande notoriété qu’il a pu offrir à l’actrice, lui attribuant alors le « graal » de la notoriété internationale et la popularité, il a bouleversé son identité par une véritable ascension sociale alors symboliquement réapproprié par la marque de luxe. Pour Dior il s’agit de jongler avec plusieurs valeurs symboliques qu’incarne l’actrice. Sa « sucess story » à l’américaine ou finalement son American Dream, donne à voir une mutation sociale basée sur les critères de la méritocratie (ici son talent de comédienne), puis son accès à une grande notoriété internationale finit de sceller à la fois la combinaison marketing parfaite pour la marque et à la fois son paradoxe : les personnages ultra mass-médiatisés et donc populaires portent le message de l’ultra privilège adouci par la clause d’accessibilité démocratique.
Kate Moss, le mythe de la transgression à l’anglaise
Si la « supermodel » des années 90 est l’incarnation de la beauté depuis des décennies, entre élégance et beauté largement appréciées, elle a néanmoins connu, au tournant de ses 40 ans, un passage à vide. Plongée dans un scandale de drogue, la mannequin perd un grand nombre de contrats avec de grandes maisons. Sa vie personnelle, racontée par la presse people, est présentée comme trash et ses fréquentations sont décriées. Icone de l’Angleterre rock voire punk avec son compagnon de l’époque Pete Doherty, elle donne à voir une petite fille, non pas de l’Amérique mais de l’Angleterre en train de traverser une période noire de sa vie personnelle. Un parallèle peut être fait avec le personnage de Britney Spears et ses frasques. Kate Moss incarne alors la « quadra » en crise existentielle mais, le déferlement médiatique défavorable à la mannequin va avoir pour effet de susciter de la compassion et de l’empathie de la part des publics. C’est avec son contrat avec Longchamp que Kate Moss reprend alors sa carrière en route et commence sa « rémission ». Elle apparaît alors comme vulnérable et profondément courageuse suscitant ainsi l’adhésion collective. Le mythe de la résurrection est en marche et Kate Moss retrouve ses lettres de noblesse à tel point qu’elle va parvenir quelques années après à être choisie comme égérie de la marque anglaise emblématique, Burberry. Elle devient alors un monument de la culture anglaise, avec son art de vivre parfois trash parfois romantique. Elle est alors une femme particulièrement désirable pour les marques de luxe car elle incarne un certain romantisme destructeur qui sublime l’art de vivre à l’anglaise et la mannequin elle-même, qui a fait preuve de courage pour surmonter des problèmes personnels et survivre à la fin de sa carrière de mannequin qui n’a finalement pas eu lieu. La majorité des mannequins doivent se reconvertir à la veille de leurs trente ans mais Kate Moss fait partie des rares top modèles à poursuivre son activité. Elle partage l’affiche avec la jeune top anglaise Cara Delevingue pour la marque Burberry et apparaît alors davantage comme une légende de la mode. A ce mythe appliqué à la mannequin s’ajoute le romantisme de la transgression et du danger. En effet, si Kate Moss apparaît comme une survivante de sa propre crise personnelle et une survivante de la fin programmée de sa carrière, elle n’en hérite pas moins de l’image d’une femme fragile et inconsciente. Elle est un joyau à protéger et par ce procédé elle apparaît quelques peu infantilisée, comme disposant de la jeunesse éternelle. Elle incarne quelque chose d’enchanteur, de magique et flirte avec l’enchantement des (anti)princesses des contes. Comme l’affirme Florence Muller de l’IFM, être Parisienne n’est pas un droit du sol ni du sang mais une combinaison de mentalité de femmes profondément libres et de femmes qui se rencontrent dans une forme « d’intelligence dans les sciences de la mode ». On voit donc que la marque Yves Saint Laurent a choisi cette égérie non sans penser aux échos à l’international que ce personnage pouvait leur offrir. Libre, transgressive et si désirable, Kate Moss donne à la marque une réponse à son ADN originel via son créateur à la fois marginal et hors norme. Si la top est d’origine anglaise et porte avec elle toute la symbolique de l’anglaise trash et inconsciente, elle parvient, par un procédé de connexion avec la valeur d’élégance innée partagée avec les codes de la Parisienne bourgeoise, à incarner la Parisienne polymorphe : la bourgeoise, le bohème et la créative. Pour Florence Muller, la Parisienne n’est pas uniforme et se meut sans cesse dans plusieurs identités incarnées par de nombreuses femmes toutes plus différentes les unes que les autres mais qui se rencontrent dans l’amour de la ville, Paris, et l’amour de la mode avec ce sens presqu’inné de l’élégance « à la Parisienne ».
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LE CORPS FEMININ, ENTRE CORPS SYMBOLE D’IMPRODUCTIVITE HERITE DU PASSE ET LUXE DANS NOS SOCIETES DE SURPRODUCTIVITE
1. Le luxe de l’improductivité
1.a) Le travail comme preuve d’assujettissement
1.b) Le paradoxe de prouver sa richesse par le confort et l’aisance sans jamais produire soimême
1.c) La vie de loisir, une vie ennoblissante
2. La femme, lieu d’investissement de prestige social et déchargée de toute production matérielle
2.a) Le droit de propriété : la femme premier bien acquis
2.b) Réduction de la femme à l’inaptitude totale
2.c) La femme comme support de réussite sociale de l’homme
3. Les imaginaires autour de la fragilité du corps féminin justifiant la vie oisive
3.a) Le corps de la femme, incarnation de sa soumission
3.b) La femme construite dans l’exact contraire de l’homme fort et dominateur
SECONDE PARTIE : DES EGERIES DE PLUS EN PLUS CONNUES ET MASS MEDIATISEES SONT CHARGEES D’INCARNER LE ROLE ET L’IDEAL DE LA FEMME BOURGEOISE DANS LES CAMPAGNES PUBLICITAIRES PRESSE
1. Le cas de Marion Cotillard : de la Môme à Dior, entre « populaire » et élite
1.a) L’Oscar ennoblissant
1.b) L’incarnation « BoBo », la bourgeoise-bohème parisienne
1.c) La figure rebelle ou la mise en scène de l’ « Artketing » personnifié
2. Une mise en scène du personnage de la Parisienne d’Yves Saint Laurent
2.a) Kate Moss, le mythe de la transgression à l’anglaise
2.b) La connexion entre rock et glamour
3. Le mythe de l’ascension sociale et son storytelling par l’industrie du luxe
3.a) L’ascension sociale racontée comme un conte de fée
3.b) La Cosette des temps modernes, largement internationalise
3.c) Quand la notion de populaire sert à l’épanouissement de l’élitisme
TROISIEME PARTIE : DES CORPS FEMININS RENDUS PLUS « ANDROGYNES » AFIN D’ESTOMPER LEUR FONCTION MATERNELLE ET DE LES RAPPROCHER D’UN MODELE DE CORPS MASCULIN
1. L’obsession de la minceur comme forme de contrôle et symbole de pouvoir
1.a) Le culte de la minceur, un culte narcissique
1.b) La porosité entre « social » et corporéité : la survivance des notions de contrôle et de domination
1.c) L’obsession inquiète de l’excellence et le défi de la grâce
2. L’exemple des corps de mannequins : quand le masculin sert de repère
2.a) La culture masculine de la performance
2.b) Le corps, lieu de reconquête de l’identité
2.c) Etre sans enfant, promesse d’une presque égalité avec l’homme
2.d) Des stylistes qui aiment les hommes et qui habillent les femmes
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet