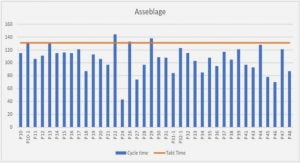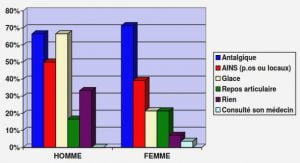Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les institutions : évolution de la traductologie et de la loi
La traductologie
La traductologie est la discipline (voire interdiscipline) académique qui s’intéresse à la traduction, sa description, sa théorie, et son application. Bien que la traduction en elle-même existe depuis aussi longtemps que les relations interculturelles, et que les premiers textes théoriques touchant à la manière de traduire remontent à l’Antiquité (avec Cicéron, par exemple), ce n’est que dans la deuxième moitié du XXe siècle qu’une véritable prétention à devenir une discipline académique s’est fait ressentir. Avant cela, directement après la Seconde Guerre mondiale, le besoin de traducteurs se fait sentir en France, puisque d’importantes discussions diplomatiques entre l’Europe et les États-Unis se déroulent sur le territoire. C’est de ce besoin que naissent dans les universités françaises des départements de traduction. En 1947, l’École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC), se dote d’un département de ce type, et est rejoint dix ans plus tard par l’université de Paris qui crée l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT), rattachée maintenant à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. À cette époque, cependant, il n’est nulle part question de théories de la traduction, ou même de traductologie, rien de cela n’existant à ce moment-là. Le but était de pallier le manque de traducteurs et d’interprètes français après-guerre, et les cursus étaient donc professionnalisants. Ce n’est qu’en 1964, de l’autre côté de l’océan Atlantique, que le chercheur états-unien Eugene Nida publie son ouvrage Toward a science of translation (Brill, 1964) ; il s’agit de la première monographie à envisager la traduction sous un angle scientifique. En d’autres termes, Eugene Nida appelle ici, pour la première fois de l’histoire, à théoriser les principes qui régissent la traduction et les traducteurs. Brian Harris répond à cet appel en 1972 en proposant, pour la première fois, d’appeler cette science en devenir la translatology. À cette même époque, en France, Jean-René Ladmiral propose le terme de traductologie pour désigner la même idée17. Mais c’est James Holmes, qui couche sur papier dans un article en 1972 (bien qu’il n’ait été publié qu’en 1988), pour la première fois, le terme de translation studies qui deviendra le terme consacré dans le monde anglo-saxon, aux dépens de la formule de Harris. Il faut dire que l’article de Holmes, The Name and Nature of Translation Studies, en plus de proposer un nom pour la discipline, présente également son champ d’action .
Cependant, avant d’arriver à s’imposer comme discipline académique à part entière, la traductologie a dû faire face à des tentatives de récupération provenant de plusieurs disciplines déjà établies des langues, et des sciences humaines et sociales. À la fin des années 1950, par exemple, ce qui deviendrait la traductologie est considérée comme une branche de la linguistique. J-P. Vinay et J. Darbelnet, linguistes, proposent d’étudier la traduction par le prisme de la linguistique, puisque cette pratique touche principalement à la langue, selon eux. Plus précisément, ils décident d’envisager la traduction par une approche en stylistique comparée. Dans les années 1960, on s’intéresse à l’aspect théorique de la chose, plus qu’à son aspect pratique comme avant. C’est l’approche favorisée par Georges Mounin dans son ouvrage Les Belles Infidèles (Cahiers du Sud, 1955). Parallèlement, se développe une autre approche opposée basée, elle, sur la linguistique appliquée, la logique derrière ce choix étant que la traduction est avant tout produite, et qu’une approche théorique ne peut pas lui rendre justice. À la même période, aux États-Unis, une approche sociolinguistique de la traduction voit le jour. L’objectif, ici, est de considérer la traduction, ainsi que le traducteur, comme des éléments d’un tout, soumis aux règles sociales et culturelles régissant la vie en société. Suivent encore l’approche herméneutique de Friedrich Schleiermacher et George Steiner, qui se base sur la compréhension et l’interprétation du matériau à traduire, l’approche idéologique, qui revendique que toute traduction est politique, et de fait, biaisée, même lorsqu’elle prétend le contraire, l’approche sémiotique, qui s’intéresse aux systèmes de signification, ou encore, plus récemment, les approches cognitives, qui tentent de découvrir grâce à des outils de neurologie comment fonctionne le cerveau lors du processus de traduction. Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, et d’autres façons d’envisager la traduction ont existé, et existent toujours. On en trouve un certain nombre dans le manuel Introduction à la traductologie : penser la traduction hier, aujourd’hui, demain de Mathieu Guidère (2016). J’ai cependant fait le choix de cette liste car elle permet la création d’une frise chronologique indiquant quelle discipline académique avait la faveur des chercheurs, de l’après-guerre à nos jours, de la linguistique, aux sciences cognitives.
L’inconvénient, si l’on peut dire, de ces approches, est qu’elles ne pensent la traduction et la traductologie que par le prisme d’autres disciplines ; la traduction et la traductologie étant alors, au mieux, des branches de ces disciplines déjà établies (c’est ce que l’on voit par exemple à la fin des années 1950 avec Darbelnet et Vinay, qui ne voient la traduction que comme une extension de la linguistique). En réaction à ces tentatives d’appropriation de la discipline en devenir par d’autres chaires, les traducteurs et traductologues ne furent pas longs à revendiquer la traductologie en tant que discipline à part entière ; discipline naissante et ayant de fait besoin d’un cadrage théorique, certes, mais discipline tout de même, non assujettie à la linguistique, l’herméneutique, la sémiotique, ou n’importe quel autre champ de recherche. Pour autant, il est important de noter que dans le cas de la traductologie, la pratique a précédé la théorie. Ainsi, ce sont les traducteurs de métier sortis de HEC et de l’ESIT qui ont entamé, quelques années après, une réflexion sur la traduction : « La reconnaissance de la traduction comme discipline scientifique autonome suit d ́assez près la reconnaissance publique du métier du traducteur (avec pourtant une trentaine d ́années de retard), puisque la fondation des chaires universitaires de formation des traducteurs a favorisé la recherche universitaire sur la théorie de la traduction de différentes orientations […]. L ́autonomisation de la traductologie dans la deuxième moitié du vingtième siècle est sanctionnée entre autres par la rédaction des livres consacrés à l ́histoire de la traduction, ce qui confère une légitimité plus grande à l’existence de la traductologie en tant que discipline scientifique. »19
Également, juste avant et après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux prix récompensant les traductions et les traducteurs voient le jour. Zuzana Raková écrit ainsi, s’inspirant de l’oeuvre Histoire de la traduction en Occident, de Henri van Hoof (1991) : « À partir de 1937, la France crée le Prix Halpérine-Kaminsky en hommage du traducteur russe et médiateur important des rapports culturels franco-russes. […]. En 1945 le Prix Denyse Clairouin est créé, pour remémorer une traductrice morte en déportation pendant la guerre ; le prix récompense la meilleure traduction de l’anglais en français […]. En 1956, La Société des Poètes français fonde le Prix Marthe Fiu-mi-Leroux réservé aux traductions de poésie contemporaine de l ́italien en français ou vice-versa. »20
De même, la Société Française des Traducteurs (SFT) voit le jour en 1947. Elle est depuis toujours en activité et est un syndicat professionnel représentant les intérêts des traducteurs. Tous ces éléments démontrent bien que la traduction se pense de prime abord dans la pratique, et que la théorie lui est postérieure.
Ce sont donc logiquement des formations professionnalisantes de l’ESIT que naissent les premières théories de la traduction, séparées en cela des approches antérieures qu’elles s’intéressent d’abord et avant tout à la traduction et, plus tard, à la traductologie, en tant que discipline à part entière. Pourtant, il apparaît très rapidement que la traductologie ne peut tout de même pas s’envisager en vase clos, mais au lieu de repartir vers le système précédent analysant seulement la traductologie en tant que branche d’une autre discipline, le choix est fait, au contraire, de considérer la traductologie comme une discipline à part entière, mais tirant bon nombre de ses réflexions des autres champs de recherche. Par exemple, il est évident que, la traduction touchant au langage, les recherches linguistiques peuvent être bénéfiques à la traductologie. De même, la sociologie, puisque la traduction est faite par des hommes vivant en société, et devant tenir compte des règles de ladite société dans leurs traductions, peut servir à appréhender la traductologie d’une certaine façon. La différence par rapport au système des « approches », donc, est que, cette fois, la traductologie reste au centre de la réflexion. Ainsi, la base solide d’une discipline de la traductologie, alimentée par des recherches extérieures, devient une interdiscipline. De cette interdiscipline, donc, naissent les fameuses théories de traduction, laissant toujours au centre de leur réflexion la traduction (pratique et théorie), ou le traducteur.
Si nous passons tant de temps, ici, à développer l’histoire de la traductologie, c’est parce que nous allons pouvoir relier ces événements et ces théories à la traduction audiovisuelle qui nous intéresse particulièrement. Il faut pourtant noter qu’aucune des théories de la traduction que je vais maintenant présenter ne sont propres à la pratique de la traduction audiovisuelle. Au contraire, elles semblent même, dans leur majorité, avoir pour intérêt la traduction, plus classique, des écrits. Pourtant, je pense instructif de mettre en place autant de parallèles que possible entre ces théories « scriptocentrées » et la traduction audiovisuelle. D’une part parce que cela peut nous permettre d’engager un processus de réflexivité sur la façon de traduire au cinéma, par rapport à ce que les précédents traducteurs ont pu faire dans leur domaine, et d’autre part, parce que cela peut permettre au traducteur audiovisuel lui-même d’envisager de nouveau sa place dans la société, comme ont pu le faire les traducteurs des formes écrites et, à terme, si le besoin s’en fait sentir, imaginer des théories de la traduction propre au milieu de l’audiovisuel. Notons, en aparté, que comme pour la partie précédente sur les approches, les explications sur les théories de la traduction proviennent du manuel Introduction à la traductologie : penser la traduction hier, aujourd’hui, demain de Mathieu Guidère.
La première théorie de la traduction, donc, a été pensée par Danica Seleskovitch et Marianne Lederer, alors qu’elles enseignaient à l’ESIT, à Paris. Cette théorie appelée « théorie interprétative » est d’ailleurs parfois présentée en tant qu’« École de Paris ». Elle est aussi toujours très prégnante dans la francophonie (sans doute parce qu’il s’agit de la théorie « nationale »). La théorie interprétative repose sur la question du sens qui est alors entendu comme « non-verbal ». L’idée est que le sens est autant porté dans ce que le locuteur dit, que dans ce qu’il ne dit pas, le « dit », et le « non-dit ». Ainsi, la traduction, dans cette théorie, est basée sur le langage plus que sur la langue seule. Seleskovitch était interprète de formation, il est donc logique que sa théorie touche à des sujets si importants dans le cadre de l’oral, où la posture et l’intonation du locuteur jouent autant que ce qu’il dit. L’École de Paris a dévolu un intérêt particulier au processus mental de la traduction : ainsi, puisque l’on part du prédicat que le sens est non-verbal, cela signifie que la traduction n’est pas un processus binaire, d’un mot vers un autre, dans un mouvement mécanique, mais un mouvement en trois étapes qui part de la compréhension que l’on a de l’idée émise par le locuteur, que l’on déverbalise ensuite afin de garder l’idée sans risquer de se bloquer dans une équivalence mot pour mot, pour finalement la réexprimer dans la langue cible. Ce processus de déverbalisation peut être rapproché de ce qui est étudié dans le cadre d’une approche cognitive, par exemple, mais aussi dans le cadre d’une approche sociolinguistique, puisque les trois actions composant le processus dynamique sont, de fait, régies par la connaissance des règles de la société du locuteur original, et de celle de la cible de la traduction. La différence, encore une fois, est que la théorie, contrairement à ces approches, laisse la traduction au centre de sa réflexion. Cette théorie s’inscrit dans une tradition cibliste : l’intégralité du processus dit de déverbalisation a pour but d’accommoder le message original à la culture et aux connaissances du destinataire. Si l’on tente d’adapter cette théorie à la traduction audiovisuelle, ou cinématographique pour être précis, l’on se rend très vite compte de sa pertinence : comme un discours nécessitant qu’on l’interprète, le cinéma est autant dans le dit que dans le non-dit. Une ligne de dialogue jouée par un acteur est aussi importante que la référence culturelle ou linguistique qu’elle laisse voir en creux, que ce qu’elle laisse non-dit. Seule une connaissance aiguë de la culture source peut permettre à un traducteur et, le cas échéant, à un doubleur de faire passer ce sous-entendu dans une forme qui soit compréhensible par le public. Lorsque l’on rajoute en plus du discours énoncé et du discours « en creux », le jeu d’acteur, autant porteur de sens que les dialogues, alors l’on comprend qu’un traducteur/adaptateur incapable d’empathie avec les personnages du film ne pourrait faire le travail de déverbalisation tel que pensé par Seleskovitch dans sa théorie interprétative, et couperait ainsi le public d’un pan sémantique entier de l’oeuvre cinématographique.
À la fin des années 1970, apparaît en Allemagne une autre théorie de la traduction : la théorie du skopos. Elle est conceptualisée, d’abord, par Hans Vermeer. Alors que jusqu’ici l’accent était mis sur la relation entre le texte source et le texte cible, il propose d’envisager de laisser de côté le texte source pour plutôt réfléchir à la relation entre le texte cible, appelé translatum, et la cible visée par ce texte traduit, le public à qui l’oeuvre est destinée, appelé le skopos. Cette théorie est considérée comme une théorie fonctionnelle, puisque la traduction se fait en fonction du skopos. Le traducteur n’est alors plus que le professionnel répondant à la demande d’un commanditaire. La théorie de Vermeer est par ce point lié à la théorie de l’action qui, elle, met l’accent uniquement sur la cible, et qui considère la traduction comme un outil d’interaction entre des experts et des clients, dans un cadre professionnel. On comprend donc que la théorie de l’action n’envisage pas l’aspect littéraire de la traduction/traductologie, et se contente de la traduction de textes pragmatiques, ou autrement dit, techniques : son scope est le monde des affaires. Avec la théorie du skopos, en revanche, même si les textes pragmatiques sont favorisés par son aspect fonctionnel, il est possible d’envisager d’autres types de traductions car le fameux skopos est variable. Katharina Reiss, dans les années 1980, apporte sa pierre à l’édifice de la théorie du skopos en proposant d’établir une méthodologie plus stricte pour déterminer comment traduire ou adapter un texte en fonction de son type (informatif, expressif, opérationnel) et de sa visée. Jusque-là, Vermeer ne préconisait rien de spécial pour ses traductions, à part la fameuse adaptation au skopos, mais l’on comprend aisément qu’il paraît compliqué de traduire de la même façon, dans le cadre d’un même skopos, un article scientifique, et un roman. Reiss, en offrant son idée de la typologie des textes, permet d’affiner la proposition de traduction appliquée de la théorie de Vermeer, au coût d’un très léger retour vers le texte source. Ainsi, l’on pourrait imaginer qu’un texte de type expressif tel l’Odyssée d’Homère soit traduit d’une façon très proche du texte original, en vers, en laissant beaucoup de marques du grec ancien, pour un public averti, rompu à la culture et à la langue de la Grèce Antique, mais aussi traduit en prose, avec un vocabulaire beaucoup plus basique, voire enfantin, pour une édition jeunesse de l’oeuvre. Le skopos change, la traduction aussi. D’une façon assez paradoxale, la théorie de Vermeer, qui est une théorie profondément cibliste puisqu’elle s’intéresse principalement au public, peut se retrouver à traduire une oeuvre de façon sourcière si le skopos, le public, le demande. Le cinéma, et surtout les blockbusters, quant à eux, suivent déjà une logique proche de la théorie du skopos : les traductions adaptent bien souvent les dialogues à la culture cible en gommant l’étrangéité, car le but avoué est de faire une traduction la plus universellement acceptable par tous les pans d’une société donnée. C’est d’ailleurs cette recherche du plus petit dénominateur commun dans le doublage qui pousse les élites culturelles, plus souvent intéressées par la vision de l’auteur ou l’altérité de la culture étrangère, à abandonner ledit doublage, voire même le sous-titrage, pour une immersion la plus totale possible dans la culture étrangère. Un voeu pieux serait dès lors d’imaginer dans le cinéma de multiples traductions de la même oeuvre, chacune s’adressant à un skopos différent, et offrant ainsi un degré différent d’immersion dans la culture, afin de s’ajuster non plus au plus petit dénominateur commun, mais à chaque préférence, ou presque. Puisque la théorie est déjà appliquée dans le monde de la littérature, pourquoi alors s’y refuser dans celui de l’audiovisuel ? Il y a fort à parier, hélas, que de telles propositions ne soient pas entendables à l’heure actuelle puisque, comme nous l’avons vu, l’art cinématographique ne semble évoluer qu’avec les réductions de coûts. Or, des « versions multiples intra-linguales » représenteraient des dépenses supplémentaires conséquentes. Peut-être pouvons-nous avancer que de telles considérations seraient plus faciles à mettre en place dans le sous-titrage que dans le doublage, grâce aux contraintes logistiques moindres impliquées par la méthode ? D’ailleurs, à vrai dire, tel système existe déjà dans le sous-titrage. Si l’on reprend l’exemple des fansubbers sous-titrant les dessins animés japonais, l’on se rend très vite compte que leur traduction n’a pas grand-chose à voir avec leur pendant présenté par des entreprises de traduction professionnelle à la télévision : le public cible des fansubbers est les passionnés, l’on se rend compte que leurs traductions sont bien plus axées sur l’étrangéité et la culture japonaise que les traductions de la télévision, qui ont tendance à gommer ces différences culturelles pour leur public moins au fait des spécificités culturelles nippones. Dans ce cas de figure, on voit que la théorie du skopos dans l’audiovisuel existe déjà, et que les différentes traductions ont chacune leur public. Pour les producteurs et distributeurs, la traduction multiple serait peut-être une piste à envisager.
• Les politiques linguistiques
Le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Avec trois cents millions de locuteurs répartis dans le monde entier, elle se place derrière le chinois, l’anglais, l’espagnol, et l’arabe23, et si elle est parlée par 4% de la population mondiale en 2019, au vu de la croissance démographique africaine, ses locuteurs représenteront alors 8% de la population mondiale, d’ici 2050. Malgré ce statut linguistique en apparence confortable, la France est malgré tout vulnérable aux « assauts » de la langue anglaise sur son propre territoire, cette dernière, représentante du soft power états-unien, est perçue comme un outil permettant d’asseoir l’hégémonie nord-américaine partout dans le monde. Pour prévenir tel résultat, la France s’est parée de lois favorisant l’emploi de la langue française sur son territoire dans le plus de domaines possibles, de la publicité aux contrats professionnels, des notices de mode d’emploi aux arts.
Si l’on se penche uniquement sur les lois touchant à la traduction audiovisuelle, on peut par exemple retrouver ce fameux décret ministériel publié en 1932, qui imposait aux versions doublées de l’être par des acteurs français, enregistrés sur le sol français. Ce décret fut transformé en 1947 en une loi obligeant, en plus de la mesure du décret, les films étrangers à être doublés avant de pouvoir être diffusés en France ; cette même loi fut remplacée en 1961, après la création de la Communauté Économique Européenne (CEE), par une autre précisant que le doublage pouvait maintenant être réalisé dans n’importe quel pays de la CEE. Depuis, presque plus rien : le Québec s’est simplement rajouté à la liste des exceptions pouvant doubler pour le marché français. La loi régissant le doublage n’a pas changé et, l’on comprend bien au vu de son évolution que, alors qu’elle assurait du travail aux traducteurs et adaptateurs français jusqu’en 1961, elle n’a fait que fragiliser leur situation après cela, en ouvrant la concurrence à deux pôles de la francophonie disposant d’une économie leur permettant d’envisager de prendre en charge les coûts du doublage : la Belgique et le Québec. Les revendications et grèves (dix-huit jours de grève des traducteurs en 1977) des corps de métier n’y changèrent rien.
Si l’on s’éloigne des lois propres au cinéma traduit pour se tourner vers celles, plus générales, axées sur la préservation du français, il devient alors possible de faire progresser cette frise des politiques linguistiques encore un peu plus loin dans le temps : en 1975, la loi Bas-Lauriol rend l’usage du français obligatoire dans l’affichage public, et interdit de plus l’utilisation de tout terme ou expression étrangère. On voit très bien ici la volonté de l’État de défendre la langue française. En 1992, après la ratification du traité de Maastricht, la France ajoute dans sa constitution, à l’article 2, la ligne « la langue de la République est le français » et, en 1994, en prenant appui sur cet article, la loi Toubon est promulguée, remplaçant au passage la loi Bas-Lauriol précédente. La loi Toubon indique que ses objectifs sont l’enrichissement de la langue, l’obligation d’utiliser la langue française, et la défense du français en tant que langue de la République. Pour ce faire, elle reconnaît le droit au citoyen, pour les textes légaux, de « recevoir toute information utile en français » ; cela signifie en fait que toute loi française, ou de l’Union Européenne, devra être disponible en langue française. Le même droit est reconnu au salarié pour tout ce qui touche au contrat de travail, ainsi qu’au consommateur pour ce qui concerne la présentation des produits, les modes d’emploi, et les garanties. Le français, ici, est bien protégé des « méfaits » de la mondialisation. Enfin, si l’on regarde les lois régissant la diffusion d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à la télévision, l’on apprend qu’à l’heure actuelle, les chaînes de télévision doivent intégrer à leur programmation 60% d’oeuvres européennes, dont 40% obligatoirement françaises, et ce, pour les oeuvres audiovisuelles ainsi que pour les oeuvres cinématographiques. De plus, toutes les chaînes en France doivent consacrer 3.2% de leur chiffre d’affaires à la production cinématographique. La volonté de préserver la langue française est bel et bien présente, de toute évidence.
Pourtant, alors que la traduction est l’acte le plus protecteur de la langue qui soit, puisqu’il consiste en un escamotage de la langue étrangère « envahissante » (surtout dans le cas de l’anglais) au profit de la « langue de la République », le traducteur semble se retrouver bien seul. Alors que l’on est obligé de forcer les publicitaires et les chaînes télévisées, entre autres, à préserver la langue par différents artifices (qui peuvent même s’avérer nocifs, à l’inverse, pour la diversité culturelle, comme le démontre un article de Philippe Mouron24), le traducteur audiovisuel, qui, il me semble, travaille activement à la préservation de la langue française, et ce sans qu’on ne le lui impose, n’en est pas mieux considéré. Pire encore : à quelques exceptions près de doubleurs connus, le traducteur est tout à fait inconnu du public. Et comment pourrait-il en être autrement ? Alors que l’Académie Française décerne chaque année presque soixante prix différents dans les champs du cinéma, de la littérature, de l’Histoire, de la philosophie, de la poésie, et du théâtre, seulement un prix est adressé aux traducteurs (prix Jules Janin). Qui plus est, lorsque l’on regarde les domaines d’exercice des lauréats, l’on se rend très vite compte que seules les traductions des grands classiques de la littérature sont représentées. De la même façon, l’Académie Française remet également chaque année le Grand Prix de la francophonie à une personne participant au rayonnement du français dans le monde. Il faut attendre 2011 pour voir arriver enfin le premier traducteur lauréat de ce prix, avant que deux autres ne suivent en 2013 et 2016. Pour autant, la traduction n’est le domaine principal d’activité pour aucune de ces trois personnes, ils ne traduisent pas vers le français, mais à partir du français, et n’ont de toute façon pas remporté le prix pour leur qualité de traducteur, mais pour l’ensemble de leur action pour la francophonie. Alors donc que les traducteurs français travaillent à préserver le français de l’intérieur, leurs efforts ne sont jamais reconnus. Le résultat est le même lorsque l’on navigue sur le site du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) : alors qu’une soixantaine d’aides diverses (bourses, conseils, etc) existent afin d’aider au financement de films, et qu’une quarantaine profitent aux oeuvres audiovisuelles, aucune n’est dévolue aux traductions. Toutes ces aides sont accessibles à condition de faire un film dont la langue soit le français, mais pour les traducteurs qui, justement, rendent accessibles des oeuvres grâce à la langue française, rien n’est prévu. Ce manque de considération n’est pas très étonnant d’une institution telle que l’Académie Française puisqu’elle promeut la culture sous toutes ses formes : sa nature « généraliste » implique qu’elle ne puisse pas tout couvrir aussi bien qu’il le faudrait. Cependant, lorsque cela provient d’un organisme comme le CNC, qui n’existe que pour s’occuper des problématiques liées au cinéma en français, l’impression d’abandon des traducteurs est pesante.
Le constat n’est pas beaucoup plus encourageant au niveau de l’Union Européenne (UE) alors même que l’un de ses objectifs officiels est le multilinguisme (à mettre en opposition avec un monde unilingue, probablement anglais). Ceci se retrouve dans sa politique reconnaissant chaque langue administrative des pays membres comme une langue officielle de l’Union. Ce choix implique d’ailleurs que les documents participant au fonctionnement de l’UE soient traduits dans les langues de chaque pays membre. Il est ainsi écrit dans le traité de Maastricht : « Tous les textes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune qui sont présentés ou adoptés lors des sessions du Conseil européen ou du Conseil ainsi que tous les textes à publier sont traduits immédiatement dans toutes les langues officielles de la Communauté »
De la même façon, il est inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l’UE, à l’article 21-1, que toute discrimination, y compris fondée sur la langue, est interdite. Hélas, l’idéologie résiste rarement à l’épreuve du réel et l’on se rend compte, en regardant les subventions proposées par l’UE dans le domaine des arts et média, que la situation est la même qu’au niveau national : sur la soixantaine de subventions proposées dans le domaine, une seule traite directement de traduction, et c’est une subvention de traduction littéraire. Il serait peut-être envisageable de faire passer les coûts de doublage ou de sous-titrage dans une des nombreuses subventions proposées à la production et à la distribution, puisque ces deux pôles sont en général les commanditaires des traductions audiovisuelles, mais rien de propre à la traduction audiovisuelle en elle-même n’est évoqué. Tout cela signifie donc que, si le traducteur littéraire peut s’extraire des contraintes imposées par l’édition afin de traduire comme il l’entend grâce à une bourse européenne, le traducteur cinématographique, lui, semble condamné à rester inféodé aux entreprises de production. L’on peut voir, qui plus est, que les centres décisionnels de l’UE eux-mêmes peinent à appliquer leur propre politique de multilinguisme : en 2008, par exemple, 72% de tous les documents écrits étaient traduits en anglais, contre 3% en allemand. Une telle proportion signifie que même des personnes dont l’anglais n’est pas la langue natale n’ont eu sous les yeux que la traduction anglaise d’un document donné. Ceci implique que l’anglais devient de facto « la langue de travail » de l’Europe, alors que les documents sont censés être traduits dans toutes les langues, et que toutes les langues sont censées pouvoir s’exprimer. À titre de comparaison, en 1986, seulement 26% des documents étaient traduits en anglais25. Il devient alors évident que l’UE n’est pas le paradis multilingue dont les traducteurs pourraient avoir besoin pour, enfin, être considérés.
• L’éclairage de Bourdieu
À propos de considération, Pierre Bourdieu explique dans Raisons pratiques (Seuil, 1994) la nature d’un concept capable de nous éclairer, celui de capital symbolique : « J’appelle capital symbolique n’importe quelle espèce de capital (économique, culturel, scolaire ou social) lorsqu’elle est perçue selon des catégories de perception, des principes de vision et de division, des systèmes de classement, des schèmes classificatoires, des schèmes cognitifs, qui sont, au moins pour une part, le produit de l’incorporation des structures objectives du champ considéré, c-à-d de la structure de la distribution du capital dans le champ considéré. »
Plus simplement dit, le capital symbolique, c’est la considération que les autres ont pour nous, la reconnaissance en tant qu’individu. C’est ce capital immatériel que l’on engrange grâce aux présents, aux marques ostensibles de considération à notre égard des gens avec qui on interagit (mimique des mouvements, place d’honneur laissée à table, prise en compte de l’avis, etc.). L’effet de cette reconnaissance de l’autre est, à un niveau personnel, bien sûr, le bonheur, la fierté. Dans l’interaction avec l’autre, par ailleurs, cela pousse à rendre la pareille, à prendre l’autre en considération puisque, de toute évidence, s’il nous considère, c’est que c’est une personne bien, et il faut donc lui rendre la faveur, en augmentant son capital symbolique à son tour. Dans notre cas précis, la question de la reconnaissance du traducteur cinématographique par le reste de la société, la situation pourrait se présenter de la sorte : une équipe de traduction est « propriétaire » d’un certain talent pour tous les aspects de la traduction cinématographique. L’équipe de traduction double un film donné de superbe façon. Devant cette réussite, le public, extatique, loue les qualités de l’équipe de traduction. Ladite équipe de traduction voit donc sa « propriété » se muer en capital symbolique qui augmente grâce à la reconnaissance du public. Se sentant redevable au public de l’augmentation de son capital symbolique, elle fera une traduction encore meilleure pour un deuxième film, sorti l’année suivante, et ajoutera dans le carton présentant l’équipe de traduction en fin de générique un petit message au public indiquant « si l’on peut faire ce métier, c’est grâce au public, merci à vous ». Le public verra donc son capital symbolique augmenter, puisqu’il sera considéré par l’équipe de traduction. L’on rentrera alors dans un cercle vertueux où chaque partie n’aura de cesse que de faire plaisir à l’autre, pour le bonheur des deux parties. Cependant, Bourdieu nous prévient que la condition sine qua non à la transformation d’une propriété (qu’elle soit culturelle, technique, foncière, etc.) en capital symbolique est la reconnaissance des agents. Ainsi, si la même équipe de traduction, avec la même propriété de « talent pour le doublage », venait à assurer l’adaptation du film X, mais que le public ne réagissait pas, ou négativement, la propriété, pourtant équivalente, ne se transformerait pas en capital symbolique, et le cercle vertueux ne pourrait se mettre en place. Peut-être, alors, faudrait-il comparer les traducteurs réels à ceux de l’exemple donné ici : ne sont-ils pas à la recherche d’une valorisation que le monde semble déterminer à ne pas leur donner ? Les lois supposées sécuriser l’emploi se retournent contre la profession et ouvrent le milieu à la concurrence internationale, les initiatives de préservation de la langue s’évertuent à les ignorer et, si l’on se souvient de la première partie, alors l’on peut aussi ajouter que les techniques de traduction les plus efficaces ont été abandonnées au profit des moins coûteuses, et que les seules fois ou presque où l’on parle de leurs traductions, comme dans l’émission radiophonique de France Inter, c’est pour en faire une critique virulente. Il semblerait que les traducteurs cinématographiques se trouvent, plutôt que dans un cercle vertueux comme exemplifié ci-dessus, dans un véritable cercle vicieux où le manque de reconnaissance entraîne la perte de moyens financiers pour faire mieux, qui elle-même entraîne la critique négative des choix de traduction, qui elle-même alimente le manque de reconnaissance envers la profession. Tournons-nous à nouveau vers Bourdieu pour trouver une solution à cette situation fâcheuse : il explique dans son oeuvre que les différents groupes sociaux ne valorisent pas les mêmes choses et qu’ainsi, on peut bénéficier d’un haut capital symbolique avec une frange de la population, et n’en avoir aucun avec une autre. Par exemple, une personne appartenant à la bourgeoisie et inscrivant son enfant à des cours d’équitation sera bien vue des autres personnes de sa classe sociale, ce qui induira le fameux cercle vertueux de l’augmentation réciproque de capital symbolique. Pour autant, la même action provenant de la même personne pourrait ne pas entraîner de réaction positive chez un ouvrier, par exemple, qui pourrait voir dans ce cours d’équitation une représentation de la différence de niveau de vie, jugée bien trop grande, entre lui-même et le bourgeois. Pour revenir à nos traducteurs : s’ils ne sont ni « aimés » par les institutions politiques nationales, ni par les media, ni par l’industrie du cinéma, quelle classe, alors, leur apportera la reconnaissance nécessaire à leur épanouissement ?
C’est entre eux, je pense, entre traducteurs et traductologues, que les traducteurs cinématographiques et les théoriciens de cette même traduction peuvent trouver une certaine forme de considération. Les pairs, parce qu’ils vivent, ou ont vécu, le même genre d’expériences peuvent être les mieux placés pour entamer une interaction positive à même d’améliorer le capital symbolique de la profession. De là, il sera alors plus aisé de se faire enfin remarquer aux yeux de la population et, à partir de là, de rentrer dans un cercle vertueux avec elle aussi.
En 1995, un traducteur littéraire états-unien, Lawrence Venuti, exposa sa théorie de l’invisibilité du traducteur dans un ouvrage du même nom26. Selon lui, les théories de la traduction ciblistes qui avaient prédominé jusqu’alors dans le monde de la traduction littéraire n’avaient fait qu’invisibiliser les traducteurs puisque, dans la logique cibliste, et en schématisant outrageusement, une bonne traduction est celle de laquelle on ne saurait dire de prime abord qu’elle est une traduction. Cela a pour effet de reléguer le traducteur au rôle de personnage de l’ombre, sans possibilité d’accéder à une quelconque forme de reconnaissance du public, et donc, à une augmentation de son capital symbolique. Pour contrer cet effet, Venuti proposait d’abandonner la pratique cibliste de la traduction littéraire et d’« étrangéifier » (« foreignizing ») à dessein les traductions proposées au public. Cette pratique aurait le double avantage d’introduire le lecteur à la culture étrangère de l’auteur de l’oeuvre, et de faire ressortir pleinement le traducteur, du fait de ses choix de traduction (par exemple : ne pas traduire un mot étranger, ou garder la syntaxe originale malgré le changement de langue). Le lecteur, alors, n’aurait d’autre choix que de reconnaître le traducteur et, à partir de ce point, l’interaction positive pourrait débuter. Cette approche directe et provocatrice, même si elle peut sembler « violente » a largement participé à la reconnaissance des traducteurs littéraires. Nous n’oserons pas avancer ici que tout un chacun en France est au fait des dernières traductions de Philippe Jaworski (traducteur de Mark Twain et Francis Scott Fitzgerald, éditeur des oeuvres de ce dernier et de celles d’Herman Melville dans la « bibliothèque de la Pléiade », et professeur émérite de littérature américaine à l’université Paris-Diderot), bien entendu, mais il n’en est pas moins vrai que la question de la traduction d’une oeuvre littéraire revient bien plus régulièrement que pour une oeuvre cinématographique. Si l’on prend à nouveau l’article d’Anne-Lise Weidmann dans la revue L’écran traduit, sa lecture nous apprend cela : dans l’émission radiophonique Le masque et la plume diffusée sur France Inter, en considérant toutes les émissions comprises entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013, pas une seule fois le nom d’un adaptateur pour le cinéma n’a été prononcé lors de la critique d’un film ; à l’inverse, en ce qui concerne les traducteurs littéraires, leur nom est cité à chaque fois (Weidmann, 2014). Parallèlement, quand les critiques apportées à la traduction cinématographique sont presque entièrement négatives, les critiques concernant les oeuvres littéraires sont, elles, bien plus élogieuses (ibid). Il est évident qu’une telle différence de traitement n’est pas l’oeuvre seule de Lawrence Venuti (ne serait-ce que parce que la communication entre les théoriciens de la traduction et les traducteurs sur le terrain pourrait être plus ouverte), mais ce serait dénigrer l’impact de son Translator’s invisibility de ne prétendre qu’il n’y est pour rien, non plus.
Les détracteurs de la théorie de Venuti mettent souvent en avant son côté provocateur, jugé trop violent. L’inquiétude, alors, est de savoir si de telles pratiques traductives ne vont pas, au contraire de l’effet recherché, aliéner le public. Deux réponses, je pense, peuvent être apportées à ces inquiétudes :
– La première est que la traduction, depuis toujours, a été dépréciée (« traduttore, traditore »). Si l’on prend ce point de départ, alors, il est impossible de s’aliéner les foules en mettant en oeuvre la proposition de Venuti puisque les foules sont déjà aliénées et partiales à l’encontre des traducteurs avant même cela. Pour le dire crûment : il n’y aurait rien à perdre.
– La seconde réponse, plus subtile, s’appuie sur la théorie du polysystème d’Even-Zohar. Venuti est un traducteur états-unien qui traduit du français, de l’italien, et du catalan, vers l’anglais. La littérature anglophone, et d’autant plus la littérature états-unienne, est un « centre », l’hégémonie culturelle du pays à l’échelle mondiale le prouve. L’on sait, toujours selon Even-Zohar, que le système « oeuvres traduites » est tributaire du système « oeuvres nationales », et est influencé par les normes dominantes dans la société d’accueil. Les États-Unis étant un centre très fort (idéologie, culture, cinématographie, politique internationale dominantes), leurs normes dominantes sont incroyablement ancrées dans la société, et une oeuvre traduite a besoin d’être filtrée via un processus d’adaptation extrême avant d’être présentable pour les membres de cette culture, peu habitués à la rencontre avec d’autres cultures. En d’autres termes, les traductions ciblistes aux États-Unis sont bien plus ciblistes et édulcorées que les traductions ciblistes, par exemple, françaises. Ainsi, quand Venuti appelle à laisser passer l’altérité de la langue originale dans les traductions, il ne faut pas l’entendre comme un appel à déconstruire le langage cible, mais simplement à proposer une oeuvre plus proche de la version originale, dans une limite très acceptable.
Ces inquiétudes élucidées, il nous est possible, dorénavant, d’encourager les traducteurs cinématographiques à suivre la voie de leurs confrères en littérature, et de s’imposer dans le cadre public par leur profession même.
Ayons conscience, bien sûr, que tout cela n’est pas aussi simple à faire qu’à dire. Peut-être encore plus que dans la littérature, les entreprises de production décident de la teneur des traductions cinématographiques. Elles font partie, cependant, des entités à convaincre que les traducteurs méritent d’être mieux considérés pour leur travail et, puisque le rapport de force est par essence inégal entre un employé et un employeur, il peut être intéressant pour l’employé de se renseigner auprès d’un syndicat ou d’une association. De nombreuses structures existent, comme entre autres la Société Française des Traducteurs (SFT), la Fédération Internationale des Traducteurs (FIT), ou l’Association des Traducteurs/Adaptateurs de l’Audiovisuel (ATAA). Ces structures, syndicats ou associations lois 1901, sont faites pour unir, faire dialoguer, et défendre les intérêts des traducteurs. Elles représentent donc des espaces où les traducteurs peuvent parler entre eux, augmentant ainsi leur capital symbolique, ainsi que des groupements assez importants pour pouvoir mener des actions, par exemple, de sensibilisation au métier de traducteur auprès du public. L’ATAA, en particulier, est une association spécialement faite pour les traducteurs et adaptateurs de l’audiovisuel, et décerne chaque année depuis 2012 six prix différents aux traducteurs de l’audiovisuel : le prix pour l’adaptation en sous-titrage d’un film non anglophone, le prix pour l’adaptation en sous-titrage d’un film anglophone, le prix pour l’adaptation en doublage d’un film de cinéma, le prix pour l’adaptation en sous-titrage d’une série télévisée, le prix pour l’adaptation en doublage d’une série télévisée, et enfin le prix pour l’adaptation d’un documentaire télévisé. Prouvant définitivement que la reconnaissance pour un traducteur, du moins à l’heure actuelle, est à aller chercher dans son champ professionnel avant tout.
Exemples de traductions audiovisuelles
Nous nous sommes interrogé dans la partie précédente sur les moyens d’action qu’avaient les équipes de traduction audiovisuelle pour être reconnues. Nous avons abordé le sujet du point de vue théorique de la traductologie, mais aussi, d’une façon plus concrète en présentant les syndicats et associations luttant pour cette reconnaissance des traducteurs. Posons-nous la question, cependant : la traduction audiovisuelle est-elle seule dans cette démarche, ou peut-elle compter sur d’autres champs de traduction pour l’épauler ? Cette question en entraîne une autre : outre la traduction littéraire qui semble avoir acquis, elle aussi, ses lettres de noblesse (même si, bien sûr, des améliorations des conditions de travail restent toujours souhaitables), les autres domaines d’exercice de la traduction font-ils face à la même situation que la traduction audiovisuelle ?
À l’aune des conclusions tirées des deux premières parties de ce mémoire, il nous est possible de comprendre le lien de cause à effet qui lie, d’une part, le manque de moyens alloué à l’exercice de la traduction audiovisuelle, d’autre part, le manque de considération envers la profession, et enfin, la qualité inégale des traductions audiovisuelles. Peu importe de savoir lequel de ces facteurs est arrivé en premier, il apparaît maintenant qu’ils s’auto-entretiennent, créant de fait un cercle vicieux. De la même façon, et comme nous l’avons abordé en évoquant le concept du capital symbolique de Pierre Bourdieu, l’on pourrait penser qu’une permutation de la reconnaissance suffirait à inverser la tendance globale et à amorcer un cercle vertueux.
• Le cinéma : s’assurer de la valeur de Star Wars
Prenons une nouvelle fois le sujet d’étude de mon Travail Encadré de Recherche en 2018 : la saga Star Wars de George Lucas. J’avais alors comparé les versions originales et françaises des six films qui composent la trilogie originale (1977-1983) et la « prélogie » (1999-2005), et en étais arrivé au constat suivant : la traduction originale, dans son ensemble, était de bonne qualité, même si quelques approximations pouvaient se remarquer quant aux termes propres à la science-fiction qui, dans les années 1980, arrivait à peine au cinéma. Citons, à titre d’exemple, la ligne “My lord, the fleet has moved out of lightspeed” dans Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back traduite par « Mon seigneur, la flotte a dépassé la vitesse lumière » dans la traduction française du film. Cette erreur de traduction semble être due à une méconnaissance du concept de vitesse lumière, ou d’hyper-espace, dont de nombreuses oeuvres littéraires de science-fiction parlent pourtant. Cette erreur de traduction soulève d’ailleurs la question du manque de communication entre les différents domaines dans lesquels travaillent les traducteurs : la science-fiction était déjà bien implantée dans la littérature à cette époque-là (le premier tome du cycle Foundation d’Isaac Asimov est publié en 1951, et le roman Dune de Franck Herbert en 1965, par exemple), pourtant les traducteurs cinématographiques ne semblent pas être au fait du lexique consacré de ce genre. Des recherches passionnantes, je n’en doute pas, pourraient être menées sur les échanges entre les différentes pratiques de la traduction (littéraire, audiovisuelle…) ; je me contente, de mon côté, d’en évoquer la possibilité afin de ne pas trop me disperser. La « prélogie » de Star Wars, contrairement à sa devancière, se démarquait, au niveau de la traduction, par des erreurs de traduction récurrentes. Alors qu’elles étaient exceptionnelles dans les années 1980, les erreurs sont devenues monnaie courante dans les années 2000. Les faux-sens et contresens se sont multipliés et n’ont plus seulement touché au lexique spécifique à la science-fiction. Au contraire, même, ce vocabulaire-là semble s’être bien fixé. L’objectif de mon TER était de tenter de comprendre, grâce à une approche comparative des deux trilogies, comment il avait été possible de passer de la qualité de la trilogie originale, à celle de la « prélogie », puisque dans le même temps, les recherches liées à la traductologie s’étaient développées. La conclusion apportée à cette interrogation indiquait qu’avec les années 2000, étaient arrivées les sorties mondiales simultanées, remplaçant l’ancien modèle où les films sortaient dans un premier temps dans leur pays d’origine, puis quelques mois plus tard à l’étranger en version traduite. Il avait été montré que cette nouvelle façon de faire avait d’autant plus pressé les traducteurs, qui ne se retrouvaient plus alors en mesure d’assurer une traduction de qualité (nous retrouvons bien, ici, les éléments à la base du cercle vicieux que nous avons évoqué). Afin que les traducteurs de la « prélogie » soient exonérés définitivement de toute critique, j’avais aussi montré que le premier film de la prélogie était sorti en 1999 (avant, donc, la popularisation des sorties mondiales simultanées), avait été traduit par la même entreprise et la même équipe que les deux autres films de cette trilogie, mais que le niveau en était prodigieusement supérieur. Cela avait permis de corréler l’apparition de la pratique des sorties mondiales simultanées avec la perte de niveau de la traduction cinématographique, donnant ce système comme principal « coupable » de cette déconvenue, et non pas les traducteurs qui, ils l’avaient prouvé, étaient capables de faire bien mieux. Si l’on reprend le concept de capital symbolique de Bourdieu pour l’appliquer à cette situation précise, l’on se rend alors compte que l’équipe de traduction en charge de cette trilogie Star Wars était « propriétaire » d’un talent pour la traduction. Cependant, ce talent semblait ne pas être reconnu par les instances ayant décidé de faire passer la traduction au second plan pour tenir les délais imposés par les sorties mondiales simultanées. Devant ce manque de considération, l’équipe de traduction ne pouvait transformer sa propriété en capital symbolique, et en souffrait. À l’inverse, pour la traduction du premier épisode de la trilogie originale (soit Star Wars Episode IV: A New Hope), Twentieth Century Fox impose le choix d’Éric Kahane27, traducteur et adaptateur de théâtre de renom, à la direction artistique. Cette volonté de la Fox montre bien l’importance que revêtait, pour l’entreprise, une bonne traduction en français, puisque leur choix s’était porté sur un homme dont on louait la qualité des adaptations. De façon assez ironique, l’aventure avec Kahane s’est avérée être un fiasco, justement parce qu’il avait trop adapté Star Wars, au point de remanier entièrement certains dialogues. Nous pouvons par exemple citer à la réplique anglaise .
|
Table des matières
Remerciements
Introduction
I. Histoire de la traduction cinématographique
• Les versions multiples
• Le doublage
• Le sous-titrage
II. Les institutions : évolution de la traductologie et de la loi
• La traductologie
• Les politiques linguistiques
• L’éclairage de Bourdieu
III. Exemples de traductions audiovisuelles
• Le cinéma : s’assurer de la valeur de Star Wars
• L’animation japonaise : Belles Infidèles contre « étrangéité »
• Le jeu vidéo : revendications d’un art naissant
Conclusion
Bibliographie
Télécharger le rapport complet