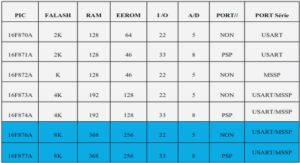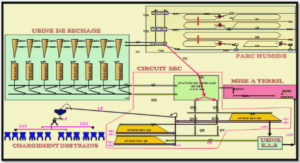Origine médiévale
Renwez est un village assez ancien, que des fouilles historiques attestent. On retrouve des mentions de son existence dès le début du XIVe siècle dans quelques documents. En effet, il figure dans un Pouillé de 1306 parmi les bénéfices du doyenné d’Aulnois.
On parle ici de quelques maisons dans une clairière, sur les terres boisées d’un fief du seigneur de Montcornet. Il s’agit vraisemblablement d’un territoire pris sur la forêt après le XIIe siècle, lorsqu’il y eu une vague d’expansion des terres cultivables. La forêt d’Ardenne ne présente déjà plus ses profondeurs impénétrables et cette étendue gigantesque décrite par Jules César, dans la Guerre des Gaules. En 1236, il est fait référence à la liberté selon la loi de Renwez dans une charte accordée aux habitants de Gédinne11 (Belgique) par Baudouin, seigneur d’Orchimont. Le village a donc rapidement bénéficié de libertés spécifiques , et d’une limitation des droits de son seigneur, de nature sans doute à stabiliser une population sur ces nouvelles terres.
Vie économique
Autrefois, il y avait des fabriques de bas de laine à aiguilles à Renwez. L’histoire raconte que la femme de François 1 er , la reine Claude, est venue choisir de jolis bas alors que leurs majestés étaient les hôtes du seigneur de Montcornet.Cette fabrication a disparu vers le milieu du XIXe siècle au profit de métiers importés d’Angleterre.
Vers 1860, une distillerie et une filature de laine se sont implantées. Toutefois, à cette époque c’est la confection de brosses, sorte de bruyères très abondantes dans les bois de l’Ardenne qui occupe une centaine d’ouvriers.
On recense également une brasserie, un pressoir à cidre, deux moulins à farine et quatre tourailles à chicorée. En 1855, Renwez fournit 180 000 kg de cossettes (chicorées torréfiées) au commerce.
La plus importante foire commerciale a lieu le jeudi après la saint André (30 novembre) soit souvent au début décembre, qui correspond à la période du début de l’avent.
Les ressources naturelles du pays contribuent fortement au développement économique. En 1855, on extrait annuellement :
– 500 000 kg de minerai de fer
– 120 m3 de pierres de tailles et moellons
– 260 m3 de sable pour les forces
– 1000 m3 de tourbe
Et on fabrique sur la commune 500 hectolitres de chaux grises et 150 000 briques.
Vie quotidienne
L‘habitat
En 1835, Lépine écrivait « on voyait encore des dates au-dessus des portes cintrées de quelques maisons de la Rue Neuve (route de la Boutillette) et de la Place : 1654, 1658, 1671, 1689, …on peut supposer que bien des maisons ont été construites sur les caves, dont certaines contiennent un puits, un four, une cheminée ».
Pas très large, mais s’étirant en profondeur, la maison renwézienne est généralement en pierre et couverte de faisiaux.
Devant ces maisons serrées les unes contre les autres, un large espace, le pavé, accueille des tas de bois, de fumiers et des brouettes.
Dans les habitats les plus pauvres, on trouve une cuisine, une chambre sans fenêtre, une écurie et une grange dans laquelle est souvent placé le four où les femmes fabriquent leur pain.
Les sols sont en terre battue.
ANTHROPONYMIE
Dans toute étude généalogique familiale, il est intéressant de se pencher quelques instants sur l’analyse des graphies phonétiques des membres de la famille étudiée. Tout au long du travail de recherche réalisé sur une seule branche, les VAIREAUX, il apparaît des changements notables : VAIREAUX- VERREAUX – VEROX – VERREAU – VEREAU S’agissait-il de changements vocaliques ou phonologiques ? Y a-t-il un lien entre son et sens ? Il serait dangereux de faire de la paléontologie linguistique, c’est-à-dire faire des déductions sur la culture, le mode de vie, et la localisation géographique des peuples qui portent ce nom tel qu’on leur a certainement attribué entre le XIVe et le XVIe siècle. Cependant, si selon Jean Tosti , il pourrait s’agir d’une variante de l’ancien français verel (= verrou, cadenas), et donc le surnom d’un serrurier :
Le rapprochement avec le verre n’est cependant pas à exclure totalement. En effet, en ancien français le verbe Verrer signifie « garnir de vitres, de verrières ». Se peut-il que ce nom soit dérivé du métier ? On trouve dans le dictionnaire du Moyen-Age :
*..rompirent de nuit huys, fenestres et* **verraulx** *de la maison dudit Clais Ceurff pour le tuer murdrièrement (MOLINET, Chron. D.J., t.2, 1474-1506, 285). »*
Il peut également s’agir d’un dérivé d’une forme régionale. Le parler ardennais est une langue orale qui fait partie de la langue champenoise. Le mot VERRAT qui désigne un cochon mâle, en français au Moyen-Age, a également le même sens que le mot oral en ardennais. Il devient avec l’accent de la région, une phonétique en /O/ = le « a » se prononce « â », pas loin du « o »). Or le sanglier est le symbole du département des Ardennes, car il y a toujours été présent dans ses forêts. VERRAT devient donc VERROT en langue parlée et la graphie phonétique s’expliquerait par les nombreuses libertés des scribes.
La concentration, au niveau national, du patronyme VAIREAUX est bien majoritairement dans les Ardennes, avec une présence en Meurthe et Moselle, qui est issue de la branche ardennaise et dans l’ouest de la France sans que j’ai pu déterminé un quelconque lien pour le moment.
Par ailleurs, on retrouve le patronyme de VERREAULTen [Français Canada] avec l’orthographe modifiée comme cela se fit beaucoup à cette époque qui prouve bien la longue existence de ce patronyme.
Regardons de plus près les membres VAIREAUX qui nous occupent pour ce travail de généalogie familiale.
Génération I
L’histoire de l’ascendance de Jean Nicolas Eugène VAIREAUX peut être racontée grâce à l’acte de mariage de ses arrière-grands-parents paternels, André VAIREAUX (Sosa 8) et Yvonnette TOURY (Sosa 9), le lundi 21 novembre 1707, à Renwez.
Les jeunes mariés ont publié un ban et obtenu la dispense des deux autres. Aucun intervalle protogénésique ne vient expliquer cette précipitation, à moins qu’il n’y ait pas eu recensement d’une naissance mort-né de leur premier enfant.
Les deux pères sont décédés, seules leurs mères sont présentes. Les jeunes gens ne savent ni lire ni écrire et signent d’une croix ce premier acte de leur vie conjointe. Sont témoins à cette union, Jean LAURAIN et Jean THIERRY, certainement son oncle maternel ou son grand-père paternel ? André est baptisé le vendredi 3 septembre 1683 et il est le fils de Jean VAIREAUX (Sosa 16), et de Jeanne THIERY (Sosa 17)comme l’atteste cet acte de mariage. Il apparaît dans une table récapitulative annuelle des naissances entre 1669 et 1812. Malheureusement l’acte n’est pas disponible.
En ce qui concerne ses parents, j’ai retrouvé un acte de sépulture de Jeanne THIERYle 17 mars 1735 décédée à l’âge de 78 ans et qui pourrait tout à fait correspondre à la mère d’André.
Le travail de recherche pour déterminer la fratrie commence par l’étude de la même table. Elle est incomplète, déchirée et ne permet pas de retrouver tous les actes qui combleraient les lacunes.
En étudiant d’autres actes de cette même période, j’ai découvert par hasard qu’une certaine Marie VERREAU épouse de François MANGIN, marie son fils André en 1707 à Renwez. L’acte stipule qu’elle est de la paroisse d’Harcy. Le prénom de son enfant me fait croire à un lien familial. Je décide donc de chercher dans ce village les membres de cette famille.
Grâce à l’étude généalogique faite par Maurice Cochart, née du relevé du cahier du curé Boulet de toutes les familles de la paroisse Saint Martin d’Harcy entre 1630 et 1746, j’ai pu constater qu’une famille VERREAU résidait dans ce petit village appartenant au même marquisat de Montcornet.
LE COUPLE VAIREAUX-LAURENT
Le premier mariage
Le lundi 3 mars 1855, à 8 heures du matin, Jean Nicolas Eugène VAIREAUX, dit Eugène, s’est présenté avec Marie Jeanne Hortense Larmigny, dit Hortense, à la maison commune de Renwez, devant l’officier de l’état-civil, Jean-Nicolas Lefebre-Millet pour célébrer leur union en présence de leurs familles. Il y a fort à parier que lors de la célébration paroissiale, Eugène et Hortense ont voulu honorer une coutume locale : à peine la messe terminée, les nouveaux époux quittent précipitamment la place qu’ils avaient occupé pendant la cérémonie et courent vers l’autel sous les rires de l’assemblée.
En effet, le premier qui baisait la nappe avait, dès ce moment, le droit de « porter la culotte » pendant toute la durée du mariage et ce jusqu’à sa mort.
Marie Jeanne Hortense est née le 25 décembre 1813 à Renwez, fille de Hyppolite Larmigny, manouvrier et de Marie Jeanne Gérard. Un premier lien existe déjà avec la famille de son futur mari puisqu’Auguste VAIREAUX est témoin de cette naissance.
En 1835, Eugène est maçon. A la naissance de son fils Hyppolite Emile, il est ardoisier. A-t-il débuté son nouveau métier à Renwez ou directement en arrivant à Deville après 1836 ? Difficile de le savoir. Ce travail existe depuis très longtemps à Renwez comme le prouve cette lettre de 1720 d’une concession d’ardoisière à Renwez.
Les ardoisières de l’Ardenne
Rien ne peut mieux définir l’Ardenne que l’ardoise . Dès la fin du paléolithique supérieur, l’homme a utilisé le schiste et l’ardoise pour les graver : parfois c’est un objet taillé qui prend la forme d’un pendentif ou d’un bracelet.
À l’époque gallo-romaine, les hommes se sont servis du schiste et de l’ardoise pour bâtir et couvrir leurs constructions. Dès l’an mil, mais surtout à partir du XIIe siècle, l’ardoise apparaît vraiment dans l’économie locale. Cependant, l’essor décisif est donné par l’expansion monastique des XIIe et XIIIe siècles : moines de Signy à Rimogne, ceux de Divers-Monts à Fumay par exemple.
L’exploitation de l’ardoise qui, dans les premiers temps, n’était bien souvent qu’une « tolérance », est rapidement gérée par des contrats : on voit alors apparaître des entrepreneurs privés et les populations locales sont de plus en plus nombreuses à travailler dans l’ardoise. Denis Diderot envoie l’ingénieur Violet à Rimogne pour se documenter. Le degré de technicité, révélé par les planches de l’Encyclopédie, prouve que le travail de l’ardoise est parfaitement maîtrisé, aussi bien au fond qu’en surface. Pour extraire l’eau qui envahit les puits de mine, les pompes à feu remplacent progressivement moulins, manèges à chevaux ou pompes à bras, manipulées par les femmes et les enfants.
Pendant des siècles, l’ardoisière a été sinon l’unique,du moins l’une des rares possibilités de travail offertes aux populations d’une contrée réputée pauvre. Au début du XVIIIe, les 2/3 des habitants des villages où se trouvaient une carrière d’ardoise, enfants compris sont occupés dans les fosses et ce n’est pas une exception. C’est même une tradition familiale comme on peut le lire dans tous les registres de ces villes : Rimogne, Fumay, Haybes, et Deville. On y découvre également un nom de famille « Scaillette » qui est un mot dérivé de cette industrie. L’ensemble des ardoisières du département employait, au milieu du XIXe siècle, 1862 ouvriers, dont 854 pour la seule Société des ardoisières de Rimogne et de Saint-Louis-sur-Meuse.
Dans les ardoisières ardennaises, dès le XIIe siècle on détecte des formes d’exploitation mixte, entre structures monastiques et particuliers dont le but était l’exportation des produits vers l’aval de la Meuse. Dans les archives départementales, on peut retrouver les contrats d’exploitation, scellés sous l’Ancien régime entre le Seigneur de Montcornet et des propriétaires, qui définissaient les conditions d’exploitation, de règlement et de vente avec notamment l’interdiction de céder à des concurrents voisins.
En 1827, on trouve un contrat de vente de Charles X qui en échange des 1/5 des bénéfices provenant de toutes les marchandises et à perpétuité la possibilité d’opter pour la 25e ardoise, leur demande que 30 ouvriers soient embauchés au bout d’un an. Et tout en précisant qu’il faut demander à l’administration une autorisation spéciale pour installer une loge sur le site pour les ouvriers. On voit là quelques ébauches de considérations sociales.
La seconde moitié du XIXe siècle et le premier quart du XXe siècle connaissent la plus intense activité : avec 175 millions d’ardoises produites, l’année 1869 marque certainement l’apogée de la production dans les Ardennes. Le lent déclin va alors commencer, dû aux destructions de la guerre, mais surtout aux difficultés à se moderniser : les veines d’ardoise sont étroites, difficiles à atteindre.
Les capitaux manquent, la main-d’œuvre se détourne d’un métier difficile, de nouveaux matériaux apparaissent. Les ardoises étrangères, moins chères, exercent une rude concurrence. L’architecture ardennaise est marquée par l’utilisation massive de l’ardoise, notamment pour la couverture et le bardage des maisons. Mais on trouve également des vestiges d’utilisations plus inattendues comme dans les cimetières par exemple ou dans les jardins pour séparer les parcelles.
Les Hommes : ceux du fond, ceux des baraques
Être ardoisier c’est faire un travail étonnant, exclusif, repris souvent de père en fils avec des moyens dérisoires… Un travail dangereux, ne pardonnant pas la moindre imprudence, tuant à l’improviste ou faisant payer, jour après jour, par une dégradation progressive de la capacité pulmonaire, le droit d’extraire la belle ardoise, plane, mince et sonore, capable de durer des siècles sur un toit d’église ou sur celui des maisons.
Il y a les hommes du fond, ceux qui descendent la galerie qui suit l’inclinaison de la veine de schiste (en moyenne d’environ 35°). Une fois en bas, à environ 13 mètres de profondeur verticale, les équipes s’acheminent à pied, vers leurs chambrées ou ouvrages (chambres d’exploitation). Ces ouvrages, d’une largeur de 15 mètres environ, sont séparés par des piliers de sécurité de 5 mètres.
Le rôle des enfants
Dans ces fosses anciennes, les enfants, les « faiseleux », ceux des ouvriers le plus souvent, étaient présents en masse. Ils étaient encore plus de mille dans les Ardennes vers 1860 . Ils n’avaient pour tout paiement que les débris de fabrication et parfois quelques morceaux de bonnes pierres qui leur étaient abandonnées. Ils en tiraient les faisiaux.
Agés de 12 ou 13 ans, levés à cinq heures du matin, été comme hiver, devaient après une longue marche en forêt, allumer le feu dans les baraques, porter les outils à la forge, préparer de grande quantité de café, préparer les débris d’ardoise qui encombraient les ateliers de fendage. Chacun avait une demiheure de liberté avant le repas de quatre heures et prenait ensuite une leçon auprès d’un fendeur.
L’apprentissage était long. Cela menait l’enfant habitué à la vie de la fosse, bon gré mal gré, à prendre la place à la suite d’un accident ou de la retraite forcée d’un ouvrier à très courte espérance de vie.
Qu’aurait-il pu faire d’autre ? En France, les sept années de service militaire subies à la fin du XIXe à la suite d’un tirage au sort défavorable en ont sauvé quelques-uns.
Certains en retiraient cependant une certaine fierté : les dangers encourus, la reconnaissance d’un véritable savoir-faire et des périodes de gains. L’obligation de scolarité jusqu’à 12 ans votée en 1883 et surtout l’interdiction du travail des enfants dans les ouvrages souterrains (en novembre 1892) a changé la donne pour la formation et le recrutement dans ces établissements, d’une main d’œuvre adaptée à l’outillage.
Les femmes
Les Ardennaises de cette époque, soucieuses d’assurer le pain quotidien à une progéniture souvent nombreuse ne ménageaient pas leur peine. Elles aidaient les hommes dans les travaux de la forêt, aux champs et à la fabrique. Il n’existe pas de statistiques sur leur importance dans les effectifs ardoisiers dans les siècles passés mais un récit de J. Vialet, en 1760, raconte que c’est par dizaine qu’il faut sans doute compter le personnel féminin chargé de ce travail de pompe (l’épuisement des eaux). Depuis toujours, le portage des débris fut aussi confié à des femmes. Elles ont poussé la brouette et porté la hotte chargé de « fouégés ». Ce sont elles qui également triaient, comptaient et rangeaient les ardoises fabriquées, aidées de leurs « gamins ». Elles chargeaient la marchandise sur les véhicules à destination des bateaux sur la Meuse.
C’étaient là des travaux de manœuvres, des besognes très peu rémunérées. La paie d’une année équivalait à peu près à celle d’un fendeur durant un mois. La loi du 15 mai 1874 interdisant l’emploi du personnel féminin dans les travaux souterrains a sans doute réduit l’embauche des femmes déjà diminuée par l’utilisation de machines hydrauliques et de la vapeur.
Les difficultés et les risques
Les ouvrages souterrains ont toujours constitué un milieu hostile dans lequel les hommes ont payé un lourd tribu. Dès l’entrée des ardoisières on risquait sa vie. Descendre par de longues échelles fixées au remblais schisteux, inclinées à 50 – 60 degrés, le pic en équilibre sur une épaule, tous les jours, plusieurs fois par jour, dans l’obscurité ou la semi-obscurité et les enduits boueux sur le plan de glissement le rendaient dangereux malgré les habitudes acquises.
Le milieu de travail est humide et froid. L’eau suinte de partout dans les cavités profondes. Le danger pouvait venir de l’effondrement d’un remblais mal monté. L’équipement individuel est sommaire, de vieux vêtements, des chaussures plus robustes que confortables et souvent usagées et une casquette pour toute protection. Le 12 nivôse, an 10, le préfet des Ardennes souhaite la présence dans le département d’un ingénieur des Mines, chargé de constater les infractions à la sécurité et prévenir les accidents.
Les troubles sociaux
Les années 1880 sont marquées par une importante crise économique et sociale. Les mouvements de grève, autorisés depuis la loi de 1864 sur les coalitions, sont fréquents. Michelle Perrot est une historienne qui a beaucoup étudié les mouvements sociaux et la condition ouvrière en France au XIXe siècle. Elle constate un effacement de la silhouette de l’ouvrier classique, parle même de muséification de l’usine et de chantiers archéologiques décryptant la société industrielle.
Par le biais de cette lecture, j’ai voulu amorcer une réflexion sur ce qu’avait pu vivre Camille VAIREAUX dans sa jeunesse ouvrière.
Camille est déjà ouvrier quand les troubles sociaux débutent dans les Ardennes. A-t-il pris part à ses mouvements de foules, ses réunions où on les exhorte à faire grève et à intégrer un syndicat ouvrier pour se défendre face à l’exploitation des patrons de la métallurgie ?
|
Table des matières
REMERCIEMENTS
SUJET DU MÉMOIRE
AVANT-PROPOS
SOMMAIRE
INTRODUCTION
LE VILLAGE DE RENWEZ
Géographie
Toponymie
Origine médiévale
Description héraldique de l’écu de la ville de Renwez
Population
Les fléaux habituels : la guerre, le feu, la peste
Vie religieuse
Vie économique
Vie quotidienne
L‘habitat
Mœurs et coutumes
ANTHROPONYMIE
L’ASCENDANCE DE JEAN NICOLAS EUGENE VAIREAUX
Arbre des ascendants
Génération I
Génération II
Génération III
LE COUPLE VAIREAUX-LAURENT
Le premier mariage
Les ardoisières de l’Ardenne
Les Hommes : ceux du fond, ceux des baraques
Le rôle des enfants
Les femmes
Les difficultés et les risques
Les maladies, l’alcoolisme
Les grèves
Un exemple de rapport d’extraction
Le second mariage
LA DESCENDANCE DE JEAN NICOLAS EUGENE VAIREAUX
Arbre des descendants
Génération V
Mouleur en sable
La vie tragique des travailleurs
Les troubles sociaux
Le secours
La première guerre mondiale
Le Chemin des dames
Génération VI
Des enfants Belges ?
La maison rue d’Alsace
Génération VII
L’immigration du labeur
METHODOLOGIE ADOPTEE
CONCLUSION
TABLE DES ILLUSTRATIONS
BIBLIOGRAPHIE
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet