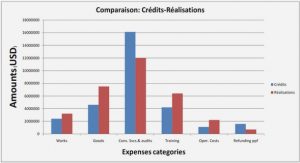Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Croiser les biographies
J’ai donc renoncé à faire parler les enfants ou adolescents qui sont au centre de mon enquête, mais réussi au-delà de mes espérances à faire parler leur entourage. Il en résulte un matériau relativement atypique : des observations menées principalement dans des établissements pour enfants ou adolescents handicapés mentaux (mais aussi lors d’une classe verte organisée par ABC École et au domicile des familles de ces jeunes), des données statistiques (nationales via l’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance, locales via les dossiers scolaires de trois établissements) et surtout des biographies croisées. La pratique la plus classique de « l’entretien ethnographique » [Beaud, 1996] consiste à mener des autobiographies qui balayent la trajectoire de la personne interrogée dans divers domaines (scolaire, professionnel, familial, amical etc.). La spécificité la plus importante de mes entretiens est qu’il s’agit plus de biographies que d’autobiographies. Faire faire des biographies pose évidemment le problème classique de « l’illusion biographique » [Bourdieu, 1990]. Quelles que soient les précautions méthodologiques que l’on prenne, on ne peut empêcher son interlocuteur de procéder à une reconstruction, une mise en cohérence (souvent plus inconsciente que consciemment stratégique) de son discours, du parcours de vie qu’il évoque, plus largement de la personne qu’il est et qu’il cherche à présenter. L’essentiel est cependant plus d’être conscient de ces processus de reconstruction que de chercher à les éviter. Dans la mesure où je m’intéresse aux manières de penser et de dire le handicap, aux différents points de vue qui peuvent être construit sur ces questions, l’illusion biographique » fait partie de mon objet et n’est pas pour moi gênante en soi. Pour autant, il serait faux de dire que la vérité des pratiques ne m’intéresse pas et que je me contente de discours fortement reconstruits. Mon dispositif d’enquête permet de cerner en partie l’ampleur et les effets de cette illusion d’ au moins trois façons : par rapport à une autobiographie, la reconstruction de la trajectoire lors d’une biographie faite par autrui est plus explicite (trous de mémoire fréquents, regardplus distant) et la mise en cohérence moins accentuée, surtout dans le cas de ces enfants et adolescents au parcours souvent heurté qui ne facilite pas une telle opération. Ensuite, le fait de pouvoir disposer de plusieurs points de vue sur cette trajectoire, quand plusieurs entretiens autour du même cas ont pu être effectués, facilite grandement la déconstruction de la biographie et invite à souligner les différences subjectives dans la perception de la trajectoire. Enfin, la répétition d’entretiens à des moments différents avec une même personne permet de faire nu premier tri entre les interprétations temporaires et les convictions durables, ou encore entre les faits qui ne sont soulignés qu’à un moment précis et ceux qui sont sans cesse rappelés.Il est frappant de voir combien des positions que l’on croyait définitives, des interprétations qui semblaient fondamentales, des affirmations qui se présentaient comme des certitudes lors d’un premier entretien ont pu s’altérer considérablement quelques mois ou annéesplus tard.
Le cœur de chaque entretien est donc consacré à la vie du jeune autour duquel est centré le « cas » . Bien sûr, chaque personne ayant participé à un entretien a aussi parlé d’elle et de sa propre trajectoire, mais le contrat tacite sur lequel reposait l’entretien était que le sujet en était l’enfant. Un tel contrat n’a rien d’évident, même si les personnes rencontrées étaient souvent (mais pas toujours) partie prenante dans la trajectoire de l’enfant ou adolescent en tant que décideurs ; souvent en ethnographie, il est difficile de faire accepter un entretien à quelqu’un en lui disant qu’il portera sur quelqu’un d’autre (ce qui ne veut pas dire qu’on ne parvient pas pendant les entretiens à faire parler les enquêtés d’autres personnes) car il est illégitime de parler pour quelqu’un d’autre, surtout si c’est en termes négatifs. Le cas qui nous occupe est particulier dans la mesure où les enfants dont il est question ne sont pas légitimes à parler d’eux-mêmes. Comme on l’a déjà vu, leur parole est deux fois illégitime. Il est donc apparu naturel à mes interlocuteurs que je les cont acte pour les faire parler de quelqu’un d’autre qu’eux.
Le problème de l’anonymat et de la confidentialité
En ethnographie, l’exigence déontologique majeure est de protéger ses enquêtés et la première des mesures à prendre est l’anonymisation, c’est-à-dire la modification des noms de lieux et de personnes afin qu’un lecteur lambda ne puisse reconnaître les personnes dont il est question. Mais à y regarder de plus près, cette opération est loin de régler tous les problèmes. En particulier, les personnes ayant participé à l’enquête peuvent difficilement ne pas se reconnaître elles-mêmes ; s’il n’est a priori pas gênant que chacun se reconnaisse personnellement, il l’est davantage que chacun puisse par ce biais reconnaître les autres enquêtés et donc accéder à leurs discours et leurspratiques, tels que l’ethnographe les expose. Ce n’est plus l’anonymat (l’impossibilité d’être reconnu par un lecteur lambda), mais la confidentialité (la garantie donnée aux personnes ueq leurs propos ne seront pas répétés) qui est ici en cause et elle est déontologiquement tout aussi problématique. « Confidentialité et anonymat sont donc les deux faces d’un même problème, celui de garantir aux personnes rencontrées une dissociation entre leurs paroles – parfois aussi leurs actes – et leur identité, soit par rapport à ceux qui les connaissent, autres enquêtés ou proches (confidentialité), soit par rapport à la masse anonyme des lecteurs potenti els (anonymat). » [Béliard et Eideliman, 2008, p. 2]
Dans le cas des monographies de familles qui composent le cœur de mon matériau, l’exigence de confidentialité est à la fois cruciale (la circulation de l’information dans la famille est, comme on le verra plus loin en détail,un enjeu très important et l’enquêteur n’a pas vocation à l’influencer) et très problématique puisque la confrontation des points de vue est essentielle à la réflexion. Plusieurs solutions peuvent être adoptées. Tout d’abord, on peut s’en tenir au maximum à l’exposé des résultats de ’analyse, aux conclusions théoriques et minimiser les citations d’extraits d’entretien et l ’exposé de cas particuliers. Cette solution comporte selon moi l’inconvénient majeur de briser pour le lecteur le lien étroit entre empirie et théorie et de rendre abstraite une réflexion ancrée dans des cas particuliers. Faire œuvre de science, en ethnographie comme ailleurs, c’est aussi mettre au jour les procédures par lesquelles les résultats sont produits et permettreaux lecteurs de refaire en pensée le chemin parcouru par l’auteur.
On peut ensuite, sans s’interdire de recourir à des cas concrets, choisir de donner un minimum de détails sur les caractéristiques de chaque protagoniste jusqu’à en faire des individus définis uniquement par leur position dansune configuration donnée et non par leurs diverses appartenances qui permettent de les identifier. Il devient alors difficile, même pour un lecteur impliqué dans le cas, d’attribuer à chacun les paroles éventuellement reproduites dans le texte final. L’adoption d’un tel procédé est, au-delà d’un choix déontologique, un choix scientifique qui oriente vers une forme particulière d’ethnographie, bien décrite par Isabelle Baszanger et Nicolas Dodier, qui la nomment « combinatoire » [Baszanger et Dodier, 1997]. Or ce type d’ethnographie suppose de mettre l’accent sur les observations plus que sur les entretiens, ce à quoi mon objet se prêtait mal .Je me suis donc plutôt dirigé, d’autant que ma formation au Laboratoire de sciences sociales (ENS/EHESS) m’y poussait, vers une ethnographie que Florence Weber appelle multi-intégrative [Weber F., 2001] et qui considère que le comportement d’un individu s’explique en gra nde partie par son appartenance à différentes sphères sociales. Les entretiens approfondis ont alors notamment pour but de mettre au jour ces appartenances25. De plus, restituer ces appartenances, c’est aussi faire apparaître au lecteur les enquêtés comme des personnes plus que comme des individus, lui permettre de les identifier socialement et ainsi attribuer, au fil de l’exposé, différents actes et discours à une même personne.
On n’en parle pas
On a notamment vu dans les chapitres précédents comment une visibilité médiatique et politique croissante du handicap, conjuguée à une sur-visibilité du handicap moteur, pouvait conduire certaines personnes à accepter de me parle r des difficultés intellectuelles d’un enfant ou adolescent qui leur est proche. Est-ce à dire qu e je n’ai rencontré que des personnes engagées dans la lutte pour la reconnaissance du handicap mental, portant des revendications pour les enfants « différents » et profitant de monenquête pour faire entendre leur voix qu’ils jugeraient trop peu audible ? Oui et non. Pour mieux comprendre ce que portent les discours que j’ai pu recueillir, il faut tâcher de cerner au maximum par qui ils sont tenus et quels sont ceux qui me sont restés inaccessibles.
En parler ou pas
Comme on le verra plus en détail au prochain chapitre, le champ du handicap s’est largement constitué en s’appuyant sur les initiatives privées de personnes handicapées et de leurs parents. Il existe donc dans ce champ une tradition d’engagement, voire de militantisme, auquel une enquête, qu’elle soit journalistique ou sociologique, donne un moyen d’expression. La façon dont j’ai contacté les personnes qui ont accepté de me parler accentue cette sélection par l’engagement : le choix d’ABC É cole (une école atypique, chère, pratiquant un volontarisme scolaire opposé au laxisme supposé des instituts spécialisés) comme l’adhésion aux Papillons Blancs de Paris sont la preuve d’une démarche volontaire de prise en main du destin de l’enfant. Il faut pourtant se garder de penser que tous mes enquêtés sont des militants. Peu d’entre eux ont réellement une activité militante et certains y sont même assez allergiques, comme le père de Pierre-Yves (troubles de type aphasique, lenteur, difficultés de compréhension), Christophe Héry (enseignant, comme sa femme)1 :
(hésite)On n’est pas très associations, sans doute (hésite)en arrière-plan, y’a le refus de reconnaître le handicap, y’a un certain scepticisme sur les informations qu’ils pourraient nous apporter puisqu’on avait des tuyaux par ailleurs sur les écoles. (hésite) (dit doucement) Ma femme a longtemps, je pense, refusé de reconnaître le handicap et par exemple n’a pas voulu qu’on demande (cherche ses mots) des subsides financiers accordés pour les parents d’enfants handicapés, je pense que c’est un peu la même démarche. Alors bon, on finit par en demander¼ (s’arrête)
Et vous, de votre côté, vous voyiez les choses différemment ?
Ben pour moi, un sou c’est un sou, j’aurais bien fa it la démarche un peu plus tôt. C’est vrai que les associations, je n’avais pas très envie de m’y mettre parce qu’après c’est toujours de la paperasse, des réunions et finalement, y’a assez peu de concret, je pense. Puis c’est des projets à très long terme finalement , des associations qui ont peut-être¼ (se reprend) alors je me suis dit qu’elles pouvaient avoir un intérêt à long terme mais finalement, (cherche ses mots) on a très longtemps vécu en envisageant les problèmes à court terme et en espérant (cherche ses mots) trouver un remède qui le sortirait définitivement du groupe des enfants handicapés. Bon, ce qui était une vision fausse, évidemment. (¼) (hésite) Bon, on a pu rencontrer d’autres familles à l’occas ion de la journée¼ (hésite)une espèce de fête de l’école, et puis de la petiteassociation de parents d’élèves qui se crée en parallèle avec l’école, donc ça évidemment, c’est à la fois casse-pieds parce que finalement, on n’a pas envie d’inve stir dans ces écoles (hésite) qui rappellent des problèmes et qui confrontent au handicap. En même temps, je pense que c’est relativement bien pour Pierre-Yves qu’il y ai t la fête de l’école et puis c’est utile qu’on connaisse un peu d’autres parents même si les échanges ne sont pas très suivis. Donc ça oui, c’est un plus tout en étant un peu¼ (se reprend) même si on y va en traînant les pieds. »
Lorsque Christophe Héry se met à parler de la question des associations, son premier réflexe est d’expliquer son attitude et celle de sa femme par leur rapport plus général au handicap de leur fils. En substance, il oppose une attitude d’investissement dans le champ du handicap à une attitude de fuite hors de ce champ. La première consiste à considérer le handicap comme le font la plupart des associations, c’est-à-dire comme une limitation définitive que la société a le devoir de compenserau maximum. Elle offre des avantages en termes de réseaux de sociabilité, d’informations etd’accès à des prestations financières (l’UNAPEI gère par exemple des assurances spécifiques pour les personnes handicapées, les rentes-survies », créées en 1963). Elle contrainten revanche à donner de son temps pour des activités qui ne sont pas toujours exaltantes (« de la paperasse, des réunions »). La seconde consiste au contraire à rester le plus éloigné possible du monde du handicap, avec éventuellement l’espoir que l’enfant rattrape son retard. Selon Christophe, sa femme a longtemps adopté la première attitude tandis que lui aurait aimé mêler les deux en profitant des avantages offerts par le système de prise en charge du handicap (« un sou c’est un sou ») tout en le fréquentant le moins possible et en essayant d’en faire sortir Pierre-Yves le plus vite possible. Il reste en tous les cas dans une logique individualiste de recherche d’un intérêt immédiat pour son fils et admet avec franchise qu’œ uvrer à long terme pour autrui n’est pas leur priorité.
Même si Christophe explicite particulièrement clairement sa distance par rapport à une activité militante dans le champ du handicap, les raisons qu’il en donne s’appliquent tout à fait à bien d’autres personnes rencontrées durant l’enquête. Mes enquêtés ne sont donc pas tous, loin s’en faut, des militants du handicap, ni même forcément des personnes engagées d’une façon ou d’une autre dans cette lutte. Ils se sentent simplement « impliqués » par certains aspects au moins de la question et veulent apporter leur témoignage, faire entendre leur voix, souligner les difficultés qu’ils rencontrent ou encore donner à voir leur manière de faire, lorsqu’elle leur semble susceptible d’être rigée, au moins en partie, en modèle. C’est de cette volonté qu’ils tirent une envie et une légitimité à parler.
Une conséquence directe de cette position est que la plupart d’entre eux ont privilégié dans leur discours les aspects de prise en charge institutionnelle, la critique du système en place, les problèmes administratifs dans lesquels ils sont empêtrés. C’est particulièrement flagrant chez les pères, généralement beaucoup plusloquaces sur ces sujets que sur les relations familiales et l’entraide autour de l’enfa nt. Denis Longin, le père de Fanny, en est un parfait exemple. Je l’ai contacté après l’avoir aperçu lors d’un entretien chez son ex-compagne, Catherine Loski, qui m’avait donné ses coordonnées en me disant qu’il accepterait sûrement de me parler, mais qu’il n’était pas très bavard. Le 11 novembre 2002, j’ai donc rendez-vous dans la banque où travaille Denis ; il me propose, comme convenu, de m’emmener dans un petit restaurant marocain du quartier qu’il connaît bien. Sur le chemin du restaurant, il commence à me parler de la prise en charge du handicap en général. Une fois installés, l’entretien commence donc sur ce point et Denis se montre plus bavard que ne l’avait laissé entendre Catherine Loski. Il me développe longuement l’idée d’un manque de structures pour les enfants handicapés, surtout à Paris, et le fait que selon lui, l’Éducation Nationale est foncièrement contre le développementde l’intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, malgré le discours officiel. Cette loquacité s’estompe peu à peu, jusqu’à s’approcher du mutisme lorsque j’aborde des sujets familiaux plus délicats :
« Oui, donc quand Fanny vient chez vous, déjà elle reste plusieurs jours en général ? Ouais.
Ça se passe comment ? Plutôt le week-end, plutôt ¼ ? Ben c’est le week-end, (hésite)le week-end, les vacances.
Et qui est-ce qui s’occupe d’elle à ce moment-là ?
Ben tout le monde et personne. Enfin moi un peu plus que les autres quand même mais (hésite) elle a envie de jouer avec sa sœur, elle joue avec sa sœur, hein ! Elles s’amusent bien toutes les deux.
Parce qu’elle a une petite sœur, c’est ça ?
Oui.
Et avec votre nouvelle compagne ? Vous avez une nouvelle compagne, c’est ça ?
Oui.
Et y’a, si j’ai bien compris, une grande demi-sœur ?
Oui.
D’un premier mariage ?
Oui, vous avez pris des notes, là (rires) ! »
Si beaucoup de personnes ont donc accepté de me parler, cela ne signifie évidemment pas qu’elles ont aussi accepté de me parler de tout. Les difficultés intellectuelles rencontrées par un enfant ont un retentissement sur beaucoup de plans (organisation domestique, relations familiales, budget du ménage, relations avec les professionnels), ce qui en fait un sujet intéressant pour le sociologue, mais aussi délicat pour les enquêtés. La construction médiatique et politique du handicap que l’on a évoquée précédemment a rendu légitime, admis, quasi-public un discours sur les problèmes de prise en charge des enfants handicapés (en particulier mentaux) et explique en partie que j’aie eu si peu de difficultés à trouver des personnes disposées à « témoigner ». Mais d’autres aspects du problème n’ont pas acquis cette visibilité publique et restent des sujets intimes, dont il peut être difficile de parler ou que l’on n’estime pas dignes d’intérêt pour un sociologue. Selon sa position, on ne répartit pas forcément de la même façon les sujets entre le dicible et l’indicible, le légitime et l’illégitime, l’intéressant et l’anecdotique, le privé et le public. Les hommes ont ainsi plus tendance à estimer que les questions majeures concernent la prise en charge institutionnelle du handicap et que le sociologue se fait voyeur lorsqu’il cherche à aborder des questions familiales, domestiques. Selon les cas, le sociologue est aussi plus ou moins assigné à une fonction de journaliste (rendre publiques les difficultés des parents d’enfants handicapés mentaux) ; lorsque sa position est plus ambiguë et se rapproch e par certains aspects de celle d’un psychologue, comme par exemple chez les Courgeon (qui sont prothésiste dentaire et agent de sécurité) dont on a parlé au chapitre précédent,s leaspects privés sont plus facilement abordés, ci-dessous par Jean-Jacques, le père d’Anaïs (qui a des difficultés intellectuelles et des troubles du comportement dus à une méningite) :
J’ai fait une grosse dépression nerveuse, j’étais très malade. Je me soigne toujours. Faut rentrer dans ma vie privée, là ?
Non non, je sais pas, c’est pas dans votre ¼ On parle d’Anaïs ? Ah ! ça se peut que mon comportement peut jouer sur elle aussi. Disons que j’ai pas un caractère facile non plus, je suis pas un gars simple. J’ai encore du mal à savoi r qui je suis vraiment. C’est vrai, hein ! (¼) (5 minutes plus tard) Mais j’avais une période, j’en pouvais plus, j’étais presque suicidaire. Ben puisqu’on y est, je vais vous parler de ma vie privée, tant pis. J’ai fait une grosse dépression en 98, l’année du mariage et je uis toujours malade. Je suis sous Hyderoxa, Sérestat, j’ai été alcoolique et j’ai arrêté de boire, je suis sous médicaments pour arrêter de boire, j’ai arrêté en 91 de fumer,bon ça ¼ Je suis très fragile. Je suis quelqu’un de peut-être trop gentil. Trop gentil ettrès con. (sa femme rigole discrètement) Ben oui, ça la fait marrer ! Ma mère m’a toujours d it : ‘T’es trop gentil, t’es trop con.’ La vie, elle m’a pas toujours aidée. J’aurais voulu que mes parents me soutiennent beaucoup plus. Ce que je fais pour Anaïs, c’est l’amour, c’e st ce que j’aurais voulu. »
Mes thèmes d’entretien permettaient aisément de mettre en évidence les réticences et les propensions à parler de certains sujets plutôt que d’autres. Lorsque c’était possible (c’est-à-dire lorsque mon interlocuteur ne bouleversait pa s cet ordre), je commençais par faire retracer la vie de l’enfant depuis sa naissance, en insistant sur sa trajectoire scolaire (ou institutionnelle lorsqu’il ne s’agissait pas à prop rement parler d’écoles) et ses apprentissages, sa trajectoire médicale (les différents professionnels vus, ce qu’ils avaient dit, les relations avec eux) et sa trajectoire administrative (relations avec les commissions pour l’enfance handicapée, démarches éventuelles de reconnaissancedu handicap). Je proposais ensuite d’établir un arbre de famille comportant les personnes qui « comptent » pour l’enfant, puis de détailler les relations avec ces personnes, en insistant sur l’organisation matérielle autour de l’enfant (et ses évolutions). La première partie del’entretien était la plus attendue par mes enquêtés et celle qui leur semblait la plus naturelle pour un entretien sociologique. La deuxième partie était souvent plus difficile à mener, même si aucun entretien ne s’est mal passé ou arrêté en cours de route. On me demandaiten revanche plus souvent de justifier pourquoi je m’intéressais à ces questions domestiques et notamment à quoi un arbre de famille pouvait bien me servir.
Les usages pratiques des discours professionnels
Les parents des enfants et adolescents ayant des difficultés intellectuelles ne sont pas les seuls à en parler. Les journalistes et les homm es politiques peuvent ainsi prétendre à une parole légitime sur ce terrain. Mais ceux dont la parole est sûrement la plus écoutée, a le plus de force et de pouvoir de coercition sur ceux qui l’écoutent, sont les professionnels plus ou moins spécialistes de l’enfance handicapée, c’est-à-dire les médecins (en particulier les psychiatres), les psychologues, les psychanalystes mais aussi les orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs, rééducateurs et d’autres encore [Gardou, 1997] dont le statut professionnel, garantissant symboliquement leurs connaissances sur les sujets » qui les concernent, est un gage de compétence et donc de légitimité à parler et à être écouté [Hughes, 1996b].
Les parents que j’ai rencontrés sont tous en interaction avec des professionnels du secteur de l’enfance handicapée. Face aux diagnostics, aux explications, aux conseils, mais aussi aux silences, fournis par ces professionnels, ils ne sont pas dépourvus de toute marge de manœuvre et se construisent au contraire leur propr e façon de penser et de dire les problèmes de leurs enfants. Cette partie est consacrée à réfléchir au statut, aux significations et aux conséquences de ces manières de penser et de dire,qui sont liées à des façons de faire, par rapport aux discours professionnels. Les questions les plus évidentes qui se posent portent sur les interactions entre discours parentaux et discours professionnels : en quoi les premiers sont une reprise, une traduction ou au contraire manifestent une opposition aux discours professionnels ? Quelles formes de résistance aux discours professionnels peuvent exister de la part des parents, et de quels parents ? Quels sont les enjeux des relations entre parents et professionnels ? Bref, en quoi les discours profanes diffèrent-ils des discours professionnels ?
Cette façon de poser la question de l’opposition pr ofanes/professionnels n’est pourtant pas entièrement satisfaisante, et ceci pour au moins trois séries de raisons. La première concerne l’opposition sous-jacente entre discours et pratiques. Ainsi posée, la question semble en effet concerner le seul domaine discursif, qui renvoie aux stratégies argumentatives et aux représentations, inconscientes ou non, sur lesquelles elles s’appuient. Or, de même que les discours professionnels (en particulier dans le cas du diagnostic) sont tout entiers tournés vers une pratique médicale (à tel point qu’un diagnostic qui n’ouvre aucune possibilité thérapeutique est souvent tu), les discours parentaux sont d’emblée pris dans des décisions à la fois ponctuelles (le choix d’une forme de prise en charge institutionnelle, par exemple scolaire, qui fera l’objet de la troisième partie) et quotidiennes (les choix d’organisation domestique autour de l’enfant, qui feront l’objet d e la quatrième partie). Se pencher sur les discours parentaux et leurs relations avec les discours professionnels, ce n’est donc aucunement renoncer à une sociologie des pratiques, comme le fait remarquer Anne Paillet à propos d’autres discours, ceux des professionnels de la réanimation néonatale :
Les multiples sortes de discours, de catégories et de mots qui sont chaque jour mobilisés dans un service hospitalier font partie du tissu même des pratiques. ¼() C’est non seulement parce qu’elle est en soi une ‘pratiqu e’ que la ‘parole sur la pratique’ fait partie intégrante de mes matériaux, mais aussi parce qu’elle est une ‘parole sur la pratique’. » [Paillet, 2007, p. 110-111].
Et plutôt que de m’intéresser aux « représentations » des uns et des autres, comme si le stock d’images sociales utilisables par la pensée était donné en dehors de tout contexte, je préfère parler de « théories diagnostiques », qui mettent d’emblée l’accent sur le lien entre manières de penser, de dire et de faire. Ce sera l’objet de l’ensemble de la partie de préciser petit à petit ce que j’entends par « théories diagnostiques » et de décrire les grandes modalités des théories diagnostiques parentales.
En second lieu, l’idée d’une opposition entre discours professionnels et discours profanes me pose problème dans la mesure où elle réifie l’opposition entre ces deux vastes ensembles. Pour commencer, il n’est pas du tout sûr que le qualificatif de « profane » s’applique bien aux parents d’enfants dits handicap és mentaux. Les caractériser ainsi, c’est gommer la différence de position primordiale qui les sépare de tous ceux qui n’ont pas affaire directement au handicap, que l’on peut aussi qualifier de profanes et qui peuvent aussi tenir des discours sur le handicap. C’est finalement nier qu’en dehors du monde professionnel, il puisse exister des connaissances, des savoirs spécifiques, qui naissent par exemple d’une fréquentation quotidienne de l’enfant. Mais opposer profanes et professionnels, c’est aussi nier, ou en tout cas minimiser, l’extraordinaire hétérogénéité interne qui caractérise ces deux ensembles. D’un segment professionnel à l’autre com me d’une famille à l’autre (par exemple selon le milieu social d’appartenance), les discours sur des adolescents dits handicapés mentaux varient très fortement. Et au sein même d’un couple parental, il n’est pas rare que des divergences de vue importantes sur la façon de considérer les problèmes de l’enfant existent. Malgré ces réserves, je centrerai malgrétout le propos dans cette deuxième partie sur ce qui oppose, du fait de leurs positions différentes, parents et professionnels. Sans nier l’hétérogénéité de ces deux ensembles, ni ravalers lparents au rang de simples profanes, je m’attarderai dans cette partie sur les différences de point de vue entre parents et professionnels, en renvoyant aux parties suivantes une analyse plus fine des différences de point de vue entre parents.
Enfin, mettre l’accent sur l’opposition entre disco urs profanes et discours professionnels pousse souvent, dans une logique interactionniste au sens restrictif, à faire l’impasse sur la genèse de ces discours, sur les conditions historiques et sociales qui les ont modelés et qui expliquent en partie leur forme actuelle. C’est pourquoi je propose de faire, dès le prochain chapitre, un détour par l’histoire qui permette de saisir, dans le prolongement des analyses de la première partie, en quoi le handicap mental d’un enfant est quelque chose de fortement « problématique » (toujours au sens de Michel Foucault) pour ses parents, quelque chose qui inspire honte et culpabilité, en particulier pour les mères. Cette culpabilité peut être considérée comme l’une des racines, l’un des moteurs de la « quête diagnostique », pour reprendre l’expression d’Anselm Strauss et Juliet C orbin [1988], dans laquelle se sont lancés tous les parents que j’ai rencontrés, et qui fera l’objet du chapitre 5. Les deux derniers chapitres se centreront plus directement sur les relations entre parents et professionnels, d’abord vus en termes d’opposition (chapitre 6), pu is plus largement en termes d’interaction, ce qui permettra d’introduire la notion de théories diagnostiques (chapitre 7).
La genèse sociale de la culpabilité
Le processus de « problématisation » du handicap mental, décrit durant la première partie, donne une connotation morale au handicap mental : celui-ci pose problème non seulement du fait des limitations qu’il implique, mais aussi des sentiments moraux qu’il suscite, qui oscillent entre pitié, compassion et méfiance, un mélange subtil qu’Erving Goffman [1975] a contribué à disséquer dans son étude générale sur les « stigmates ». Du point de vue des parents d’adolescents dits handicapés mentaux que j’ai rencontrés, on retrouve des sentiments complexes, qui tournent souvent autour de la honte et de la culpabilité, bien qu’ils soient parfois enfouis derrière des attitudes revendicatives ou enthousiastes.
Comment comprendre ces sentiments sans recourir à d es explications psychologisantes toutes faites ? Un détour par l’histoire de la catégorie de handicap mental, les institutions qui ont jalonné son chemin et les enjeux politiques et moraux qui s’y sont attachés permet d’y voir plus clair et de donner aux sentiments et discours observables aujourd’hui une profondeur historique et sociale qui, si elle n’explique évidemment pas tout, fournit un arrière-plan indispensable. Que recouvre la catégorie de handicap mental, hier et aujourd’hui ? À quelles valeurs a-t-elle pu, plus o u moins durablement, être associée ? Et surtout quelles conséquences ces associations peuvent-elles avoir sur les parents d’enfants dits handicapés mentaux aujourd’hui ?
Plus précisément, ces analyses socio-historiques vont être articulées avec les problèmes spécifiques aux parents que j’ai rencontrés qui, je le rappelle, ne sont pas n’importe quels parents. Comme on l’a vu lors de la première partie, ce sont des parents impliqués dans la prise en charge du handicap de leur enfant, qui appartiennent souvent à des milieux sociaux favorisés et qui disposent en tout cas toujours de ressources suffisantes pour se sentir légitimes à tenir un discours argumenté sur leur enfant devant un sociologue. Pour ces parents, les formes de dévalorisation sociale induites par le handicap pèsent d’un poids particulier, que l’on va tâcher d’apprécier.
Le handicap mental, entre criminalisation et médicalisation
Une lecture historique (trop) rapide des avatars de la catégorie de handicap mental pourrait inciter à penser son évolution de manière linéaire, d’une criminalisation à partir du ème ème ème siècle. Une analyse plus attentive montre que la réalité est bien plus complexe et que les valeurs attachées aujourd’hui au handicap mental mêlent bien souventles deux optiques.
Il faut dire que la catégorie de handicap mental a été construite par des définitions qui forment comme des strates successives, proposées par des acteurs issus de segments professionnels les plus divers (psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres, psychologues, psychanalystes). Aujourd’hui, le handicap mental recouvre un ensemble composite de déficiences intellectuelles, qui sont parfois associées (en tant que cause, conséquence ou sans lien causal déterminé) à des troubles du comportement. Pour les parents d’enfants qui entrent dans ces catégories, il est difficile de s’abstraire des connotations que plusieurs siècles d’histoire ont amoncelées.
Handicap mental et criminalisation
Les analyses de Michel Foucault [2006] sur le « grand renfermement » survenu un peu partout en Europe au XVIIème siècle sont bien connues. Il montre comment, pour prendre l’exemple de la France, la création de l’Hôpital général a été l’occasion d’interner en un même lieu toutes sortes de personnes mettant potentiellement en péril l’ordre social et moral. L’édit royal du 27 avril 1656 vise la « masse un peu indistincte » [Foucault, 2006, p. 90] des mendiants et des oisifs :
Faisons très expresses inhibitions et défenses àtoutes personnes de tous sexes, lieux et âges, de quelque qualité et naissance et en quelque état qu’ils puissent être, valides ou invalides, malades ou convalescents, curables ou incurables, de mendier dans la ville et faubourgs de Paris, ni dans les églises, ni aux portes d’icelles, aux portes des maisons ni dans les rues, ni ailleurs publiquement, ni en secret, de jour et de nuit » [Foucault, 2006, p. 92]
L’association entre pauvreté, immoralité et criminalité se durcit alors et s’incarne dans le projet même de l’Hôpital général :
Aussi bien l’Hôpital général n’a-t-il pas l’allure d’un simple refuge pour ceux que la vieillesse, l’infirmité ou la maladie empêchent detravailler ; il n’aura pas seulement l’aspect d’un atelier de travail forcé, mais plutôt d’une institution morale chargée de châtier, de corriger une certaine ‘vacance’ morale, qui ne mérite pas le tribunal des hommes, mais ne saurait être redressée par la seulesévérité de la pénitence. L’Hôpital général a un statut éthique. [Foucault,» 2006, p. 103]
Il ne faut pas s’étonner de cette indifférence que l’âge classique semble opposer au partage entre la folie et la faute, l’aliénation et la méchanceté. Cette indifférence n’est pas d’un savoir trop fruste encore, elle est d’une équivalence choisie de façon concertée et posée en connaissance de cause. Folie et crime ne s’excluent pas ; mais ils ne sont pas confondus dans un concept indistinct ; ils s’impliquent l’un l’autre à l’intérieur d’une conscience qu’on traitera aussi raisonnablement, et selon ce qu’imposent les circonstances, par la prison ou par l’hôpital. » [Foucault, 2006, p. 182]
Malgré la naissance et le développement rapide de al psychiatrie au XIXème siècle, dont le projet classificatoire [Goldstein, 1997] remet en cause l’indistinction sur laquelle repose l’Hôpital général, l’association latente entre arriération mentale (elle-même associée à l’inutilité sociale, parfois à la folie) et criminalité persiste, dans les esprits du plus grand nombre comme dans de nombreux écrits de spécialiste. La notion de « dégénérescence », que partir de ses études sur les « crétins », met ainsi en valeur l’importance de l’hérédité comme facteur de transmission de tares résultant de certaines conditions de vie, comme l’alcoolisme ou le manque d’hygiène. Lombroso parlera même quelque temps plus tard de « maladie sociale », avec l’idée d’une liaison entre déchéance sociale, criminalité et débilité mentale [Stiker, 1997 et 2001].
Cette liaison entre handicap mental et délinquance va occuper une place importante dans les représentations jusqu’à aujourd’hui, confortée par les analyses du nouveau discours psychiatrique de l’entre-deux-guerres, comme le montrent Patrice Pinell et Markos Zafiropoulos :
On voit donc (…) le mixage réalisé entre la psych ologie génétique, la psychométrie, la psychanalyse et la génétique. Ces différents corpsd’explication parcellaire sont utilisés pour donner un fondement scientifique à la liaison inadaptation-personnalité fragile-délinquance. »[Pinell et Zafiropoulos, 1978, p. 31]
L’association entre ce qu’on appellera bientôt le h andicap mental et la délinquance va se poursuivre dans les années 50 en se focalisant sur les « bandes de blousons noirs », nouvelle figure de la délinquance populaire érigéepar les média de l’époque en fléau social. Or Patrice Pinell et Markos Zafiropoulos montrent que pour nombre de neuropsychiatres de l’époque [Fau et alii, 1966], ces bandes sont composées de diverses sortes de « débiles » : Dans ce discours [celui de Fau et alii, 1966], les bandes de blousons noirs sont représentées comme composées en partie par des ‘débiles qualitatifs’, éléments structurants du groupe ‘asocial’ et, en partie, par des débiles quantitatifs (débiles légers pour la plupart, plus rarement débiles moyens), fournissant la masse de manœuvre. »
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
PREMIÈRE PARTIE (INTRODUCTIVE) DES ENFANTS DONT ON PARLE ?
CHAPITRE I. ON EN PARLE
CHAPITRE II. COMMENT EN PARLER ?
CHAPITRE III. ON N’EN PARLE PAS
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
DEUXIÈME PARTIE LES USAGES PRATIQUES DES DISCOURS PROFESSIONNELS
CHAPITRE IV. LA GENÈSE SOCIALE DE LA CULPABILITÉ
CHAPITRE V. LES ENJEUX DE LA QUÊTE DIAGNOSTIQUE
CHAPITRE VI. FACE AUX DISCOURS PROFESSIONNELS
CHAPITRE VII.DES DISCOURS PROFESSIONNELS AUX THÉORIES DIAGNOSTIQUES
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
TROISIÈME PARTIE LES ENJEUX INSTITUTIONNELS DES THÉORIES DIAGNOSTIQUES
CHAPITRE VIII. À CHAQUE ENFANT SON ÉTABLISSEMENT ?
CHAPITRE IX. LA PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE VUE PAR LES PARENTS
CHAPITRE X. LES ENSEIGNEMENTS D’UN CHOIX ATYPIQUE
CHAPITRE XI. LE PARCOURS DU COMBATTANT POUR TOUS ?
CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE
QUATRIÈME PARTIE LES ENJEUX FAMILIAUX DES THÉORIES DIAGNOSTIQUES
CHAPITRE XII.LA FAMILLE À L’ÉPREUVE
CHAPITRE XIII. CONSTRUCTION ET FRONTIÈRES DE LA MAISONNÉE
CHAPITRE XIV. TROUVER SA PLACE DANS LA MAISONNÉE
CHAPITRE XV. DES FAMILLES EN RECOMPOSITION
CONCLUSION DE LA QUATRIÈME PARTIE
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE
Télécharger le rapport complet