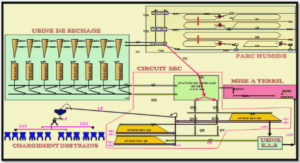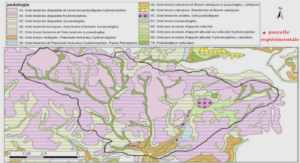Le terme Anthropocène a récemment été proposé comme qualificatif de la période en cours depuis la fin du XVIIIe siècle, caractérisée par des altérations d’origine humaine de la structure et du fonctionnement biophysique du système terrestre à l’échelle planétaire (Crutzen, 2002). Résultant majoritairement de l’altération des cycles biogéochimiques globaux de carbone, d’azote et d’eau, l’influence des activités humaines porte à la fois sur le climat, la biodiversité et la structure des écosystèmes et conduit à des changements globaux irréversibles ou susceptibles de persister sur plusieurs millénaires (McNeill, 2001, Hansen et al., 2005, Steffen et al., 2007).
L’Anthropocène fait partie de l’ère géologique de l’Holocène qui englobe l’époque postglaciaire des derniers dix à douze milliers d’années, caractérisée par l’élévation d’origine non-anthropique des concentrations atmosphériques de CO2, des températures moyennes, et par la naissance, vers le début de l’Holocène, de l’agriculture qui représente un mode de subsistance inédit dans l’histoire naturelle. La production des subsistances et les pratiques qui l’accompagnent se sont progressivement substituées au mode de vie, non-sédentaire, des groupements de chasseurs-cueilleurs qui, comme toute autre espèce animale, dépendaient de la productivité des écosystèmes naturels. Accordant un pouvoir considérable aux sociétés qui l’adoptaient, l’agriculture a longtemps constitué un facteur déterminant du rapport de force entre différents groupes de populations (Diamond, 1997) et a constitué l’instrument de la domination humaine sur la nature : l’homme transforme les écosystèmes naturels en agro-systèmes abritant les espèces de son choix et entre en compétition directe avec toutes les autres espèces végétales et les animaux qui dépendent de celles-ci pour leur alimentation et leur habitat.
Le pouvoir de l’agriculture réside dans le contrôle qu’elle induit sur la production primaire des écosystèmes (Vitousek et al., 1986). Par unité de surface cultivée, plus de 90 % de la biomasse produite est potentiellement métabolisable par les hommes et le bétail contre environ 0,1 % par unité de surface d’écosystème naturel (Diamond, 1997). L’essor de la production agricole est tel qu’à la fin du XXe siècle, l’homme et son bétail étaient estimés représenter environ 97 % de la biomasse de l’ensemble des vertébrés terrestres (Smil, 1992).
La filière « viande »
Par opposition à l’élevage faisant l’objet d’une autoconsommation, l’approvisionnement en viande d’une ville fait appel à une filière plus ou moins complexe, nécessitant plusieurs manipulations entre la production à la ferme et l’achat par les consommateurs. L’abattage des animaux peut survenir soit proche de la ville dans des tueries ou des abattoirs – ce qui présuppose le transport du bétail vivant – soit proche des lieux d’élevage, ce qui présuppose des moyens de transport munis des technologies de conservation. Jusqu’au début du XXe siècle, l’approvisionnement des villes françaises s’effectue majoritairement sous forme d’animaux vivants, qui s’y rendent (quasi-) exclusivement à pied jusqu’au début des années 1850 puis, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, de plus en plus en chemin de fer. On peut distinguer quatre étapes incontournables dans l’approvisionnement d’une ville en animaux vivants : la production chez l’éleveur, le transport, la présentation des bestiaux aux marchés de vif et la transformation en viande par les bouchers chez qui s’approvisionne le public. Toutefois, plus le milieu desservi est peuplé, plus le nombre des intermédiaires est important et leur spécialisation poussée. Par exemple, dans le cas des grandes villes munies des abattoirs, la chaine d’approvisionnement comporte une étape supplémentaire qui témoigne d’une structure davantage spécialisée : des bouchers de gros achètent des bêtes dans les marchés aux bestiaux, les découpent et les dépècent, avant qu’elles soient apprêtées par le boucher détaillant chez qui s’approvisionne le public (Fouéré, 1939). En revanche, lorsque l’approvisionnement s’effectue au moyen des envois de viande morte, abattue proche des lieux d’élevage, la chaine de l’approvisionnement s’inverse : les bouchers sont décentralisés, le transport s’effectue sous conditionnement et les viandes introduites aux marchés alimentaires sont prêtes à consommer.
Se trouvant en tête de l’urbanisation française, la ville de Paris a été ravitaillée dans l’histoire récente à travers des structures en voie d’exploration, non pas sans susciter des inquiétudes de la part de l’administration. C’est ce qui a conduit les gouvernants sous le règne de Louis XIV d’exprimer l’espoir «que le trop grand accroissement de la capitale ne devint pas le principe de sa perte » (cité dans Husson, 1856). L’histoire récente de l’approvisionnement parisien en viande, illustre les évolutions de la filière sous la pression de l’urbanisation et en fonction du développement des technologiques de transport et de conservation.
Au début du XIXe siècle, six marchés situés à l’intérieur ou aux alentours de Paris en assuraient l’essentiel de l’approvisionnement en viande : Sceaux, Poissy, Bernardins, Maison Blanche, la Chapelle et Saint-Germain. Situés dans les communes homonymes, les marchés de Sceaux et de Poissy, actifs depuis au moins XVIIe siècle (Abad, 2002), se spécialisaient en bovins et en moutons et en assuraient la majorité des apports. Le marché de la commune de Saint-Germain assurait l’essentiel de l’approvisionnement en porcs alors que les marchés des Bernardins, situé intramuros, et ceux de La Chapelle et de la Maison Blanche, situés en périphérie, se partageaient entre les bœufs et les porcs mais leur apports étaient d’une importance secondaire (Coffignon, non daté).
Nécessaires pour rassembler des crédits, centraliser les importations de bestiaux depuis les régions d’élevage, réguler les prix et faciliter les inspections hygiéniques, les marchés aux bestiaux se sont institués bien avant les abattoirs publics (Philipp, 2004). Au début du XIXe siècle, ils constituaient des points exclusifs pour l’approvisionnement des bouchers parisiens (Leteux, 2005), qui conduisaient ensuite les animaux dont ils étaient devenus propriétaires à l’intérieur des fortifications pour les abattre. Jusqu’au début du XIXe siècle, la situation des abattages était beaucoup plus floue que celle des marchés et dans une certaine mesure contradictoire avec la salubrité recherchée par les inspections vétérinaires au sein de ces derniers. Alors qu’à l’origine les bêtes ne devaient être abattues que sur les bords de la Seine afin de faciliter l’évacuation des déchets et le lavage des carcasses, les bouchers se sont affranchis de cette obligation et ont pris l’habitude de tuer les animaux dans leurs boutiques ou en pleine rue, malgré les nuisances liées aux abats et sang qui pourrissaient, donnant lieux à des protestations des citadins. Les boucheries se sont ainsi mises à remplir la double fonction de tuer et de vendre de la viande faisant de la ville une vaste tuerie (Coffignon, non daté). Le cartier du Châtelet, bien qu’étant le cœur géographique et le ventre de Paris, était nommé l’endroit le plus puant du monde entier , résultant du pourrissement lent des restes des abattages exhalant une puanteur insoutenable (Chemla, 1994).
La filière « lait »
L’approvisionnement en lait frais relève d’une structure plus simple au sein de la ville par rapport à la viande : il nécessite moins d’intermédiaires et subit toute transformation à proximité du lieu de production. C’est peut-être pour cette raison que l’on trouve peu d’information sur l’approvisionnement en cet aliment. Celui-ci n’a fait l’objet d’aucune statistique officielle au XIXe et au début de XXe siècle et a été peu étudié de manière systématique (Dubuc, 1938, Flandrin et Montanari, 1996). Néanmoins l’approvisionnement en lait sain, riche et bien conservé pour une grande cité comme Paris en une époque des technologies de transport et de conservation rudimentaires, représentait des défis sanitaires et organisationnels complexes qui conviendrait pourtant de résoudre au vu du rôle particulièrement bienfaisant de cet aliment chez les enfants, les vieillards et les convalescents (Dubuc, 1938, Huard, 1939). Pour ces raisons, les différences entre l’approvisionnement en viande – aliment caractérisé par une certaine autonomie de transport – et en lait – denrée volumineuse et périssable dont l’acheminement exige impérativement la rapidité des moyens de transport et leur équipement en dispositifs de conservation – sont fondamentales.
On sait depuis le temps de Pasteur que le lait constitue un milieu idéal pour le développement rapide des microbes pathogènes et que son altération s’accélère sous l’action des températures élevées. Ainsi, consommer du lait ailleurs qu’à l’endroit de sa production, présuppose des mesures de prévention des conditions défavorables, la manière la plus simple et intuitive d’y parvenir étant de minimiser les distances de transport. Pourtant, antérieurement à l’apparition du chemin de fer, le transport du lait n’était pas vraiment une option, le commerce s’était donc structuré d’une manière toute particulière : au lieu d’importer du lait frais, les villes étaient directement équipées des vaches laitières importées des régions d’élevage (Fanica, 2008). L’offre se trouvait ainsi à proximité physique directe de la demande et la traite des vaches se faisait au seuil des maisons ou, au pire, dans les marchés .
On ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre des vaches vivant à l’intérieur des fortifications de Paris au début du XIXe siècle – les effectifs que l’on trouve ça et là dans la littérature sont la plupart du temps déduits des quantités de lait vendues à partir des hypothèses de production laitière unitaire. Toutefois, le commerce laitier s’était structuré autour des nourrisseurs – des petits propriétaires de vacheries – qui livraient eux-mêmes le lait sitôt trait aux habitants (Huard, 1939). De manière analogue aux boucheries particulières du début du XIXe siècle, les vacheries garantissaient en grande partie le ravitaillement en lait de la capitale avant que des structures plus élaborées soient mises au service de l’approvisionnement afin de rattraper la demande croissante de la population pour cette précieuse denrée. Au fait, le déséquilibre en termes de concentration spatiale entre l’offre et la demande s’est véritablement fait sentir dans la deuxième moitié du XIXe siècle sous le double effet de la croissance démographique et du recul de la production départementale (Dubuc, 1938). Le recours aux apports de chemin de fer pour palier à ce déséquilibre a en retour conduit à bouleverser l’organisation de la filière, en raison à la fois de l’accroissement du nombre d’intermédiaires nécessaires pour assurer le service et du regroupement des arrivages de lait en une poignée des points au sein de la ville. Le besoin de gestion et de redistribution des tonnages relevait d’une étape supplémentaire dans la chaîne d’approvisionnement. Tout ceci a engendré un nouveau déterminisme spatial aussi bien au sein de la ville que dans les lieux de production et de chargement des trains d’expédition de lait.
|
Table des matières
Introduction
Chapitre 1 : Evolution de la structure d’approvisionnement en viande et en lait de la capitale : quelques éléments historiques, XIXe – XXIe siècles.
1.1. La filière « viande »
1.2. La filière « lait »
1.3. Conclusion
Chapitre 2 : Démographie parisienne et consommation de viande et de lait, XIXe -XXIe siècles
2.1. Préalable
2.2. Evolution démographique de Paris, XIXe – XXIe siècles
2.3. Consommation de viande de l’agglomération parisienne
2.4. Consommation de lait de l’agglomération parisienne
2.5. Conclusion
Chapitre 3 : Géographie de l’approvisionnement parisien en viande et en lait et taux d’appropriation des subsistances régionales, XIXe – XXIe siècles.
3.1. Généralités
3.2. Données et méthodes de calcul
3.2.1. Données sur les provenances des importations parisiennes
3.3.2. Données sur la production totale du territoire. Comment comparer les importations au potentiel de production
3.3. Géographie de l’approvisionnement en viande et en lait et taux d’appropriation du potentiel de production
3.3.1 Début XIXe – début XXe siècle
3.3.2 Début XXIe siècle
3.4. Conclusion
Chapitre 4 : Reconstitution des rations animales
4.1. Généralités
4.2 La notion des besoins
4.3 Méthodes et données pour le calcul des besoins de production, XIXe – XXIe siècles
4.3.1 Viande porcine
4.3.2 Viande et lait bovins
4.4 Disponibilité fourragère et reconstitution des rations, XIXe-XXIe siècles
4.4.1. Généralités
4.4.2 Evolution de la disponibilité fourragère, XIXe – XXIe siècles
4.4.3 Les rations animales XIXe – XXIe siècles
4.5 Conclusion
Chapitre 5 : L’empreinte spatiale de l’alimentation parisienne, XIXe -XXIe siècles
5.1 Généralités
5.2 Méthode de calcul de l’empreinte spatiale
5.3 Aliments d’importation et localisation de l’empreinte
5.3 L’empreinte spatiale de la consommation parisienne, XIXe – XXIe siècles
5.4 Conclusion
Chapitre 6 : L’empreinte azote de l’approvisionnement parisien
6.1 Introduction
6.2 Les composantes de l’empreinte azote
6.3 Empreintes N brute et nette de l’approvisionnement parisien, XIXe – XXIe siècles
6.3.1 Inputs d’azote dans les surfaces nourricières locales
6.3.2 Inputs d’azote dans les surfaces nourricières externes
6.3.3 Les empreintes brute et nette de l’approvisionnement parisien
6.4 Partage de l’Emp_N-nette locale en empreinte N utile et en profondeur de l’empreinte, XIXe – XXIe siècles
6.4.1 Les cheptels approvisionnant Paris comme fraction des cheptels régionaux
6.4.2 Calcul de l’azote exporté sous forme de fumure des exploitations d’élevage
6.4.3 Profondeur et Empreinte_N-utile de l’approvisionnement parisien, XIXe – XXIe siècles
6.5 Conclusion
Chapitre 7 : L’empreinte hydrique de l’approvisionnement parisien
7.1 Généralités
7.2 Méthodes et données
7.2.1 L’empreinte hydrique quantitative
7.2.2 L’empreinte hydrique qualitative
7.3 L’empreinte hydrique de l’approvisionnement parisien, XIXe – XXIe siècles
7.4. Conclusion
Conclusion générale
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet