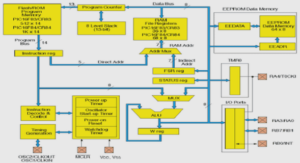Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les difficultés rencontrées lors du passage dans les études supérieures
Ici, il s’agira de revenir sur les difficultés que les enfants d’ouvriers peuvent être amenés à rencontrer lors de leur passage dans les études supérieures. L’on va donc aborder pour cela les questions d’ordres social, culturel, économique, institutionnel, pédagogique et organisationnel, avant de faire un focus sur la filière droit puisqu’il s’agit de celle qui retiendra toute notre attention dans le cadre de cette recherche.
Des difficultés sociales, culturelles et économiques
En nous centrant sur un ensemble d’études concordantes fondées sur l’analyse des données statistiques, il apparait que le capital culturel et l’habitus sont corrélés à la question de la réussite scolaire et ce de manière d’autant plus marquée à mesure que l’on progresse dans les niveaux d’enseignement. Il semblerait en fait que l’école tende à perpétuer les inégalités sociales dans le champ scolaire de manière assez marquée et ce, à travers des méthodes et contenus d’enseignement qui privilégient implicitement une culture propre aux classes dominantes (l’exemple connu des cours magistraux). Elle fait fructifier le capital culturel que certains possèdent déjà, une culture libre jugée plus légitime, du non explicite et des « allant de soi » que les cultures dominantes ont déjà. Il y a dès lors une inégale distance vis-à-vis de cette culture libre et légitime (Bourdieu et Passeron, 1964). L’ « héritier » comme les auteurs le nomment, possède toutes les règles implicites propres à la forme scolaire en vigueur et favorables à son enseignement, ce qui n’est pas le cas de l’enfant d’ouvrier qui se sent en dehors de ces codes et qui doit presque tout apprendre à l’entrée en études supérieures. La culture scolaire contribue donc fortement à la reproduction des inégalités sociales.
De facto, les héritiers sont les élèves qui partent avec un bagage socio-culturel important L’héritage culturel des élèves possède donc un rôle capital dans leur rapport à l’école. Cet héritage se constitue d’un ensemble de codes sociaux, de règles, de savoir-faire, savoir-être, savoir parler, savoir-dire et de savoirs au sens large (que l’on nomme habitus de classe et donc des prédispositions sociales) qui seraient l’apanage des classes aisées. C’est pourquoi ces élèves disposeraient de davantage de chances à l’école en général (peu importe le niveau d’enseignement, même s’il est vrai que cela s’accentue d’autant plus à mesure que l’on progresse comme souligné plus haut), lieu où ce sont les codes sociaux des classes favorisées qui dominent. Les autres élèves, quant à eux, ne bénéficient pas de la même culture libre et légitime, du même vocabulaire propre à la culture scolaire attendue, leur rapport au savoir est différent. De fait, « les temps de primes socialisations jouent un rôle décisif dans la formation des premières dispositions mentales et comportementales qui vont les marquer durablement. Or, ces dispositions ne sont jamais “neutres” socialement : elles constituent autant de ressources économiques, culturelles, scolaires, langagières, morales, corporelles ou sanitaires, ou, au contraire, des obstacles, ou ce qu’il faut bien nommer des handicaps à la réussite tant scolaire que professionnelle. » (Lahire, 2019, p.13). Les bouleversements découlant du passage en études supérieures sont a fortiori vécus plus difficilement en fonction des familiarités que l’étudiant possède vis-à-vis de la culture scolaire, et donc par extension de son habitus (Boyer, Coridian et Erlich, 2001).
Ainsi, il peut être intéressant de se questionner sur le rapport au langage qu’il soit écrit ou oral, et de ce que cela traduit sur le passage des inégalités sociales aux inégalités scolaires. Si Bourdieu et Passeron (1964, 1970) ont mis en exergue la violence symbolique générée par le langage dans leurs diverses recherches, Bernstein (1975), a établi un lien entre le langage et les codes socio-linguistiques, et la classe sociale. Selon lui le langage structure l’expérience des individus et détermine les rôles sociaux. Il y aurait alors une dichotomie entre deux types de code linguistique qu’il qualifie de code « élaboré » et de code « restreint », lesquels s’appuient sur un niveau linguistique (« par la prévisibilité de la structure syntaxique »), sur un niveau psychologique (« par la facilité de verbalisation des intentions ») et enfin sur un niveau comportemental (« par des modes d’autorégulation différents »). Les travaux de Bernstein ont ainsi montré que les enfants de classes populaires ont davantage recours à un langage commun et familier et à des codes restreints, tandis que les enfants issus de classes aisées usent de formes verbales plus complexes, de mots et expressions plus « rares » et d’une façon de parler que l’on qualifierait de plus éloquente, réfléchie et complexe, en somme de codes élaborés. Verret (1986) a également noté un écart entre la culture ouvrière et la culture scolaire en termes de langage notamment écrit. Il explique à ce titre que les individus issus de classes ouvrières ont plus de mal à faire preuve d’abstraction. Selon lui, si l’individu veut surmonter cet écart, cela implique de se séparer de sa propre culture. Lahire (1993) s’est réinterrogé sur cette question quelques années après. De ses travaux sur le sujet, l’on retiendra ici que le langage possède un poids non négligeable dans tous les champs sociaux quels qu’ils soient et notamment à l’école, où le lexique utilisé découle des classes aisées, mettant d’entrée de jeu les élèves issus de milieux défavorisés à l’écart. C’est donc un véritable instrument de pouvoir et de domination. L’auteur voit dès lors le langage comme facteur explicatif de l’échec scolaire chez les personnes d’origine populaire dans la mesure où il n’est pas seulement affaire de communication au sens propre, mais renvoie également à des facteurs cognitifs et au rapport au savoir entre autres. Ainsi, Terrail (2002) revient sur l’idée selon laquelle, en fonction de notre capital culturel et, par extension, de notre socialisation et notre héritage familiaux, nos aptitudes scolaires diffèrent. Néanmoins, contrairement à Bourdieu ou encore Lahire, Terrail n’opère pas de dichotomie formelle entre les classes populaires et les classes aisées. La principale thèse avancée consiste plus à dire que la réussite scolaire est affaire de rapport au langage, qu’il soit écrit ou oral et que c’est par cette entrée qu’il pourra y avoir apprentissage. Par conséquent, c’est ce rapport au langage qui est à l’origine de l’inégalité scolaire selon lui. C’est donc sur ce point qu’il faudra être vigilant et c’est de cette façon qu’on pourra rendre l’école démocratique. Mais qu’en est-il une fois arrivé en études supérieures s’agissant du domaine qui nous intéresse ici ?
Dans une enquête réalisée auprès d’étudiants durant leur première année d’études supérieures, Erlich (2003) a souligné qu’il fallait une maitrise des codes d’écriture ainsi qu’une maitrise du lexique disciplinaire dès l’entrée en études. En effet, les enseignants considèrent que les étudiants doivent savoir maitriser toutes les règles de la langue mais également la méthodologie comme celle de la dissertation. Or, ces codes académiques peuvent échapper aux étudiants ayant toujours présenté des difficultés à cet égard et qui ne disposent pas des prédispositions nécessaires à l’exercice de la dissertation par exemple (les étudiants issus de milieux populaires si l’on en croit les travaux ci-avant exposés). Les résultats dépendent donc bien souvent de la façon d’écrire des étudiants et de leur façon d’organiser leur pensée à l’écrit ce que l’enquête de l’autrice a permis de rendre compte. Plus généralement, l’arrivée dans les études supérieures peut s’avérer complexe pour les étudiants en difficultés langagières. Il n’est pas toujours aisé de saisir le sens des propos avancés par l’enseignant, lequel a souvent tendance à ne pas reformuler ou ne pas répéter. Dans la même enquête, Erlich a notamment repris les travaux de Lahire selon lequel la maitrise de la culture écrite était davantage l’apanage des classes aisées. Mais selon Erlich, il semble difficile à ce stade de la scolarité d’établir des corrélations fiables entre origine sociale et maitrise des formes de langage. Ce qu’elle a pu remarquer en revanche, c’est que cette maitrise semblait être liée au niveau de diplôme des parents. Toujours est-il qu’en matière de culture linguistique comme elle a pu le souligner, la question du niveau de diplôme des parents semble prégnante, notamment pour ce qui est de l’expression et de la connaissance des termes techniques.
Par ailleurs, il faut avoir à l’esprit que les employeurs valorisent de plus en plus des compétences annexes (liées aux voyages, à la possibilité de faire des activités culturelles, de parler plusieurs langues etc.), choses que les individus acquièrent pour beaucoup dans l’éducation primaire et qui sont davantage l’apanage des classes aisées La conséquence peut alors être la suivante : exclusion symbolique générant auto-exclusion des élèves issus de milieux défavorisés. Convert (2003) explique également que les élèves d’origine ouvrière peuvent présenter des réticences quant à s’orienter vers des filières prestigieuses comme les classes préparatoires. En effet, si leur expérience antérieure dans les disciplines liées à ce type de filière a été un échec, cela ne leur donnera pas envie de poursuivre lesdites disciplines. Ainsi, il semblerait que le lien entre classe sociale et culturelle et la fréquentation des filières de l’enseignement supérieur soit toujours aussi prégnant. Toutefois, pour Lahire (2006), il faut aller voir au-delà des classes sociales et ne pas voir le concept d’habitus comme déterminant et emprisonnant les individus. La réalité est de fait plus complexe selon l’auteur dans la mesure où les individus, qu’importe leur classe sociale d’appartenance, subissent de multiples influences de nature différente tout au long de leur vie. Ils peuvent dès lors acquérir d’autres codes sociaux et aspirer à une autre culture en fonction de ces influences, d’où le terme
« dissonance culturelle ». Il s’agit moins d’une culture jugée légitime ou illégitime selon la classe sociale, que de différences à l’intérieur même desdites classes et c’est sur ce point qu’il faut être vigilant. Ce mémoire s’inscrit d’ailleurs davantage dans cette perspective.
In fine, le niveau scolaire apparait fortement corrélé à l’origine sociale (Convert, 2003). Plus encore, « on retrouve systématiquement une corrélation entre l’origine sociale, le type de bac et les chances de réussite scolaire » (Blöss/Erlich, 2000 cités par Jellab, 2011). Or, il apparait que l’affiliation des étudiants, et donc par extension leur réussite, est soumise à leur origine sociale selon Jellab (2011), ce qui pose question en ce qui concerne les enfants d’ouvriers dès leur passage en études supérieures. Pris entre des cultures et injonctions différentes, ces derniers doivent sans cesse opérer une « lutte de soi à soi » (Lahire, 2006).
Ainsi, dans une enquête réalisée auprès d’élèves issus de milieux populaires, Truong (2015) réfléchit aux différents types de filières dans l’enseignement supérieur. Il note une amplitude du déplacement social plus ou moins grande selon où l’on se trouve. Il montre notamment les vertus des conventions ZEP avec Sciences Po mais aussi la pression exercée sur ces élèves qui doivent sans cesse prouver qu’ils ont le niveau notamment via l’exemple d’une élève issue de ces conventions. Cette dernière explique que, lors de ses exposés, ses pairs lui faisaient comprendre qu’elle n’avait pas sa place générant de surcroît sentiment d’illégitimité et fort manque de reconnaissance. Son accès « facilité » par voie de discrimination positive l’a d’entrée de jeu mise dans une posture « inférieure » aux yeux de ses pairs qui se reconnaissent davantage de légitimité en raison de leur réussite au concours d’entrée. Il en va de même pour Hoggart (1970), qui a constaté qu’il y avait une certaine mise à distance de l’élève boursier qui est considéré différemment aux yeux des élèves de classes sociales aisées. Pour être plus claire, si l’on prend le cas d’un élève boursier qui accède à une filière prestigieuse grâce à ladite bourse, il sera tout de même perçu comme étant différent d’eux car il est boursier et donc n’a pas la même légitimité, d’où l’opposition « eux » et « lui » ici. L’on retrouve la même idée chez Masy (2014) qui a enquêté auprès des élèves boursiers. Selon lui, les étudiants boursiers décèlent chez leurs pairs non boursiers une certaine jalousie car ces derniers voient en cette discrimination positive une certaine forme d’injustice et, par voie de conséquence, les boursiers y voient une remise en cause de leur mérite, ce qui peut impacter leur sentiment de reconnaissance.
Mais le passage en études supérieures ne peut pas seulement s’appréhender sous l’angle des prédispositions sociales, culturelles et économiques des étudiants. Il couvre en effet un large spectre entourant les questions institutionnelles, pédagogiques et organisationnelles, lesquelles constituent autant de facteurs pouvant impacter leur condition étudiante et plus spécifiquement, les difficultés qu’ils rencontrent.
Des difficultés institutionnelles, pédagogiques et organisationnelles
Il apparait avant tout que la massification scolaire a « accentué la distance vis-à-vis de l’académisme universitaire (et le fait que les étudiants soient peu au fait des normes), des non-dits institutionnels » et de ce qui est exigé à l’université (Lahire, 2000, cité par Jellab, 2011, p.3). La « forme scolaire flottante » façonne dès lors la condition étudiante et interroge les manières d’étudier, forme qui semble par ailleurs « plus flottante » et moins visible à l’université (Jellab, 2011). L’entrée à l’université, par exemple, est notamment marquée par de multiples difficultés institutionnelles : les professeurs parlent trop vite d’où la difficulté à prendre des notes et à comprendre les cours (dont il est d’ailleurs difficile de trier l’information entre le pertinent et le superflu), ces derniers sont quant à eux jugés trop théoriques, tout comme il est difficile de nouer des « alliances » avec les chargés de travaux dirigés et de retrouver le contact avec les enseignants comme ce fut le cas au lycée. La participation et l’effort ne sont dès lors pas nécessairement valorisés (Beaud, 1997 ; Erlich, 1998, 2000 ; Galland et Oberti, 1996 ; Altet, Fabre et Rayou, 2001). Par ailleurs, la façon de s’organiser en autonomie ou encore le manque d’encadrement que l’on reconnait à l’université ainsi que les problèmes de rédaction écrite (Galland et Oberti, 1996) peuvent bouleverser ce passage et rendre cette acculturation difficile pour les étudiants qui ne sont pas familiers de ces codes. De plus, selon la plupart des enseignants, les étudiants sont encore des enfants à la recherche de maternage, ce qui est incompatible avec la rigueur scientifique qu’exige l’université, et ce qui peut de surcroît jouer sur réussite et intégration des étudiants (Altet, Fabre et Rayou, 2001).
De fait, le travail personnel entraîne deux logiques, qui n’engagent elles-mêmes pas la même réussite : soit l’étudiant choisit de se concentrer uniquement sur le cours, soit il entame des recherches supplémentaires qui peuvent l’alimenter. Cela n’implique dès lors pas la même « représentation du travail intellectuel » et du rapport à la réussite (Altet, Fabre, Rayou, 2001). A ce titre, plusieurs facteurs peuvent entraver l’affiliation des étudiants selon Alain Coulon (2005) : à la fois la défaillance du système d’orientation et la quasi inexistence de la pédagogie universitaire, mais également le développement d’un rapport utilitariste au savoir aux antipodes des attentes académiques du monde universitaire. Dans son article sur la socialisation universitaire, Jellab (2011) revient notamment sur les manières d’étudier qui peuvent être appréhendées selon des prismes différents : les modes d’appropriation des savoirs (Soulié, 2002 ; Millet, 2003), les manières de s’organiser face aux études (Erlich, 1998) et les pratiques culturelles en lien avec la culture scolaire telle que la lecture (Lahire, 2000 ; Dorronzoro, 2007, cités par Jellab, 2011).
Les manières d’étudier ont plus spécifiquement été étudiées par Lahire (1997) qui met en avant leur diversité en fonction des filières, selon qu’elles sont à dominante populaire ou bourgeoise, courtes et professionnalisantes ou longues et généralistes, sous-tendues par un ancrage professionnel ou par des enjeux scolaires, selon que l’établissement permet un fort encadrement ou non, selon que les effectifs sont importants ou non, et enfin selon qu’elles sont à dominante scientifique ou littéraire, auquel cas elles nécessitent plus d’organisation et d’investissement universitaires en général. Dans le cas de la présente recherche, je m’interroge sur la filière droit. En l’espèce, il s’agit d’une filière universitaire surreprésentée par des étudiants issus de milieux aisés (comme l’attestent les propos ci-avant exposés), mais également d’une filière longue et généraliste. Cette dernière est sous-tendue par des enjeux scolaires et possède un faible encadrement en raison d’un important effectif étudiant. Par ailleurs, elle est à dominante plutôt littéraire. Les étudiants vont donc dès le début être contraints à devenir autonomes, engager un travail important et approfondi, persévérer et vite saisir les attentes universitaires pour pouvoir y répondre d’eux-mêmes.
Ainsi, en s’intéressant aux manières d’étudier et en se fondant sur les différentes matrices disciplinaires9, Millet (2003) soulève quant à lui l’idée selon laquelle la matrice disciplinaire des filières dites prestigieuses et sélectives telle que la médecine par exemple, « induit une homogénéisation des étudiants et des modes d’appropriation des savoirs » (Sylvia Faure, 2004 à propos de Millet, 2003, p.147), c’est-à-dire que les savoirs sont plus ou moins implicites et objectivés en fonction de la matrice en question, ce qui aura des conséquences sur les manières d’étudier des étudiants. Il serait donc plus compliqué de répondre aux attentes universitaires dans le cas d’une filière sélective où les codes, particulièrement ancrés et implicites, sont sources d’incertitude pour les étudiants qui n’en sont pas familiers. Une filière très codifiée induit de fait une « homogénéisation des étudiants » dans le sens où, devant intérioriser ces codes qui font le propre de la filière en question, les étudiants possèdent en définitive tous les mêmes codes alors essentiels pour s’intégrer à cette filière. Et pour ce qui est des étudiants qui n’ont pas ces codes-là, ils n’auront d’autre choix que de les assimiler s’ils espèrent s’intégrer et réussir.
Métier d’étudiant : entre affiliation institutionnelle et intellectuelle
James Masy (2014) a souligné l’importance de l’acculturation à la filière chez les élèves boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles, acculturation d’autant plus significative en fonction de la distance entre la culture des étudiants en question et la culture inhérente à la filière qu’ils ont intégrée. En d’autres termes, les boursiers doivent imiter leurs camarades ayant la culture légitime, celle propre à la filière dans laquelle ils se trouvent, en l’occurrence une filière élitiste. Toutefois, Masy insiste sur le fait qu’il faut avoir à l’esprit qu’il n’y a pas vraiment d’homogénéité dans ces cultures et qu’il existe entre autres des disparités au sein même du groupe des boursiers. Cependant, il est pertinent dans le cadre de ce mémoire, d’étudier les modes d’acculturation des enfants d’ouvriers une fois arrivés dans une filière élitiste. Cela peut donner des clés de compréhension à l’égard des stratégies qu’ils emploient pour s’intégrer.
Relativement à cette idée d’acculturation, n’existerait-il pas des codes propres à l’enseignement supérieur et que chaque individu devrait acquérir pour espérer s’intégrer et réussir ? En effet, les difficultés pédagogiques inhérentes au passage en études supérieures (ayant trait comme on a pu le voir au manque d’encadrement que l’on reconnait à l’université et donc à la façon de s’organiser en autonomie, à l’apprentissage de la prise de notes et les problèmes de rédaction écrite entre autres) (Galland et Oberti, 1996), peuvent bouleverser ce passage et rendre cette acculturation difficile. Selon Coulon, (2005) il y aurait ainsi un véritable « métier d’étudiant » à apprendre et à intérioriser pour espérer s’affilier. Il indique que ce passage en études supérieures induit un changement dans le rapport aux règles et au savoir qui se voient bouleversés. Cela reprend de près les travaux de Becker et al (1961), qui avaient mis en évidence la part d’affiliation nécessaire aux étudiants en médecine qui doivent passer par plusieurs rites d’initiation et d’interactions pour pouvoir s’acculturer à cette filière. Pour Coulon, la culture étudiante est riche de codes et ce qu’on demande aux étudiants est parfois difficile à décrypter d’où, je pense, la difficulté à s’acculturer en tant qu’enfant d’ouvrier, car les codes ne vont pas avec ceux que l’on a appris dans notre éducation primaire. Il faut donc s’enrichir d’expériences nouvelles, sans cesse se développer au contact de cette nouvelle instance de socialisation et de ces nouveaux codes. Coulon voit cela comme un nouveau métier qui prépare au monde professionnel et va même au-delà de cette idée en indiquant qu’il s’agit bien d’une affiliation qu’il entend comme étant « la démarche par laquelle quelqu’un acquiert un statut social nouveau. L’étudiant doit montrer son savoir-faire, puisque c’est une condition de la réussite » (Coulon, 2005 : 2).
Conditions de vie : logement et travail salarié
Enfin, pour terminer sur les facteurs pouvant influencer la réussite et l’intégration et en particulier en ce qui concerne les étudiants issus de milieux ouvriers, il semble important que ces derniers fassent – dans la mesure du possible – le choix d’un logement économique lorsque cela est permis (rester chez ses parents par exemple, auquel cas l’étudiant n’est en toute logique pas tenu de payer le loyer, les courses ou la laverie). Et ceci est d’autant plus prégnant que lors du passage du lycée à l’université, la destruction des cadres de vie ainsi que des repères temporels peut devenir un frein à l’affiliation (Boyer, Coridian, Erlich, 2001). Il s’agit par ailleurs d’une des raisons qui freinent la mobilité des étudiants issus de milieux ouvriers.
Qui plus est, il apparaît que le travail salarié peut être un frein à la réussite. Certains étudiants sont en effet contraints d’avoir un travail salarié à côté de leurs études en vue de les financer. Il s’agit des étudiants qui ne sont pas ou peu aidés par leurs parents (les enfants d’ouvriers en sont un parfait exemple) et/ou qui ne touchent pas de bourses et/ou encore ceux dont la bourse n’est pas suffisante pour subvenir à leurs besoins. Ce travail salarié peut également concerner les étudiants qui n’ont pas réussi à obtenir de prêt étudiant car les débouchés auxquels leurs études destinent sont incertains (Dmitrijeva et al. 2015). Or, ce travail concerne aujourd’hui près d’un étudiant sur deux selon l’enquête Conditions de vie réalisée en 2013 par l’Observatoire de la Vie Etudiante (cf. article de Dmitrijeva et al. 2015). Sur les 46% étudiants ayant un travail, 51% d’entre eux le font par nécessité économique et 19% d’entre eux estiment que cela a un impact négatif sur leurs résultats scolaires, soit trois points de plus qu’en 2010. Cela peut a fortiori empiéter sur le temps des études, accentuer l’absentéisme en cours, prendre sur le temps de travail universitaire ainsi que les révisions et plus globalement, ce travail salarié peut réduire les chances de réussite dans l’enseignement supérieur (Dmitrijeva et al. 2015). Il devient donc nécessaire d’éviter un temps de travail excessif.
Cependant, les étudiants ne sont pas tous égaux face à cette question. Ceux qui ont le moins de revenus seront donc plus portés à accepter des horaires larges, des heures supplémentaires et des boulots qui ne sont pas en adéquation même de loin avec leurs études. On parle du « piège du travail salarié » qui réduit les chances de réussite et accroît la fréquence des abandons (Dustmann et Van Soest, 2007 ; Rothstein, 2007). Cela empiète à la fois sur le temps de loisirs et de repos et sur le temps d’étude (Kalenkoski et Pabilonia, 2012). L’impact sur les performances universitaires est par ailleurs négatif au-delà de 16h de travail hebdomadaires (Beffy et al, 2009). En l’espèce, il semble que « les enfants d’ouvriers (En France) sont particulièrement exposés aux emplois susceptibles d’entraver la réussite universitaire » (Pinto, 2010 cité par Dmitrijeva et al. 2015). L’on peut dès lors s’interroger sur les stratégies que les étudiants concernés peuvent mobiliser afin que ce travail salarié, s’ils ne peuvent faire sans, ne devienne pas un obstacle dans leur réussite universitaire. A cet effet, l’idée peut être soit de ne travailler que lors des congés scolaires, soit de ne pas excéder un volume horaire qui pourrait contrevenir à la réussite.
Somme toute, il apparait que tous les facteurs ici mis en exergue participent tout à tour de la réussite et de l’intégration des étudiants, et plus spécifiquement des enfants d’ouvriers. Si certains facteurs semblent plus probants que d’autres, tout doit être pris en compte afin d’appréhender de la façon la plus complète possible l’expérience universitaire des enfants d’ouvriers dans les filières élitistes et prestigieuses de façon systémique. Néanmoins, il manque ici un élément on ne peut plus pertinent dans la prise en compte de leur milieu social et sa relation avec leur expérience : leur émancipation. L’ultime sous-partie qui suit, qui conjugue à la fois les questions d’autorisation et de subjectivation, viendra donc clôturer les stratégies d’affiliation mobilisées par les enfants d’ouvriers.
Une nécessaire émancipation de son milieu social
Cette dernière sous-partie conclut sur les stratégies mobilisées par les enfants d’ouvriers qui espèrent réussir et s’intégrer dans une filière élitiste et prestigieuse. Il apparaît de fait que ces derniers doivent s’émanciper de leur milieu social d’origine, ce qui ne signifie pas faire une croix sur leur famille mais accepter de devenir autres et se transformer.
Une triple autorisation intersubjective
Ainsi, qu’en est-il du ressenti des enfants d’ouvriers ? Sont-ils amenés à s’auto-exclure et donc à opérer une sorte de renoncement ou, au contraire, à aspirer à une ascension sociale ? Se sentent-ils légitimes ou non ? Toutes ces éléments loin de s’exclure, viennent s’imbriquer les uns aux autres pour forger les ressentis des enfants issus de milieu ouvrier.
Bourdieu lui-même a avancé dans nombre de ses ouvrages la question de la légitimité. Plus encore que l’idée d’une culture légitime, l’individu quel qu’il soit a besoin de se sentir légitime ne serait-ce que pour se sentir exister. Or, comment se sentir légitime dans une société marquée par les clivages, une société qui instaure implicitement des façons d’être ou des façons de faire jugées plus légitimes que d’autres ? Dès lors, la société s’appuierait sur un principe structurant opposant « eux » et « nous », et ceux qui essayent de sortir du groupe connaitraient un rappel à l’ordre ce qui renvoie dès lors à un principe de conformité (Hoggart, 1970). L’on note alors un possible écart dans les façons d’être, les savoir-faire, savoir-dire et les savoirs entre ces deux groupes. L’une des stratégies opérées notamment par les classes populaires repose alors dans « l’indifférence » à l’égard des « autres », ces êtres qui ne sont pas « eux » (on retrouve ici l’opposition).
Comment alors se sentir légitime ou encore s’autoriser à suivre telle ou telle orientation ? Rochex (2008) donne quelques clés d’analyse à cet égard. Avec l’entrée à l’école, un nouveau monde s’offre à l’enfant qui est alors plongé dans une nouvelle instance de socialisation et pris entre des injonctions diverses : l’école ce n’est pas la maison et inversement. Comment composer avec ces différentes cultures ? Rochex parle de triple autorisation intersubjective à comprendre de la façon suivante :
v L’individu doit s’autoriser à devenir autre que ses parents (c’est parfois l’idée d’ascension sociale et ce qui, le cas échéant, pourrait relever d’un conflit de loyauté). C’est notamment le cas chez les enfants d’ouvriers qui intègrent les filières sélectives ce qui implique de se sentir légitime et de s’autoriser à le faire.
v Il faut que ses parents l’y autorisent en retour, c’est-à-dire qu’ils intègrent que leur enfant a le droit de devenir autre qu’eux et n’est pas tenu de reproduire leur histoire et leur parcours (autorisation davantage symbolique selon l’auteur, c’est par exemple encourager ses enfants s’ils souhaitent intégrer une filière sélective lorsqu’ils sont issus d’une classe populaire).
v Il faut enfin que l’individu reconnaisse la légitimité de l’histoire et des pratiques de ses parents dont il veut s’émanciper.
|
Table des matières
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
INTRODUCTION
PARTIE I : CLASSE OUVRIERE ET ETUDES SUPERIEURES
1. CADRE THEORIQUE
1.1. ÉLEMENTS DE CONTEXTUALISATION : LA CLASSE OUVRIERE CONTEMPORAINE ET SES ASPIRATIONS
1.1.1. Quid de la classe ouvrière
1.1.2. Classe sociale, aspirations scolaires et orientation
1.1.2.1. Aspirations scolaires des familles ouvrières
1.1.2.2. Place des enfants d’ouvriers dans les études supérieures, les cycles universitaires et les filières
1.2. LES DIFFICULTES RENCONTREES LORS DU PASSAGE DANS LES ETUDES SUPERIEURES
1.2.1. Des difficultés sociales, culturelles et économiques
1.2.2. Des difficultés institutionnelles, pédagogiques et organisationnelles
1.2.3. Focus sur le droit
1.3. SURMONTER LES DIFFICULTES, S’AFFILIER ET REUSSIR : DES STRATEGIES A L’ŒUVRE
1.3.1. Quelques facteurs influençant la réussite et l’intégration
1.3.1.1. Projet professionnel et projet d’études
1.3.1.2. Métier d’étudiant : entre affiliation institutionnelle et intellectuelle
1.3.1.3. Contexte d’études
1.3.1.4. Sociabilités et loisirs
1.3.1.5. Conditions de vie : logement et travail salarié
1.3.2. Une nécessaire émancipation de son milieu social
1.3.2.1. Une triple autorisation intersubjective
1.3.2.2. L’expérience de la subjectivation
2. PROBLEMATISATION DU SUJET
3. HYPOTHESES
PARTIE II : UNE ENQUETE A LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQU DE NANTES
1. TERRAIN D’ENQUETE
2. METHODOLOGIE
3. REFLEXION AUTOUR DU GUIDE D’ENTRETIEN
PARTIE III : ANALYSE DES RESULTATS DE L’ENQUETE
1. QUATRE PORTRAITS EMBLEMATIQUES
1.1. PORTRAIT DE HUGO : « C’EST UN PEU LA GRANDE FAMILLE DU DROIT. »
1.1.1. Présentation générale
1.1.2. Motivations pour le droit et expérience dans la filière
1.1.3. Métier d’étudiant
1.1.4. Sociabilités, loisirs et investissement extra-universitaire
1.2. PORTRAIT DE IRIS : « JE PENSE QU’IL FAUT DES PRE-REQUIS POUR REUSSIR EN DROIT. »
1.2.1. Présentation générale
1.2.2. Motivations pour le droit et expérience dans la filière
1.2.3. Métier d’étudiant
1.2.4. Sociabilités, loisirs et investissement extra-universitaire
1.3. PORTRAIT DE JULIA : « J’AI L’IMPRESSION D’ETRE EN MEDECINE. »
1.3.1. Présentation générale
1.3.2. Motivations pour le droit et expérience dans la filière
1.3.3. Métier d’étudiant
1.3.4. Sociabilités, loisirs et investissement extra-universitaire
1.4. PORTRAIT DE KATIA : « LE DOYEN NOUS L’AVAIT DIT QU’ON ETAIT SUR DES SIEGES EJECTABLES. »
1.4.1. Présentation générale
1.4.2. Motivations pour le droit et expérience dans la filière
1.4.3. Métier d’étudiant
1.4.4. Sociabilités, loisirs et investissement extra-universitaire
2. ANALYSE THEMATIQUE CROISEE
2.1. UN OBJECTIF COMMUN : UNE VOLONTE DE PROMOTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
2.1.1. Une orientation en droit pour l’utilité sociale du diplôme
2.1.1.1. La question des débouchés
2.1.1.2. La question de l’auto-exclusion
2.1.2. Le projet professionnel : un projet d’abord en construction
2.1.2.1. Un projet principalement construit dans et par la formation académique
2.1.2.2. Un projet né ou renforcé grâce aux stages
2.1.2.3. De grandes aspirations : entre avocature, doctorat et autres métiers juridiques
2.2. PLACE ET MOBILISATION DES FAMILLES DANS L’EXPERIENCE ET LA REUSSITE ETUDIANTES
2.2.1. La volonté de s’élever socialement
2.2.2. La mobilisation des parents autour de la réussite de leurs enfants
2.3. LA QUESTION DES SOCIABILITES : AMITIES NECESSAIRES MAIS CERCLE RESTREINT
2.3.1. L’amitié comme vecteur de motivation : un soutien avant tout moral
2.3.2. Moqueries, sentiment de décalage et absence de mélange
2.4. LES LOISIRS : LE CHOIX DE LA RESTRICTION
2.4.1. L’arrêt de certains loisirs face à la primauté des études
2.4.2. Des loisirs centrés sur les réseaux de sociabilités et sur les études
2.5. LE TRAVAIL SALARIE : UN PASSAGE OBLIGE
2.5.1. La contrainte du job d’été
2.5.2. La crainte du job étudiant
2.6. LES DIFFICULTES RENCONTREES DURANT LEUR PARCOURS UNIVERSITAIRE
2.6.1. Des difficultés d’ordre économique
2.6.2. Des difficultés d’ordre institutionnel, organisationnel et pédagogique
2.6.3. Des difficultés culturelles et sociales
2.7. APPRENDRE A DEVENIR ETUDIANT EN DROIT
2.7.1. Un métier d’étudiant pleinement intégré
2.7.2. Une acculturation réussie
DISCUSSION ET CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet