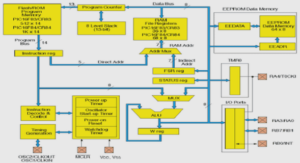Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Approche sociologique : l’influence de l’estime de soi sur le bien-être et le lien social
Si, alors, la confiance en soi détermine l’estime de soi, qu’engendre cette dernière ? Dans la littérature psycho-sociologique, « une haute estime de soi est généralement associée […] à un meilleur bien-être psycho-social » (Namian & Kirouac, 2015, p. 285) et crée des sentiments positifs tels la fierté ou la stabilité.
C’est en ayant une haute estime de soi que l’individu va d’une part être en situation de rester lui-même, et d’autre part être capable de faire face plus sereinement aux réussites et aux échecs dans son parcours social de vie : l’image qu’il a de lui-même et qu’il projette aux autres sera moins dérégulée (Baumeister et al., 2003). Une haute estime de soi serait par ailleurs motrice de l’action individuelle et permettrait l’adaptation à des situations nouvelles et la découverte de solutions face aux difficultés (André, 2013). Cette capacité d’adaptation renforcée contribuerait alors à une meilleure inclusion sociale (Brown & Dutton, 1995).
Dans nos sociétés contemporaines, on observe une individualisation de la responsabilité vis-à-vis du lien et du statut sociaux. Dans leur étude sur les relations entre narcissisme, estime de soi et société, Namian & Kirouac (2015) placent ainsi la banalisation d’un narcissisme ordinaire comme une des caractéristiques du renversement social qui s’est opéré depuis les années 1980, et qui assimilerait l’estime de soi à un indicateur de réussite sociale : « Dans un contexte où l’autonomie, l’initiative, la responsabilité sont à la fois des valeurs positives et des contraintes de masse (Ehrenberg, 1998), l’estime de soi s’institue alors comme un « sociomètre » incontournable pour se mesurer à soi-même et aux autres. Autre manière de dire que si le narcissisme constitue une facette banale ou ordinaire de l’individualité contemporaine, manquer d’estime de soi s’apparente en contrepartie à une faille coûteuse tant pour la santé mentale que la mobilité sociale. » (Namian & Kirouac, 2015, p. 290).
Si une haute estime de soi serait le propre de la réussite moderne, à l’inverse un manque d’estime de soi serait source de potentielles difficultés à l’épanouissement d’un individu dans la société individualiste occidentale.
Francois (2015) distingue les individus en fonction de leur estime personnelle en ces termes : quand les individus à haute estime de soi « savent parler d’eux de façon positive et ont des idées claires sur eux-mêmes tel que ce jugement dépend peu des circonstances et des interlocuteurs. L’inconvénient est que trop de certitudes risque de déplaire à certains interlocuteurs. » (Francois, 2015, p.8) ; les individus à faible estime de soi « se décrivent de manière floue, moyenne et tiennent sur eux-mêmes un discours parfois contradictoire, peu stable qui dépend souvent des circonstances et des interlocuteurs. L’avantage est qu’ils ont le sens de la nuance et s’adaptent aux interlocuteurs » (Francois, 2015, p.8). Prosaïquement, on pourrait alors associer les individus à haute estime personnelle aux caractéristiques d’autonomie et d’indépendance, et les individus à faible estime personnelle aux caractéristiques de dépendance et d’adaptation. Si les effets positifs de la haute estime de soi sur le bien-être et l’intégration sociale semblent faire consensus, et par voie de conséquence si la faible estime de soi semble un facteur limitant à l’épanouissement personnel et social, les conclusions de Francois nous permettent de complexifier le lien entre l’estime de soi et la relation à autrui : une haute estime de soi n’est pas une garantie de réussite sociale au sens interactionnel, et à l’inverse une faible estime de soi pourra aussi être source de comportements interpersonnels adaptés.
De même, une étude réalisée auprès des agents des entreprises publiques en République Démocratique du Congo peut attirer notre attention sur la potentielle difficulté d’établir un lien effectif. Cette étude visait à établir un lien entre estime de soi et habiletés de communication. « On s’attendait à ce que l’estime de soi favorise positivement la communication des agents des entreprises publiques lors de leurs prestations. Les résultats auxquels nous avons abouti montrent avec précision que l’hypothèse est infirmée, car, les résultats avancés par des agents reflètent des corrélations faibles et non significatives avec l’estime de soi » (Balume Bakulikira, 2016, p.119). Plusieurs études présentent par ailleurs la variable « estime de soi » comme une variable biaisée dans l’analyse de la réussite scolaire. Des études de Bachman & O’Malley (1977, 1980) établissent que « l’estime de soi et les indicateurs de réussite scolaire et professionnelle partageraient les mêmes déterminants individuels et sociaux : les compétences académiques, les performances scolaires passées et le statut socio-économique de la famille. Autrement dit, plutôt que de s’en tenir à l’explication voulant qu’une haute estime de soi favorise, en règle générale, la réussite scolaire et professionnelle – et réciproquement –, […] ils dépendraient tous de facteurs communs, notamment du statut socio-économique d’origine » (Namian & Kirouac, 2015, p.288).
Il s’agit pour nous d’une potentielle première limite à prendre en considération : le lien entre estime de soi et bien-être semble admis, mais le lien entre estime de soi et habiletés de communication ou réussite scolaire pourrait être non-établi ou biaisé.
La difficulté de la mesure de l’estime de soi
La mesure de l’estime de soi est particulièrement complexe, principalement pour deux raisons : le débat sur sa possible variation en fonction du contexte et la méthode utilisée pour la mesurer.
L’estime de soi, un concept uni- ou pluridimensionnel ?
Tout d’abord, la nature de l’estime de soi prête à un débat opposant un modèle unidimensionnel qui considère que les individus s’estiment et s’évaluent de la même manière dans tous les domaines de leur vie (Coopersmith, 1967), et un modèle multidimensionnel qui postule à l’inverse que l’estime de soi d’un même individu peut varier selon les domaines (Harter, 1999). Selon le modèle unidimensionnel, un individu s’estimera de manière générale et n’aura pas, par exemple, une estime de soi meilleure dans le contexte scolaire que sportif. Pour les modèles multi-dimensionnalisés à l’inverse, un individu peut avoir une estime de soi variable, et par exemple avoir une faible estime personnelle globale mais une bonne estime de soi dans le domaine scolaire. Cette distinction nous intéresse directement dans le cadre de nos recherches : le fait que mon estime personnelle puisse soit évoluer selon le contexte, soit former un tout invariable aura un impact significatif sur d’éventuelles recommandations que nous pourrions être amenés à formuler. S’agira-t-il de recommandations qui auront un impact uniquement sur l’estime de soi contextualisée (ici scolaire) et/ou sur l’estime de soi globale ? Il faudrait alors s’assurer qu’on peut identifier, différencier (s’il y a lieu) et mesurer l’estime de soi, qu’elle soit unique ou plurielle.
Les échelles traditionnelles de mesure de l’estime de soi
L’évaluation de l’estime de soi se base souvent sur des questionnaires ou entretiens qui relèvent la perception que les individus ont d’eux-mêmes, ce qui sous-entend un risque que les réponses soient biaisées : l’interrogé ne répond pas forcément ce qu’il estime réellement de lui-même, mais potentiellement ce qu’il souhaite que les autres perçoivent de lui ou de son estime (Namian & Kirouac, 2015). Cela peut par exemple être le propre d’un individu qui souffre d’une forme de complexe : il pourra ne pas vouloir reconnaître être préoccupé par cela par protection vis-à-vis du regard d’autrui.
L’échelle de mesure de l’estime de soi la plus répandue est actuellement la Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE ; Rosenberg, 1965) 2 . Elle consiste à demander directement aux enquêtés d’estimer si certaines affirmations correspondent à la façon dont ils se perçoivent, avec une échelle allant de « peu » à « beaucoup ». Sur les dix questions proposées, cinq questions cherchent à évaluer l’estime de soi positive, et cinq l’estime de soi négative. A partir des réponses données, on peut calculer par un système de points cumulés l’estime de soi du participant, de très faible à très forte.
Si l’usage de cette échelle est très répandu, nous voyons néanmoins plusieurs facteurs limitants à son utilisation dans notre mémoire : tout d’abord, le questionnaire s’attache à mesurer une seule dimension, globale, de l’estime de soi. Il n’approfondit pas les différents piliers, ce qui, dans le cadre de notre choix méthodologique, ne nous permettra pas de nous concentrer sur les activités d’enseignement. Par ailleurs, les questions sont clairement orientées de manière positive ou négative. L’enquêté peut être biaisé dans ses réponses s’il interprète les questions et oriente ses réponses en fonction du message sur lui-même qu’il pourrait souhaiter transmettre, à l’enquêteur ou à lui-même. Ensuite, il nous semble qu’il aurait été difficile pour nous, étant donné le mode d’administration (questionnaire en ligne) et la méthode de recherche (pas d’entretien qualitatif en face-à-face) de pouvoir véritablement interpréter les résultats et en tirer des enseignements quant aux méthodes d’apprentissage. Enfin, nous estimons qu’il est particulièrement complexe de mener de front un questionnaire portant à la fois sur la psychologie et sur les activités d’apprentissage langagier, courant le risque de perdre l’intérêt des enquêtés par le nombre de questions et leur adhésion du fait que les questions d’ordre psychologique touchent à l’intime.
Nous devrons de fait garder à l’esprit ces facteurs limitants lors de la conduite de notre enquête : leur identification et leur neutralisation feront partie des critères d’évaluation de la réussite de notre projet.
Approcher l’estime de soi par les éléments pédagogiques et didactiques
Face à cette difficulté de mesurer l’estime de soi, nous pouvons reprendre la définition-résumé du psychologue américain James (1892) : le degré d’estime de soi correspond au niveau d’adéquation entre aspirations et succès. On peut alors noter la formule : Estime de soi = réussites / aspirations
Plus un individu va réussir des projets tel qu’il y aspire, plus son estime de soi va augmenter. A l’inverse, moins ses réussites seront au niveau de ses ambitions, plus son estime de lui-même sera faible. J’interprète cette équation comme un double-appel : un appel à se donner les moyens de ses ambitions en persévérant pour réaliser un objectif, et un appel au réalisme en sachant définir des aspirations difficiles d’accès mais potentiellement réalistes.
Dans le cadre de notre recherche empirique par questionnaire, il s’agira d’utiliser ce double-appel pour placer le curseur au plus près de ce que l’enseignant peut directement influencer : un objectif de réussite de l’apprenant dans une entreprise définie de manière réaliste. Cela sous-entendra d’une part de (re)définir l’objectif final de l’apprentissage avant et pendant l’action de formation en fonction du rythme de progression et du caractère réaliste de son avènement, et d’autre part de mettre en place des activités de formation adaptées. Nous nous proposons ainsi, dans le cadre de ce mémoire, de ne pas chercher à mesurer directement l’estime de soi des enquêtés selon les grilles d’évaluation traditionnelles, mais plutôt d’identifier les éléments pédagogiques et didactiques que les enquêtés définissent comme (in)efficaces d’après leurs expériences, puis de traduire ces retours contextualisés en indicateurs d’estime et de confiance qui pourront permettre d’infirmer ou confirmer nos hypothèses.
CONFIANCE EN SOI ET SENTIMENT D’EFFICACITE PERSONNELLE : LES REPRESENTATIONS DE L’APPRENANT AU CŒUR DE SA MOTIVATION
Dans son Dictionnaire de l’éducation, van Zanten (2008) établit un lien de corrélation entre confiance en soi et motivation : plus l’élève a confiance en lui et apprécie la valeur de ce qu’il sait faire, plus il est motivé pour apprendre. Nous pouvons étudier cette relation en combinant la définition des déterminants sociocognitifs de la construction de la motivation et l’approfondissement de la nature de la relation entre les compétences de l’individu, son environnement et ses représentations.
Définition sociocognitive de la motivation : entre représentations et objectif
Dans les sciences sociocognitives qui mettent l’accent sur les liens entre l’individu et son environnement, on propose la définition suivante de la motivation : « la motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but » (Viau, 2004, p.7). On définit alors la motivation comme une dynamique associant représentations et effort personnel par rapport à un objectif.
Dans son modèle motivationnel, Viau (2004) représente cette dynamique et positionne les perceptions de l’élève comme déterminantes, et l’interaction entre le contexte et les perceptions de l’élève comme le moteur qui va engendrer (ou non) la motivation de l’élève. Trois perceptions en particulier sont ici avancées comme centrales : de sa compétence, de la contrôlabilité d’une activité, et de la valeur de cette activité.
Cette approche permet d’expliquer les comportements des apprenants, positifs ou négatifs : « je m’investis dans l’apprentissage de l’informatique parce que savoir me servir d’un ordinateur me sera utile pour mes candidatures futures ; je m’investis dans ce cours pour montrer à tel individu (y compris le formateur ou moi-même) que j’en suis capable ; je ne suis pas motivé par la pratique de la course à pied car non seulement je ne suis pas un bon coureur, mais en plus cette activité a peu de valeur à mes yeux. »
Dans cette perspective, la motivation se développe alors directement à partir des représentations de l’apprenant. On postule alors que pour motiver quelqu’un, il faut agir sur ses représentations.
Croire en ses capacités : le sentiment d’efficacité personnelle
Bandura (1997) place également les croyances en ses aptitudes et les perceptions de l’apprenant au cœur de la construction de la motivation, et les relie en particulier aux natures des expériences vécues à travers son concept d’efficacité personnelle. Dans ce concept, au-delà de la maitrise, c’est la croyance en cette maitrise qui prime : « des personnes différentes avec des aptitudes identiques, ou la même personne dans des circonstances différentes, peuvent obtenir des performances faibles, bonnes ou remarquables, selon les variations de leurs croyances d’efficacité personnelle. Certes le niveau de compétences influe sur les performances obtenues, mais son impact est fortement médiatisé par les croyances d’efficacité personnelle » (Lecomte, 2004, p.60).
Cette croyance en son efficacité personnelle se construit, d’après Bandura (1997), à partir de quatre sources. Tout d’abord la maîtrise personnelle se nourrit de l’accumulation d’expériences positives et crée ainsi un cercle vertueux de la réussite qui appelle la performance ; à l’inverse, l’accumulation d’échecs nourrira un cercle vicieux où les échecs antérieurs appelleront la possible résignation (Lecomte, 2004). L’apprentissage social est le deuxième vecteur de l’efficacité personnelle, et correspond à l’inspiration dont se nourrit un individu en voyant des autres réussir, en particulier s’ils ont les mêmes caractéristiques que lui (Ibid.). On parle par exemple d’un apprenant qui se reconnaît semblable à un autre et le voit réussir. Cet exemple appelle néanmoins une interrogation : si je me sens semblable à un autre, et que je le vois réussir, cette observation sera-t-elle inspirante pour moi car je suis semblable à lui donc capable des mêmes succès, ou à l’inverse dépréciative car la possible peur de l’échec comparativement à un de mes semblables en situation de réussite sera source de frustration et de dénigrement ? Troisième source, la persuasion par autrui (Lecomte, 2004) est elle aussi ambivalente : encouragé par un professeur quant à mes capacités pour y parvenir, serai-je poussé vers tenter davantage ? Le retour du professeur est-il une influence suffisante pour me faire croire en mes qualités, ou fera-t-il office d’influence satellite par rapport à l’essence de ma personnalité et de ma situation ? Enfin, l’état psychologique et émotionnel aurait également une influence sur le sentiment d’efficacité d’un individu : il aura tendance à se sentir plus à l’aise dans un environnement calme et sécurisant (Lecomte, 2004). Cette variable prête là aussi à discussion, on observe ainsi que l’adrénaline dans de multiples domaines (sport, examen, négociation ou contexte militaire) peut transcender certains profils individuels qui se sentent portés par l’incertitude et l’excitation.
Le sentiment d’efficacité personnelle est donc le résultat de plusieurs variables. Au fil d’expériences et d’interactions, positives ou négatives, seront nourris non seulement les capacités de l’individu mais aussi son regard sur celles-ci ; c’est l’accumulation de ces expériences qui va développer un regard sur soi et sa performance. Un sentiment de faible efficacité personnelle et une faible estime de soi seront alors nuisibles à la confiance en soi et de fait à la motivation de l’élève, tandis qu’un sentiment de haute efficacité personnelle et une haute estime de soi auront un effet positif. On trouvera également des situations particulières où un individu pourra avoir un haut sentiment d’efficacité et une faible estime de soi, caractéristique par exemple des personnes qui sont très performantes dans une activité qu’elles réprouvent moralement, ou un faible niveau d’efficacité et une haute estime de soi, par exemple pour les personnes qui ne se sentent pas performantes sur une activité mais n’en sont pas affectées car cette activité ne les intéresse pas (Lecomte, 2004). Il s’agira alors de développer non seulement les compétences de l’individu, mais aussi d’influencer ses représentations de celles-ci : il faut à la fois avoir les capacités et croire en le fait de les avoir, ou dans le cadre de l’apprentissage à la fois viser à acquérir ces capacités et être convaincu d’en être capable.
Interactions individu et environnement dans les concepts de soi
La question sous-jacente à ce constat est alors le rapport entre les éléments individuels et les éléments environnementaux dans ce sentiment d’efficacité personnelle. Quels sont ainsi les éléments qui ont le plus d’effet sur le sentiment individuel : y a-t-il un degré de confiance en soi propre à chaque individu et qui intrinsèquement l’amènera à une certaine perception de soi quels que soient les éléments extérieurs, ou l’ampleur de l’impact des facteurs environnementaux est-elle bien supérieure au caractère individuel ?
Bandura (1997) fonde sa conception du sentiment d’efficacité en premier lieu sur les interactions entre l’individu et l’environnement. Pour lui donc, « le comportement et les états émotionnels de l’être humain sont mieux prédits par l’influence combinée des croyances d’efficacité et par les performances attendues au sein de sociétés données. Il y a donc interaction entre les croyances d’efficacité et la réceptivité de l’environnement. » (Lecomte, 2004, p.61). Il propose alors les quatre combinaisons suivantes de sentiment d’efficacité et de réceptivité de l’environnement :
– Dans un environnement faiblement réactif,
o un individu au sentiment d’efficacité élevé compensera ce manque par une hyperactivité sociale (promotion du changement) ou personnelle,
o un individu au sentiment d’efficacité faible renoncera rapidement à s’engager ;
– Dans un environnement hautement réactif,
o un individu au sentiment d’efficacité élevé sera dans une forme de cercle vertueux investissement personnel / motivation élevée / satisfaction des réussites,
o un individu au sentiment d’efficacité faible se sentira inefficace et tombera dans le dénigrement de soi. (Lecomte, 2004)
En d’autres termes, selon cette corrélation, si, dans le cadre de l’apprentissage, on crée un environnement qui stimule des individus déjà en confiance, alors on créera pour eux le cadre optimal d’expression. A l’inverse, si l’on met en place un cadre inadapté à des personnes manquant de confiance en leurs capacités, alors on entretiendra leur cercle perceptif négatif au risque de les voir se démotiver, se dévaloriser ou s’enfermer. On pourra néanmoins avancer que certaines variables non-inclues ici peuvent avoir une influence significative. Ainsi, on peut s’attendre à ce que les encouragements, l’encadrement ou la bienveillance viennent compléter le niveau brut d’attentes de résultat pour influencer positivement le sentiment d’efficacité personnelle. Nous approfondirons par ailleurs cette hypothèse.
Si Bandura se concentre sur cette efficacité personnelle reliée à l’environnement, on peut également chercher à évaluer si le sentiment d’efficacité personnelle est corrélé aux caractéristiques propres d’un individu. Plusieurs études se sont penchées sur ce point. Bong (1999) montre ainsi une spécificité par genre : dans le contexte éducatif, les garçons semblent avoir un sentiment d’efficacité plus homogène entre les matières quand chez les filles le sentiment est plus hétérogène en particulier entre les matières scientifiques et littéraires. Pour Schunk et Pajares (2002), les garçons auraient également un sentiment d’efficacité plus important dans les matières technologiques et scientifiques, et les filles pour les matières littéraires. Les garçons, également, tendraient à se montrer sous un meilleur jour pour ce type d’études, et les filles seraient plus modestes. Néanmoins, ce centrage sur le genre est probablement incomplet et on peut regretter le risque que « finalement, la nature même de l’auto-efficacité pourrait masquer ces différences : les différences de genre seraient le reflet des stéréotypes que les élèves ont intériorisés via des influences sociales » (Galand & Vanlede, 2004, p. 106).
D’autres études ont également tâché d’identifier le sentiment d’efficacité en fonction de l’âge ou de l’origine ethnique, mais leurs conclusions sont parfois en contradiction ou appellent à limiter leur portée en raison du risque d’interprétation biaisée par la similitude avec d’autres facteurs. De manière générale, « il reste de nombreux points à éclaircir concernant le rôle des caractéristiques personnelles dans le sentiment d’efficacité, mais ces caractéristiques apparaissent en tout cas moins déterminantes que les autres sources » (Galand & Vanlede, 2004, p. 106).
Dans ce contexte, il nous semble approprié de se concentrer ici sur l’interaction entre l’individu et l’environnement pour tâcher de déterminer les conditions les plus pertinentes d’apprentissage pour améliorer sa confiance en expression orale. Le formateur ne prétendra ainsi pas influencer l’estime générale de l’individu (ou alors de manière indirecte), mais pourra par contre s’attacher à créer un cadre propice à l’expression et à la prise de risque de l’apprenant dans un objectif d’acquisition de capacités réutilisables dans le cadre précis de situations réelles.
Les représentations issues du parcours de vie semblent donc fondatrices de la définition et de la valorisation du soi, et par là-même de la confiance en soi et des concepts attenants d’estime de soi et de sentiment d’efficacité personnelle. Elles seront au cœur de notre cadre d’analyse.
Pris isolément en considération, certains cadres d’analyse peuvent néanmoins mener à des interprétations incomplètes ou difficiles à réinvestir en pédagogie : il faut ainsi enrichir la corrélation entre le sentiment d’auto-efficacité et la réceptivité de l’environnement de variables interactives pour capturer la complexité des personnalités et contextes, ou s’assurer d’identifier des biais potentiels avant de tirer des conclusions à partir de certaines variables prises en isolation. Dans ce contexte, nous avons retenu comme définition de la confiance en soi le rapport entre réussites et aspirations de l’apprenant, et intégrerons et lierons cette définition aux éléments pédagogiques et didactiques que les enquêtés auront perçus et retenus comme efficaces dans leur parcours d’apprenant de langue étrangère pour avancer dans nos analyses.
INFLUENCES ET DETERMINANTS PRINCIPAUX DE LA CONFIANCE EN SOI
Les niveaux de confiance et d’estime de soi d’un individu ne sont pas donnés et établis : ils sont construits et évoluent en fonction de plusieurs déterminants, au fur et à mesure du parcours de vie. Il s’agit dans ce chapitre d’approfondir les premières définitions énoncées auparavant en détaillant la nature et la relation des influences, déterminants et procédés qui génèrent la confiance en soi.
LE ROLE DE L’ANXIETE ET DES FACTEURS AFFECTIFS
Les facteurs d’ordre affectif constituent la première influence. Ces facteurs tels que la motivation, l’anxiété, les attitudes, les croyances ou les styles d’apprentissage peuvent avoir divers effets psychologiques encourageants ou limitants : on note par exemple qu’il existe une corrélation inversée entre l’anxiété et la confiance en soi, et que « les croyances négatives sur soi-même empêchent de se concentrer sur les tâches didactiques à réaliser pour pouvoir apprendre, car une grande partie des énergies cognitives seront dépensées à nourrir des préoccupations concernant le manque de capacités ou de valeur » (Arnold, 2006, p. 415). Chastain (1988, p. 122) a ainsi montré que « le domaine affectif joue un plus grand rôle que le cognitif dans le développement des compétences en langues secondes car les émotions contrôlent la volonté d’activer ou d’arrêter la fonction cognitive ». Stevick (1980) recommande alors de s’attacher à diminuer les facteurs affectifs négatifs tels que l’anxiété ou la peur et augmenter les facteurs affectifs positifs pour élever la motivation et l’estime de soi, et par là-même la confiance.
Néanmoins, à la définition d’une confiance en soi qui serait construite en excluant systématiquement la peur ou l’anxiété comme émotions négatives, on peut opposer les bienfaits potentiels de ces dernières. En l’occurrence, Kotsou (2016) fait même de l’anxiété une émotion potentiellement positive si l’on parvient à l’équilibrer, avançant qu’une anxiété régulée peut faire partie intégrante d’une préparation à l’action. Il prend ainsi l’exemple d’étudiants en situation de préparation à un examen : ceux qui refoulent une éventuelle anxiété vont peu réviser et risquent l’échec ; ceux qui ressentent trop d’anxiété oublieront les sujets pourtant révisés et perdront leurs moyens au moindre froncement de sourcils de l’examinateur ; seuls ceux qui, modérément anxieux, ne sont pas certains de réussir vont se motiver pour faire au mieux… et courent ainsi au succès (Kotsou, 2007). On considère avec ce positionnement face aux émotions potentiellement négatives qu’accueillir toutes les émotions quelles qu’elles soient, les verbaliser, les apprivoiser et s’en accommoder fait partie du parcours de vie et psychologique d’un individu et lui permettra de se sentir ensuite plus à l’aise dans l’action et de mieux contrôler ses émotions. Exclure ou refuser de voir les émotions dites négatives car elles nous donnent un sentiment désagréable serait alors une trop grande prise de risque et pourrait engendrer des difficultés lorsqu’elles adviendraient, il faut au contraire les apprivoiser pour apprendre à les contrôler.
Dans les domaines de la représentation tels que les arts du spectacle ou de la compétition tels que le sport, le phénomène d’anxiété est omniprésent et son contrôle fait souvent partie de la préparation et de l’apprentissage sous la forme de l’adrénaline, potentiel catalyseur de performance. Martens, Vealey & Burton (1990) décomposent ainsi l’anxiété dans le sport de haut niveau en deux éléments : l’état d’anxiété cognitif et somatique qui traduit l’émotion en comportement face à un environnement, et le trait d’anxiété qui est durable et stable chez un individu, faisant véritablement partie de sa personnalité. L’état d’anxiété résulte de deux représentations : la perception de l’incertitude du résultat (liée aux capacités de l’individu de parvenir à ce résultat) et la perception de l’importance du résultat (et la pression qui y est attachée) (Martens, Vealey & Burton, 1990). La perception de l’incertitude du résultat est déterminée par la perception de ses propres compétences spécifiques à la tâche à accomplir et de la difficulté de réalisation de celle-ci. La perception de l’importance du résultat est fonction notamment de l’estime de soi, la confiance en soi, l’attente personnelle de performance et les croyances subjectives quant à l’influence du résultat (Fleurance, 1998, p. 89).
Les effets de l’anxiété, sous certaines conditions, sont ainsi démontrés comme ayant un impact positif sur la performance jusqu’à un certain seuil, au-delà duquel ils jouent au contraire en sa défaveur (Izard, 1991). Survient alors un travail d’identification des sources à l’origine de ces affects et spécifiquement au contexte, tel que le décrit Fleurance (1998, p. 90) : « Il s’agit donc d’une réponse complexe associant les dimensions cognitives et somatiques qui se manifestent souvent par le développement d’affects négatifs, de sentiment d’appréhension et de tensions associées à un haut niveau d’activation du système nerveux. Dans une perspective de régulation et de contrôle, il s’agit donc d’identifier les prédicteurs de l’anxiété compétitive en s’attachant à comprendre quelles sont les sources génériques du stress, chez les sportifs, dans le contexte particulier de chaque activité sportive. »
En s’inspirant de cette double approche d’appropriation des sentiments potentiellement négatifs et de leur transformation en influences ou croyances positives, nous nous proposerons d’identifier quelles peuvent être les sources d’anxiété de l’expression orale chez les apprenants. Partant d’une volonté de réguler ces facteurs d’anxiété en amont des situations-cibles, il faudra tâcher d’identifier quels seraient les effets de leur intégration pertinente et mesurée dans les apprentissages afin de créer une forme d’accoutumance constructive à ces sentiments chez les apprenants.
LE CONTEXTE ET L’ENVIRONNEMENT SOCIAL
Dans sa pyramide des besoins, Maslow (1943) établit une relation pyramidale des besoins individuels : en partant de besoins physiologiques (boire, manger dormir) pour arriver à des besoins d’accomplissement avec plusieurs types de besoins intermédiaires, un individu parvient à la réalisation de soi par le franchissement d’étapes de moins en moins vitales au sens physiologique et de plus en plus liées à la perception de soi, au contexte et à l’environnement social : des besoins d’appartenance, d’estime, d’accomplissement personnel.
Dans cette conception, le besoin d’estime intervient une fois satisfaits les besoins physiologiques, de sécurité et d’appartenance et se définit comme « le sentiment d’être utile et d’avoir de la valeur, de conserver son identité » (1943, p.383). Une fois satisfait, le besoin d’estime de soi conduit alors à un sentiment de confiance en soi qui, de fait, peut contribuer à la réalisation de soi. Le fait que le besoin d’appartenance, donc de lien social, intervienne avant le besoin d’estime et donc de perception de soi est déterminant dans le cadre d’un apprentissage langagier : lien social et concept de soi sont intimement liés et l’un est antérieur à l’autre. Le concept de soi et la valeur que l’on s’attribue interviennent ainsi après que l’individu ait eu à faire face à autrui ; en particulier la reconnaissance d’autrui détermine l’étape suivante, la reconnaissance de soi.
Maslow (1943) relie par ailleurs la satisfaction de ce besoin d’estime de soi au concept d’efficacité personnelle appliqué à une compétence bien particulière, à la différence de la confiance en soi qui est plus générale et relative à une personnalité dans sa globalité. Ainsi, dans le cadre de l’enseignement, il peut être pertinent pour l’enseignant d’une part de se concentrer sur l’intégration sociale des apprenants pour satisfaire à leur besoin d’appartenance, d’autre part de travailler au développement de l’efficacité dans le cadre d’une tâche précise pour développer ce sentiment d’efficacité personnelle, et par là-même satisfaire le besoin d’estime de l’apprenant.
Les conclusions de Maslow et l’interprétation qui en a été faite menant à la création d’un modèle pyramidal ont néanmoins été remises en question par la suite, notamment par rapport à la hiérarchisation absolue et figée des besoins. Ainsi, on opposera à cette pyramide des modèles plus dynamiques et sans hiérarchisation systématique : on peut, par exemple, avoir un grand besoin de connaissances sans forcément ressentir un besoin d’appartenance à un groupe ; la difficulté d’assouvir un besoin physiologique n’est par ailleurs pas forcément un frein à un grand besoin d’estime de soi. Mobley & Locke (1970) écrivent ainsi que l’importance du besoin est déterminée par l’individu lui-même et peut différer d’une hiérarchie préétablie. L’antériorité du besoin d’appartenance par rapport au besoin d’estime n’est ainsi pas forcément démontrée.
Malgré ces critiques, la théorie de Maslow permet de clairement poser la complexité et la multiplicité des besoins humains pour tendre vers la réalisation de soi, ainsi que leur interconnexion et la prééminence de la relation à l’autre et à l’environnement social comme variables déterminantes. Du fait de cette multiplicité, un même individu peut être amené à connaître divers niveaux de confiance en fonction des contexte et groupe sociaux où ils se trouvent. On peut, par exemple, imaginer un apprenant très en confiance dans un contexte mathématique et moins à l’aise dans un contexte littéraire en fonction de ses affinités, de son niveau de compétence, des retours qu’il a l’habitude de recevoir de son enseignant et du contexte de classe. Il en va de même lors des interventions en groupe : l’échange est fonction des dispositions des membres du groupe. Selon les groupes (enfants, étudiants, hommes, femmes, cultures, sportifs), les codes sociaux peuvent varier considérablement. La reliance comme fait de « créer ou recréer des liens, établir ou rétablir une liaison entre une personne et soit un système dont elle fait partie, soit l’un de ses sous-systèmes » (Bolle de Bal, 2003, p. 38) pourra alors être posée comme fondatrice du ciment social : lorsqu’elle sera positive, elle influencera positivement la confiance de l’individu. Bolle de Bal établit sociologiquement la reliance comme un incontournable pour faire face à la déliance croissante de nos sociétés : d’après lui, l’atomisation et l’individualisation (reliance à soi) qui caractérisent nos sociétés contemporaines légitiment le besoin de reliance sociale (Bolle de Bal, 2003). Dans mon cas, il est intéressant de noter que lors de mon premier stage d’enseignement auprès d’un groupe d’adultes ayant majoritairement quitté la vie professionnelle ou active, le cours de français était surtout un prétexte au lien social : beaucoup affirmaient qu’ils se joignaient au cours au moins autant pour des raisons sociales que pour l’apprentissage ou l’acquisition de connaissances linguistiques.
LA GESTION DES EMOTIONS : ENTRE EMOTIONS, SENTIMENTS ET REPRESENTATIONS
L’un des mécanismes individuels directement liés à la prépondérance du lien social et de l’affectif sur la confiance en soi est la gestion des émotions et des représentations. Chaque individu croit ainsi en des représentations qui correspondent à des perceptions : sur lui-même, sur sa relation au groupe, sur une langue, sur l’apprentissage, sur l’enseignement… Ces représentations vont conditionner son mode de pensée, son comportement, son ressenti (Riquois, 2018). Germain (1993) parle ainsi de « filtre affectif », composé de trois éléments : la motivation-attitude, la confiance en soi, et l’absence d’anxiété pour qualifier l’influence des représentations. Lorsqu’il est fort, il « filtre » les émotions et se mue en mécanisme de défense psychologique limitant pour l’expression : la peur de se tromper ou du ridicule par exemple. Lorsqu’il est faible, il est à l’origine d’un cercle vertueux motivation – attitude / confiance en soi / absence d’anxiété (Germain, 1993). Ces représentations peuvent avoir plusieurs origines. Dans le cadre de l’apprentissage par exemple, elles peuvent être héritées du parcours scolaire antérieur. Elles peuvent également être un héritage culturel, comme par exemple l’idée préconçue du lien entre l’assiduité scolaire et les origines sociales ou culturelles d’autrui.
Damasio (2003) ajoute une variable à cette problématique en distinguant émotions et sentiments. Après avoir également montré que les émotions jouent un rôle biologique dans nos réactions, nos raisonnements et nos prises de décision (Damasio, 1994), il a ajouté que pour bien comprendre le fonctionnement du cerveau, il faut distinguer notre première réaction, biologique, à un évènement (l’émotion) de notre interprétation et de ce qu’elle nous fait ressentir (le sentiment). Le passage des émotions aux sentiments puis au raisonnement / à la décision se fait par « l’activation à couvert de biais liés à des expériences émotionnelles antérieures de situations comparables » (Damasio, 2003, p. 152), c’est-à-dire de représentations et de sentiments issus du passé. Pour lui ainsi, les processus émotionnels influencent significativement la prise de décision par le biais de marqueurs somatiques formés à partir des traces biologiques de nos expériences émotionnelles passées.
Ce sont donc nos représentations des expériences passées et notre confrontation neurologique à celles-ci qui vont influencer dans un premier temps nos relations aux émotions suscitées par un évènement, puis dans un deuxième temps notre réaction rationnelle. Dans cette acception, la gestion des émotions vient s’articuler aux représentations du passé : les émotions ne peuvent en tant que telles se contrôler et sont une réaction naturelle à un évènement donné. Néanmoins, on peut apprendre à contrôler et orienter les sentiments et les raisonnements qui s’en suivront, soit par des expériences antérieures positives, soit par l’acquisition de stratégies de raisonnement qui nous permettront de pouvoir faire face, quelle que soit la nature de nos expériences antérieures. Si ce processus pourra faire partie d’un développement d’une forme de confiance en soi, on comprend néanmoins qu’il est difficile voire impossible de le faire dans le cadre d’un cours de langues. A cette fin, nous nous concentrerons sur la création d’expériences positives, par la réussite, par l’apprentissage constructif à partir de l’échec, voire par le contournement complexe des notions de réussite et d’échec.
CONFIANCE EN SOI ET CONFIANCE EN L’AUTRE
La confiance en soi peut aussi passer par la confiance en l’autre. Plusieurs théories établissent ainsi un lien direct entre la confiance en soi d’un individu et la confiance qu’il a en l’autre ou la confiance que manifeste l’autre à son égard, établissant la confiance collective comme contributrice d’une confiance individuelle renforcée. On parle alors ici de l’acception de la confiance comme « présomption que, en situation d’incertitude, l’autre partie va, y compris face à des circonstances imprévues, agir en fonction de règles de comportement que nous trouvons acceptables » (Bidault & Jarillo, 1995, p.113). La création d’une identité collective basée sur la confiance intègre à la fois un objectif commun et le respect des différences de chacun (Morin, 1986). Le fait que l’on puisse faire confiance à l’autre et obtenir son soutien en cas de difficulté font de la confiance et du soutien deux facteurs importants de reliance (Bolle de Bal, 2003). Flessel (2018) mentionne ainsi les bienfaits de cette forme de solidarité dans l’apprentissage sur la confiance d’étudiants en anglais langue étrangère. Bandura (1997) mentionne également dans son concept d’efficacité collective les bénéfices de l’apprentissage vicariant, apprentissage basé sur l’observation d’autrui : si je fais confiance à autrui ou suis admiratif de sa réussite parce que je me trouve des affinités avec lui, alors je serai potentiellement plus enclin à apprendre de lui. On peut enfin retrouver le bénéfice essentiel de la confiance en l’autre dans la théorie de l’attachement de Guedeney (2006) : au contact de ses parents, l’enfant en bas âge se construit par la satisfaction de son besoin inné de proximité et de sécurité avec les figures censées le protéger. Ce besoin de proximité, avec des applications diverses, peut alors être un moteur essentiel de la construction de l’estime également à l’âge adulte.
A l’inverse, certaines théories remettent en question cet impact positif/négatif de la confiance collective et du rapport avec l’autre sur la confiance en soi. Harter (1990) apporte ainsi une première nuance : oui, l’estime de soi d’un individu est influencée par autrui, mais seulement si cet autrui fait partie de son groupe social de référence (Harter, 1990). Par exemple, dans l’enfance et l’adolescence, l’image qu’un individu a de lui-même se construira alors d’abord à partir des images de lui-même que lui renverront ses parents, et pourront être corroborées par ses amis ou professeurs qu’il tient pour forte influence. Kenny & De Paulo (1993) voient même en notre perception de ce que pensent les autres de nous avant tout une traduction de ce que nous pensons de nous-mêmes. L’influence de notre relation à autrui ne serait alors qu’une interprétation personnelle du miroir qu’elle nous renvoie, et non une influence directe. D’ailleurs, Crocker & Major (1989) montrent que l’étude des niveaux d’estime de soi de groupes discriminés par rapport à des groupes non-discriminés ne montre pas de différence significative.
On comprend ici toute la complexité de la psychologie sociale, et toute la difficulté que peut revêtir la mise en place d’une forme de solidarité dans une salle de classe, d’autant plus si son efficacité sur l’estime de soi des apprenants n’est pas démontrée. Il n’existe en effet aujourd’hui pas de compromis scientifique sur l’influence de la confiance collective sur l’estime de soi et la confiance individuelle.
L’AGE ET LES CARACTERISTIQUES PERSONNELLES
La confiance en soi n’est pas invariable, elle évolue au fur et à mesure du parcours de vie. L’âge semble ainsi être une variable influente, et la prégnance des représentations et la gestion des filtres affectifs changent avec la période de la vie. Le prendre en compte pour aborder la confiance et le comportement de chacun, en particulier dans l’apprentissage, semble pertinent : « A l’école primaire, l’apprentissage (du français) est placé sous la dépendance de facteurs à la fois cognitifs et développementaux ; au collège, les facteurs d’ordre socioculturel semblent l’emporter, c’est-à-dire ceux liés à l’image de la langue que se font les élèves (valorisée dans certains milieux, dénigrée dans d’autres), ainsi qu’à la signification que peut revêtir son apprentissage » (Vigner, 2001, p. 1).
On peut ainsi noter une courbe descendante de l’estime de soi à la sortie de la petite enfance : vers la fin de l’école primaire, les enfants semblent atténuer l’évaluation de leurs capacités personnelles, passant d’une surestimation de soi à une représentation plus modeste de leurs compétences, associée à une diminution de leur estime personnelle (Harter, 1999). Cette évolution semble couplée au fait que les enfants, sur la période de 7 à 10 ans, substituent progressivement leur autoévaluation par la prise en compte de plus en plus importante de l’appréciation que les autres peuvent avoir d’eux, avec un paroxysme à l’adolescence (Harter, 1999). La période chronologique suivante de l’adolescence est souvent perçue comme celle où la confiance et l’estime de soi connaissent une diminution significative.
S’agissant de l’âge adulte, on semble observer une tendance d’augmentation de l’estime de soi moyenne de 25 à 60 ans, avant une diminution irrémédiable pour les personnes dépassant les soixante ans (Orth, Trzesniewski & Robins, 2010). Les auteurs notent plusieurs variables : les jeunes femmes tendent à avoir une estime personnelle inférieure aux jeunes hommes, mais les trajectoires des courbes convergent par la suite ; l’estime des personnes issues de minorités décline plus vite ; les personnes avec une éducation supérieure ont montré un pic d’estime supérieur, mais la trajectoire de la courbe est similaire quel que soit le niveau d’éducation ; les changements socioéconomiques et physiques propres à l’évolution des années semblent expliquer en grande partie le déclin de l’estime personnelle (Orth, Trzesniewski & Robins, 2010).
|
Table des matières
1 INTRODUCTION
2 LA CONFIANCE ET LES CONCEPTS DE SOI
2.1 Les différents concepts de soi : confiance, estime, efficacité
2.2 Confiance en soi et sentiment d’efficacité personnelle : les représentations de l’apprenant au cœu de sa motivation
3 INFLUENCES ET DETERMINANTS PRINCIPAUX DE LA CONFIANCE EN SOI
3.1 Le rôle de l’anxiété et des facteurs affectifs
3.2 Le contexte et l’environnement social
3.3 La gestion des émotions : entre émotions, sentiments et représentations
3.4 Confiance en soi et confiance en l’autre
3.5 L’âge et les caractéristiques personnelles
3.6 Confiance en soi et performance
4 APPRENTISSAGE DES LANGUES ET CONFIANCE EN SOI
4.1 l’apprentissage des langues
4.2 Les différentes méthodologies d’apprentissage et leur rapport a la confiance
4.3 Interactions entre apprentissage et confiance en soi
5 LES DENOMINATEURS COMMUNS A LA CONFIANCE EN SOI ET L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
5.1 La motivation
5.2 Le rapport à autrui
5.3 Franchir des barrières – l’importance des émotions
5.4 La construction de son autonomie
6 METHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNEES
6.1 Contexte méthodologique et démarche pedagogique
6.2 Echantillon et contexte de diffusion
6.3 Format et thèmes du questionnaire
7 ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
7.1 Donnéés descriptives
7.2 Données sur la performance
7.3 Existence de corrélations statistiques entre les variables
7.4 Analyse critique des limites du questionnaire
8 DISCUSSION DES RESULTATS
8.1 L’influence des expériences d’apprentissage sur la capacité d’expression orale
8.2 Gestion des représentations et confiance en son expression orale
8.3 Les activités d’apprentissage facilitant la confiance en soi
9 CONCLUSION
Télécharger le rapport complet