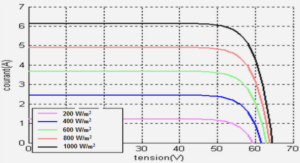Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
La culture Betsimisaraka et l’eau
L’eau est utilisée dans la bénédiction, pour l’honneur pendant le « tso-drano ». Elle est également l’expression de la fidélité et de loyauté, traduite par le «velorano » (serment). Elle est ensuite utilisée pour le «fafirano ny Maty » ou jet d’eau au mort. Pendant le transport du défunt vers la tombe familiale ; à chaque passage par une source d’eau (ruisseau, rivières, etc.), les individus qui transportent le défunt jettent de l’eau sur ce dernier. Et enfin, ne pas donner de l’eau chez les betsimisaraka signifie ôte r la vie. Ainsi, donner de l’eau c’est donner la vie14. Il est même interdit de ne pas offrir de l’eau, c’est-à-dire priver de l’eau à un inconnu, même de passage, «Vahiny ».
L’eau et son cadre juridique
L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. L’eau, que ce soit l’eau de pluie, l’eau de surface et l’eau souterraine, est u n bien public relevant du domaine public. Elle ne peut faire l’objet d’appropriation privative que dans les conditions fixées par les dispositions de droit civil traitant de la matière, ainsi que des servitudes qui y sont attachées en vigueur sur le territoire de Madagascar (Cf. Annexe II).
Historique de l’Association d’usagers d’eau de la plaine d’Iazafo Sud
De 1997 à 2002, la plaine Sud d’Iazafo a bénéficiéd’un projet financier par la Banque mondiale et sous tutelle du ministère de l’agriculture, dont le but principal est la réhabilitation physique du réseau hydro-agricole dela plaine d’Iazafo Sud. Il s’inscrit dans un programme de petits périmètres irrigués ou PPI quivise à l’aménagement et à la réhabilitation physique des ouvrages hydro agricole. A cet effet, des structures d’opération composées des usagers bénéficient du projet, appeléAssociation des usagers d’eau ou AUE ont été créées pour la gestion, l’entretien, et lapolice des réseaux des eaux agricoles (Cf. Annexe III). Après la fermeture momentanément du projet PPI en 2002 dans la plaine Sud d’Iazafo, ces structures d’opération AUE ont disparu petit à petit. Actuellement aucune AUE formelle existe dans le périmètre.
Simbondrano
Dans le périmètre, 39,7% des rizières exploités auniveau de la plaine par l’ensemble des agriculteurs sont des « Simbondrano », La plus forte proportion sont celles de typologie de type 1 avec 69,7% et la type 2 avec 35% des périmètres.
Religion
On compte 9 affiliations religieuses dans la zone : catholique, FJKM, Arapilazantsara, Jesosy Mamonjy, Adventiste, Néo-apostolique, Anglicane et Assemblée de Dieu dont les plus dominantes sont la FJKM et la catholique. Après recensement, on compte que 49,9% des exploitants enquêtés comme étant deschrétiens et affirment être non pratiquant à des rituels traditionnel.
L’émergence du social par rapport à l’économie
Malgré la superposition de l’économie sur le social. L’économie n’a pas changé la cohésion des paysans, d’où 56,7% des exploitants tiennent à la valeur du « fihavanana » par rapport au gain d’argent.
L’entraide et le partage de travail agricole
L’entraide et le partage de travail agricole sont très prépondérants dans la société villageoise de la plaine. Celle-ci favorisée par la disposition traditionnelle. L’entraide et le partage de travail sont encore pratiqués par 75% des agriculteurs et s’effectue pendant les périodes de pointe de travail dont les plus connussont : le « findramana » ou « laho tanana », le « fandriaka 26», le « lampon27 », le « tambirô 28».
Concurrence inter famille au sein du village
Les concurrences entre familles au sein d’un même village sont rares. Celles-ci représentent les respects mutuels et la coexistenceharmonieuse entre les villageois.
Les plus écouté au sein de la société
Dans la plaine, les « Ray amandreny » sont les plus écoutés au sein de la société, avec une moyenne de 75% par rapport à d’autre auxil iaire29 de la société. Ce statut renforce l’importance de ces derniers dans les prises de décision.
Les perceptions des agriculteurs des ouvrages de maîtrise moderne
Dans le secteur, 85,5% des agriculteurs perçoivent la nécessité d’ouvrage moderne de maîtrise d’eau, et que cette innovation doit con cerner tout le monde, c’est-à-dire il faut que cette perception intéresse tout le monde. Si les autres n’innovent pas, alors il ne faut pas changer. Si une majorité d’individus innovent, alors il faut les imiter et adopter la modernisation. Les exploitants perçoivent que le p assage d’un état à un autre ne peut se faire que collectivement ; ce qui ne peut survenir que suite à une concertation des membres de la communauté qui décident d’assumer le risque ensembl.
La perception des exploitations de la gestion de l’eau
Les cultures, mises en évidence dans la vie de la population, guide les comportements quotidiens des agriculteurs ; surtout face à la ressource d’eau. La perception de gestion des réseaux agricole, qu’ils sont très développés ou pas, semble jouer un rôle dans la prise de conscience individuelle et collective des exploitants. Pour convertir cette perception des agriculteurs de la gestion de l’eau dans le périmètre, les critères suivant sont évalués : motivation vis-à-vis de la gestion existante, motivation vis-à-vis des entretiens collectifs, analyse de satisfaction en eau des surfaces irriguées, motivation économique, et viabilité financière.
Structuration des usagers d’eau
Les aménagements en dur nécessaires à la maîtrise et à la gestion de l’eau sur cette plaine sont quasi-inexistants, mise à part un barra ge en béton armé en bon état sur la rivière Sahavaviana. Grâce à ce vide et pour s’adapter à l’ environnement, les exploitants se sont organisés en une structure d’usagers d’eau pour mettre en œuvre les activités économiques. Cette structuration des usagers est caractérisée par la solidarité hydraulique, moyennant d’un barrage en béton et des moyens traditionnels.
Organisation paysanne liée à la modernité
L’existence d’un barrage en béton armé en bon étatsur la rivière Sahavaviana, a motivé les agriculteurs à se constituer en association des usagers d’eau ou AUE. Ce barrage couvre une superficie de 52 ha en rive gauche, et 78 ha en rive droite de l’ancien lit de rivière Sahavaviana. Cette association prend en charge la gestion et l’entretien du barrage de dérivation sur la rivière Sahavaviana, ainsi que des infrastructures qui en sont issues (canaux rive droite et rive gauche, équipés de petits ouvrages de franchissement et de partition) se trouvant sur la zone appelée Ambalakondro.
La maîtrise des AUE des secteurs du périmètre
La maîtrise et la gestion des réseaux d’irrigation du périmètre sont caractérisées par des ouvrages artisanaux de type batardeau de retenu et permanent, des canaux secondaires d’irrigation issus des sources (ruisseau), des canaux de drainage, des canaux de ceinture d’irrigation et de protection, etc. Cette maîtrise des usagers du secteur du périmètre de la situation actuelle, cas de la 2° saison (période décembre-juin) est caractérisée par zone et est détaillée dans l’Annexe II.
L’organisation institutionnelle des usagers pour une gestion communautaire d’eau.
La gestion communautaire de l’eau se caractérise et conditionnée dans l’entraide communautaire, surtout dans l’aménagement et la réhabilitation, l’entretien collectifs de réseau d’irrigation ; dans la société essentielleme rurale, elle est régie par la communauté de travail qui définit les rapports sociaux, et que l’organisation institutionnelles de la gestion communautaire d’eau. Prêter main forte aux membres de la communauté constitue une obligation soutenue et renforcée par le «fihavanana », à laquelle il est, en pratique, difficile voire impossible de se soustraire, vu le contexte d’incertitudes qui caractérisent l’irrigation agricole aussi bien en amont qu’en aval.
A cet effet, la figure 12 ci-dessous analyse le taux de participation en pourcentage des exploitants à la communauté de travail dans l’entretien collectifs des réseaux d’irrigation de la 2° saison rizicole décembre – juin.
|
Table des matières
I- MATERIELS ET METHODES
1.1 Matériel
1.1.1 Quelques concepts et définitions
1.1.1.1 Identité culturelle de la plaine d’Iazafo Sud
1.1.1.2 Les structures sociales traditionnelles dans la plaine d’Iazafo
1.1.1.3 Les Fady
1.1.1.4 Conception de la culture Betsimisaraka sur la terre et la culture irriguée.
1.1.1.5 Source des rizières de la plaine d’Iazafo Sud
1.1.1.6 La culture Betsimisaraka et l’eau
1.1.1.7 L’eau et son cadre juridique
1.1.1.8 Historique de l’Association d’usagers d’eau de la plaine d’Iazafo Sud
1.1.2 Présentation de la zone d’Etude
1.2 Méthodologie générale
1.2.1 Démarche globale de vérification commune aux trois hypothèses
1.2.1.1 Phase préparatoire
a. Bibliographie
b. Webographie
c Phase d’élaboration de questionnaire
d Traitement par Système Information Géographique(SIG)
1.2.1.2 Phase opérationnelle
a. L’Enquêtes
b. Echantillonnage.
c. Typologie des exploitants
e. Repérage des fonctionnalités des SIG : « 5A »
1.2.1.3 Phase de traitement
a. Traitement de données collectées
b. Traitement SIG
1.2.2 Démarche de vérification des hypothèses
1.2.2.1 Hypothèse 1
a. Elaboration de la typologie
b. Le Système d’Information Géographique
1.2.2.2 Hypothèse 2
a. Le Système d’Information Géographique
b. Capital social
c. Les observations
1.2.2.3 Hypothèse 3
a. SIG
b. L’enquête
1.2.3 Limites méthodologiques
1.2.4 Chronogramme d’activité
II- RESULTATS
2.1 Caractérisation des exploitations rizicole dans la plaine
2.1.1 Typologie de la représentation sociale de la plaine
2.1.1.1 Typologie des caractéristiques du capital humain
a. Niveau d’instruction
b. Filiation des exploitants
c. Les « Fady » aux jours
d. Rituel agraire individuel
e. Rituel agraire collectifs
f. Simbondrano
g. Religion
h. L’émergence du social par rapport à l’économie
i. L’entraide et le partage de travail agricole
j. Concurrence inter famille au sein du village
k. Les plus écouté au sein de la société
l. Les perceptions des agriculteurs des ouvrages de maîtrise moderne
2.1.1.2 Typologie de la caractéristique du ménage
2.1.1.3 Typologie des caractéristiques des exploitants
a. Mode de faire valoir
b. Chefs d’exploitation
2.1.2 La perception des exploitations de la gestion de l’eau
2.1.3 Fonctionnement du réseau
2.2. Le principe de gestion communautaire de l’eau adopté
2.2.1 Structuration des usagers d’eau
2.2.1.1 Organisation paysanne liée à la modernité
2.2.1.2 Organisation paysanne liée à la tradition
2.2.2 Organisation et fonctionnement du réseau dans un système de solidarité traditionnelle
2.2.3 Les conditions et principes d’une gestion communautaire de l’eau dans le périmètre
2.3. Promotion de la gestion communautaire du réseau hydro agricole du périmètre
2.3.1 La maîtrise des AUE des secteurs du périmètre
2.3.2 L’organisation institutionnelle des usagers pour une gestion communautaire d’eau
2.3.3 Les modalités pratiques de la gestion des conflits de l’eau pour une meilleure
Convenance dans le périmètre.
III DISCUSSION
3.1 Les Formes de structure d’AUE dans le périmètre
3.1.1 Structure d’AUE prévue par le PPI
3.1.2 Une structure d’organisation paysanne liée à la modernité
3.1.2.1 Statut juridique de l’AUE dans le périmètre étudié
3.1..2.2 Statut juridique d’AUE en tant qu’association
3.2 Avantages et limites de la solidarité traditionnelle du périmètre
3.2.1 Avantage de la solidarité traditionnelle
3.2.1.1 Efficacité
3.2.1.2 Efficience
3.2.1.3 Profit économique
3.2.1.4 Profit social
3.2.2 Limites de la solidarité traditionnelle
3.2.2.1 Changement de climat
3.2.2.2 Conflit foncier
3.2.2.3 Conflit d’eau
3.2.2.4. L’individualisme Betsimisaraka
3.3 Fihavanana, une assurance communautaire
Conclusion
Bibliographie
Télécharger le rapport complet