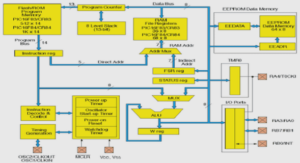Guyane, enjeux de représentation
Le projet Pictonia naît dans un contexte où la question de la représentation s’inscrit dans une histoire lourde et complexe. Les altérités (Carde, 2010) sont multiples et territorialisées entre un intérieur « primitif » et un littoral « civilisé » qui ont connu deux modèles distincts d’administration coloniale (Guyon, 2013), et une application différenciée, mais non moins désastreuse, de politiques d’assimilation. Se représenter dans ce contexte multiculturel est un besoin et une urgence face au traitement médiatique et politique, émanant de l’Hexagone, stéréotypé (Jolivet, 2002) et sans cesse erroné.
Vivre la diversité culturelle de Guyane
La multiculturalité renvoie à la notion de diversité culturelle (Milena, 2010). Cette dernière, n’est pas une exception guyanaise, mais un fait qui concerne de nombreux pays à travers le monde. Quand nous évoquons la diversité culturelle, à quoi nous nous référons-nous en matière de concepts et à quelles réalités renvoie-t-elle en Guyane ?
Les concepts associés à la diversité culturelle
En France, la notion de diversité culturelle est employée pour rendre compte de la pluriethnicité de la société (Doytcheva, 2010). Ici, lorsque nous parlons d’ethnie, nous nous reportons à la définition que propose le professeur Kabengele Munanga. Pour ce dernier, l’ethnie est « socio-culturelle, historique et psychologique ». Il s’agit d’« un conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo território » (« un ensemble d’individus, qui historiquement ou mythologiquement, ont un ancêtre commun, un langage commun, une même religion ou vision du monde, une même culture, et vivent géographiquement sur un même territoire ») (Munanga, 2004 : p. 12, traduction libre). En 1989, dans son article « Nouvelles ethnicités », Stuart Hall se rapproche de cette définition et relie l’ethnicité à la construction identitaire. Il affirme ainsi : « Le mot ethnicité reconnaît la place de l’histoire, de la langue et de la culture dans la construction de la subjectivité et de l’identité ainsi que le fait que tout discours est placé, positionné, situé, et que tout savoir est contextuel . » .
Ceci nous amène à traiter une autre notion associée à la diversité culturelle, la notion d’identité. Celle-ci n’est pas toujours facile à aborder, mais nous pouvons retenir deux caractéristiques fondamentales. La première caractéristique, comme vu précédemment, est qu’il s’agit d’une construction ou d’un processus non figé22. Pour Judith Butler, « les identifications ne sont jamais entièrement et définitivement réalisées. […] Elles sont constamment canalisées, réduites, contestées » (Butler, 2018 : p. 155). La deuxième caractéristique est que, comme les notions de diversité et de représentation, l’identité est intrinsèquement liée à l’altérité. Stuart Hall (2018) affirme ainsi que l’identité « se construit dans ou à travers la différance ». Il synthétise clairement comment s’imbriquent ces trois notions (altérité, identité, représentation) :
« Les identités sont, pour ainsi dire, les positions que le sujet est obligé de prendre alors qu’il sait […] qu’elles sont des représentations, que la représentation est toujours construite sur un « manque », une division, à la place de l’Autre24. » Pour Lepiansky, « la conscience de soi ne se définit et ne se construit que dans une relation d’identification et d’opposition à autrui ». Il s’agit d’une double négation25 : « Autrui n’est pas moi et je ne suis pas autrui » (Lipiansky, 1993). En Guyane, cette notion d’altérité est multiple.
Les altérités de Guyane
L’article d’Estelle Carde sur l’accès aux soins en Guyane met en évidence la « double altérité » du point de vue des soignants qui viennent de l’Hexagone travailler en Guyane. Cette notion de double altérité est intéressante, mais s’il est question des personnes qui sont de Guyane et non de l’Hexagone, cette altérité n’est pas seulement double mais multiple (Collomb, 1999).
L’altérité « originelle » est celle qui vient du fait que la Guyane est un territoire français. Tout territoire ou personne dite « d’outre-mer », est « d’outre-mer » du point de vue de l’Hexagone (Depraz, 2017). Ainsi, tout territoire ou personne « d’outre-mer » est par essence « frappée d’extériorité » (Bernabé et al., 1993). Les autres altérités dans le territoire sont inscrites au sein même des grands « ensembles » de populations.
Cependant, il convient de préciser que le terme « ensemble » ne veut pas dire qu’il s’agit d’une seule et même ethnie. Les populations autochtones amérindiennes ne sont pas un seul groupe ethnique unique qui partage la même langue et la même culture (Collomb, 1999 ; Léglise, 2017 ; Renault-Lescure & Goury, 2009). Ce sont six ethnies appartenant à « trois ensembles linguistiques et culturels différents (Carib, Arawak, Tupi) », qui vivent entre littoral et intérieur et ne partagent pas les mêmes modes de vie. C’est également le cas pour les populations Bushinengue (Fleury, 2018 ; Price, 2013) (fig. 2). Elles peuvent avoir des pratiques culturelles communes, mais ce sont six ethnies différentes et trois ensembles linguistiques différents.
Pour ce qui est des Créoles comme « ensemble », il existe l’idée d’une association au « processus de la créolisation27, comme creuset culturel » (Collomb, 1999 : §18), où se sont fondus descendants d’esclavisés, personnes nées de métissages divers et personnes issues des différentes politiques de peuplement et des vagues d’immigration (Piantoni, 2009). Le nouvel arrivant, avant d’être intégré à la population (donc intégré à la population créole), est considéré comme « Autre » avec sa propre langue, sa propre culture, et parfois son propre mode de vie. Autre altérité.
Nous ne pouvons dire si le « creuset culturel » créole décrit par Collomb est toujours en oeuvre, mais il est certain qu’aujourd’hui, les immigrations des pays voisins s’opèrent toujours et avec cette altérité, les formes de xénophobie et de stigmatisation aussi (Hidair, 2008).
Ces « ensembles » de population forment encore aujourd’hui une certaine version de la diversité qui sépare les Amérindiens, les Créoles et les Bushinenge des Autres (avant que les populations immigrées ne soient intégrées au « creuset culturel créole »). Cette version de la diversité guyanaise, c’est le concept de la guyanité qui se développe dans les années soixante-dix et quatre-vingts. La guyanité « associe prioritairement les trois populations « natives » – Créoles, Amérindiens et Noirs marrons – et [est] progressivement ouverte aux groupes d’arrivée plus récente (par exemple Chinois, Hmong…) » (Collomb, 1999). Ce concept identitaire est particulièrement porté par la classe politique, qui est dominée par la bourgeoisie créole (Jolivet, 1997 ; Collomb, 1999). Cette dernière est considérée comme la plus assimilée au modèle occidental. S’il est certain que la population créole a été le plus tôt « assimilée », d’une manière ou d’une autre, l’assimilation en Guyane n’a épargné personne.
Hégémonie et hiérarchisation sociale
En Guyane, l’« hégémonie » gramscienne se voit dès la fin du XIXe siècle, quand la culture occidentale véhiculée par l’Empire (Said, 2011) impose son « mode de vie et de pensée par laquelle une conception unique de la réalité est diffusée dans toute la société ». Par ailleurs, l’Empire français est « dynamisé par le prestige » (Said, 2011 : p. 149) : la Guyane est une colonie de l’Empire qui veille à diffuser son « mode de vie et de pensée » « prestigieux ». Cependant, dans ce mode de vie et de pensée qui fait la propagande de la colonisation et sa « mission civilisatrice » (Blanchard & Lemaire, 2004), l’idée circule que les populations seraient hiérarchisées. Il y a les « civilisés » et les « primitifs » (Guyon, 2013 ; Jolivet, 1997). En Guyane, cette pensée opère une sorte de déplacement des colons aux créoles et des créoles aux populations considérées alors comme « primitives », les Autochtones Amérindiens et les Bushinenge (Jolivet, 1997). De sorte que perdure, jusque dans les années 1970, une conception hiérarchisée des populations qui place « les métropolitains au plus haut niveau », puis les créoles, « tandis qu’Amérindiens et Noirs marrons, globalement désignés comme « populations primitives », sont rejetés tout en bas de l’échelle sociale » (Jolivet, 1997 : p. 813). Ces relations hiérarchisées rentrent aussi dans l’histoire administrative du territoire (et des peuples) par l’État.
Domination et hiérarchisation territoriale
En Guyane, du point de vue de la « domination directe » selon Gramsci, outre la dimension violente de la colonisation et de l’esclavage que nous avons vue, la hiérarchisation des populations se cale sur une dichotomie territoriale entre le littoral et l’intérieur, que la force du pouvoir de l’État a institutionnalisée. Ici, nous nous appuierons essentiellement sur l’article de Stéphanie Guyon, « Des « primitifs » aux « autochtones34 » ». Comme l’explique la politologue : « En Guyane, la distinction entre « civilisés » et « sauvages » se superposait à des représentations antagonistes des territoires et espaces de vie (littoral civilisé versus intérieur, forêt sauvage) » (Guyon, 2013 : p. 51).
À partir de 1930, le territoire guyanais est administré par deux entités coloniales distinctes qui pratiquent deux modèles d’administration. Alors que le littoral connaît une administration de comptoir comme les Antilles et La Réunion « dans le cadre d’une économie de plantation puis pénitentiaire », qui « entérine un alignement progressif des institutions […] de la colonie sur celles de la métropole et consacre le rôle central des institutions électives locales », l’intérieur forestier, « le territoire autonome de l’Inini35 », est « aux marges coloniales ». Ce dispositif naît de politiques dites « indigénistes », qui favorisent une logique de tutelle où les populations autochtones amérindiennes et bushinenge de Guyane sont sous le statut de « protégées ». La protection « vise à la fois à les préserver d’eux-mêmes (interdiction de la vente d’alcool aux Indiens) et du reste de la population guyanaise (exploitation, accaparement des terres) » (Guyon, 2013 : p. 55). Bien sûr, on est loin du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes36 ». Il n’en reste pas moins qu’il existe une institutionnalisation du clivage entre littoral et intérieur, ce qui marque profondément les destins des populations de Guyane.
Répercussions sociales
Avec la départementalisation de 1946, le territoire de l’Inini devient un arrondissement et perdure jusqu’à la réforme de 1969 (fig. 3). Cependant, la réforme ne mettra pas fin à la différenciation entre littoral et intérieur ; elle introduira en revanche l’assimilation « brutale » dans un territoire jusque-là plus ou moins protégé. En effet, dès 1964, l’État entreprend une vaste opération pour donner la nationalité aux populations autochtones amérindiennes et bushinenge (Boullosa Joly & Guyon, 2014), qui conduit à une « normalisation administrative ». Cette « normalisation » se fait à travers le prisme des valeurs occidentales et au mépris de la structuration politique et sociale des ethnies. C’est ainsi que, comme l’expliquent Maïté Boullosa Joly et Stéphanie Guyon :
[dans] l’intérieur du pays […] on favorise […] la sédentarisation des villageois pour demeurer à proximité des écoles. L’administration impose également progressivement la reconnaissance des enfants par le père et donc le nom du père. Cette pratique administrative tend ainsi à substituer la filiation patrilinéaire au système de filiation matrilinéaire en vigueur chez les Noirs marrons, mais aussi chez les Amérindiens lokono.
La scolarisation, qui oblige les jeunes à quitter leur village pour être scolarisés en ville (Galvao, 2007 ; Perigny-Baumann & Chevallier, 2019), perturbe leur mode de vie et leur développement au sein de leur communauté. Ils se retrouvent alors « livrés à eux-mêmes » et « rencontrent bien souvent l’échec scolaire, l’alcool [et] les drogues » (Bullosa & Guyon : p. 237). Avec cet éloignement obligatoire, c’est la transmission des savoirs et des savoir-faire qui est ébranlée. C’est ainsi tout le socle des savoirs et des valeurs identitaires, qui permettent notamment de se représenter, qui est mis à mal.
De la représentation de la Guyane
Il existe bien des films, des ouvrages, des documentaires ou des travaux d’arts visuels qui font état d’une représentation positive ou simplement juste de la Guyane. Cependant, le poids des innombrables représentations stéréotypées (Jolivet, 2002), erronées ou stigmatisées (Marcou, 2001) prédomine jusqu’à aujourd’hui.
S’il arrive que l’actualité guyanaise et des Outre-mer soient traitées par les médias nationaux42, cela ne veut pas pour autant dire que ce traitement soit réalisé correctement. Les médias nationaux font autant d’erreurs que le gouvernement (et la classe politique) en fait lui-même. Ainsi, en avril 2020, une allocution d’Édouard Philippe au journal du soir43,44 était accompagnée d’une présentation montrant toutes les cartes des Outre-mer à l’envers (fig. 13).
En juin 2020, une journaliste de BFM soulignait à propos de la Guyane : « Là-bas, on entre dans l’hiver et ça ne va pas aider non plus. » On pourrait supposer qu’il ne s’agit là que de « bourdes » parmi tant d’autres, mais ces erreurs sont, en réalité, très fréquentes. Lorsqu’elles proviennent des médias et des plus hautes sphères de l’État, c’est la métropole toute entière qui semble ne rien savoir sur la Guyane, mis à part les grands clichés sur « le bagne, la fusée, la jungle », des éléments marqueurs de représentations, souvent stéréotypées (Antice & Guidez, 2019 : p. 37) ou fantasmagoriques sur la Guyane, véhiculés depuis les premières heures de la colonisation (Jolivet, 2002 : p. 122).
Il convient de souligner que la Guyane subit encore les effets de l’imaginaire de la période coloniale45 (Blanchard & Lemaire, 2004 ; Todorov, 2013) qui la situe à la fois comme terre d’exploration fantasmée (à la recherche de l’Eldorado) et « enfer vert » (Bouyer, 1867). Comme le précise M.-J. Jolivet, l’« enfer vert » est utilisé pour désigner « la forêt amazonienne comme prison, voire tombeau des bagnards » (Jolivet, 2002). Ce sont les stigmates que portent la Guyane des premières heures de la colonisation, jusqu’à nos jours.
Puisque nous parlons de « l’imaginaire du bagne » associé à la Guyane, prenons l’exemple de la dernière adaptation cinématographique du livre autobiographique de Papillon de Michael Noer46. Le film est tourné dans plusieurs pays européens (Serbie, Monténégro et l’île de Malte47). Si le choix de tourner en Europe est motivé par des besoins logistiques, les efforts pour représenter la spécificité de la forêt amazonienne restent laconiques. Mieux encore, le sol calcaire remplace la latérite48. Cela ne signifie peut-être rien pour le réalisateur, mais l’image « d’un paysage de relief d’origine calcaire aux côtes déchiquetées, alternant falaises et baies49 » est choquant pour n’importe quel Guyanais50. Le choc est d’autant plus fort que la seule fois où est entendu le son51 emblématique du Paypayo52, qui caractérise la vie en forêt amazonienne, est sur une plage qui est censée être au Honduras, alors qu’il n’est jamais entendu dans les scènes supposées se dérouler dans la forêt guyanaise. Or, le Paypayo, qui est reconnu par son chant trisyllabique, ne vole pas près de la mer. Il ne vole qu’en milieu forestier, au niveau de la canopée53,54. Cet oiseau « est le symbole de la forêt amazonienne ». Il a non seulement été utilisé dans un contexte peu probable, mais il est de surcroît déconnecté de son milieu naturel et de son pouvoir représentatif du territoire amazonien qu’est la Guyane.
Pour un design qui s’intéresse à la diversité, l’étude de la complexité d’un phénomène est fondamentale et ne peut se faire en dehors de l’histoire et des réalités locales (Escobar, 2018), qui sont elles-mêmes complexes. Les populations de Guyane dans toute leur diversité, qu’elles soient du littoral ou de l’intérieur, sont pétries de marqueurs culturels et naturels forts. Comment les pictogrammes peuvent-ils avoir pour fonction la représentation de la diversité ?
Pictogrammes et représentation de la diversité
Les pictogrammes sont à la base du projet Pictonia. Ceux qui nous intéressent particulièrement sont ceux qui ne cessent de s’imposer dans le monde de la communication. Affiches, panneaux de signalisation, sites internet, brochures, réseaux sociaux, messages sur WhatsApp ; les pictogrammes, qu’ils soient en tracé ou pleins, sous forme d’esquisse ou structurés, sont inévitables. Ici, nous nous intéressons aux évolutions des usages autour des pictogrammes qui suivent celles de la communication, y compris dans ses remises en cause. Nous proposons d’analyser deux projets symptomatiques de ces évolutions et de voir comment les designers se positionnent pour plus de diversité dans la création de pictogrammes.
L’Isotype d’Otto Neurath, des pictogrammes universels ?
Comme le précisent Rayan Abdullah et Roger Hübner, « au sens strict le pictogramme est une invention moderne » du début du XXe siècle. Si la Société des Nations acte, en 1927, la recommandation d’une série de signes pour le trafic routier55, on ne parle pas encore de pictogrammes et ceux-ci ne sont pas, non plus, pensés de manière standardisée. Le système qui va initier une approche standardisée du pictogramme, c’est l’ISOTYPE (International System of Typographie Picture Education) fondé notamment56 par Otto Neurath (1882-1945).
Neurath évoque d’abord une méthode de statistique par l’image, la Wiener Méthodes der Bildstatistik [Méthode viennoise de statistique par l’image], développée dès 1923. L’appellation « Isotype » est inventée en 193557. Le point de départ de ce système typographique est de communiquer des données et des informations pour éduquer. Pour ce faire, il utilise des diagrammes associés à des « symboles individuels », qu’ils « simplifient » de plus en plus :
Quand nous avons commencé, les symboles individuels étaient dessinés de manière relativement réaliste, mais en utilisant une nouvelle technique, ils se sont rapidement simplifiés, sans pour autant devenir moins explicites. […] Nous découpions ces symboles […] dans du papier de couleur, réduisant ainsi les contours à un minimum, et évitions bien évidemment les traits intérieurs à chaque fois que c’était possible.
De la simplification des symboles individuels, Neurath et son équipe procèdent à la duplication qui permet d’avoir un langage qui peut être utilisé par « des locuteurs de différentes langues ». Là est le but de la démarche : « diffuser le savoir de manière aussi étendue que possible, en réduisant les fossés qui séparent les nations et les familles de langues » (Neurath, 2018 : p. 164). Le cadre dans lequel émerge l’Isotype se prête particulièrement à cette double intention populaire et cosmopolite. En effet, Otto Neurath dirige le Musée de l’habitat moderne, qui est ouvert le soir pour permettre aux travailleurs viennois de le visiter (intention populaire) (Neurath, 2018 : p. 164). Aussi, l’institution est ouverte à l’international à travers ses collaborations (intention cosmopolite). Selon Otto Neurath, pour qui « les mots divisent, les images unissent », l’Isotype peut « s’adresser à l’humanité tout entière, et permettre à n’importe qui de contribuer au débat au moyen d’une base d’information visuelle ». Il confère donc à son système typographique une dimension universelle qui implique que le « créateur de diagrammes Isotype [soit] aussi « neutre » qu’un cartographe ».
Malgré les intentions de neutralité et d’universalité d’Otto Neurath, il convient de rappeler que l’Isotype a été pensé dans les années 1920, en pleine période d’expansion des empires coloniaux (Pater, 2016). Cela n’est pas sans rappeler le concept d’hégémonie de Gramsci. Edward Said (2014) étend le concept d’hégémonie à celui d’impérialisme culturel. Ce dernier permet de comprendre comment, à travers les mécanismes démontrés par Gramsci, une conception « spiritualiste58 » de la culture s’est développée en Occident et a favorisé son « hégémonie » par la diffusion « de sa propre vision du monde » (Gramsci, 2011). Cette vision a servi le déploiement du « prestige » des empires, comme on l’a vu plus haut. L’intention selon laquelle l’Isotype s’adresse « à l’humanité tout entière » est considérée du point de vue européen de l’époque qui assigne les altérités à l’infériorité (Said, 2014 ; Hall, 2019). Ces altérités sont considérées à travers le prisme du concept de race.
Le professeur Kabengele Munanga oppose le concept d’ethnie, qui est « socio-culturel, historique et psychologique », à celui de race. Pour lui, le concept de race est « morpho-biologique », il s’inscrit « na história das ciências naturais […] foi primeiramente usado na Zoologia e na Botânica para classificar as espécies animais e vegetais ». Il affirme que c’est à partir du XVIe siècle que le concept est utilisé pour désigner « un groupe de personnes qui ont un ancêtre commun et qui, de fait, possèdent des caractéristiques physiques communes ». D’abord utilisé pour distinguer les classes sociales (noblesse et plèbe60), il est utilisé pour « diviser » et hiérarchiser l’humanité en plusieurs races à partir du XVIIIe siècle61. « Assim, os indivíduos da raça “branca”, foram decretados coletivamente superiores aos da raça “negra” e “amarela” ».
Le système typographique d’Otto Neurath représente ainsi l’humanité en cinq groupes différents qui distinguent les Européens (représentés pas l’homme64 habillé) des non-Européens – les Autres – (représentés par des hommes sans t-shirt et avec des tenues qui seraient traditionnelles) (fig. 17 & 18). Cette humanité est aussi signifiée par les couleurs assignées à ces différentes races. Otto Neurath reconnaît lui-même une difficulté au moment de choisir une couleur spécifique pour « indiquer le mot « homme (en général) » » puisque, « […] le noir ; le blanc, le rouge, le marron et le jaune sont déjà utilisés pour désigner certains groupes de population […] » (Neurath, 2018 : p. 142).
Otto Neurath souhaitait adresser l’Isotype à « l’humanité tout entière », mais ce dernier n’était ni universel, ni neutre. Il était ancré dans une conception raciale de l’humanité véhiculée par l’impérialisme culturel de l’Occident. Cependant, la méthode a été déployée avec suffisamment de « qualité et de consistance » (Pater, 2019) pour marquer le design graphique du pictogramme pour plusieurs décennies. Le pictogramme, particulièrement utilisé pour la signalétique, passe des supports de signalisation aux objets numériques et devient incontournable avec la communication globale, appelée aussi, communication à 360 degrés.
Le projet « Identités complexes » d’Unistra, pictogrammes d’une marque à 360 degrés
En distinguant les pictogrammes « commerciaux » des pictogrammes « pionniers», Rayan Abdullah & Roger Hübner (200665) mettent en avant le lien d’interdépendance des évolutions des pictogrammes avec celles de la communication. Cette relation est particulièrement visible avec le tournant de la communication globale que le projet « Identités complexes » de l’université de Strasbourg illustre.
La communication globale est liée à la globalisation66, et nécessairement 67, au développement des nouvelles technologies (Mattelart, 2008). Laurent Habib, dans son ouvrage La communication transformative, considère que le champ de la communication initialement ouvert exclusivement aux clients et aux consommateurs « s’est […] élargi aux « parties prenantes » : salariés, journalistes, organisations professionnelles, pouvoirs publics […] ». Étant « contre-productif » d’aborder chaque public individuellement, « les communicants ont naturellement trouvé une réponse à ce nouveau défi dans une « communication multicanale intégrée », pour décliner les messages de la marque sur une multiplicité de supports vers l’ensemble de ses publics, et ainsi parler à tous comme à chacun ». Ainsi, la communication globale amène à communiquer à 360 degrés à travers des canaux (points de contact) de plus en plus divers (Habib, 2010). La marque doit être visible et visible partout. Pour Pierre Litzer (2016), à l’heure de la mondialisation, une « culture de la visibilité » émerge. Le pictogramme, qui figure dans le « système visuel de la marque », participe à cette culture.
« Identités complexes », le projet de recherche-action de l’Université de Strasbourg pour la création collective68 du système visuel de l’établissement illustre notre propos, en plus d’être intéressant pour notre démarche. Nous proposons d’étudier brièvement les principes qui ont conduit à l’élaboration de la série de pictogrammes.
|
Table des matières
Résumé
Abstract
Introduction
01. Repérer
1. Guyane, enjeux de représentation
2. Pictogrammes et représentation de la diversité
3. Pictonia, pour une représentation de soi
02.Valoriser
4. Culture mondiale & culture locale : des pictogrammes « locaux » d’Afrique de l’Ouest
5. Culture locale & culture graphique : voir la diversité des ressources graphiques en Guyane
6. Culture graphique & représentation : opportunités et freins
03. Réapproprier
7. Je crée, tu crées, nous créons
8. Designer Shiva : les multiples postures du designer
9. Réappropriation pour un dialogue entre imaginaires
Conclusion
Bibliographie
Annexes
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet