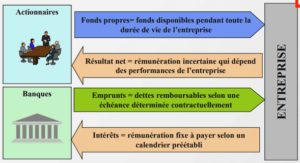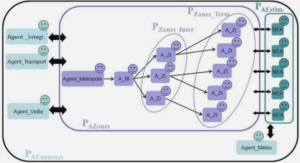Techniques et méthodologie : de l’acquisition jusqu’au mapping
Ici nous décrirons la méthode d’acquisition photogrammétriaue en l’illustrant par le cas pratique de ce mémoire : L’Abri du Poisson. Les manipulations ont été faites par agisoft photoscan.
Trois phases sont à distinguer dans cette chaîne opératoire du relevé numérique et qui construiront un modèle à plusieurs niveaux tel que :
1. L’acquisition photos et des repères (géoréférencés)
2. La construction tridimentionnelle (avec le maillage « fil de fer » et « surfacé »)
3. La texturisation du modèle 3D par acquisition photographique
L’idée d’un espace 3D est avant tout une représentation numérique de notre perception binoculaire de l’espace, c’est à dire que c’est une projection de l’espace tel que nous le percevons : selon des droites, des axes, des repères, ou des primitives géométriques tel que le décrivait Livio de Luca.
L’espace se contruit alors autour de 3 axes, 3 axes qui caractérisent aussi notre propre spatialité par ailleurs : XYZ. Le but du relevé numérique est également de mettre en exergue un objet par rapport à son environnement, proche ou lointain et d’avoir un regard omniscient dessus.
Etape 1 : L’acquisition photos et des repères (géoréférencés)
La phase d’acquisition doit se faire de préférence lors d’une même session, par une lumière homogène, avec une même focale. Plusieurs guides conseillent de faire plus de photos que pas assez: une moyenne de 50 à 100 photos pour un objet de taille moyenne. En effet Il est important qu’un point soit visible sur deux caméras (deux photographies) minimum afin d’avoir un minimum de continuité (80 % de recouvrement est préconisé) (fig 1).
Il existe différentes manières de prendre les photos qui viendront créer notre maillage. (fig 5) Cependant une bonne acquisition photo découle préalablement d’une bonne compréhension de la géométrie du sites étudié. On parlera alors de « compréhension morphologique » afin de trouver quelle méthode convient à quelle morphologie. Certains sites patrimoniaux présentent des discontinuités ou des morphologies complexes mais d’une manière générale on pourra parler de la présence de plan dominant dans chaque acquisition.
On peut voir sur ce graphique (fig 6) que la méthode d’acquisition varie en fonction de la planéité de l’objet à modéliser, de sa taille et de sa morphologie. C3DC définit ces méthodes comme la ‘‘prise de vue en axes parallèles (stratégie linéaire), la prise de vues convergentes ou divergentes (stratégie circulaire), ou mixte (stratégie aléatoire)
Une fois cette étape de terrain réalisée on peut aligner les photos et obtenir un nuage montrant les points de liaisons trouvés entre les photos (fig 2)
Le fait que la photomodélisation est une technique de relevé indirect n’exempte pas le fait que la prise photographique peut être associée à une prise de relevé et de mesure manuelle afin de fiabiliser ses recherches (établir un schéma de l’environnement).Par rigueur il est conseillé de prendre des longueurs de références en notes et d’appliquer un processus systématique dans ses méthodes d’acquisitions photographiques. Il sera possible de les reporter plus tard dans le modèle. Agisoft permet également de placer des points de repères préalablement (à des endroits stratégiques, exemple : Une tâche, un angle) qui pourront plus tard ou pendant le processus d’acquisition être géoréférencé. Ici je les ai placés manuellement à partir de chaque photo (fig 3). Placer les repères sur des photos permet de reporter automatiquement ces repères sur le modèle 3D. Il est possible aussi de déterminer les coordonnées (voir les valeurs estimées) d’autres repères dans le modèle si l’on possède déja au minimum 4 repères géo référencés. (fig 4)
C’est grâce à ces repères que différents modèles pourront être combinés en l’absence de recouvrement photographique.
Etape 2 : La construction tridimensionelle
C’est le pixel en tant qu’unité de mesure qui va définir la qualité d’un maillage tridimensionnel. A partir des points de liaison le logiciel va construire un nuage de points denses. Sur un plan théorique 1 pixel= 1 coordonnée, bien qu’aucun ordinateur ne soit assez puissant pour le moment pour calculer ce ratio. C’est ainsi que pour une méthode d’acquisition nous pouvons utiliser un simple smartphone 12mpx comme un appareil reflex avec un objectif d’une qualité bien plus supérieure. (fig 6)
Ensuite il sera possible de construire un maillage surfacé (fig 7) à partir de ce nuage de points qui sera notre base pour l’Etape 3 : le mappage texturé. Le maillage correspond au nombre de face.
Tout comme le nuage dense il est possible de le parametré.
Etape 3 : Le mappage texturé ou texturisation 3
La mapping des textures en photogrammétrie correspond dans la majorité des cas au mapping de texture réel prise par photographie. (fig 8) (fig 9) Livio de luca dans son livre 4 explique que l’on peut considerer l’application de texture réelle comme étant elle-même une interprétation de la machine, qui comporte ainsi potentiellement des incohérences par endroit de par sa complexité mathématique.
On parlera de surface polyédrique pour les surfaces que l’on obtient, et il peut être possible d’avoir des rendus de texture appliquée trop « anamorphosés » pour correspondre à la réalité.
Cependant ces soucis de cohérence peuvent être gommés par une rigoureuse prise de repères associés à une qualité de photo optimum. On va donc associer une image 2D (plane) un polygones ou a une forme paramétrique, et ce plaquage de texture s’effectue simultanément entre toutes les caméras. Ceci explique que le processus est relativement long lorsque l’on veut obtenir un résultat satisfaisant, voire impossible lorsque le matériel n’est pas adapté.
Différents modes d’application sont possibles en fonction du volume : Générique, orthophotos, orthophotos adaptatives.
Technique propre à l’archéologie :
Dans le domaine de l’archéologie appliquée à la photogrammétrie un rapport de recherche détaille quelques modalités intéressantes à explorer pour faciliter l’acquisition :
• l’utilisation mixte de la vidéo et de la photo pour une acquisition rapide ;
• l’utilisation de la macrophotographie pour la modélisation de petits objets ;
• l’utilisation d’objectifs à bascule pour la modélisation des objets plans ;
• la modélisation de petits artéfacts en limitant le nombre de prises de vues ;
• le développement d’une technique d’éclairage rasant « légère » (utilisable en lumière naturelle).
M. Samaan développe dans ce rapport que la photogrammétrie pour le moment est limité dans la mise en valeur de détails fins, notamment lorsqu’il n’y a pas de recours à une technique d’éclairage rasant (mise en valeur de microtraces).
Le caractère sacré du modèle numérique ?
Une tendance s’opère à mieux considérer le numérique que des relevés graphiques et à donner plus de véracité aux calculs numériques. Pour autant le relevé manuel, graphique, analogique permettait de se poser plus de problématiques que les modèles numériques qui auront tendance à les occulter de par le fait que l’on se «repose » sur la capacité de la machine. On peut appeler cela le caractère sacré que nous donnons à ce qui ressort de la machine. Pourtant nous le verrons dans le cas de la grotte du Poisson.
Dans le domaine de la recherche, mais dans les faits, les aller-retours, afin de comparer constations de visu/Model numérique sont nécessaires.
“‘L’appareil photo devient machine à capturer la réalité »’
Cette phrase de 2009 prononcé par Livio de Luca 1 n’a jamais été aussi vraie, car l’appareil peut maintenant non seulement figer le temps, au même titre que les clichés argentiques début 19e, mais également le dérouler spatialement, en lui donnant une forme, un lieu fictif, un lieu virtuel.
M. Maumont dans ses récentes recherches affirme que la domination du numérique sur le graphique occulte certaines questions, et notamment la supériorité d’exactitude totale qu’aurait le numérique :
Il faut aussi reconnaître que nous attribuons au numérique une résonnance particulière, quelque chose d’un peu ‘spécieux’ dans ses facultés. Nous imaginons toujours que les chiffres sont plus précis que le graphique. Or le graphique et ses représentations généraient des questions, alors que le numérique a tendance à les occulter. Pourtant, ce mappage, cette texturation ‘vraie’, s’avère absolument indispensable pour se repérer dans la représentation d’un objet en trois dimensions. C’est le produit vers lequel il faut tendre et oeuvrer pour ses développements.»
Dans <<images virtuelles et horizons du regard » 3 le postulat est pris que l’image, son traitement, permet ‘‘une meilleure compréhension, une intelligibilité du visible ». Plusieurs référents se heurtent dans ce processus. Celui du réel et celui de la logique mathématique pure. Dans le cas de la photomodélisation, nous sommes dans ce paradigme entre ce que nous voyons, et ce qui est ‘‘ressorti »’ des calculs de notre logiciel. Le lieu virtuel peut être modifié selon notre bon vouloir (modification du nuage de point pour exemple avant la phase de reconstitution), on peut également y joindre des données scientifiques qui vont venir modifier l’image numérique (dans le cas d’un processus de recherches). Aussi l’image numérique tend vers un modèle théorique, mathématique qui peut venir requestionner notre expérience de ce lieu virtuel.
Ces images, ces modèles 3D sont devenus essentiels en 2018 dans la recherche, la médiation, etc., aussi bien qu’à présent le domaine de la recherche est en lien avec l’évolution du numérique et de l’imagerie. On peut extrapoler cela à la photomodélisation, mais cela concerne plutôt le principe de caméra, des outils qui permettent de percevoir notre environnement. Plusieurs domaines, perdent ainsi un certain contrôle sur leur propre domaine, car leur dépendance à un autre est devenue trop forte.
On parlera d’industrie de l’image : une industrie qui va venir assujettir d’autre domaine à son évolution.
Pourtant, le numérique possède ses détracteurs, et ceux de tout domaine : Serge Tisseron parle de ‘‘super illusion’’ en parlant de la réalité virtuelle et certains universitaires d’une ‘‘opposition soit avec le potentiel, soit avec l’actuel, soit avec le tangible’’. Il y a de cela quelques années il était abérrqnt de conjuguer ‘‘virtuel et réel, fiction et histoire, jeu et devoir de mémoire’’ : Des domaines que tout semble opposer : l’une par son goût pour sa projection et son évolution dans le futur et l’autre par son attachement au passé et à la mémoire. Ainsi nous sommes en présence d’une opposition des temporalités propres à chacunes des discipline.
Une contradiction se retrouvant dans les acteurs de ces domaines ayant parfois des rapports non pas de force, mais des objectifs différents. Schedae, revue de la presse universitaire de Caen, expose que d’autre part, qu’il faut considérer les problématiques qui sont de l’ordre de la conception et de la diffusion de ces mediums.
Pour la conception, on peut évoquer alors les acteurs de ces domaines ‘‘soumis’ (ceux perdant le contrôle de leur diffusion) et se poser de légitimes questions : Sont-ils préparés à pouvoir exploiter les images et à manier les processus de fabrication de l’image ? Dans le cas de notre mémoire et de manières plus claires : les acteurs en lien avec le patrimoine ; archéologue, architecte ; ont-ils les clefs pour comprendre cette technologie de plus en plus émergente ? Ou doivent-il devenir assujettis à une autre profession maniant mieux les méthodes (Infographistes, topographe). Le manque de partenariat entre ceux qui exploitent les données et ceux qui les créent expliquerait alors possiblement le manque de <<générosité » et d’ambiance de certaines initiatives de reconstitution 3D (ou autres processus d’image numérique).
La réalité est toute autre, et l’outil 3D, en particulier, ne souffre aucun amateurisme, tant le travail de restitution, s’il prétend à un quelconque intérêt scientifique, est d’une grande complexité.’’
Mariam Samam dans sa thèse de doctorat ‘‘La photogrammétrie rapprochée au service de l’archéologie préventive’’ estime que malgrè les solutions de démocratisation de l’outil, un accompagnement est nécessaire dans certaines situations délicates:
En effet, il existe aujourd’hui, et nous pensons que cela restera longtemps le cas des situations limites dans lesquelles ces solutions tout automatiques ne fonctionnent pas encore. Dans ces problèmes limites, la connaissance fine des contraintes de la photogrammétrie pour mettre au point un ensemble cohérent ‘protocole d’acquisition et flux de traitements dédiés reste nécessaire. »
Pour conclure le relevé analogique, manuel du patrimoine bati est une étape nécessaire dans la compréhension que nous faisons d’un bâtiment. En préalable à un relevé photographique (ou au laser) elle permet également de comprendre les éléments d’un édifice et la géométrie descriptive de celui-ci afin d’avoir la meilleure acquisition possible. A côté de cela, l’étude récente de H.Marcher, en 2017, démontre que le processus de photogrammétrie tend à aller vers toujours plus d’automatisation en se détachant du nombre important d’étape de traitements.
“Nous savons également par la pratique que la photogrammétrie, encore plus précise, est plus lourde à mettre en oeoeuvre dans le domaine des grottes. Hormis quelques cas spécifiques, nous devons aujourd’hui considérer que la lasergrammétrie présente le meilleur concept en conciliant capacité, rapidité d’acquisition (parce qu’automatisée) et bonne précision, offrant donc un coût de revient avantageux. Dans certains cas, il est néanmoins possible d’imaginer la complémentarité des deux techniques (MNT laser et MNT par corrélation avec calage topométrique succinct), notamment pour le suivi microbiologique dans certaines cavités. ‘’1 M.Maumont a conclu dans son rapport que ces deux techniques sont efficientes pour les relevés d’art rupestre (en caverne) mais ceux au vu de la topologie du site et des ‘’envies’’ et réutilisation qui se feront de ce modèle. En effet, il apparait important aussi de se questionner sur la qualité de ces rendus 3D et de ne pas surestimer les instruments sans quoi le projet 3D pourrait aboutir à une’’précision relative fictive et inutilement onéreuse”’. Il ajoutera que définir en amont les objectifs et besoins scientifiques/ pédagogiques permet dès le début de choisir les meilleures techniques et définitions pour le projet, au risque sinon d’occulter le fait/questionnement scientifique par la simple création systématique de plusieurs médiums de travail numérique, parfois inutiles.
Bien que la photomodélisation se soit démocratisée et soit maintenant “’facile”’ d’accès, elle pioche des compétences de plusieurs domaines, classant ainsi ses utilisateurs dans le domaine de ces “nouveaux métiers” du numérique. En effet, à mi-chemin entre l’infographie, les compétences du géometres, de photographe, intrinsèquement elle est liée aussi à l’architecture par l’analyse des espaces. Aussi elle occasione des partenariats entre Archéologue/Architecte donc le cas pratique de ce mémoire fait partiellement état.
Concernant les collaborations (archéologue-architecte), je n’en ai pas encore assez vu pour me faire une idée globale de la pertinence.
Ce que je vois aujourd’hui c’est que des archéologues se transforment en archéomaticiens. Certains se passent désormais de géomètres sur les chantiers et utilisent eux-mêmes d’autres moyens d’acquisitions comme la photogrammétrie ou le scanner-laser : souvent par souci d’économie ou pour faire le chantier dans les temps. (…)
Parfois, des archéologues pensent avoir suffisamment de connaissances pour produire les données qui répondent exactement à leur besoin mais ce n’est pas toujours le cas. Et les personnes qui reprennent la suite se rendent compte bien plus tard que les choses ne vont pas. Bien évidemment, il y a aussi des archéologues qui maîtrisent les aspects de la topographie et donc cela ne pose pas de soucis. Mais ceux qui maîtrisent la topographie et la photogrammétrie sont plutôt rares… PhotoScan et bien d’autres logiciels permettent de faire facilement de la photogrammétrie aujourd’hui cependant qualifier les données produites demande des compétences en plus de savoir utiliser le soft et le piège est que l’on peut vite produire un résultat qui visuellement est correct mais qui ne répond pas peut-être pas aux objectifs fixés.
(…) La qualité des données est importantes surtout dans les systèmes ou l’on automatise des analyses >>
Xavier Muth (Get In Situ), topographe du projet de l’Abri du Poisson me délivre un contast similaire. Hormis pour les projets de grandes envergures possédant des financement importants (ex : Lascaux), il y a peu de financement notamment dans le domaine de l’archéologie pour des projets de numerisation poussée par photogrammétrie pour le moment : le marché reste relativement restreint.
Les relevés archéologiques :Du manuel au numérique — aller vers plus de complémentaritée
Les récentes technologies nous interrogent sur l’avenir du relevé manuel. Les drones et l’optimisation des caméras d’acquisition jouent pour beaucoup car l’on obtient à present de meilleur résultat par le numérique que par le dessin.
Les compétences de guidage de drone ou celle de photographe s’ajoutent à la palette de la personne souhaitant faire un relevé photogrammétrique. De ce fait la photogrammétrie n’est plus si accessible que cela et est souvent assimilée au métier de géomètre, géomaticien etc. On peut se demander pour le métier d’archéologues si ceux ci restent sur l’ancienne methode du « relevé » manuel ou préfèrent le relevé numérique ? Et si oui, sont-ils aptent à le faire par euxmêmes?
Il est particulièrement intéressant comme dispositif pour palier aux problèmes de terrain évoqués plus tôt telles que les pentes escarpées, mais également pour pouvoir faire des acquisitions «vues du ciel afin de capter toutes les faces d’un édifice. D’autres startups font le fer-de-lance de cette technique comme Iconem, entreprise de cartographie numérique ne cache pas ses ambitions de pouvoir créer un jour “‘une sorte de wiki »’ qui deviendrait une base de données pour l’UNESCO.
D’une part, les moyens techniques nécessaires sont encore assez onéreux et, d’autre part, l’étude archéologique d’un édifice en élévation se fonde avant tout sur l’analyse stratigraphique de l’ensemble avec un objectif et une méthodologie bien distincts de l’approche patrimoniale. Dans ce contexte, le relevé en plan et en élévation est généralement suffisant pour créer des supports graphiques à des fins archéologiques. Toutefois, le relevé en trois dimensions possède quelques attraits que nous illustrerons à travers deux études d’édifices en élévation. ‘‘ 2 Simon Bryant Simon Bryant corrobore les dires de l’étudiant à l’ENSG et mes observations sur le terrain (partie 2 du mémoire) en expliquant que l’apparent désintérêt des archéologues pour la 3D tient au fait que les compétences nécessaires sont en décalage avec la formation initiale/continue ce qui amène les archéologues à sous traiter majoritairement.
‘‘Dès lors, les archéologues risquent de se voir marginalisés face à la tendance du ‘tout technique’ de ces cabinets d’ingénieurs, capables de fournir de belles images mais sans réelle valeur archéologique ou historique car créées sans analyse technique et stratigraphique’’.
Les partenariats avec architectes du patrimoine, géomètres, infographiste etc semble nécessaire en amont du processus afin de garantir la fidélité des documents 3D sur lesquels ils peuvent avoir peu de contrôle lors de leur édition.
LA REUTILSIATION DES PHOTOMODELISATIONS
Sa réutilisation est multiple, source de nombreuses interrogations. Elle permet de pérenniser un lieu dans le temps, d’être support de recherches scientifiques comme elle permet d’être support pédagogique ou d’être vecteur de démocratisation à l’accès au patrimoine par son caractère d’ubiquité.
Le modèle 3D vient offrir une plasticité modifiable à l’infini en phase de création et l’on pourrait dire que cela ne concerne pas le patrimoine. Pourtant elle nous intéresse en cela que le modèle tridimensionnel se finalise souvent dans un but de recherches ou d’outil pédagogique en reconstitutions. La photogrammétrie sert de basent de modèle qui pourront être modifiables.
Les reconstitution se base sur des hypothèses ellesmême faites par des équipes de scientifiques, d’archéologues, d’historien ou d’architecte BAF. Ces dispositifs de reconstitution font parfois l’objet d’un travail plus poussé tel que l’ajout des ambiances (lumineuse, mobilité des personnages). Le modelé tridimensionnel va pouvoir permettre de s’affranchir de la notion de présence et ainsi nous amener à explorer un lieu en 3D à l’infini sans répercussions directes. Pour le moment le modèle 3D reste un support au travers d’un médium (Ordinateur, tablette, smartphone). Bien que la récente venue sur le marché de casque oculusrifte et autre interface immersive vient requestionner le statut de ces lieux numériques. Hormis l’outil scientifique, sa forme se simplifie et s’épure pour l’outil pédagogique, venant inclure l’histoire et l’ambiance du lieu à cette interface virtuelle. On pourra noter que de plus en plus de musées se détachent de leur support classique pour tendre vers ces interfaces numériques.
|
Table des matières
SOMMAIRE
Comment la mémoire de lieux patrimoniaux sensibles peut elle être perpétuée grâce aux photomodélisations?
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION
VOCABULAIRE
LES SITES PATRIMONIAUX ET LEUR PENDANT NUMÉRIQUE
LE NUMERIQUE ET LES SITES PATRIMONIAUX ARCHÉOLOGIQUES EN PÉRIL
Les causes de dégradation des sites patrimoniaux
L’engouement du public pour le patrimoine
La notion de présence dans un lieu et les immersions virtuelles
LA MÉMOIRE DES LIEUX SOUS FORME VIRTUELLE
Le lieu virtuel, lieu réel et leur ubiquité
La question de l’archivage numérique
À qui appartient la mémoire numérique ?
UNE DES TECHNIQUES QUI LE PERMETTE : LA PHOTOGRAMMÉTRIE : DE L’ANALOGIQUE A L’INFORMATIQUE
Historique : De la photogrammétrie à la photomodélisation
Techniques et méthodologie : de l’acquisition jusqu’au mapping
Le caractère sacré du modèle numérique
1ere partie
VOCABULAIRE
La réalité du terrain : entre topologie des sites et réalité économique
Les relevés archéologiques
Du manuel au numérique : les exemples de l’Abri du Poisson
LA DÉMOCRATISATION DE LA 3D : LES MAILLAGES DE POINTS ET LES PLATEFORMES COMMUNAUTAIRES
LA REUTILSIATION DES PHOTOMODELISATIONS
La photomodélisation comme support de recherches
Reproduction en fac similé : les grottes de Lascaux
La cartographie par photomodélisation comme support de planification urbaine
Maillage de points et multiplicité des sources pour l’acquisition
Utilisation des environnements pris par photogrammétrie en jeux videos
2e Partie
PLONGÉE EN DORDOGNE
Réutilisation de données
DERNIERE OPERATION
HISTORIQUE DU SITE ÉTUDIÉ
Localisation
Historique des précédentes opérations et descriptif
Traitement de photos par numérique
Création d’une photomodélisation
RESTITUTION DU TRAVAIL
Les relevés archéologiques
Du manuel au numérique : les exemples de l’Abri du Poisson
Edition d’orthophotos — DEM d’élément de détail
Elévations, coupes à l’échelle — Méthologie
Plateforme Aioli — Plateforme sémantique
Processus immerssif — Sketchfab
Déroulement de la dernière opération et Matériel Utilisé
CONCLUSION ET DISCUSSION
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet