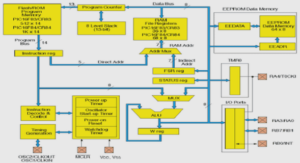Les diplômes nationaux de l’enseignement supérieur connaissent donc un régime qui diffère complètement des diplômes nationaux soumis aux Commissions Professionnelles Consultatives. Actuellement, ils dépendent de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur et plus précisément de son article 17.
Ce texte affirme solennellement le monopole de l’Etat en matière de collation des grades et titres universitaires. Véritablement instauré par la loi de 1880, ce monopole ne concerne pas la formation elle-même mais se manifeste par la légitimité des professeurs de l’enseignement public à examiner les candidats aux diplômes délivrés par l’Etat. La pertinence de ce principe fut remise en question en 1968 avec la loi d’orientation sur l’enseignement supérieur. Devenues autonomes, les universités y sont-elles toujours soumises ou peuvent-elles délivrer leurs propres diplômes ? En réalité, la loi de 1968, telle qu’elle était rédigée, ne remettait pas en cause la prérogative exclusive de l’Etat. Les universités se voyaient attribuer une certaine liberté en matière d’enseignement mais pas dans le domaine de la certification. La plupart des interrogations trouvaient leur origine dans l’abandon par la loi de 1968 de toute référence aux grades au profit d’une nouvelle notion, les diplômes nationaux 134: « les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux relevant du ministère de l’éducation nationale, les conditions d’obtention de ces diplômes et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent sont définies par le ministre (…) ». Cette référence au régime des diplômes nationaux ne s’accompagne d’aucune définition de cette catégorie de certifications. Ce n’est qu’en 1971135 que seront enfin définis les diplômes nationaux: « Sont considérés comme diplômes nationaux, les diplômes qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Pour autant, il n’est nullement question de monopole de délivrance de ces diplômes par l’Etat.
La loi de 1984 rétablit donc solennellement la compétence exclusive des autorités publiques en matière de délivrance de diplômes136 mettant fin à toute illusion sur les compétences des établissements supérieurs. Suit une reprise de la définition posée par la loi de 1971 : « Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. (…) Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires quelque soit l’établissement qui l’a délivré ». Deux éléments apparaissent pour définir un diplôme de l’enseignement supérieur.
Ce type de diplôme se définit d’abord par ses effets : il confère l’un des grades ou titres universitaires. Il parait donc nécessaire de s’arrêter sur les aspects sémantiques mis en jeu par une telle combinaison. Qu’est ce qu’un grade et un titre universitaire ? La notion de grade apparaît dans le Décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l’université dans ses scientifiques conférés par l’Etat qui s’est réservé le monopole de leur collation »137. Jusqu’en 1999, les grades étaient au nombre de trois: le baccalauréat, la licence et le doctorat138 mais, dans un souci d’harmonisation européenne139, un décret est venu en créer un nouveau, le mastaire140.
La notion de grade présente une certaine connotation militaire ou, du moins, celle d’une forte hiérarchie141. Elle témoigne ainsi que celui qui le possède est parvenu à un niveau déterminé dans cette hiérarchie. Le grade est un concept générique désignant l’accès à un niveau d’études universitaires. « Celui ci ne donne pas le droit à la fonction publique ou à l’exercice de certaines professions; ce droit appartient virtuellement à tout citoyen qui réunit certaines conditions d’instruction, que le grade ne fait que constater: il est donc pour parler la langue du droit, déclaratif et non attributif »142. Si l’on en croit certains auteurs143, la constatation de l’accession à ce grade « conduirait à la délivrance du diplôme, pièce émanant de l’autorité universitaire ». Mais, si matériellement, la délivrance du diplôme intervient après la constatation du niveau atteint, ce rapport de cause à effet entre diplôme et grade est assez imprécis au regard des termes du décret impérial de 1808 et de la loi de 1984. L’article 96 du décret impérial dispose que le recteur délivre les diplômes des gradués144. Dans cette logique, le grade préexiste au diplôme, celui ci ne venant simplement qu’en constater la possession. Mais l’article 17 de la loi de 1984 spécifie que « les diplômes nationaux sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires » ce qui inverse les perspectives puisque l’acquisition du grade est, alors, une conséquence de la délivrance du diplôme national. Quelle solution retenir ? Du point de vue du droit, il convient de privilégier le texte le plus récent et donc l’interprétation découlant de l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir, le diplôme confère le grade.
Cette distinction diplôme national/grade nous parait à l’heure actuelle avoir perdu tout son intérêt. La notion de grade n’a jamais été définie en tant que telle et la situation des grades n’a été modifiée qu’à une seule reprise depuis 1808145. Qu’en est-il des autres diplômes de l’enseignement supérieur ? Ne peuvent-ils conférer de grade à leur titulaire ? La loi de 1968 avait évité cet écueil en écartant la notion de grade et en s’attachant à la notion de diplôme national. Il semble que le législateur, à cette époque, ait surtout voulu consacrer de cette façon la désuétude de la notion de grade. Mais celui de 1984, devant la volonté des universités de délivrer leurs propres diplômes nationaux, a réaffirmé la compétence exclusive de l’Etat en reprenant la vieille formule de monopole de collation des grades. Cette solution présente toujours le même inconvénient: maintenir une confusion qui n’a plus lieu d’être. La suppression pure et simple de la notion de grade et la simple affirmation du monopole étatique de délivrance des diplômes nationaux pourraient résoudre ce problème. Certes, cette question ne contient aucun aspect pratique. Mais peut-être permettrait-elle d’éviter une confusion sémantique que nous retrouvons aussi au niveau de la notion de titre.
Le titre universitaire dont le monopole est affirmé par la loi, est aussi une conséquence de la délivrance du diplôme. Ce dernier confère un titre à celui qui en est muni : bachelier, docteur… La confusion entre les notions réside encore dans la rédaction de l’article 17 de la loi de 1984 et de ses décrets d’application: « les diplômes nationaux (…) confèrent l’un des grades ou titres universitaires ». Ce « ou » est-il exclusif ou fait-il une assimilation ? Le titulaire d’un diplôme national se voit-il attribuer un grade et pas de titre, ou vice versa ? Cette hypothèse doit être écartée. Prenons le cas du diplôme de doctorat. Celui-ci est un grade selon les termes inchangés du décret de 1808. Or, l’article 16 de la loi évoque aussi le titre de docteur. Il est donc bien des cas où on peut avoir et un grade et un titre pour le même diplôme. Faut-il alors confondre grade et titre ? A cette nouvelle question, il convient de répondre par la négative. Il y a en effet plus de diplômes nationaux que de grades. Or la rédaction de la loi suggère que tous les diplômes nationaux sont concernés.
La procédure de validation des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur voit l’Etat intervenir en amont de la création de la certification par l’élaboration d’un référentiel et en aval de ce processus par l’habilitation d’une formation satisfaisant aux conditions préétablies.
Face à des certifications émanant d’organismes privés, des techniques différentes fondées sur une autre logique peuvent être mises en œuvre. L’intervention de l’Etat se fait alors essentiellement a posteriori par le contrôle des établissements et la validation des référents de ces titres. Une fois ces opérations effectuées, les autorités publiques attribuent à ces certifications une valeur nationale. La diversité des techniques utilisées trouve son explication dans leur apparition à différentes époques et dans l’hétérogénéité des certifications concernées. Ainsi, les diplômes de l’enseignement technique peuvent-ils faire l’objet d’une apposition, par l’Etat, d’un visa officiel ou d’une délivrance contrôlée après habilitation de l’établissement qui y prépare s’il s’agit de diplômes d’ingénieurs. Enfin, depuis 1971, les titres et diplômes de l’enseignement technologique peuvent être soumis à une procédure originale, appelée homologation.
La technique du « visa » du diplôme est propre aux diplômes de l’enseignement technique. Que faut-il entendre par enseignement technique ? Le Code de l’enseignement technique, reprenant l’article 1 de la loi du 25 juillet 1919 relative à l’organisation de l’enseignement technique industriel et commercial posait la définition suivante :
L’enseignement technique a pour objet, sans préjudice d’un complément d’enseignement général, l’étude théorique et pratique des sciences, des arts et métiers en vue de l’industrie ou du commerce »153. L’enseignement technique a donc pour finalité d’assurer une véritable éducation, distincte de l’enseignement général, pour ceux qui se destinent aux domaines de l’industrie et du commerce.
La création de l’enseignement technique repose sur une loi du 26 janvier 1892 mais c’est véritablement la loi du 25 juillet 1919 qui en établit une charte d’organisation. Il s’agissait de substituer au « dressage antérieur »154 une véritable éducation professionnelle conçue en fonction du métier et susceptible d’accroître le rendement économique et la valeur sociale des employés. L’enseignement technique doit répondre aux besoins modernes de l’économie à laquelle il fournit une main d’œuvre et des cadres. Cela suppose donc une perpétuelle évolution du système éducatif technique pour suivre les transformations des conditions de production et de vente afin que les élèves formés puissent être opérationnels dès la sortie de leur école.
De ces caractères de l’enseignement technique, il convient dorénavant de parler au passé. La loi du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique a abrogé la définition posée par la loi de 1919155 sans lui en substituer d’autre. Faut-il supposer que l’enseignement technique est une notion aujourd’hui disparue et intégrée à l’enseignement technologique, objet de la loi de 1971 ? Probablement, si l’on se réfère au caractère large de la définition de ce nouvel enseignement : « les enseignements technologiques sont constitués par l’ensemble des moyens destinés à assurer la formation professionnelle initiale et la formation continue dans le différents domaines de l’économie » et « doivent permettre à ceux qui le suivent l’entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et faciliter l’accès à des professions ultérieures » 156. Mais, là encore, après avoir fait œuvre de construction, le législateur abroge cette définition de l’enseignement technologique dans la loi de programme sur l’enseignement technologique et professionnel du 23 décembre 1985 qui dispose seulement que « l’enseignement technologique et professionnel contribue à l’élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification »157. Même abrogées, les définitions de 1919 et 1971 mettaient l’accent sur les éléments essentiels de l’enseignement technique, de l’enseignement technologique et de l’enseignement professionnel : un aspect essentiellement professionnalisant, un enseignement distinct de l’enseignement général et l’importance des sciences, des techniques et des technologies dans le domaine de l’économie. Malgré son ancienneté, la procédure des diplômes visés a conservé toute son originalité côté de l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement158. Elle est née dans la première moitié du siècle et met en avant la question des écoles privées et de la délivrance des diplômes auxquelles elles peuvent préparer. Elle repose sur l’articulation de deux textes: la loi Astier du 25 juillet 1919 relative à l’organisation de l’enseignement technique industriel et commercial et la loi du 4 août 1942 relative à la délivrance des diplômes professionnels159. Ces deux textes sont incorporés, du moins pour les mentions qui nous intéressent, au Code de l’enseignement technique.
L’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique.
La procédure originale de l’homologation apparaît au début des années 70. Jusqu’à cette période, la notion de diplôme comme sanction d’un niveau d’étude atteint n’était rattachée qu’à la formation initiale. Mais le doute apparaît de plus en plus quant à la pertinence de ce postulat. L’augmentation du chômage et le nombre grandissant des salariés non ou peu qualifiés incitent à une prise de conscience : la formation initiale n’est plus la seule dépositaire de la transmission du savoir professionnel, notamment au regard de l’évolution rapide des technologies. L’année 1966 marque une première évolution. La loi du 3 décembre 1966 d’orientation et de programme sur la formation professionnelle et la promotion sociale incite à harmoniser les procédures d’estimation des formations. Une circulaire d’application de 1967233 adopte une échelle unique des niveaux de formation. La même année, l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.) se voit attribuer un régime entièrement nouveau. Or, l’A.F.P.A. délivre ses propres certificats de formation professionnelle. Leur statut est totalement privé mais les employeurs leur reconnaissent une certaine valeur puisque les examens sont organisés sous la tutelle du ministère du travail et non du ministère de l’Education nationale.
Au delà, c’est un besoin de donner une valeur officielle à toutes les certifications de la formation professionnelle qui apparaît, afin de permettre aux titulaires de ces titres et diplômes de les faire valoir dans le monde du travail. Dans le même temps, les organismes de formation ne souhaitent pas que cette reconnaissance de leurs certifications s’accompagne d’une prise de contrôle par le Ministère de l’Education nationale. Cette quête de légitimité, destinée à se défaire justement des pesanteurs du système national des diplômes, se fait cependant en correspondance avec l’Education nationale, détentrice depuis le début du XIXème siècle des « étalons » de la certification. Sans chercher une équivalence juridique avec les titres et diplômes de l’Education nationale, il existe une volonté d’établir une échelle de niveau permettant une mise en comparaison de toutes les certifications.
Un groupe de travail interministériel, dirigé par Jacques Delors, alors chef du service des affaires sociales au Commissariat général au plan (1962-1969), est créé en 1967-1968 sur le sujet234. Le constat qui en découle est qu’une telle opération ne peut concerner un type précis de certification (les certificats de formation professionnelle de l’AFPA) et qu’on ne peut retenir le principe d’une équivalence stricto sensu avec les diplômes et titres délivrés par l’Education nationale. En effet, celle-ci ayant le contrôle absolu de l’octroi de ces certifications, elle seule peut être habilitée à décider de l’équivalence de ses titres avec d’autres. C’est alors que naissent, avec les lois de 1971 sur la formation professionnelle continue, la notion et la procédure d’homologation.
Le premier consiste à permettre l’acquisition des titres et diplômes de l’enseignement technologique aussi bien par les voies scolaires et universitaires que par l’apprentissage et la formation continue. Cette disposition est capitale puisqu’elle fait des titres et diplômes la notion centrale de l’enseignement en la dissociant de son mode d’acquisition. Ce texte contribue à mettre fin à la confusion entretenue entre la formation, évaluation comprise, et sa sanction. Si ces opérations sont étroitement liées, elles n’en sont pas moins distinctes. Ce texte affirme ainsi que la formation initiale n’est plus la voie royale pour l’acquisition d’une certification de l’enseignement technologique. La logique est la suivante: « seul l’octroi d’un diplôme identique peut apporter à l’adulte qui a atteint un niveau de connaissance et de compétence requis la garantie que son titre ne sera pas considéré comme de valeur inférieure au titre de celui qui a eu la chance de l’obtenir dans sa jeunesse »235. Ainsi la loi de 1971 n’exige-t-elle pas que les contenus de formation soient identiques entre la formation initiale et la formation continue.
Le second principe posé par l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 est l’instauration de la procédure d’homologation par une simple proposition: « les titres et diplômes de l’enseignement technologique sont inscrits sur une liste d’homologation ». La notion même d’homologation n’est pas définie, la loi la caractérisant par son aspect procédural. Aucun texte de l’époque ne définit réellement l’homologation. Il faut pour cela attendre des textes beaucoup plus récents. C’est pourquoi nous retiendrons la définition qui en est donnée par la circulaire n° 5 du 12 avril 1994 du ministre de l’Education nationale : l’homologation est un mode de validation publique consistant à classer par niveau et par groupes de métiers, les titres ou diplômes délivrés par des organismes de formation publics ou privés qui en font la demande. (…) L’objectif de l’homologation est professionnel. Il s’agit de déterminer l’aptitude à occuper un emploi déterminé ». Ainsi, les éléments constitutifs principaux de cette technique originale peuvent être utilisés pour une analyse de la notion d’homologation avant l’examen de la procédure.
La notion d’homologation.
Il convient de rappeler une donnée essentielle: l’objet de l’homologation est le titre ou le diplôme et non l’établissement qui le délivre. L’homologation diffère donc totalement de la technique des diplômes visés qui nécessite une reconnaissance préalable par l’Etat de l’établissement qui sollicite l’apposition du visa ministériel sur la certification qu’il délivre.
L’homologation est une validation publique. Une nouvelle fois, l’Etat et ses représentants interviennent dans le système national de la certification mais en complète conformité avec les volontés émises au cours des années 60. En effet, il ne s’agit pas ici de contrôler les titres et diplômes de l’enseignement technologique comme c’est le cas à travers le mécanisme de visa des diplômes techniques. Nous ne sommes absolument pas, en matière d’enseignement technologique, dans une situation de monopole étatique de délivrance comme en matière d’enseignement technique. Cette situation peut être justifiée au regard de l’objet de chacun de ces enseignements.
Même si l’enseignement technique n’est plus aujourd’hui légalement défini, il a pour but de préparer à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale et artisanale236, dans une vision complètement professionnalisante, comme l’enseignement ménager familial (Titre VI du Code de l’enseignement technique), l’horlogerie, la photographie…L’Etat, dans le contexte historique -rappelons qu’il s’agit d’un texte de 1942-, estimait qu’il était nécessaire pour lui d’attester les compétences ouvrant cet accès professionnel.
En matière d’enseignement technologique, les principales références légales sont les deux lois n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique237 et n° 85-1371 du 23 décembre 1985 de programme sur l’enseignement technologique et professionnel238. La loi de 1971 précise dans son article 5 que « les enseignements technologiques sont constitués par l’ensemble des moyens destinés à assurer la formation professionnelle initiale et la formation continue dans les différents domaines de l’économie ». Une fois écartés les éléments de définition de l’enseignement (moyens destinés à assurer la formation), subsiste ce qui paraît définir la technologie, c’est à dire ce qui a trait aux différents domaines de l’économie. La loi de 1985 n’apporte aucun élément supplémentaire si ce n’est que « l’enseignement technologique et professionnel contribue à l’élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification »et que « la technologie est une des composantes fondamentales de la culture »239. Technologie trouve son étymologie dans le grec Teknologia signifiant « traité ou dissertation sur un art, exposé des règles d’un art »240. La technologie se rapporterait donc à un ensemble de règles relatives aux arts, aux techniques… Dans l’histoire de l’éducation, le premier enseignement technologique déclaré comme tel fut délivré par Johann Beckman, à partir de 1772, à Göttingen. Cet enseignement se présentait comme une discipline destinée à éclairer les administrateurs appelés à faire des choix économiques241. Si l’enseignement technologique est un enseignement se rapportant aux différents domaines de l’économie, on est en droit de se demander quel type d’enseignement n’est pas susceptible de rentrer dans cette catégorie. Cette analyse se confirme lorsqu’on examine les diplômes faisant l’objet, en pratique, d’une homologation et donc entrant dans le champ de l’enseignement technologique : les diplômes délivrés par l’Education nationale, les diplômes d’ingénieurs, les diplômes visés sont homologués de droit.
En réalité, comme nous le verrons242, seules sont écartées les certifications de formations à caractère général, sans finalité directement professionnalisante.
L’homologation est un acte de reconnaissance officielle par l’Etat d’un titre émanant d’un organisme privé ou public243.
L’arrêté d’homologation d’une certification ne consiste, en aucun cas, en un acte de délivrance d’un titre, ni en une validation d’acquis. Dans le mécanisme d’homologation, la délivrance du titre est faite par l’organisme de formation et les titres homologués demeurent la propriété de celui-ci. Dans le même ordre d’idée, il ne s’agit pas non plus d’une validation d’acquis. Celle-ci est effectuée par le jury chargé d’examiner l’aptitude du candidat à l’obtention du titre et ses modalités sont choisies par l’organisme de formation.
L’homologation ne consiste pas, non plus, en la reconnaissance d’une équivalence entre diplômes de même niveau. Cette dernière consiste à apprécier si un titre déterminé peut être considéré comme tenant lieu du titre exigé. Il n’y a donc équivalence que lorsque deux diplômes peuvent se superposer exactement. La caractéristique essentielle de cette technique repose sur ses conséquences: deux diplômes équivalents entraînent les mêmes droits pour leur titulaires. Or, l’homologation repose sur une appréciation de formations et de certifications dont on aura étudié la valeur intrinsèque et l’utilité professionnelle244. Il s’agit, comme nous allons le voir, de situer ces titres ou diplômes dans une hiérarchie de niveaux de formation. Dans cette optique, on trouve à un même niveau des certifications de formations portant sur des activités professionnelles qui n’ont rien à voir entre elles. Si homologation et équivalence sont des notions différentes, elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Un arrêté pourra ainsi établir l’équivalence entre deux certifications de même niveau si celles-ci confèrent à leurs titulaires la même capacité à occuper un emploi ou à prolonger leurs études dans les mêmes conditions.
L’homologation est une appréciation des certifications de l’enseignement technologique à travers une lecture professionnelle, c’est-à-dire en situant ces certifications par métier. L’objectif étant d’établir une comparaison entre les divers titres et diplômes, la lecture qui doit en être faite ne peut passer que par cette segmentarisation entre secteurs et métiers, sinon l’homologation perd tout son sens et son intérêt. Au sein d’un même groupe de métiers, les titres et diplômes de l’enseignement technologique sont classés par niveaux245.
Ces derniers trouvent leur origine dans une nomenclature interministérielle adaptée246 aux besoins de l’homologation et diffèrente de celle retenue par l’Education nationale247. En effet, cette dernière fusionne les niveaux I et II (personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d’ingénieurs) et comprend deux niveaux supplémentaires: le niveau Vbis concernant le personnel occupant des emplois supposant une formation courte d’une durée maximum d’un an, conduisant notamment au certificat d’éducation professionnelle ou à toute autre attestation de même nature, le niveau VI concernant le personnel occupant des emplois n’exigeant pas de formation allant au delà de la fin de la scolarité obligatoire.
Matériellement, l’homologation d’un diplôme se fait par l’inscription de celui-ci sur une liste dite d’homologation spécifiant son niveau et son groupe de métiers. La vision professionnalisante de la formation et de la certification est un élément essentiel de l’homologation. Les références aux différents diplômes, faites à chaque niveau, sont en relation avec un emploi. Cette procédure vise à rendre, par exemple, le titulaire d’un diplôme ou titre classé au niveau III par la commission d’homologation apte à occuper un emploi confié généralement au titulaire d’un DUT ou d’un BTS. Il ne faut en effet jamais perdre de vue que l’homologation est, entre autres, destinée aux employeurs. Il s’agit de leur permettre d’apprécier la qualification d’un candidat à un emploi ou de juger les acquis obtenus au cours de la formation qu’a suivi ou que pourra suivre un demandeur d’emploi ou un salarié.
Les employeurs ne sont pas les seuls à trouver des avantages à cette procédure. Pour les titulaires d’une certification homologuée, salariés ou non, l’intérêt réside justement dans la possibilité de mettre en avant leur titre ou diplôme en sachant qu’il est reconnu équivalent à un diplôme « Education nationale » qui reste, ne l’oublions pas, la valeur de référence dans l’esprit de la majorité des habitants de ce pays.
Enfin, l’organisme de formation en retire un bénéfice non négligeable puisqu’il s’agit, pour lui, de faire reconnaître que la certification qu’il délivre est d’un niveau national. Système de validation étatique, l’homologation confère juridiquement au titre et, dans les faits, à l’organisme qui y prépare, un caractère de sérieux. Il s’agit d’un effet « label »248 que l’organisme de formation peut faire valoir en mentionnant « titre homologué » pour la certification à laquelle il prépare249.
Pour autant, il s’agit d’être très prudent sur cette question et de ne pas la confondre avec ce que l’on appelle la démarche « qualité » en matière de formation. Cette dernière désigne la recherche par l’ensemble des partenaires d’une adéquation optimale entre l’action de formation prise dans ses différentes composantes et les attentes des clients de l’organisme de formation250. Or, il règne entre l’homologation et la qualité une certaine confusion sémantique. Ainsi, trouve-t-on parfois dans la pratique de l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique les termes de « label », « qualité », « certification »… En matière de qualité, ce sont les termes de « certification », labellisation », « qualification » et… « homologation » qui reviennent très souvent251. Pourtant, il s’agit de deux notions complètement différentes. Tout d’abord, l’homologation est une validation publique du titre ou du diplôme et non une certification. Et surtout, juridiquement, l’homologation porte sur le titre lui-même et non sur l’organisme de formation comme c’est le cas en matière de qualité au moyen des normes AFNOR, ISO, assurance-qualité…
La demande d’homologation est une faculté pour l’organisme de formation. Il s’agit d’une différence notable avec la procédure de visa du diplôme. Dans cette dernière, le contexte est celui de l’exercice d’un monopole de l’Etat sur la délivrance des diplômes techniques. Les écoles privées reconnues y trouvent leur place via une délégation obligatoire avec, en contrepartie, des contrôles. Demander l’homologation n’est pas une obligation. Mais dans le même temps, ce caractère volontaire a son revers: l’homologation n’est pas un droit pour celui qui en fait la demande.
La procédure d’homologation.
Plusieurs modifications de la législation relative à l’homologation ont été faites depuis la loi du 16 juillet 1971. Pendant longtemps, le régime a été celui du décret n° 72-979 du 12 avril 1972, très légèrement modifié en 1977. Le processus s’accélère dans les dernières années. Un décret du 1er octobre 1990 refonde la procédure et notamment le fonctionnement de la commission d’homologation, décret dont la durée sera éphémère puisqu’il est rapporté le 3 juillet 1991. Aujourd’hui, le régime de l’homologation est fixé par le décret n°92-23 du 8 janvier 1992.
Il convient de distinguer deux types de certification dans la procédure d’homologation. Certains diplômes sont inscrits de droit. Il en est ainsi pour les diplômes délivrés par l’Education nationale. Il faut y voir le résultat des négociations entre les divers ministères en 1971. L’Education nationale qui, jusqu’ici, détenait la norme « diplôme » par excellence, ne pouvait admettre de voir ses certifications faire l’objet d’un examen poussé afin de déterminer à quel niveau elles devraient se situer. Cette homologation de droit se fait par simple information de la commission de toute création ou modification des titres ou diplômes. Les diplômes d’ingénieurs subissent un traitement identique. Comme nous l’avons déjà examiné, ces certifications, pour prétendre à cette dénomination, font l’objet d’une habilitation par la Commission des Titres d’Ingénieurs. Admettre qu’elles puissent avoir à passer un nouveau contrôle dans le cadre de l’homologation revient à considérer inutile l’action de cette Commission des Titres d’Ingénieurs. Si cette dernière estime qu’un titre doit porter l’appellation « titre d’ingénieur diplômé », il parait évident que celui-ci doit être inscrit de droit dans le niveau I de la nomenclature de l’homologation. Enfin, sont homologués de droit les diplômes visés selon les dispositions du Code de l’enseignement technique.
Tous les autres titres et diplômes doivent satisfaire à la procédure d’homologation. En réalité, sont uniquement concernés les titres et diplômes non homologués de droit, à visée professionnelle ce qui signifie que toutes les certifications à caractère général ne peuvent solliciter leur homologation. Concrètement, cela recouvre plusieurs catégories de titres et diplômes. Il s’agit de tous les diplômes nationaux délivrés par un ministère et non homologués de droit (ministères de la jeunesse et des sports, de la santé et des affaires sociales, de la défense, de la culture…). On trouve aussi tous les diplômes délivrés par des établissements publics de formation tels que les GRETA, l’A.F.P.A, les universités… Pour ces dernières, seuls les diplômes évoqués à l’article 17 de la loi de 1984 sur l’enseignement supérieur, appelés « diplômes d’établissement », doivent passer par l’homologation puisque échappant à la législation des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur. Le souhait des universités est alors d’assurer un positionnement de leurs certifications dans l’ensemble des titres et diplômes de l’enseignement technologique. Parmi les diplômes non homologués de droit, on trouve aussi les certifications délivrées par les établissements sous tutelle juridique d’un ministère. Citons, à titre d’exemple, les certifications délivrées à l’issue de formations dispensées par les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers. Dans les années qui ont suivi la création de l’homologation, les demandes se concentraient toutes autour de ces grands pôles. Aujourd’hui, ces mêmes demandes émanent de plus en plus d’organismes privés et d’entreprises qui cherchent à faire reconnaître une valeur nationale à leurs formations et surtout à leurs certifications.
Pour toutes ces certifications, l’homologation n’est pas de droit et doit suivre une procédure spécifique devant la Commission Technique d’Homologation.
La Commission Technique d’Homologation.
La création d’une commission de contrôle réunissant un nombre important de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées dans le domaine concerné apparaît comme une caractéristique commune à toutes les interventions de l’Etat en matière de certification252. L’homologation n’échappe pas à cette règle puisque la procédure débute par un passage devant une Commission Technique d’Homologation (CTH).
Les Commissions Professionnelles Consultatives et les Commissions Pédagogiques Nationales pour l’élaboration des diplômes nationaux, le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la recherche pour les diplômes nationaux de l’enseignement supérieur et les diplômes visés (parmi d’autres attributions) et la Commission des Titres d’Ingénieurs pour les titres d’ingénieurs diplômés.
A l’origine, en 1972, on retrouvait essentiellement des représentants des divers ministères (Education nationale, défense, industrie, agriculture, travail, économie et finances et fonction publique) et sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur expérience en matière de formation professionnelle. Ils étaient assistés d’experts choisis parmi des personnes proposées par le C.E.R.E.Q., les Commission Professionnelles Consultatives et les organismes professionnels compétents pour les enseignements technologiques. Cette composition témoignait d’une surreprésentation de l’Etat dans une logique « Education nationale » à qui le processus d’homologation ne devait pas échapper. Pour preuve, la présence des experts était simplement à visée consultative.
Le décret de 1992 inverse totalement cette logique en prenant en considération de manière significative les représentants du monde du travail et de la production. Bien sûr, la place des représentants de l’Etat demeure assez forte mais des organismes, ayant précédemment voix consultative, rentrent comme membres à part entière dans la commission. Enfin, on peut noter la prise en compte non négligeable de l’aspect désormais régional de la formation professionnelle254.