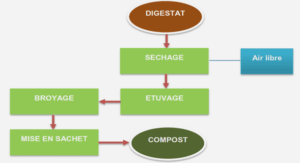Au XIIe siècle, la « banlieue » désigne les territoires situés en dehors des enceintes des villes mais sur lesquels s’applique la juridiction de celles-ci. Selon Annie Fourcaut, ce mot aurait perdu ce sens juridique précis au XIXe siècle pour évoquer plus largement les environs d’une ville, au moment de la « naissance des banlieues modernes dues au chemin de fer et à l’industrialisation. » (Fourcaut, 1988, p.17) L’évolution de la « banlieue » vers sa signification contemporaine apparaît donc indissociable des transports en commun. Pour Alain Faure, c’est même avec cette acceptation précise que le mot est passé dans la langue commune, au tournant du XIXe siècle : « le banlieusard est celui qui habite la banlieue, bien sûr, mais qui n’y travaille pas, qui prend tous les matins le train ou le tramway, le plus souvent pour Paris, et rentre le soir chez lui par le même moyen. » (Faure, 2003, p.63) Le rôle du ferroviaire en particulier dans la formation de la région parisienne a été largement étudié, tant sous l’angle de la géographie (Clozier, 1940 ; Bastié, 1964 ; Merlin, 1967, Beaucire, 1988) que sous celui de la décision et de l’action publique (Larroque & al., 2002 ; Desjardins & al., 2012). Mais ce qui apparaît en revanche moins connu, c’est la manière dont les opérateurs ferroviaires ont, de leur côté, envisagé leur développement dans cette « banlieue ».
De cela il ressort que la desserte de la « banlieue » ne fut jamais une vocation du ferroviaire pour les compagnies de chemin de fer comme pour la SNCF. Les premières lignes ont d’abord été pensées par les administrateurs des compagnies comme des amorces pour desservir la province. Elles se développèrent au milieu du XIXe siècle comme un antitransport urbain dans une certaine « banlieue » lointaine, pour une clientèle bourgeoise. La massification du trafic sur ces lignes au tournant du XXe siècle semble avoir été bien plus subie qu’encouragée par ceux-ci. Les nombreux travaux alors rendus nécessaires se soldèrent par un déficit chronique des compagnies qui précipita, pour certaines d’entre elles, leur reprise par l’État. Si durant les premières années de la SNCF, le réseau francilien se vit amputé d’un certain nombre de ses lignes dans le cadre du chantier de la coordination rail-route, celui-ci se modernisa significativement dans les années 1970, sous l’impulsion de l’État planificateur. Mais là où les dirigeants de la RATP se positionnaient comme des partenaires actifs de l’aménagement, ceux de la SNCF semblaient eux voir leurs intérêts commerciaux ailleurs, notamment sur les lignes de la grande vitesse alors en gestation. Et c’est d’ailleurs bien sur cette part de son activité que l’entreprise concentra l’essentiel des ses investissements dans les années 1980 et 1990. L’effondrement de la rentabilité de la branche Grandes Lignes à la fin des années 2000, couplé à l’ouverture à la concurrence des services de transport de voyageurs, conduisirent toutefois les dirigeants du groupe à réinterroger leur vocation de transporteur régional. Si la « banlieue » revêt, à partir des années 2000, un caractère stratégique inédit, son imaginaire ne s’en est pas moins forgé parmi les rangs cheminots à travers l’expression d’une longue forme de déconsidération.
L’amorce du lointain
L’une des premières lignes ferroviaires ouvertes en France pour le trafic de voyageurs est une ligne de « banlieue ». Il s’agit de celle reliant Paris au Pecq puis à SaintGermain-en-Laye, c’est-à-dire « le nouveau centre des affaires parisien (le quartier de l’Europe) » à « une ville royale et une promenade célèbre (la « montagne du Bon-Air ») », dont le premier tronçon est inauguré en 1837 (Carrière, 2012, p.4). Dans les deux décennies suivantes, près de dix-huit lignes ainsi que sept rameaux sont mis en service en région parisienne (Cf. Figure 2). Ceux-ci sont le fait de multiples compagnies privées auxquelles l’État confie, par un système de concessions, une partie de leur construction et leur exploitation. Suivant un mécanisme de fusions, le nombre de ces compagnies se réduit tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, au point de n’être plus que cinq à se partager le territoire francilien en 1900 : la compagnie du Nord, de l’Est, de Paris-LyonMarseille (PLM), de l’Ouest et du Paris-Orléans (PO) (Ribeill, 1993, p.150-155). À quelques exceptions près (les lignes de Sceaux et de Vincennes notamment), ces lignes au départ de Paris sont pensées comme les amorces des grandes artères devant desservir la province. C’est par exemple le cas du service Paris – Pontoise qui était prévu comme l’itinéraire primitif du Paris – Lille, ou celui du Paris – Corbeil pour celui du Paris – Lyon (Carrière, 1998, p.5, 24). Cela tient au fait que ces compagnies étaient alors soumises à une forte tutelle commerciale de l’État qui se traduisait, entre autres, par un cahier des charges exigeant un minimum de trains quotidiens sur chaque ligne exploitée, des tarifs fixés par nature de trafic, ou encore par un important contrôle de la part l’administration des Ponts et Chaussées sur le développement des lignes et le fonctionnement des compagnies (Ribeill, 1984, p.12). Or pour l’État, « le réseau de chemin de fer était clairement, comme le réseau routier et le réseau des voies navigables, un instrument majeur de la construction du territoire national. » (Caron, 1997, p.77-78) Cette conception aurait en particulier été portée par les ingénieurs du corps des Ponts et Chaussées, qui auraient « appliqué une culture de réseau aux chemins de fer devant renforcer la centralisation du territoire français et lui assurer un rayonnement économique, militaire et culturel. » (Castagnino, 2017, p.84) Avec ses sept lignes au départ de Paris rejoignant les grandes villes portuaires et les frontières dupays, le schéma en étoile de Legrand, adopté en 1842, s’inscrit dans cette logique. La desserte de la « banlieue » n’était donc aucunement une vocation première du ferroviaire. Celle-ci s’imposa néanmoins aux compagnies dès les premières années de mise en service de ces lignes, concomitamment à l’essor de la double résidence comme pratique sociale élitiste.
Un succès bourgeois
Au moins jusqu’au début du XXe siècle, la « banlieue » est associée à l’image d’une campagne rurale, nourricière et sanitaire, « essentiellement peuplée d’arbres et de jolis endroits pour se poser. Banlieue égale bonté de la nature, de multiples textes le disent. » (Faure, 2003, p.61) Ce thème de la « banlieue exquise » traverse notamment les chansons entre 1880 et 1900, dont les paroles relatent « le voyage d’une journée, la fuite de Paris, en trois étapes : le voyage vers la banlieue, le délassement, le retour et les souvenirs nostalgiques. » (Fourcaut & al., 2007, p.39 40) Cette image de la « banlieue » renvoie à un ensemble de pratiques de loisirs reposant largement sur l’utilisation du chemin de fer, pour « passer un dimanche de détente à la campagne et de s’adonner aux joies de la vie au grand air » – dont les vertus thérapeutiques et hygiéniques étaient alors largement partagées, notamment en ce qu’il « fortifiait les organismes affaiblis par une vie citadine jugée malsaine » (Rabault-Mazières, 1998) –, mais aussi pour profiter des réjouissances festives que constituaient par exemple « la foire de Versailles, la fête des Loges à Saint-Germain enLaye, ou les courses à Chantilly. » (Caron, 1997, p.592-593) Les premières lignes suburbaines ont ainsi été utilisées en premier lieu comme « « circulations touristiques de luxe », pour satisfaire le besoin d’évasion d’un public bourgeois et parisien. Parallèlement, un certain nombre d’habitudes résidentielles impliquant le chemin de fer se prennent, notamment pendant le Second Empire. Pour Isabelle Rabault-Mazières, la villégiature devient alors, sous le double effet du développement du ferroviaire et de l’enrichissement général de la société, « l’un des rites de la vie bourgeoise. Les littérateurs ne manquaient d’ailleurs pas d’ironiser sur cette « fièvre de la villégiature » qui poussait tout Parisien un tant soit peu fortuné à émigrer loin de la capitale, sitôt les beaux jours venus. » (RabaultMazières, 1998, p.31) Pour François Caron, le pouvoir impérial encouragea de surcroît « l’essor des banlieues résidentielles, et la spéculation immobilière s’en mêla. » (Caron, 1997, p.593) Cet essor combiné des pratiques touristiques et de la double-résidence caractérise les usages du ferroviaire en région parisienne au XIXe siècle. C’est d’ailleurs ce qu’observent eux-mêmes les administrateurs des compagnies, comme en témoigne ce rapport du 25 octobre 1854 rédigé par l’ingénieur Bassompierre dans lequel est fait état de ces deux types de publics qui utilisent les lignes du réseau de l’Est :
« La population qui fréquente un chemin de fer de banlieue se compose à peu près exclusivement de propriétaires demeurant toute l’année ou une partie de l’année à la campagne, et de promeneurs dont les goûts varient comme la mode, et que les industries locales s’efforcent d’attirer par l’espérance du plaisir, quand la beauté du site et des promenades ne suffit pas. À ces catégories de voyageurs, on pourrait ajouter celle du visiteur, que la proximité des châteaux, et des maisons de campagne appelle pour quelques heures seulement hors de la ville, ou d’une banlieue à une autre. » .
Ce succès bourgeois du ferroviaire se traduit en premier lieu par une montée en puissance des dessertes intermédiaires, ce à quoi les observateurs de l’époque s’attendaient visiblement peu, comme en témoigne cet extrait du Journal des débats du 26 mars 1838 cité par Bruno Carrière (2012, p.47) :
« Ce qui n’est pas moins curieux, ce à quoi on devait moins s’attendre, c’est l’activité qu’ont prise, grâce au chemin de fer, les rapports de Paris avec de minces villages intermédiaires. Jusqu’à présent les trains ne s’arrêtent entre Paris et le Pecq qu’à Nanterre et Chatou : dès l’origine, le nombre de voyageurs fournis par ces deux points n’a cessé de s’accroître, même quand la rigueur de la saison allait toujours croissant. » .
Les administrateurs des compagnies auraient été pour leur part bien plus témoins de cette évolution qu’ils n’auraient cherché à l’encourager. En effet, la plupart d’entre eux considéraient alors que les villages de la région parisienne n’avaient pas de liens suffisants avec la capitale pour justifier la construction de nouvelles liaisons ou dessertes ferroviaires (Carrière, 2012, p.46). Les élus de ces communes ne les y auraient d’ailleurs pas spécialement encouragés, et nombreux auraient même été ceux à avoir cherché à écarter le tracé du chemin de fer de leur territoire communal, comme en attestent un certain nombre d’archives de conseils municipaux étudiées par Alain Faure (1993). Mais surtout, les administrateurs des compagnies voyaient alors leurs intérêts commerciaux ailleurs : « pour les compagnies les mieux nanties, dont le fonds de commerce reposait sur les grandes artères (Paris – Lille, Paris – Strasbourg, Paris – Lyon, Paris – Orléans, Paris – Rouen), la desserte de banlieue parisienne n’était pas leur principal souci, loin s’en faut. Elle ne le fut d’ailleurs jamais. Bien plus rémunérateurs étaient, en effet, le service marchandises et celui des trains de grand parcours. » (Carrière, 1998, p.24) .
|
Table des matières
Introduction générale
Chapitre 1. Une étude par l’imaginaire : éléments de cadrage
Partie I. Archéologie
Chapitre 2. Les « banlieues » imposées au ferroviaire
Chapitre 3. La gare de « banlieue » comme palimpseste de représentations
Partie II. Cristallisation
Chapitre 4. L’urgence politique du « quotidien »
Chapitre 5. La conversion des gares de « banlieue » au « quotidien »
Chapitre 6. La promesse urbaine des gares du « quotidien »
Conclusion générale
Annexes
Sources principales
Bibliographie
Table des matières
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet