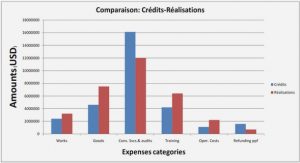Les êtres humains ont toujours été entourés par des animaux et ont tissé des liens particuliers avec eux. Déjà, dans l’art préhistorique, les hommes ont principalement représenté la faune qu’ils côtoyaient. Les attitudes que les humains ont développées à l’égard des animaux sont diverses. Eagly et Chaiken définissent l’attitude comme « une tendance psychologique exprimée par l’évaluation d’une entité particulière avec un certain degré de faveur ou de dépréciation » (Eagly & Chaiken, 1993). L’attitude qu’a un individu envers un animal dépend de très nombreux facteurs.
Les attitudes envers les animaux : la combinaison complexe de nombreux facteurs
Ces facteurs peuvent être propres à l’individu, à l’animal ou bien à la relation entre les deux. Ainsi, l’attitude envers les animaux dépend du genre de la personne. Le plus souvent, les femmes ont des attitudes plus positives vis-à-vis des animaux (Herzog et al., 1991 ; Herzog 2007 ; Cailly Arnulphi et al., 2017). Elles sont par exemple plus nombreuses à être engagées dans la protection animale (dans la revue de 9 articles de Herzog en 2007, le pourcentage de femmes dans l’activisme en faveur des animaux varie de 67% à 80%) tandis que les hommes sont plus susceptibles de chasser (dans un recensement de United States Census Bureau en 2004-2005, les États-Unis comptaient 17 millions de chasseurs contre 2,6 millions de chasseuses) ou de maltraiter des animaux (Herzog 2007). Cependant, les hommes sont plus à l’aise avec l’idée de toucher certains animaux généralement perçus négativement comme les araignées, serpents, vers, crapauds, souris et chauve souris (Herzog et al., 1991). En effet, d’autres études tendent à montrer que les individus de genre féminin ont plus souvent peur de certains animaux comme les serpents (Prokop et al., 2009), les crapauds, les araignées, les insectes ou les limaces (Zhang et al., 2014). Ceci serait dû à une pression sociale exercée sur les garçons de la part de leurs semblables et de leurs parents qui les encourageraient à ne pas avoir peur de la nature, alors qu’au contraire les filles seraient poussées à en avoir peur en étant découragées à faire des activités extérieures ou à être des garçons manqués et la désirabilité sociale peut être une force puissante (voir Crowne & Marlow, 1960 ; Holtgraves, 2004). L’âge entre aussi en compte. Par exemple, les rats, les chauve-souris, les escargots en Norvège (Bjerke & Østdahl, 2004) ou le condor des Andes (Cailly Arnulphi et al., 2017) sont plus appréciés par les personnes les plus jeunes. Au contraire, d’autres espèces animales sont plus appréciées par les personnes plus âgées : toujours en Norvège, les papillons, les pies, les mouettes ou les abeilles sont plus aimés par les plus âgés (Bjerke & Østdahl, 2004). Le niveau d’étude a également un impact sur l’attitude envers un animal ; en général, les personnes ayant fait le plus d’études ont tendance à plus aimer certaines espèces animales comme les papillons, les hérissons, les canards et les renards (Bjerke & Østdahl, 2004) ou le condor des Andes (Cailly Arnulphi et al., 2017). L’endroit où vit l’individu a aussi son importance ; ainsi, les enfants chinois qui vivent à la campagne sont plus en contact avec la nature que ceux des villes, ce qui les rend plus biophiles (qui « aiment la vie et les systèmes vivants » ; Fromm, 1964) et moins biophobes (qui a « peur des êtres vivants ou [a de] l’aversion à leur égard»; Simaika & Samways, 2010 ; Zhang et al., 2014). Le métier ou les études suivies peuvent aussi avoir une incidence sur l’attitude. Les fermiers voient le condor des Andes plus négativement car ils craignent à tort des attaques contre leurs troupeaux (Cailly Arnulphi et al., 2017). Il en est de même pour le loup qui reçoit moins d’attitudes positives de la part des éleveurs que des autres personnes (Williams et al., 2002), mais cette fois les attaques envers les troupeaux sont bien réelles. Les étudiants en biologie ont une attitude plus positive envers les serpents que les autres étudiants (Prokop et al., 2009) ce qui pourrait être dû à une meilleure connaissances de ces animaux ou à une affinité initiale avec les animaux qui les ont poussés à s’inscrire en biologie. D’autres facteurs propres à l’individu (ou aux sociétés) peuvent influencer l’attitude visà-vis des animaux tels que la culture (Kellert, 1984a) qui comprend l’histoire, les croyances notamment religieuses, les pratiques et les représentations culturelles (Serpell, 2004), le contexte local comme l’environnement immédiat (Hunter & Brehm, 2004), l’orientation des valeurs notamment environnementales (Hunter & Brehm, 2004), etc…
Les caractéristiques propres à l’animal jouent aussi un rôle dans l’attitude que les personnes ont envers eux. Différentes espèces reçoivent généralement différentes appréciations (Driscoll, 1995 ; Bjerke & Østdahl, 2004 ; Batt, 2009 ; George et al., 2016). Leur physique a une influence sur l’attitude : la taille (généralement les animaux les plus grands sont préférés) et l’esthétique (comme les papillons qui sont appréciés pour leur beauté ; Kellert, 1984a), le côté laid ou visqueux peut les rendre effrayant (comme les limaces et les vers ; Bennett‐Levy & Marteau, 1984), mais aussi l’apparence visuelle de manière générale, l’impression tactile et l’impression auditive (Merckelbach et al., 1987). Certaines caractéristiques physiques des animaux tels que les griffes ou les dents tranchantes peuvent même les faire passer pour des « méchants » aux yeux des enfants (Lee, 2012). Les êtres humains ont aussi tendance à plus apprécier les animaux qui leur ressemblent biologiquement (Batt, 2009) et/ou qui sont proches phylogénétiquement (i.e. dans l’arbre de parenté du vivant ; Kellert, 1984a). C’est le cas du chimpanzé qui est l’animal le plus aimé dans une liste de 40 animaux (Batt, 2009) et qui ressemble beaucoup à l’homme du fait qu’il est son plus proche parent actuel. D’autre part, les animaux aux caractéristiques néoténiques (qui conservent les caractéristiques des bébés à l’âge adulte : tête et yeux proportionnellement plus grands comme chez les écureuils, démarche instable comme celle des manchots…) reçoivent plus d’intérêt de la part du public et même des scientifiques (Estren, 2012). La néoténie serait un processus adaptatif qui permettrait d’inhiber l’agressivité des prédateurs et/ou des compétiteurs (Lorenz, 1943).
Une perception relative et évolutive : elle varie selon les aires culturelles et évolue dans le temps
Les perceptions sont extrêmement diverses en fonction des régions culturelles et peuvent évoluer dans le temps. Le rapport aux animaux diffère selon les cultures. Dans le monde occidental, ce rapport est très hiérarchisé et l’homme est considéré comme une espèce supérieure qui peut à sa guise utiliser les autres espèces qui lui sont, en quelque, sorte inféodées. Ce rapport dérive sans doute de la religion et notamment de la Bible. Dans la Genèse, il est écrit : « Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. ». Mais, il existe, bien sûr, d’autres types de relations entre humains et animaux. Philippe Descola, dans son livre Par-delà nature et culture (2005), a par exemple distingué quatre types de relations entre humains et non-humains qui existent à travers le monde en fonction de la ressemblance et de la différence entre les physicalités et les intériorités . Les physicalités correspondent à l’apparence extérieure, mais aussi aux modes d’existence, aux régimes alimentaires et aux modes de reproduction. Les intériorités correspondent, quant à elles, à la subjectivité, à la conscience notamment de soi, à la connaissance, à la mémoire, à l’intentionnalité, à la communication et à la mortalité.
Le naturalisme est ce que nous connaissons dans le monde occidental où il existe une frontière entre ce qui relève des hommes (i. e. la culture) et le reste du monde (i. e. la nature) ; il y a donc une différence des intériorités. Cependant, le monde physique et donc les physicalités y sont les mêmes pour les humains comme les non-humains : ils sont tous constitués d’atomes, les mêmes lois physiques s’y appliquent… Au contraire, dans l’animisme qui existe par exemple chez les Dogons du Mali (Petit, 1997), les humains et les non-humains possèdent tous un « esprit » (ressemblance des intériorités) mais leurs corps diffèrent ainsi que « leurs mœurs [ou leurs modes] de comportement spécialisé » (Descola, 2005) (différence des physicalités). Dans le totémisme, qu’on trouve entre autres chez les Aborigènes d’Australie (Peterson, 1972), les non-humains ont les mêmes intériorités (émotions, conscience, désirs…) que les humains mais aussi les mêmes physicalités (« [mêmes substances telles que la chair, le sang et la peau et] une même forme de vie » ; Descola, 2005). Enfin, dans l’analogisme comme chez les peuples indigènes des Andes (Descola, 2008), les intériorités comme les physicalités sont différentes entre les humains et les non-humains. Il existe donc bien différentes façons de considérer les non-humains dont les animaux font partie selon les régions culturelles.
Les perceptions et attitudes envers les animaux peuvent aussi évoluer dans le temps. Dans l’Europe pré-indo-européenne (i. e. lors de la préhistoire), les animaux pouvaient être divinisés. Il existait, par exemple, une déesse-serpent et une déesse-oiseau (Boekhoorn, 2008). Au fil du temps, ces animaux ont perdu leur côté divin, notamment avec l’émergence de la religion monothéiste. Comme nous l’avons vu, avec l’arrivée du Christianisme, les animaux sont devenus des êtres dominés par l’homme. Cette vision est alors celle qui a perdurée jusqu’à aujourd’hui. Cependant, récemment, cette perception est de plus en plus remise en cause en Occident avec, par exemple, le mouvement antispéciste. Ce mouvement, apparu en France en 1985, « revendique un traitement identique pour les hommes et pour les animaux, en vertu de leur capacité commune à vouloir vivre et à pouvoir souffrir. ») (Dubreuil, 2009). L’antispécisme est généralement associé au végétarisme (i. e. régime alimentaire où est exclue la chair animale ; Laisney, 2016) et au véganisme (i. e. mode de vie où est exclu tout type d’exploitation des animaux ; Laisney, 2016) qui semblent aussi progresser. D’après une enquête de l’IFEN-INSEE en 1998, seul 2% des Français étaient végétariens. Plus récemment, dans un sondage Opinion Way pour le magazine Terra Eco réalisé en 2016, 3% des personnes interrogées se déclaraient végétariennes, et 10% envisageraient de suivre ce régime. Dans une enquête Toluna de 2015 pour AgroParisTech, 10% des 15 à 24 ans seraient végétariens en France. Il y aurait donc bien une tendance à une augmentation du régime végétarien qui est en partie motivé par le bien-être animal. En effet, ce dernier arrive en deuxième position, après la raison économique, dans les raisons pour lesquelles les personnes ne consomment pas ou moins de viande (d’après le Sondage Mediaprism pour Good Planet). Cependant, ces évolutions récentes restent encore marginales et l’approche anthropocentrée est encore celle qui domine en Occident.
L’attitude spécifique envers un animal peut également évoluer dans le temps. Même si George et ses collègues (2016) ont constaté que les attitudes moyennes des hommes envers une espèce animale étaient relativement constantes sur le court terme (de 1978 à 2014, soit 36 ans), quelques espèces comme le loup (voir aussi Kellert et al., 1996), le rat ou le coyote ont connu une amélioration de l’attitude des Américains à leur égard sur cette période. Sur du plus long terme, les perceptions de certains animaux peuvent évoluer de façon favorable ou non. Ainsi, l’image du pigeon s’est dégradé dans le monde occidental au cours du XXème siècle (Jerolmack, 2008 ; Skandrani et al., 2014). Au contraire, le hérisson qui était mal vu notamment en France au début du XXème siècle est devenu un animal très apprécié aujourd’hui (Burgaud, 1996). Ainsi, les perceptions et attitudes envers les animaux ne sont ni constantes, ni universelles.
Les différentes attitudes vis-à-vis des animaux : l’échelle de Kellert et Berry
Au début des années 1980, Kellert et Berry ont mis au point une échelle des attitudes à l’égard des animaux . Ils en distinguent neuf principales qui sont : la naturaliste, l’écologiste, l’humaniste, la moraliste, la scientifique, l’esthétique, l’utilitariste, la dominioniste et la négativiste/neutraliste.
Ils ont également évalué quelle était leur prévalence estimée dans la population américaine c’est-à-dire quels sont les pourcentages des attitudes dominantes dans la population. Les attitudes envers les animaux les plus courantes étaient : la négativiste/neutraliste (37%), l’humaniste (35%), la moraliste (20%) et l’utilitariste (20% ; Kellert & Berry, 1980). Les attitudes peuvent varier en fonction de la culture ; par exemple, les étudiants turcs ont des attitudes scientifique et naturaliste plus positives vis à vis des serpents que les étudiants slovaques (Prokop et al., 2009). Concernant l’attitude utilitariste qui sera celle qui nous intéressera le plus ici, Kellert (1984a) a constaté que les personnes qui ont le plus une attitude utilitariste sont les fermiers, les chasseurs, les pêcheurs, les plus âgés et les moins utilitaristes sont les jeunes, les personnes en faveur de la protection de l’environnement ou de la vie sauvage, les gens ayant fait des études et les personnes seules. De plus, les adultes sont plus utilitaristes que les enfants, les garçons plus que les filles, et les urbains plus que les ruraux (Kellert, 1984b).
L’utilité des animaux pour les êtres humains : des services aux nuisances
Comme nous l’avons vu l’utilité des animaux, avec l’affect, sont les deux plus importants déterminants dans les attitudes humaines vis-à-vis des animaux selon Serpell (Serpell, 2004). Lorsque des personnes estiment l’utilité d’une espèce animale, celle-ci est positivement corrélée à l’appréciation de cette espèce, mais aussi à leur importance estimée, à leur intelligence estimée et à leur innocuité estimée (Driscoll, 1995). Certaines personnes sont plus susceptibles d’accepter l’utilisation des animaux : plus une personne croit en l’esprit animal, plus son attitude envers l’utilisation des animaux est négative (Knight et al., 2004) ; les hommes et les nonvégétariens sont plus favorables à l’utilisation des animaux que les femmes et les végétariens (Knight et al., 2004). Mais d’autres facteurs peuvent agir sur les attitudes à l’égard de l’utilisation des animaux, comme le traitement cognitif, les caractéristiques des espèces d’animaux utilisés et le type d’utilisation des animaux (Knight et al., 2003). Certains auteurs ont mis en place une échelle des attitudes envers le traitement des animaux et ont constaté que trois catégories se distinguaient : celle des « animaux de compagnie » qui obtiennent les meilleurs scores (les plus pro-animal), suivie de celle des « animaux utiles » et enfin celle des « animaux nuisibles » (Taylor & Signal, 2009). Ceci indique que l’utilité des animaux pour les hommes conditionnent comment ils seront traités.
Un concept qui est en accord avec l’attitude utilitariste des animaux et qui s’est beaucoup développé ces dernières années est celui des services écosystémiques. Dès 1970, ce concept est apparu dans des textes académiques (SCEP, 1970). Il a ensuite été démocratisé parmi les écologues lors de l’Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire en 2005. Les services écosystémiques y ont été définis comme « les bénéfices que les humains tirent des écosystèmes » (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). L’écosystème, quant à lui, y est défini comme « un complexe dynamique composé de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de la nature morte environnante agissant en interaction en tant qu’unité fonctionnelle » (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Les services écosystémiques y ont été divisés en quatre catégories qui sont : les services de prélèvement (ou de production), les services de régulation, les services culturels et les services d’auto-entretien (ou de support) (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Des exemples de services de prélèvement sont les jardins privés au Vall Fosca, dans les Pyrénées Catalans en Espagne, qui fournissent de la nourriture de qualité, du fourrage, des engrais naturels ou encore des plantes médicinales (Calvet-Mir et al., 2012). Un cas de service de régulation est l’équarrissage de carcasses d »animaux d’élevage dans les Cévennes par les vautours fauves (Sarrazin, 2013). En effet, en mangeant les carcasses des animaux morts, les vautours permettent de réguler ce type de déchets. De plus, ils permettent de faire moins souvent appel à des entreprises ce qui aide à faire des économies financières et à relâcher moins de CO₂ dans l’atmosphère (Dupont et al. 2011, 2012). Un exemple de service écosystémique culturel est l’écotourisme. Par exemple, en Polynésie française, au large de l’île de Moorea, des touristes viennent voir les requins-citrons faucilles (Clua & Pascal, 2014). Un cas de service d’auto-entretien est la formation des sols dans les cultures arables conventionnelles et biologiques en Nouvelle-Zélande grâce en partie aux 12 à 244 vers de terre présents par m² (Sandhu et al., 2010). Cependant, les écosystèmes peuvent être aussi la source de mauvais services (disservices en anglais) c’est-à-dire de nuisances comme par exemple, les maladies (comme le virus d’Ebola qui peut être transmis par certaines chauves-souris frugivores ; Leroy et al., 2005), les morsures de serpents (Dunn, 2010), les allergies (notamment dues aux pollens des arbres) ou les piqûres d’insectes (Carinanos et al., 2017). Lyytimäki et Sipilä (2009) définissent les mauvais services comme des « fonctions d’écosystèmes perçues comme étant négatives pour le bien-être humain. ». On retrouve ces mauvais services aussi dans le milieu urbain où les éléments de nature qui y sont présents peuvent aussi bien rendre des services aux citadins qu’entraîner des désagréments (Lyytimäki et al., 2008). Par exemple, des dommages aux structures peuvent être causés par décomposition du bois par activité microbienne, les excréments d’oiseaux peuvent accélérer la corrosion, les racines des arbres endommager les trottoirs ou les animaux creuser des trous pour la nidification (Petersen et al., 2007). D’après une revue de Von Döhren et Haase (2015), les mauvais services urbains touchent principalement l’écologie (c’est-à-dire les structures, les fonctionnements et/ou services écosystémiques), suivie par l’économie (les structures et les processus (socio-)économiques), la santé humaine et la psychologie (comme la création de sentiments négatifs tels que l’anxiété et l’inconfort chez certaines personnes). Il y aurait donc des éléments de nature qui seraient désirables et d’autres indésirables pour l’homme notamment dans le milieu urbain qui est pensé pour lui et par lui.
|
Table des matières
Introduction
1. Les attitudes envers les animaux : la combinaison complexe de nombreux facteurs
2. Une perception relative et évolutive : elle varie selon les aires culturelles et évolue dans le temps
3. Les différentes attitudes vis-à-vis des animaux : l’échelle de Kellert et Berry
4. L’utilité des animaux pour les êtres humains : des services aux nuisances
5. Le milieu urbain : un écosystème particulier
Problématique de la thèse
Objectifs de la thèse
Matériel et méthode général
Modèles d’études
Le pigeon
Le rat
Le hérisson
Méthodologies
1. Composition du questionnaire et déroulement de l’enquête
2. Test de l’effet fertilisant du guano de pigeons sur différentes espèces cultivées en ville
3. Confrontation des usagers de la ville avec les services rendus par les pigeons
Chapitre 1 : Perception de la faune urbaine spontanée par les usagers de Paris Appreciation and perception of spontaneous urban fauna by humans in a French city, Paris
Chapitre 2 : Un service écosystémique rendu par le pigeon urbain : l’effet fertilisant de ses fientes dans l’agriculture urbaine
Utilisation of pigeon guano as a fertilizer on cherry tomato plants in urban agriculture
Utilisation de guano de pigeons comme engrais sur des courgettes, des mâches et des radis dans le cadre de l’agriculture urbaine
Quantifying trace metals in pigeon guano-fertilized vegetables in an urban agriculture
context
Chapitre 3 : Peut-on améliorer l’appréciation et la perception d’un animal urbain en fournissant des informations sur les services qu’il rend ?
Can the appreciation and perception of an urban animal be improved by providing knowledge
about the services it provides?
Synthèse et perspectives
Conclusion
Bibliographie
Annexes
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet