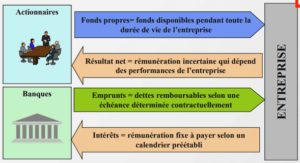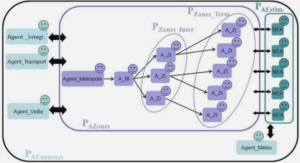Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les ONGs nationales dominées par les associations religieuses
La libéralisation politique et économique depuis 193 a permis l‘apparition d’organisations issues de la société civile et deséglises. Ce mouvement est d’autant plus important que 1’État se désengage, voire abandonne nombre de ses fonctions antérieures et que la dégradation du niveau de vie se poursuit inévitablement. L‘influence chrétienne reste sensible, même si ces nouvelles organisations affichent leur laïcité, et se démarquent parfois des positions de l’Église. Ce phénomène se manifeste surtout chez les catholiques à travers les différentes œuvres caritatives qui se démarquent dans le pays.
Des ONGs nationales sont créées sous l’impulsion d’organismes étrangers à savoir les groupements mutualistes, groupements professionnels. Les ONGs étrangères ou les projets de coopération bilatérale fournissent ainsides moyens qui permettent le décollage des actions ou pour canaliser « la rente du développement ». Tout en reconnaissant la nécessité d’appuyer et de favoriser la rénovation ud système administratif, les bailleurs de fonds sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de l’administration malgache dont les rigidités et la force d’inertie stérilisent parfois l’efficacité des projets. Les flux financiers des bailleurs s’orientent de plus en plus vers des opérateurs privés depuis les années 90.
L’émergences des ONGs étrangères
Les résultats de l’inventaire de 1994 montrent la croissance du nombre des ONGs à Madagascar. Il y a 20 ans, on comptait moins de 10 ONGs ou associations étrangères à Madagascar. D’après le ministère de la Population, elles sont actuellement moins de 100, ce qui correspond à une ouverture du pays à ce type de coopération. Les ONGs étrangères sont, au moment de leur installation, plus contrôlées que les associations malgaches. Elles doivent signer un accord de siège, en passant par le ministère de l’Intérieur, les Affaires étrangères et le ministère technique concerné par leur action .Les statuts et le fonctionnement interne de ces ONGs sont règlementés par le cadre légal dont ils dépendent dans leur pays d’origine. Actuellement, la moitié des ONGs étrangères présentes à Madagascar sont françaises. Les plus connues interviennent dans le développement rural, la santé, l’éducation et les 20 autres ONGs européennes sont représentéesà Madagascar. Ensuite, viennent les ONGs américaines qui se sont implantées récemmentt esont au nombre de 10 actuellement. Les programmes de défense de l’environnement tiennent une place importante dans leurs interventions. L‘installation récente des Corps de la Paix (Peace Corps) et de Green Peace est une illustration du rapprochement politique des deux pays. Lors de la période du socialisme exclusif durant la deuxième république,Madagascar avait coupé ses relations diplomatiques avec les États-Unis. On peut noter au ssi la présence de 3 ONGs japonaises. Malgré cela, Il est donc assez surprenant de constater qu’actuellement personne ne sait combien d’ONG interviennent à Madagascar, exception faite des ONG internationales qui sont bien répertoriées. Le flou dans la définitiondes ONG et le vide juridique sont sans doute les premiers responsables de cette situation20.
La particularité de l’ONG
Définition de l’ONG
La définition du terme Organisation Non Gouvernementale change souvent selon les auteurs, ce terme désigne généralement des organisations composées d’individus qui se rassemblent volontairement en associations pour poursuivre des objectifs communs et non lucratifs. Aujourd’hui sont regroupées sous la mêmeterminologie, des organisations de défense des droits de l’homme, des organisations de développement, des associations caritatives, des secouristes, des protecteurs de l’environnement mettant leurs compétences au service d’un idéal dit « humanitaire » ou de « solidarité » à travers lequel se voient recyclées différentes traditions idéologiques : charité chrétienne, militantisme social-chrétien, tiers-mondisme, internationalisme, humanisme républicainou environnementalisme.
En France, le terme ONG renvoie uniquement à des or ganisations de solidarité, contrairement au terme anglo-saxon « NGO » qui désigne toute organisation qui n’est pas gouvernementale, qu’il s’agisse d’une organisation terroriste ou d’une association de solidarité.
L’art. 71 de la charte de l’ONU définit les ONG comme des organisations de constitution privée, à caractère non-lucratif, et à utilité sociale.
Selon la définition devenue célèbre de Jan Aart SCHOLTE, elles sont « le lieu d’activité volontaires, hors Etat et hors-marché, uiq ont pour but d’influencer les politiques, la formation des normes, ou la structure de la société ».
Ces définitions renvoient toutes à un principe d’externalité totale à la sphère publique. De plus, les ONGs sont toujours apparues aux yeux de l’opinion publique internationale comme un « monde à part » qui serait un contre pouvoir des états. Par conséquent, à l’heure où l’on observe l’essor des ONGs, on peut se poser la question : Dans quelle mesure ces dernières sont réellement indépendantes du domaine public ? Une ONG pourrait être définie comme un groupement,une association, un mouvement, une institution, créé non par un accord entre Etats mais par une initiative privée ou mixte, qui rassemble des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, de nationalités diverses pour mener une action internationale, c’est-à-dire étendue à plusieurs Etats, qui n’a pas de caractère lucratif.
Les ONGs sont une réalité difficile à définir, unesorte de masse nuageuse. Elles contiennent tant des branches nationales, qu’internationales, ainsi que des fédérations sportives.
La définition reste indécise et controversée, le champ d’étude est encore à approfondir. Cette « liberté » terminologique manifeste en fait des objectifs très divers.
Devant ces nombreuses définitions, nous préfèreronscelle qui est développée par Philippe RYFMAN et qui s’articule autour de cinq caractéristiques :
– être de caractère associatif avec la définition’und idéal ou d’une conviction dans un but non lucratif et tourné vers le bénéfice d’autrui ;
– être de la forme juridique particulière correspondant au terme « d’association » ou « d’organisation non lucrative » en rigueur dans le pays d’origine ;
– entretenir un rapport avec les puissances publiques comme privées tant au niveau national qu’international mais selon une visée autonome, à savoir que l’Etat ne doit pas être à l’origine de sa création ni la domestiquer ;
– faire référence à des valeurs et avoir une volontéd’action citoyenne dans un cadre démocratique ;
– être de caractère transnational.
Il n’existe pas ainsi de définition unanime mais une multiplicité de définitions étant donné que les ONGs ne sont pas des organisations de droit international et ne bénéficient donc pas d’un statut international.
L’article 2 de la loi 96-030 définit l’ONG à Madagascar comme étant : « groupement de personnes morales ou physiques, qui a une nature juridique originale, la distinguant de la société commerciale ou de l’association ou de toutes autres entités soumises à différentes lois relevant du Droit malgache ». L’ONG a un régime particulier et ses règles propres. Les caractéristiques essentielles d’une ONG sont :
– elle est une personne morale de droit privé ;
– elle dispose d’une large autonomie, d’un patrimoi ne et d’une structure lui permettant d’exercer ses activités de façon professionnelle et permanente.
Selon les articles 5 à 7 de la précédente loi, la personnalité morale et la qualité d’ONG ne s’acquièrent qu’une fois l’ONG déclarée et agrée.
Raison d’existence et références des textes
C’est l’ordonnance 96-030 portants régimes particuliers des ONGs à Madagascar, datant du 29 novembre 1996 qui règlemente les ONGs. Cette loi est très proche de la loi de 60-133 promulguée en 1960 qui s’applique aux associations. Les ONGs sont ainsi classées parmi les associations à but non lucratif 23. Elle est pourtant différente d’une association par l’étendue de ses activités d’où l’origine de la loi sur les ONGs en 1996. Elle est une organisation à but non lucratif et à vocation human itaire. Elle dispose de ressources humaines, matérielles et financières pour ses interventions. Il est précisé que l’ONG, « peut dans les limites définies par ses statuts et règlements intérieurs, gérer ses propres fonds, les utiliser, en bon père de famille, pour le paiement des salaires, indemnités ou primes du personnel travaillant pour l’objet du groupement ainsi que pour le règlement des charges permanentes et des frais divers de gestion »24. Aucune limite n’est fixée, si ce n’est celles que l’ONG se donne elle-même. Elle peut donc répartirntre ses membres sous une forme ou une autre, les différents fonds dont elle bénéficie, sans se soucier des tiers pour lesquels elle est censée travailler ; elle peut par là même prouver que ses revenus moins ses dépenses sont égaux à zéro. Elle peut bénéficier aussi grâceà son statut importé, d’une franchise douanière pour « les marchandises qui vont directement et exclusivement aux nécessiteux » et d’une exonération d’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe professionnelle.
Principes d’actions
Selon l’article 2 de la loi 96-030, l’ONG exerce se s activités sous forme de prestation de service qu’elle fournit en se conformant à 2 exigen ces :
– la professionnalisation, qui doit l’inciter à prosc rire tout comportement velléitaire et tout amateurisme ;
– la permanence qui signifie sérieux, continuité et onstance dans la gestion et souci de pérenniser les actions.
Dans un souci de clarification, on distingue 4 catégories des ONGs :
– les ONGs humanitaires qui ont des activités à caractère caritatif, social et de bienfaisance : ONG médico-sociales.
Il existe également des ONGs menant des activités pécifiques de lutte contre la pauvreté telles que:
– les ONGs de développement économique se consacrant à des actions de développement rural, artisanal, de promotion économique d’une région ou d’incitation à l’émergence d’exploitation ou de petites entreprises autonomes dans les zones rurales ou urbaines défavorisées. On classe parmi ces ONG celles ayant des actions environnementales spécifiques ;
– les ONGs œuvrant pour la promotion de l’homme qui ont des préoccupations socio-éducatives, de formation professionnelle ou de réinsertion sociale ;
– les ONGs à objectif culturel qui s’occupent de la promotion culturelle, soit de la diffusion de la culture, l’encouragement à la lectu re, à la communication et à l’éducation culturelle ou encore les ONGs orientant leurs activités vers la protection du patrimoine national.
Organisation et fonctionnement
Les articles 13 et suivants de la loi 96-030 définissent les règles essentielles devant régir l’organisation et le fonctionnement de l’ONG. Une ONG doit avoir un organe, un statut, des règlements intérieurs, un budget pour ons fonctionnement. Les organes les plus importantes qu’une ONG doit avoir sont :
– l’Assemblée Générale est l’organe suprême de décision et de délibération de l’ONG ;
– le Conseil d’Administration a des pouvoirs d’orient ation et de suivi. Il détient également des pouvoirs destinés à assurer la pérennité, le professionnalisme, l’efficacité, la qualité des prestations, la bonne gestion financière et le recrutement rationnel du personnel de l’ONG ;
– le Comité directeur ou Direction est l’organe d’exécution : c’est l’organe technique, opérationnel de l’ONG ;
– le Commissaire aux Comptes est l’organe de contrôle . L’ampleur et les dimensions des activités des ONGs peuvent être différentes. La itudelat est ainsi donnée aux ONG de prévoir la forme que doit prendre la Direction et les modalités d’exercice des fonctions du Commissaire aux Comptes.
Quant au statut, le statut d’une ONG doit être librement conçu, rédigé et approuvé par les fondateurs. Il tient lieu de véritable loiinterne. Certes, il ne doit pas aller à l’encontre de la loi et des règlements mais il doit constituer une règlementation de base pour l’ONG et être, de ce fait, spécifique à chaque ONG. Il doitservir uniquement de guide pour les fondateurs. Le contenu du statut doit être profondément débattu, élaboré pour être conforme à la mission et aux objectifs visés par l’ONG et adapté aux moyens dont l’ONG dispose, en se souciant de le rendre le plus spécifique possible.
Les ONGs doivent avoir un règlement intérieur équivalant à la charte de fonctionnement de l’ONG ou encore à son manuel de p rocédures internes. En d’autres termes, c’est le texte d’application du statut. Pou r l’élaborer, les membres doivent se référer à chaque titre et article du statut et en développer les détails qui doivent décrire les procédures de fonctionnement de l’ONG. De ce fait, il doit être le plus exhaustif possible et être rédigé à l’image de l’ONG. Le statut et le règlement intérieur sont approuvés lors de l’Assemblée Générale constitutive. Chacune de ses agesp est paraphée par le Président de l’ONG.
Sources de revenu et rémunération du personnel
L’article 13 de la fameuse loi 96-030 prévoit que «les fonctions au sein de l’ONG sont gratuites». Pourtant, il existe une nuance entre les termes « bénévolat » et « gratuité ». Le bénévolat est un accord, une adhésion volontaired’une personne (morale ou physique) pour contribuer aux objectifs de l’ONG. Si cette personne fournit des prestations, sa rétribution doit se conformer au règlement intérieude l’ONG. La gratuité signifie que cette personne ne peut prétendre à une rémunération salariale. Entre autres, les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites lorsque les membres ont engagé des dépenses à l’occasion de missions ou de services effectués pour le compte de l’ONG, ils peuvent obtenir des remboursements.
Le personnel travaillant pour l’ONG, c’est-à-dire l e Comité Directeur ou la Direction, est un personnel salarié, soumis au régime légal de rémunération prévu dans l’article 6 de la loi. De plus, si un membre de l’O NG devient salarié, c’est-à-dire qu’il devient partie du personnel du Comité Directeur, ce membre perd alors son statut de membre et devient un contractant de l’ONG.
Analyse des secteurs d’interventions des ONGs dans la région Analamanga
Dans ce chapitre, nous allons essayer d’analyser les secteurs d’interventions des ONGs dans l région Analamanga. A travers l’étudede la répartition des ONGs, nous allons aborder la prédominance du secteur social dans la ville, la priorité des organisations des producteurs en milieu rural et l’émergence des organisations œuvrant pour l’environnement.
Etude de la répartition des ONGs
Prédominance du secteur social dans la ville
Les interventions des ONGs en milieu urbain sont essentiellement liées à la lutte contre la pauvreté basée sur l’insertion et la réinsertion sociale des enfants démunis. D’autre part, l’enfant a toujours été d’une valeur inestimable pour les malgaches, de plus ce sont eux qui forment l’avenir d’un pays. C’est la raison pou r laquelle beaucoup d’ONGs offrent des services sous forme caritative pour pallier les défaillances du système public. Ils’agit des aides aux populations vulnérables non prises en charge par la société, comme les handicapés, les orphelins, les personnes âgées sansfamille et sans ressources.
Ces offres peuvent se présenter sous forme d’aide à la réinsertion sociale des populations marginalisées (sans travail et sans abri). C’est notamment le travail de l’association Akamasoa, créée par le Père Pedro à Antananarivo, de même que pour le cas de l’ONG manda.
Certaines ONGs proposent un appui à la formation p rofessionnelle, comme au centre de développement d’Andohatapenaka (CDA), installé dans un quartier pauvre de la périphérie d’Antananarivo. De même l’ONG manda aéécr des formations professionnelles.
Vers la fin de l’année 1995, un programme de la coopération bilatérale utilise le savoir-faire des ONGs par le Programme d’Appui aux Initiatives de Quartier ou PAIQ, promu par la coopération française. Il s’agit d’unprogramme d’accompagnement social pour atténuer les effets du flottement de la monnaie malgache auprès des populations vulnérables (on l’appelle aussi « filet de sécurité »). Une « approche par quartier avec une responsabilisation des populations bénéficiaires aété retenue pour être mise en œuvre dans les quartiers précaires d’Antananarivo » . Les objectifs sont « l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations urbaines, la responsabilisation des populations dans le développement de leur quartier et le renforcement des associations de quartiers et des ONG ».26
Priorité des organisations des producteurs en milieu rural
Durant la deuxième république, Madagascar s’est engagé dans une politique de type collectiviste qui s’est concrétisée par la créationde coopératives socialistes. Malheureusement, ce type d’organisation à la fois économique et sociale n’a pas eu un réel succès. L’argent des coopératives s’est dilapidé àd’autres fins et les terres doivent être redistribuées, ce qui a créé un désordre. Depuis rs,lo l’organisation du milieu rural est fragilisée. Outre les interventions classiques de réhabilitation d’infrastructures telles que les pistes, l’aménagement hydro-agricole ou le développement intégré, certains bailleurs de fonds favorisent actuellement deux axes : l’appui à l’émergence d’organisations professionnelles agricoles et la création de mutueles d’épargne et de crédit.
Cette orientation correspond au désengagement de l’Etat d’un certain nombre de fonctions qui sont transférées aux usagers à savoirl’entretien des réseaux hydro-agricoles. L’appui aux organisations professionnelles prend plusieurs formes. Elle se manifeste souvent par la création des groupements à vocation économique ou renforcement des capacités de négociation des agriculteurs, par exemple, la création d’un mouvement de type syndical. L’appui à la création d’un réseau de mutuelles d’épargne et de crédit est transféré aux organisations non gouvernementales étrangères.
Emergence des organisations œuvrant pour l’e nvironnement
Depuis une dizaine d’années, les programmes de protection de l’environnement occupent une place de plus en plus importante dans les préoccupations des bailleurs de fonds. En effet, la dégradation accélérée du couvert forestier a des conséquences irréversibles sur l’ensemble de l’équilibre écologique. Ce n’est pas seulement la biodiversité de l’île qui est menacé (faune et flore endémiques), mais aussi le potentiel de production agricole (érosion des bassins versants, ensablement des fleuves et rivières menaçant les grandes plaines rizicoles). La culture sur brûlis forestiers ou la pratique du « tavy », les feux de brousse en zone de savane et la fabrication de charbon de bois sont les principales causes du déboisement et de l’appauvrissement des ressources naturelles.
L’intervention pour la protection de l’environnement est réalisée à travers des entreprises de conservation relativement classiques. Les actions des ONG se manifestent par la création de parcs et des zones protégées. Et, depuis une période plus récente, par des programmes de développement rural entre autres le reboisement paysan, l’agroforesterie, l’aménagement de bassins versants, l’introduction de techniques de culture intensive notamment dans la riziculture pour limiter la culture extensive sur brûlis. On distingue parmi ces organisations le Groupement SRI, SRA, etc. Le problème du bois de chauffage est abordé au niveau du consommateur. Faute de substitut possible actuellement, une des solutions est d’économiser le charbon de bois par l’utilisation de foyers améliorés. Les ONG occupent une place très importante dans ce secteur. Cependant, les ONGs interviennent dans tous les milieux, notamment dans la zone très isolée où l’Etat n’intervient pas, elles ne représentent en aucun cas des adversaires ou des rivaux pour l’Etat. Elles aident l’Etat dans le cad re des actions de développement local et communautaire sous différents domaines. Elles exercent de façon professionnelle et permanente des activités à caractère caritatif, socio-économique, socioéducatif et culturel sous le mode de prestations de services en vue du développement humain durable, de l’autopromotion de la communauté ainsi que de la protection de l’environnement. Elles effectuent leurs activités suivant le principe du bénévolat, avec impartialité, sans discrimination de race, de religion ou d’appartenance politique. Elles travaillent alors de concert avec l’Etat.
Monographie de l’ONG Manda
Dans ce chapitre, nous allons parler de la monographie de l’ONG Manda en dégageant son histoire, ses missions et objectifs, les différents projets existants, ses ressources de fonctionnements et ses partenaires. Ensuite, nous allons analyser les situations des bénéficiaires de ladite organisation.
Présentation générale du centre
Historique de l’ONG Manda
L’initiative fut déclenchée par deux touristes allemands venus à Madagascar en 1992. La misère qui frappe beaucoup d’enfants sur les rues de la capitale les a beaucoup secoués. A la suite de son séjour, ils ont collectédes fonds en Allemagne et ont décidé de venir à leur rescousse. En effet, ils ont donné naissance à une association dénommée ZAZA FALY en mai 1994 dont les principales actions furent la mise en place de deux centres sociaux à Antsirabe et à Antananarivo. Dès lors, de s sous projets s’opèrent de façon progressive et complémentaire. Sous l’impulsion de contraintes majeures, la structure mise en place à Antsirabe a du être abandonnée. Les responsables ont alors concentrés leurs efforts sur les trois projets VONY, TSIRY et FELANA qui se déroulent à Antananarivo. Les investigateurs ont dû quitter le pays et ont laissé le projet entre les mains de leurs compatriotes malgaches, embauchés en tant qu’éducateurs, cuisinier etc. au sein de l’organisation à la même période. En 1999, l’association est devenue Organisation Non Gouvernementale (ONG), baptisée Manda. Ce fut une étape importante du projet qui reflète la prise de conscience des acteurs malgaches concernant la participation effective au développement du pays.
Ainsi, l’ONG Manda est née en 1999. Etymologiquemen le mot Manda signifie « aro » ou rempart. Sa mission est basée à Antananarivo, où l’exode rural et la misère développent des zones d’habitation hors de toute règle d’urbanisme. Dans beaucoup de quartiers défavorisés, les plus petits sont exposésaux maladies infectieuses, les plus grands quittent l’école et sont amenés à travailler tôt, ou sont tentés par la délinquance et la prostitution. Cette situation de misère qui frappe la capitale a affecté une majeure partie des jeunes de rue. Ainsi, l’association œuvre sur un pr ogramme global en faveur de l’enfance qui vise à soutenir les familles en détresse et les enfants et jeunes de rue en matière d’éducation, d’aide sociale, de santé ou encore d’aide à l’obtention de papiers d’état civil.
Missions et objectifs
L’ONG Manda a pour mission principale la promotion sociale orientée sur le développement des services de base liés à l’assurance du bien être de l’enfant notamment sur l’accès à l’éducation et fourniture de services de santé de base aux enfants de rues.
En effet, l’objectif principal de l’ONG est la réinsertion sociale des enfants de rues de la ville d’Antananarivo. Elle a par ailleurs débuté ses activités par un programme d’éducation et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes non scolarisés. Ce programme a pour but d’améliorer les conditions de vie et les capacités des jeunes non scolarisés, âgés de 4 à 26 ans, vivant dans les quartiers défavorisés d’Antananarivo. Manda travaille avec les enfants en âge d’aller à l’école maternelle et prim aire et avec les jeunes en grande difficulté. Plus de 400 enfants ont été pris en charge de manière permanente à travers des activités de scolarisation, d’animations et de formation, et de nombreuses familles de façon ponctuelle grâce à des aides sociales.
Les projets de l’ONG Manda
Pour atteindre son objectif, l’ONG Manda a mis en place trois types de projets axés sur la satisfaction des besoins vitaux des enfants.
Le projet TSIRY
En octobre 1995 Zaza Faly a crée le centre de jour Tsiry27, sis à Tsiadana. Il s’agit d’un centre de prévention sociale qui accueille les enfants des deux sexes âgés de 4 à 16 ans et plus. La prévention sociale dont l’objectif estde prévenir le phénomène des enfants des rues à travers l’action sociale auprès des enfants et des familles : identification des enfants les plus en difficulté, scolarisation, accès à la santé, appui nutritionnel. La préparation des enfants au système scolaire ou à la formation professionnelle fait partie donc de la raison d’être du projet Tsiry. Cette préparation a été matérialisée par la création des classes préparatoires pour trois niveaux. Si les 2 classes d’alphabétisation existent depuis 1999 avec une capacité d’accueil de 50 enfants et jeunes. Les deux classes préscolaires n’ont quant à elles vu le jour qu’en 2003. Cette dernière peut accueillir 40 enfants. Ce n’est qu’en 2005 que les deux classes d’ASAMA 28 sont ouvertes pour 50 enfants.
Le projet Tsiry constitue un point culminant à trav ers lequel se réalise l’évaluation de la potentialité des bénéficiaires. Les jeunes cruesre répondants aux critères d’inaptitude définis par le centre rejoignent la classe d’alphabétisation. Pour les jeunes ayant déjà été scolarisés et ayant arrêté l’école de manière prématurée peuvent profiter de séances de rattrapage scolaire au sein de la classe ASAMA. Après leur passage au Centre « Tsiry », les enfants deviennent titulaire d´un Certificat d´Etud e Primaire Elémentaire (CEPE). Ce diplôme leur permet de continuer les études dans les collèges privés ou publics. Suite aux différents problèmes à savoir le limite d’âge au sein des collèges publiques, le manque de courage pour poursuivre l’enseignement les jeunes pourront choisir entre les trois (03) centres de formations existantes auprès de « Manda » : Vony, Felana, Tourisme, ou les autres centres de formations ailleurs pour continuer son apprentissage.
Le projet Felana et Vony
Les deux projets Vony et Felana engagent des actions en faveur de la réinsertion professionnelle des jeunes. L’ouverture du centre de formation en tissage Vony pour 10 filles, et du centre de formation en menuiserie Felana pour 10 garçons, en 1998, matérialise ces projets. Le volet formation professionnelle des jeunes, cible particulièrement les jeunes âgés de 14 à 18 ans et en grande difficulté. L’objectif de l’action est de leur permettre d’exercer une activité professionnelle rémunératrice et de lutter contre l’exclusion sociale, la délinquance et la prostitution. Ces deux projets fonctionnent avec un système d’internat.
Le projet tourisme
Le projet tourisme a été mis en marche en 2007. Cette année fut marqué par l’ouverture du centre Tourisme pour 14 garçons et f illes. L’objectif est de former des jeunes âgés de plus de 16 ans pour devenir des guides touristiques. Il constitue aussi une opportunité pour les jeunes du centre Tsiry d’avoir un nouveau type de formation. Dans ce projet, l’ONG espère développer un nouveau mode detourisme axé sur la vie sociale dans la capitale. Les responsables ont conçu ce projet suit e au constat que les enfants de rues connaissent mieux que quiconque la capitale et ses petits recoins. Ces enfants seront donc capables de faire découvrir la facette cachée d’Antananarivo, le centre de la misère. L’ONG a comme partenaire l’Office Régional du Tourisme d’Analamanga (ORTANA) dans ce projet. Ce partenariat avait pour objectif de mettre en place le tourisme alternatif à Antananarivo, tourisme basé sur la connaissance des enfants de rue et des enjeux sociaux qui animent la ville. Il s’agit en effet de mettre sur le marché une nouvelle offre touristique afin de dépasser le type de tourisme fondé essentiellement sur l’histoire, l’art et les cultures ancestrales. Dans son projet Manda espère attirer les touristes vers les réalités sociales et leur faire visiter les organismes œuvrant dans le d omaine social pour qu’ils comprennent la complexité et le fonctionnement de la société malgache.
Les ressources de fonctionnements et les partenaires
L’ONG Manda est une organisation sociale appuyée par des fonds étrangers. Les 93,15% ressources financières viennent de l’extérieur, essentiellement de l’association Zaza Faly, dont le siège est en Allemagne, à Berlin. On a recensé quelques organismes internationaux qui se présentent comme partenaires financiers de l’ONG à savoir le PNUD, l’Alliance française. La somme restante soit 6,84% est issue des dons et aides et productions des jeunes sur place. Néanmoins, la participation du Ministère de la Population se présente sous forme d’aide alimentaire le jour de la fête del’indépendance. Cet acte symbolise la participation de l’Etat. Ces différentes ressources sont réparties sur les projets entrepris par Manda. Les activités du centre Tsiry figurent parmi les principaux consommateurs de fonds soit 37,46 % du budget total suivi de près par les trois centres de formation avec 31,25%. A la troisième place se trouvent les activités socioculturelles avec 25,60%. Enfin la scolarisation représente 5,69% et arrive donc en fin de classement.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : CADRE GENERAL DE L’ETUDE
CHAPITRE I : Généralités sur les ONGs
I.1.Contexte global de l’évolution des ONGs à Madagascar
I.1.2 Les ONGs nationales dominées par les associations religieuses
I.2.1 Définition de l’ONG
I.2.3 Principes d’actions
CHAPITRE II : Analyse des secteurs d’interventions des ONGs dans la région Analamanga
II.1 Etude de la répartition des ONGs
CONCLUSION PARTIELLE
DEUXIEME PARTIE : LES ACTIVITES D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE L’ONG MANDA
CHAPITRE III : Monographie de l’ONG Manda
III.1 Présentation générale du centre
III.2 Analyses des situations des bénéficiaires
CHAPITRE IV : Les activités d’insertion sociale de l’ONG Manda
IV.1 L’hébergement
IV.2 La scolarisation (et ASAMA)
IV.3 L’éducation morale et sanitaire
IV.4 Les aides socioéconomiques et l’éducation familiale pour les parents
CHAPITRE V : Les activités d’insertion professionnelle de l’ONG Manda
V.1 La formation en tissage
V.2 La formation en menuiserie
V.3 La formation en guide touristique solidaire
V.4 Les autres activités
CONCLUSION PARTIELLE
TROISIEME PARTIE : IMPACTS DES ACTIVITES D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR
CHAPITRES VI : Les impacts des activités d’insertion socio-professionnelle pour les bénéficiaires
VI.1 Impacts sur les enfants et jeunes de rues
VI.3 Impacts au niveau des parents
VI.4 Impacts au niveau de la société
VI.5 Impacts des activités basant sur l’étude des cas
CHAPITRE VII : Les perspectives pour développer l’ONG Manda
VII.1 Suggestions pour les bénéficiaires
II.2 Suggestions pour améliorer les activités d’insertion socioprofessionnelle
VII.3 Suggestions pour les centres et le service social
VII.4 Suggestions pour la société
CONCLUSION PARTIELLE
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet