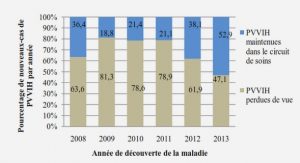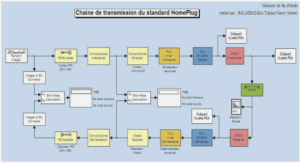Du purpose à la prise en compte des attentes plurielles des parties prenantes
L’origine de l’analyse organisationnelle à travers la grille des « parties prenantes » est souvent attribuée aux recherches du SRI (Stanford Research Institute) au début des années 1960. L’objet de ces recherches est la nécessaire prise en compte et l’équilibre des intérêts des différentes parties contribuant ou étant impactées par l’activité de l’organisation. Cette mise en évidence des revendications et intérêts divergents des acteurs de l’organisation avait déjà été effectuée par plusieurs théories d’inspiration sociologique, comme celle de Cyert et March (1963), sur les comportements au sein de la firme (Behavioral Theory of the Firm).
La théorie comportementale de la firme : l’impossible accord sur un purpose unique Pour Cyert et March (1963), le but organisationnel, s’il est reconnu, ne peut provenir que de la coalition organisationnelle, et c’est alors un ensemble de contraintes que celle-ci impose aux autres acteurs. Ils critiquent ainsi l’utilisation du concept de purpose, rejetant l’existence d’un but organisationnel unique à l’entreprise. Pour March (1962), plus précisément, l’entreprise est un système conflictuel dans lequel les préférences des différentes unités sont forcément contradictoires : une hausse des salaires des employés n’est pas compatible avec la redistribution de la valeur aux actionnaires. Le rôle du dirigeant est alors de procéder à des classements de ces préférences, et de jongler avec les intérêts des différentes coalitions. Il ne peut y avoir, dans cette perspective, de but commun à l’ensemble des acteurs. Celui qui sera retenu par le dirigeant traduira la domination de ce groupe sur un autre. En 1997, March réaffirmera cette idée, en écrivant avec Sutton : « It is not clear that organizational purpose can be portrayed as unitary or that the multiple purposes of an organization are reliably consistent. It is not clear that a single conception of purposes is shared among participants in an organization » (Ibid., p. 698).
Ainsi, Cyert et March présentent cette divergence ou ce clivage sur les buts ou objectifs d’une organisation comme fondamentalement irrésoluble. Or, il semble que ce présupposé théorique ne sera pas remis en question par la théorie des parties prenantes.
La réintroduction d’une dimension responsable de l’action collective grâce à la TPP, sans objectif commun.
Dans les années 1970, une recherche sur la responsabilité sociale des entreprises est menée à Harvard ; l’objet de celle-ci est en effet de se demander comment l’entreprise peut répondre à des attentes formulées par la société. Or, c’est, selon Freeman et Reed (1983), en ce lieu que ce développe les premiers travaux sur la théorie des parties prenantes (TPP), qui participent à la réintroduction de l’idée d’une responsabilité envers des parties externes à l’entreprise.
Freeman, à travers la TPP, réintroduit le principe selon lequel les valeurs font nécessairement et explicitement partie du monde de l’entreprise (1994). Selon Freeman et ses collègues (2004) « quel que soit le but final de l’entreprise, les managers et entrepreneurs doivent prendre en compte les intérêts légitimes des groupes et individus qui peuvent affecter ou être affectés par ses activités » (Ibid., p.365). Selon l’auteur, la TPP aurait donc réussi à réformer le rôle même des entreprises. En revanche, cette considération ne peut être assimilée à un processus d’institutionnalisation tel qu’il a été conceptualisé par Selznick, où l’entreprise constitue un véhicule de valeurs collectivement reconnues comme importantes par les parties de l’organisation. Par exemple, Clarkson (1995), affirme explicitement que selon la TPP, il n’appartient pas à l’entreprise de répondre à des besoins sociaux, et réitère le besoin de distinguer les enjeux de la société dans son ensemble, de ceux des parties prenantes, qui leur sont propres.
Par ailleurs la théorie des parties prenantes donnera lieu à deux approches distinctes : un courant instrumental, et un courant normatif. Or, il nous semble que l’existence même de cette divergence traduit une difficulté à faire de la responsabilité un objet scientifique et atteste de la solidité du clivage entre les dimensions (a priori) rationnelle et éthique de l’action organisationnelle.
Dans le courant instrumental, la prise en compte des intérêts des parties revêt un intérêt stratégique et permet à l’entreprise d’accroître ses chances de durabilité : elle constitue un enjeu nécessitant un raisonnement stratégique rationnel. Le courant normatif de la théorie des parties prenantes, exprime, lui, la nécessité éthique ou morale de prendre en compte les intérêts de chaque partie prenante de l’organisation.
La théorie de l’Entreprise comme Projet : les fondements d’une nouvelle finalité de l’entreprise aux dimensions idéale et responsable
Dans leur ouvrage Repenser l’entreprise, Bréchet et Desreumaux (2018), proposent une théorie de l’entreprise qui permet, à notre sens, d’effectuer un recouplage de ce que nous avons décrit comme les fonctions de coordination et de cohésion. Ce texte, paru en 2018, synthétise en réalité les travaux des deux auteurs menés depuis la fin des années 1990, qui font état d’une insuffisance des théories existantes de la firme ou des organisations à décrire une réalité observable par les chercheurs (Bréchet et Desreumaux, 1998). La Project-Based View a alors vocation à appréhender l’entreprise dans sa «singularité phénoménologique» (Bréchet et Desreumaux, 2011, p.59), et à étudier ses différentes facettes. A travers cette modélisation de l’entreprise, les acteurs avancent, entre autres, l’idée d’une indissociabilité des dimensions instrumentales et politique du projet qui fonde l’action collective.
Ils formulent un ensemble de propositions fondamentales dont la première porte sur l’essence de ce que l’on appelle entreprise : «la conception et la conduite d’un projet productif (ou projet de création de valeur)» (2018., p.100). Il nous semble alors que la finalité de ce projet peut désigner, dans une certaine mesure, ce que nous nommons ici purpose. En effet, la deuxième proposition fondamentale de la théorie porte sur l’ «action d’organiser». Or pour les auteurs, celle-ci suppose la résolution de deux types de problèmes : le premier, d’ordre politique, renvoie à la fonction de cohésion que nous avons mobilisée dans ce Chapitre. Le problème est en effet celui de la coopération qui consiste à obtenir l’adhésion des membres à cette finalité du projet. Le second problème, d’ordre technique, qui est celui de la coordination, correspond à la mobilisation de ressources et de connaissances complémentaires qui sont nécessaires au projet et à la poursuite de cette finalité.
Dans cette proposition, les auteurs explicitent les liens entre ces deux problèmes : pour susciter l’adhésion des acteurs, il est nécessaire que soient rendus compréhensibles les choix stratégiques qui sont pris dans l’intérêt du projet et que la finalité de celui-ci soit acceptée par les acteurs qui participent au projet. Penser les règles qui régissent l’organisation de l’activité ne peut se faire sans penser les relations aux acteurs qui se reconnaissent dans ce projet – qu’ils s’agissent de membres juridiquement liés à la firme ou bien des membres qui se jugent concernés, d’une façon ou d’une autre, par le projet.
Par la suite, les auteurs formulent une proposition qui porte sur la forme organisationnelle qui concrétise le projet productif ; or, à cette occasion, ils affirment, d’un point de vue épistémologique, l’impossibilité de détacher la rationalité économique des acteurs de l’expression de leurs préférences. En ce sens, ils expriment les limites que représentent une modélisation de la mission – ou du projet – sous une seule dimension purement instrumentale, à la manière d’une focalisation sur le critère d’efficience (Simon, 1947). Bréchet et Desreumaux déclarent ainsi : «il est nécessaire de ne pas se limiter à la vision d’une rationalité purement instrumentale, mais d’inclure la rationalité politique ou en finalité, les fins qui donnent sens au projet et par rapport auxquelles se jouent les logiques de coopération» (p. 104). A travers la notion d’ «agir projectif», ils affirment une indissociabilité de la construction de l’action elle-même – de son intelligibilité par les acteurs qui la mènent – de la construction du sens de l’action – qui désigne alors l’adhésion des acteurs au Projet.
Les critiques de l’organisation bureaucratique : un contrôle des comportements politiques jugé inefficace
Bien que ce modèle reste hégémonique jusqu’à la fin des années 1970 (Merrien (1999), la bureaucratie Wébérienne rencontrera rapidement de nombreuses critiques, portant notamment sur son incapacité à contrer des comportements individuels jugés opportunistes. Le difficile contrôle de ces comportements justifiera ainsi le renouvellement des cadres de gouvernance du service public, notamment l’adoption de modes de coordination contractuels via le New Public Management.
C’est cet argument qui est utilisé, dès les années 1960, par « l’économie des choix publics » (public choice) pour remettre en question, entre autres, ce modèle d‘action administrative. Ce courant de la pensée économique est attribué notamment à Buchanan et Tullock (1962) ainsi qu’à Banerjee (1997). Ils formulent une théorie économique de la bureaucratie, qui consiste à mettre l’accent sur les stratégies de maximisation de budget poursuivies par les agents de l’État (Dunleavy, 1995). Selon eux, c’est la poursuite des intérêts personnels par les bureaucrates eux-mêmes qui suppose un disfonctionnement de la bureaucratie : c’est parce que les intérêts des bureaucrates sont servis en priorité que des dépenses connaissent une augmentation dans le temps, et que la qualité du service public déclinerait (Stiglitz et al., 2018). Dans ce paradigme libéral, ce courant considère que la poursuite de l’intérêt personnel par les bureaucrates est d’ordre naturel. En effet, la rationalité de l’homme politique est celle d’un acteur privé, égoïste ; celui-ci place son intérêt particulier à un niveau de critère de décision supérieur à celui de l’intérêt de la collectivité. L’école du public choice considère alors que la gestion administrative aboutirait nécessairement à une inefficience des décisions publiques (Chevallier, 2007). Seront alors recommandés d’autres modes de gestion du service public, notamment contractuels, à travers le New Public Management .
En conclusion, le modèle bureaucratique met en évidence la conduite d’une action publique sur la base d’une compétence, et la nécessaire spécialisation des fonctionnaires qui l’exercent. Néanmoins, ce cadre n’envisage pas de poursuite d’une mission à part entière, ni de pilotage de l’évolution des compétences dans le temps pour faire face aux environnements changeants, et potentiellement inventer de nouveaux services publics. Par ailleurs, ce cadre ne définit pas d’action dirigeante qui servirait à orchestrer l’action collective engagée dans cette mission. le modèle prévoit le respect des règles qui fondent le service public et qui garantissent que l’action soit conduite dans l’intérêt général déterminé par la loi, et non dans l‘intérêt personnel de celui qui œuvre à cette mission. En ce sens, les principes bureaucratiques tentent d’assurer la préservation de la poursuite de l’intérêt général, et correspond ainsi à une forme d’engagement, indirecte, envers les administrés.
Les critiques de la gestion administrative et le contrôle de tout monopole
Premièrement, la théorie du monopole naturel sera contestée : il sera reconnu que ce sont bien les États qui ont construit des services à travers leurs interventions, remplaçant le caractère «naturel» de ces services par un caractère délibéré, afin de garantir une accessibilité d’un service (DiLorenzo, 1996 ; Thierer, 1994). Dans le cas de la téléphonie aux États-Unis, il y aurait ainsi, selon DiLorenzo « a conspiracy between AT&T and politicians who wanted to offer a universal telephone service » (p. 57). Pour ces auteurs, si l’infrastructure de certains services est en effet difficilement duplicable (monopole naturel), les services eux-mêmes peuvent être rendus par plusieurs entreprises en concurrence. C’est ainsi que les théories de la régulation vont se pencher sur les alternatives souhaitables à la gestion administrative ou monopolistique d’un marché donné. A cette époque en effet, se développe l’idée qu’en l’absence de concurrence, la motivation du monopoleur à rendre des services performants ne pourrait exister. Il y aurait une tendance de la part de l’entreprise monopolistique à se reposer sur ses lauriers (Posner,1969 ; Stiglitz et al., 2018). Par ailleurs, les marchés sont imparfaits et comprennent en effet des inégalités sociales, mais il existe plusieurs façons de les corriger, au-delà du monopole. Ce dernier a l’inconvénient d’une grande « opacité » portant sur les activités de l’opérateur désigné, pour Benzoni (1999). Selon Borsenberger6 des alternatives au monopole naturel sont le financement des obligations de service universel par des subventions publiques ou un fonds de compensation : dans ce cas, on a donc toujours une subvention du marché, mais on maintient un système concurrentiel, considéré comme plus efficient. Ainsi, si les auteurs ne défendent pas une absence d’intervention de l’État, l’ensemble de ces questions vont pousser les économistes à chercher les formes de régulations les plus souhaitables des marchés considérés comme défaillants. Avec la globalisation des échanges, selon Dardot et Laval (2020), on assiste à une nouvelle forme de gouvernance des États, car ceux-ci se soumettent eux-mêmes à de nouveaux régimes normatifs conçus au niveau international. Ces régimes prennent la forme d’une «gouvernance internationale capitalistique» qui se caractérise, selon eux, par la « montée en puissance d’institutions intergouvernementales et internationales ».
Or, ces institutions, telles que la Banque Mondiale ou l’OCDE, vont s’approprier des théories économiques portant sur les réformes souhaitables de l’État et véhiculer ainsi une nouvelle représentation souhaitable du mode de gouvernance du service public, qui ne sera plus celui du modèle de la gestion bureaucratique, en propre, par l’administration (selon Chanut et al., 2018 ; Guegoun et Matyjasik, 2019). Par ailleurs, selon Bauby (1998), dès les années 1930 en France, on remarque une « inefficacité » de certaines entreprises de service public, auxquelles l’on reproche de pratiquer des tarifs trop élevés au regard du déploiement de leur capacité à desservir les zones les moins denses du territoire. Un besoin nouveau de régulation semble donc provenir de ces critiques qui portent sur les modes de gestion des services publics.
La gouvernance par le recours au droit public
Premièrement, l’État possède historiquement la possibilité de gérer opérationnellement les activités qui relèvent du secteur public (à travers le fonctionnement de la régie) mais aussi de fixer les règles de gestion du service public. Toutefois, les évolutions du droit français montrent qu’il y a eu une décorrélation progressive entre la personne morale en charge d’un service public et le service public lui-même : s’est ainsi instaurée la possibilité pour un service public d’être délivré par un acteur indépendant de l’État, de droit privé. Si le service public demeure considéré comme un bien a priori non-rentable, l’entreprise en charge de sa réalisation peut être soumise à des règles de concurrence. Ainsi, bien que le droit tente d’introduire, à travers l’EPIC, un statut à part entière d’une entreprise dédiée au service public, la question sera, notamment pour la Commission Européenne, de la situer comme un acteur appartenant au marché, et non à l’État.
Le droit européen viendra également affaiblir le rôle de régulateur de l’État, en lui substituant des agences de régulation indépendantes, dont la mission sera de maintenir l’État à distance des marchés concurrentiels, notamment ceux sur lesquels opèrent les EPIC.
La définition du régime et des missions de service public
Comme nous l’avons vu précédemment, au début du 20ème siècle, et à défaut de définir les activités relevant du domaine public et celles du privé, les juristes définiront des principes de gestion des activités des services publics, notamment ceux énoncés par les lois de Rolland (1928) : équité de traitement des utilisateurs, continuité du service en toutes circonstances, et une adaptabilité aux perturbations de l’environnement.
Les principes traditionnels du service public ont été pensés pour l’État lui-même, mais ils ont été également ceux que se devaient de respecter les entreprises publiques, qui demeurent dans le domaine de la propriété de l’État. En revanche, pour Bauby (1998), ces principes se sont majoritairement traduits en propriétés du service à conserver dans le temps, telles que la continuité de fourniture sur l’ensemble du territoire, la péréquation nationale des tarifs, mais aussi selon lui par une certaine « prise en compte du long terme », moins encouragée dans un cadre de gouvernance d’une entreprise privée.
Avec ces lois Rolland, on définit un «régime» de service public : selon Bauby, les principes constituent des « éléments d’appréciation et des critères de choix », qui sont propres à la conduite des activités publiques (p.26). Mais pour Margairaz et Dard (2005), ce régime ne peut être mis en place qu’en délimitant « des activités continues dans le temps et dans l’espace » (Ibid., p. 6). En effet, ces principes ont toujours été interprétés au regard d’une activité déjà conçue. Nous possédons peu d’éléments qui nous permettraient d’expliciter dans quelle mesure les entreprises ont pu mobiliser ce principe pour penser une évolution de leurs propres capacités au regard d’un environnement changeant. Plutôt, et comme nous le verrons dans le cadre de la délégation de service public, il semble que ce besoin, pour l’État, de s’adapter à un cadre technologique en progrès l’ait conduit à légitimement changer d’opérateur lorsqu’une technologie plus moderne venait à lui être proposé.
Outre les lois Rolland, l’État a édicté plusieurs règles au sein de différents codes les obligations de service public qui tombent dans l’arène de responsabilité des entreprises de service public (Code de l’énergie, des Postes par exemple). Si de nombreuses lois définissent encore les missions des opérateurs de service public, le rôle de régulation de l’État a faibli avec l’arrivée du droit européen. Les institutions requièrent en effet qu’une séparation soit effective entre l’État régalien, qui fixe le droit, et l’État exploitant d’entreprises (à travers les EPIC et l’actionnariat, que nous aborderons par la suite). Ne pouvant être juge et partie, l’État a dû créer des agences dédiées, des « autorités administratives indépendantes ». Le rôle de ces agences de régulation est d’assurer le respect des règles de marché édictées au niveau européen, en garantissant la frontière entre marchés concurrentiels et marchés régulés (Delion, 2007).
La gestion en propre du service public : la régie
Avant l’établissement de théories économiques dédiées à la justification des interventions étatiques dans le domaine économique, avait déjà eu lieu, en France, une réflexion législative sur le concept de « monopole ». Dans le cas postal, par exemple, entre 1830 et 1850, la distribution du courrier était envisagée comme un service public basé sur un monopole, dont l’exploitation devait être assurée par l’État, car il était entendu que lui seul serait apte à gérer ce service dans l’intérêt général de la société française (Langlois-Thiel, 2014).
La régie directe : le modèle de l’administration :Concrètement, une régie est un établissement public chargé de la gestion d’un service public. Dans une régie intéressée, l’établissement perçoit une rémunération de la part de la collectivité pour exploiter les infrastructures, qui dépend en partie du chiffre d’affaires (Nakhla et Breuil, 2005). Ce type de dispositif existait déjà au 8ème siècle selon de Rothschild. «Un service public est géré en régie si la personne publique, assume non seulement la gestion stratégique mais aussi la gestion opérationnelle du service» (Guglielmi, 1996). Ainsi, le personnel est recruté directement par la personne publique, et le statut des fonctionnaires est réglé par la loi (Weber, 1921, p.589). C’est la loi qui confère au fonctionnaire une compétence sur un domaine, lui attribue un pouvoir qui peut être d’ordre légal. Dans l’école du service public, les finalités publiques sont fixées par les politiques, il s’agit de mettre en œuvre à travers le travail de fonctionnaires spécialisés : selon Laufer (1985), il s’agit du savoir nécessaire à la mise en œuvre de ces fameuses fins.
Cependant, il existe aussi des contrats d’affermage (ou de régie affermée), lorsque la collectivité finance les investissements de type génie civil qui sont exploités par un délégataire, qui peut être une personne morale de droit privé (Nakhla et Breuil, 2005) : ceci correspond à une concession de l’exploitation d’actifs demeurant la propriété de l’État. Cette modalité – délégation des activités d’exploitation seulement – traduit la possibilité de décorréler ce qui relève de la gestion – ici l’exploitation – d’un service public) du caractère public de l’organisation qui le réalise.
Selon Chevallier, ceci a conduit à une « transformation profonde des modes de gestion » qui a accompagné l’expansion des service public (p. 135), où on s’est surtout éloigné de la formule «traditionnelle» de la régie directe.
La décorrélation entre le service public et la personne morale Dès 1912, un arrêt du Conseil d’État reconnaît pour les personnes publiques la possibilité de contracter sous l’empire du droit privé, comme un particulier (CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges). Ainsi, il n’est pas suffisant qu’une organisation soit « publique », c’est-à-dire appartenant statutairement à l’État, pour que le droit public s’applique.
Le 22 janvier 1921, le Tribunal des conflits dégage, dans sa décision portant sur la société commerciale de l’Ouest africain la notion de service public industriel et commercial (SPIC), géré pour l’essentiel dans les conditions du droit privé. Cette notion a été par la suite grandement utilisée pour savoir quelle juridiction était compétente pour trancher les litiges soulevés: administrative ou judiciaire ? Notons que s’est alors posé la question de la nature du droit s’appliquant à un service dans son ensemble – et non à une décision de gestion en particulier, qui aurait pu faire l’objet du litige selon Bernard Stirn (2017).
Par la suite, le Conseil d’État décide que la qualification de service public industriel et commercial peut être accordée par la loi ou identifiée par le juge. Enfin, le conseil décide, dans un arrêt de 1935, que, réciproquement, une personnalité morale constituée en droit privée peut, elle, gérer une activité qui est reconnue de service public. En d’autres termes, l’État peut se comporter comme un acteur économique comme un autre, évoluant sur des marchés concurrentiels ; les acteurs privés peuvent eux fournir des services qui relevaient précédemment de la prérogative de l’État. Ainsi, si «le temps de la parfaite unité est loin». (Discours de Bernard Stirn, 2017), on continue de penser le service public comme étant assuré par deux grands ordres – l’État et le marché.
|
Table des matières
Introduction générale – L’entreprise à mission, un cadre qui interroge l’entreprise de service public
I. Motivations empiriques et théoriques : le rapprochement entre entreprise à mission et
entreprise de service public
II. Problématique et questions de recherche
III. Méthodologie de recherche
IV. Synopsis de la thèse
Chapitre préalable : une relecture des différentes approches du concept de purpose
I. Le purpose de Barnard et Selznick : un objet de gestion idéal et responsable
II. Les critiques adressées au purpose : une transformation des enjeux de coordination et de cohésion
III. Années 1990 – la réapparition du purpose dans le champ de la rationalité managériale
IV. Quels enseignements pour le concept de raison d’être ?
V. Conclusion : quelles perspectives pour la mission de l’entreprise de service public ?
Partie I – Les cadres théoriques du service public : l’entreprise masquée par l’État et le marché ?
Chapitre 1 – Les théories juridiques du service public : l’énonciation de principes de responsabilité de l’État
I. Le service public comme fondement de la responsabilité de l’État
II. Un régime spécial de la responsabilité publique ?
III. Le modèle de la bureaucratie Wébériennne : une gestion par les normes du service public
Chapitre 2 – Les théories économiques du service public : la consécration du modèle du cahier des charges
I. L’entreprise de service public comme réponse à une défaillance de marché
II. Les instruments de la régulation européen : une consécration du cahier des charges
III. Les réformes du New Public Management : l’entreprise de service public, un acteur de marché comme un autre
Chapitre 3 – La gouvernance du service public : l’absence de cadre unificateur de l’entreprise de service public
I. La gouvernance par le recours au droit public
II. La gouvernance par le contrat de service public
III. La gouvernance par le capital public : l’entreprise publique
Chapitre 4 – La recherche en management public : la mise en lumière des défis de gestion du service public
I. Le dépassement du critère de productivité : des enjeux plus abstraits de service public
II. La Nouvelle Gouvernance Publique : un service public démocratique ?
Conclusion de la Partie I
Partie II – La qualification des dynamiques de création collective de l’entreprise de service public
Chapitre 5 – La construction du cadre de gouvernance de La Poste : une hybridité masquée qui oppose la réalisation d’un service connu et des dynamiques d’exploration
I. L’entreprise de service public, construite sur des logiques d’État et de marché
II. La recherche d’une autonomie de gestion nécessaires au développement des compétences
de l’entreprise
III. Le passage au droit privé : l’entérinement de la mission comme un service public donné
IV. D’une hybridité à l’autre : un schisme entre les activités connues et à concevoir
Chapitre 6 – L’analyse de l’évolution des missions de service public de La Poste : une dynamique d’expansion des objets et des parties
I. Un développement en lignée des compétences de l’administration des Postes
II. Le déploiement d’une gouvernance de l’innovation
III. Analyse de la formulations des missions contractuelles de 1991 à aujourd’hui : une générativité croissante des missions
Chapitre 7 – L’analyse des initiatives sociales et environnementales de La Poste : une réinterprétation, en local, des responsabilités de l’entreprise
I. Approche méthodologique : une rétro-conception de deux initiatives sociales et environnementales
II. Analyse de la rétro-conception de deux initiatives sociales et environnementales : cinq raisonnements de conception
III. Discussion : une réinterprétation en local de la responsabilité de l’entreprise, au-delà de la recherche de rentabilité
Conclusion de la Partie II
I. Une exigence d’ « accessibilité pour tous » au cœur des explorations de l’entreprise
II. La constitution de nouveaux potentiels pour un service public futur
III. Une illisibilité de la direction d’exploration de l’entreprise de service public
Partie III – La raison d’être : la construction d’une identité « reliée » de l’entreprise de service public
Chapitre 8 – A travers la raison d’être, un questionnement sur l’identité de l’entreprise
I. Des entreprises de service public aux configurations variées
II. Les enjeux de la raison d’être : réintégrer une logique d’entreprise
III. L’exercice de définition de la raison d’être : un questionnement identitaire
Chapitre 9 – La raison d’être comme instrument d’une nouvelle « identité reliée » : un ancrage des explorations dans les mutations de la société
I. Première méthode de définition de la raison d’être : la quête de traits identitaires fondamentaux ?
II. Seconde méthode de définition de la raison d’être : qualifier en quoi les mutations actuelles
de La Poste font sens
III. La raison d’être ou l’expression d’une identité reliée
Chapitre 10 – Les apports théoriques potentiels de l’ « identité reliée »
I. L’identité reliée et l’identité organisationnelle
II. L’identité reliée et le néo-institutionnalisme
III. L’identité reliée, un recouplage particulier des dimensions idéale et responsable du purpose
Conclusion de la Partie III
Conclusion générale – La mission, un cadre possible pour l’entreprise de service public ?
I. Principaux résultats de la thèse
II. Limites de la recherche
III. Perspectives de recherche
Bibliographie
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet