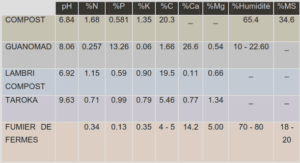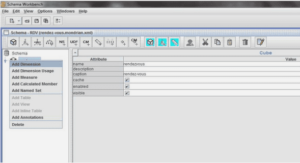Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
PLAN DU TRAVAIL
La partie 1 montre comment la catastrophe s’envisage à la fois comme un produit du social et comme une production de lien social et ce, en étudiant en détail les formes d’interactions et de sociabilité observées durant le temps court de la catastrophe avec l’hypothèse rappelons-le que cette sociabilité est à la fois présente avant, créée pendant et maintenue après la catastrophe. Les chapitres 1 et 2 distinguent respectivement cette production réflexive au niveau collectif et au niveau individuel, ce dernier étant l’objet spécifique de ce travail. Les parties 2 et 3 présentent les résultats obtenus à partir de l’analyse des textes. La partie 2 traite de la manifestation de l’ « extraordinaire » de la catastrophe dans les interactions quotidiennes, avant-pendant et après la réalisation de l’événement. La partie 3 développe une réflexion sur une forme particulière et caractéristique des interactions de catastrophe, le secours, à travers sa réalité vécue et perçue. Ce vécu est analysé en fonction de différents régimes d’entraide, endogène ou exogène, et distingués à la fois par la rationalité des objectifs et des réactions et par l’adaptabilité des « normes de l’aide » au terrain. Enfin, la conclusion s’attache à brosser un portrait de la sociabilité événementielle étudiée ici à partir des témoignages des contemporains des inondations du bas Rhône entre 1755 et 2003.
La mémoire des catastrophes
Les événements se vivent puis se gardent en mémoire ou s’oublient selon une destinée qui leur est propre (DUCLOS, Quand les pouvoirs bégaient : la catastrophe et nous, 2005). Leur portée sociale s’évalue selon le temps individuel de l’acteur ou le temps historique de sa société d’appartenance. Nous allons nous intéresser dans ce paragraphe à la portée sociale historique de l’événement catastrophique, sa portée individuelle étant abordée dans le chapitre 2. Une distinction donne à mieux comprendre la manière dont une société conserve « la mémoire collective » d’un événement à une époque donnée : l’opposition entre les notions de réel et de virtuel. Aujourd’hui, et notamment dans le cas des inondations dans le bas Rhône, le passé fait l’objet d’enjeux idéologique et économique dans la gestion du risque, marquant « la passion collective d’un retour au passé dans nos sociétés post-modernes » (JEUDY, Mémoires du social, 1986) . Les populations actuelles sont appelées à se souvenir d’un risque qu’elles n’ont pour la plupart pas vécu, et ce souvenir d’un passé virtuel doit les amener à mieux réagir face à l’inondation future, dans sa prévention comme dans son déroulement. Ce passé virtuel est un héritage dont il faut se souvenir : l’oubli se retrouve porteur de valeurs mettant à mal une « éthique du souvenir » (MARGALIT, 2006). Cette volonté de conserver les traces écrites ou orales des événements s’accompagne de l’existence d’institutions comme les archives ou les musées et d’outils de classification des documents. Nous en présenterons ici un exemple toujours à propos de la mémoire des inondations du Rhône.
Mémoire identitaire et mémoire opérationnelle56
Les inondations ne sont pas abordées de la même manière lorsqu’il s’agit d’épisodes récurrents qui font l’objet d’une gestion collective (limitation de la vulnérabilité, protection des biens matériels, savoir-faire municipal pour les interventions auprès des habitants etc.) ou lorsqu’il s’agit d’épisodes survenant à l’improviste alors que la protection semblait assurée par des ouvrages récents. La mémoire des inondations passées diffusées comme à Caderousse par l’école, des émissions de télévisions et de nombreux ouvrages, n’a pas empêché la population d’être prises au dépourvu en 2002 et surtout en 2003. Il semble que la « mémoire opérationnelle » qui servait à combattre l’inondation et à en minorer les effets ait été perdue, en témoigne cet adjoint au maire de Caderousse : Alors c’était une inondation un peu particulière en 2002 parce que nous n’avons pas été inondés par le Rhône, nous avons été inondés par la Meyne qui vient d’Orange. Donc c’était une inondation un peu particulière parce que c’étaient de très fortes pluies. Egalement, ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que l’on était nouvellement élu… alors cela c’est très important parce que bon on n’était pas non plus au courant de… vous savez que l’on a un système de vannes… Donc déjà ces vannes n’étaient pas en très bon état, je pense qu’il y avait autant d’eau qui entrait que d’eau qui sortait et nous avions aussi un système de pompage un peu défectueux, il n’était pas approprié avec cet épisode cévenol parce qu’il ne faut pas oublier que c’était un épisode cévenol. Donc le dimanche on a eu énormément de pluie, on a réussi quand même… bon on ne s’inquiétait pas trop parce que bon on était un peu… et le lundi alors là cela a été vraiment catastrophique parce que là on était inondé par la Meyne et avec ce qui tombait malheureusement on a essayé par beaucoup de moyens d’étancher plus ou moins bien avec des sacs plastiques surtout la vanne qu’il y a au sud de Caderousse, et on s’est aperçu voilà malheureusement qu’il y avait 70 centimètres d’eau dans le village, dans tout le village, sur les cours il y en avait partout. Donc nous on était un peu perdu. »57
La mémoire opérationnelle est basée sur la mémoire individuelle et collective dans le cadre de la famille et de la société environnante. Elle est adaptée à des événements dont la périodicité est à l’échelle de quelques années. Des différences peuvent exister selon les endommagements prévisibles qui dépendent de la situation des biens et des personnes par rapport à l’inondation, le niveau de richesse peut donc être un facteur important. Dans ce cas de figure d’une mémoire liée à la fréquence du phénomène, il peut y avoir une gestion de l’inondation qui s’appuie sur une gestion préalable de la vulnérabilité afin de diminuer les endommagements probables. Certains épisodes peuvent prendre l’allure d’une « catastrophe » lorsqu’ils dépassent les capacités de résilience du système mis en place. Les techniques de gestion de l’aléa sont alors insuffisantes et les endommagements sont considérés comme insupportables dans le cadre habituel de la gestion de l’évènement. Cette mémoire opérationnelle est souvent une caractéristique de zones inondables jusqu’à des périodes plus ou moins récentes, et dépend des aménagements de protection et des changements dans la fréquence des inondations. Elle dépend également de l’évolution des activités économiques et des usages des sols sous l’influence notamment de l’urbanisation dans la périphérie des villes et villages. La transmission peut ne pas être assurée du fait du renouvellement des populations. Elle peut également s’estomper si l’aléa paraît cesser d’être une menace, par exemple à la suite de la construction d’aménagements de protection et d’une baisse de la fréquence des inondations.
La mémoire des inondations disparaît, s’affaiblit ou cesse d’être « opérationnelle » lorsqu’elle n’est plus réactivée par des épisodes d’inondation. La croyance en l’efficacité de nouveaux aménagements, amplifiées par la confiance accordée à la maîtrise toujours plus grande des techniques peut rendre obsolète en peu de temps les connaissances pratiques liées aux inondations. La mémoire peut alors devenir une mémoire identitaire, basée sur des évènements anciens qui ne concernent plus directement la vie des contemporains, et attachée au lieu, se confondant avec une connaissance livresque ou actuellement télévisuelle. La mémoire cesse alors d’être opérationnelle. Paul Ricoeur distingue deux types de mémoire pouvant caractériser la mémoire identitaire. Il y a tout d’abord la « mémoire manipulée » qui est l’un des abus politiques et intellectuels de l’idéologie ou la «mémoire obligée » c’est-à-dire une assignation à un devoir de mémoire par l’Etat ou des groupes d’appartenance (RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 2000). Cette injonction à la mémoire d’événements créée bien plus que des « souvenirs communs » à l’ensemble des acteurs de l’événement : elle créée des « souvenirs partagés » par l’ensemble des individus de la société en question par un procédé de diffusion et de communication porté par les institutions autour du souvenir commun, c’est-à-dire autour de l’expérience des acteurs de l’événement (MARGALIT, 2006). Ici encore, le récit est le porteur historique de l’action particulière et localisée.
Les inondations récentes dans la région du bas Rhône ont constitué une catastrophe et ont surpris les habitants. Notons que ces évènements nouveaux ont créé une « mémoire traumatique » chez de nombreux habitants, mémoire assimilable à la mémoire empêchée » qui, selon les mécanismes décrits par Freud et transposés par Ricœur au plan collectif, est une mémoire blessée, traumatisée, à laquelle il faut un long travail pour éviter les répétitions que produisent trop de refoulement ou trop de commémoration, mauvaise conscience ici, délectation morose là. Les épisodes récents d’inondation ont remis en cause, d’une part les systèmes de protection dans lesquels la population avait placé sa confiance, et d’autre part ont inscrit dans la mémoire des personnes des souvenirs dramatiques, parfois amplifié par le retour des inondations à peu d’années d’intervalles. Ainsi le questionnement autour de la mémoire des inondations nous amène à nous intéresser aux émotions et à la manière dont elles agissent sur la mémorisation de l’événement. En effet, le moment de l’inondation est un moment émotionnellement fort parce qu’il provoque des dégâts, aussi bien matériels qu’humains. Au traumatisme révélé par le syndrome de stress post traumatique s’ajoute une fixation particulière des souvenirs d’un événement de vie marquant dans une mémoire émotionnelle (White et Robert McDonald, 2002). Une des manifestations de cette mémoire est le souvenir-flash qui correspond à un rappel vivace et détaillé des circonstances dans lesquelles nous avons pris connaissance d’un événement émotionnellement fort comme l’attentat contre les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001.
LES CATASTROPHES ET LEURS HOMMES62
Quels que soient le paradigme explicatif ou la signification collective de la catastrophe, force est de constater que les populations vivent, ont vécu et continueront vivre des événements de cette nature (WALTER, 2008). Ces derniers mobilisent l’ensemble des sociétés qui les subissent et se pose ainsi la question de l’organisation des groupes et des collectivités face à des situations extrêmes. Deux problématiques peuvent être envisagées : la première interroge la capacité de la crise à briser le lien social ou en tout cas à désagréger une communauté humaine et la seconde interroge la capacité des structures sociales à intégrer et à contrôler les états de stress collectif (DUCLOS, La construction sociale des risques majeurs, 1987). Nous nous situons ici dans la deuxième approche, la première d’inspiration anomique durkheimienne reflétant plutôt comme nous l’avons vu au chapitre précédent un préjugé des situations catastrophiques plus qu’une réalité observée, certaines études psycho-sociologiques montrant qu’il n’existe pas plus de manifestation d’hystérie ou de retrait au moment des catastrophes qu’en situation ordinaire (DUCLOS, La construction sociale des risques majeurs, 1987). De plus nous privilégions une sociologie pragmatique à une sociologie critique en définissant le lien social de catastrophe comme une interaction plutôt que comme une pratique, c’est-à-dire en envisageant plutôt un social en train de se faire qu’un social déterminé. La catégorisation sociale classique n’est pas totalement performante selon nous pour expliquer les comportements observés lors des catastrophes, sachant que la microsociété de crise observée à ce moment-là possède rappelons-le des caractéristiques de fonctionnement qui diffèrent de l’organisation ordinaire. Le cadre théorique retenu s’appuie sur le programme sociologique d’Erving Goffman : Il nous faut identifier les modèles et les suites naturelles de comportements qui apparaissent à chaque fois que des personnes se trouvent immédiatement en présence les unes des autres. Et il convient d’étudier ces événements comme un objet d’étude en soi… -…- Dans ce livre, je pose en hypothèse qu’une étude convenable des interactions s’intéresse, non pas à l’individu et à sa psychologie, mais plutôt aux mutuellement en présence. -…- Nous en appelons ici à une sociologie des circonstances. L’organisation sociale en est le thème central, mais la matière organisée est faite de conjonctions de personnes et des interactions temporaires qui peuvent y prendre naissance. Il y a bien une structure stabilisée par des normes, une « réunion sociale », mais il s’agit d’une entité mouvante, nécessairement évanescente, créée par les arrivées et supprimée par les départs. -…- Ainsi donc non pas les hommes et leurs moments ; mais plutôt les moments et leurs hommes »63
D’où l’hypothèse d’un lien social de catastrophe adaptatif répondant à une contingence déterminée (KAUFMANN & QUERE, 2001), c’est-à-dire d’acteurs s’adaptant à l’événement plus selon la situation nouvelle engendrée par la catastrophe qu’en fonction d’appartenances sociales collectives préalables. Si la population jouait simplement son rôle de victime et si les secours appliquaient à la lettre les directives gestionnaires, le théâtre de la catastrophe serait totalement prévisible, ce qui évidemment ne correspond pas à la volatilité des comportements et à la difficulté à gérer les crises décrites lors des retours d’expériences.
Une foule indexée
Pourquoi « se mettre ensemble » ? Comment penser l’agrégation d’individus ? Quel sont leurs supports sociaux ? Quels sont les critères dont il faut tenir compte pour définir un ensemble social cohérent en son sein et différencié des autres ? Telles sont les principales interrogations lorsque l’on veut étudier les groupes d’individus.
Le temps de la catastrophe est par définition ponctuel et ne se prête pas a priori à une transposition précise des caractéristiques générales des groupes qui se manifestent plus dans la régularité de la vie sociale quotidienne que dans l’exceptionnalité d’un quotidien extraordinaire. Pourtant les liens sociaux de catastrophe émanent eux aussi de structures d’individus animées par des interactions et des relations réciproques.
Et loin d’être un frein à l’analyse des collectifs, nous estimons que la nature Idem pour cette citation événementielle de la catastrophe va permettre de mieux déterminer l’émergence et l’évolution dans le temps d’un lien social particulier.
Nous allons commencer par exposer une typologie se voulant exhaustive des regroupements d’individus. La définition des différentes structures de groupe vont ici nous aider à déterminer la nature et le fonctionnement du « collectif de catastrophe » constituant la microsociété de crise créée lors d’un événement extrême. Ensuite, nous verrons comment la ponctualité de la catastrophe appelle à prendre en compte la situation sociale interactionnelle du collectif étudié et à tenir compte de sa temporalité dans l’évolution même de la structure des interactions observées.
Le collectif de catastrophe
La notion de groupe, définie comme un regroupement de personnes, n’apparaît qu’au XVIIIe siècle dans la langue française (ANZIEU & MARTIN, 1969). A l’interface entre l’individuel et le collectif, ce concept intéresse particulièrement la psychologie sociale et notamment l’un de ses fondateur Kurt Lewin. Il définit le groupe comme « un tout différent de la somme de ses éléments » et qui se caractérise par l’interdépendance dans un premier temps de ses membres bien sûr mais aussi de ses buts ; ses valeurs ; ses normes ; ses modalités de communication et de commandement ; et enfin du rôle et du statut des participants (LEWIN, 1948). Ainsi, les interactions directes ou indirectes entre les membres obéissent à des règles particulières, créant par la même occasion la conscience d’appartenance commune à un tout (MERTON, Eléments de théorie et de méthode sociologiques, 1950).
La temporalité du lien social de catastrophe
Le courant ethnométhodologique repose essentiellement sur deux principes. Le premier est que toutes les pratiques, même les plus minimes, sont équivalentes et significatives en termes de production de la vie sociale. Le second est qu’il faut être attentif aux phénomènes tels que décrits par les acteurs en suivant les trois propriétés des pratiques qui les rendent compréhensibles au chercheur : la réflexivité, la descriptibilité et surtout l’indexicalité (COULON, 1992). En effet l’individu racontant son vécu d’un événement construit durablement son action par le récit66 (WHITE, 1992) et en même temps décrit les échanges qu’il a eu avec son environnement social ce moment-là, en exposant son comportement dans un réseau de relations locales et particulières à sa situation. Or l’indexicalité de son action, marquée nous venons de le voir par la pluralité d’acteurs et de situations possibles, est aussi changeante, les mêmes acteurs et les mêmes situations évoluant au fil du déroulement de la catastrophe. Ces actions situées ont donc une temporalité, ce qui modifie la structure du collectif de catastrophe et appelle à s’interroger sur la persistance de ce lien social particulier.
La résilience d’urgence ou le temps de la solidarité
La littérature sur les désastres fait généralement appel au concept de solidarité pour qualifier le fonctionnement des groupes dans l’urgence de la catastrophe67. Nous proposons ici d’élargir cette approche en développant le concept très usité dans la pensée autour du risque, celui de résilience et en définissant dans un premier temps une sorte de résilience par la cohésion propre à ce moment de la catastrophe. La résilience décrit en général « la capacité de l’individu de faire face à une difficulté ou à un stress importants, de façon non seulement efficace, mais susceptible d’engendrer une meilleure capacité de réagir plus tard à une difficulté. » (MANGHAM, 1995). Elle est donc envisagée comme l’habileté individuelle de résister aux effets négatifs des vulnérabilités internes et environnementales (ALLEN, 1998). Elle se manifeste par des attitudes de faire-face et le sentiment d’être sorti grandi d’une épreuve avec l’hypothèse que les traumatismes révèlent les capacités d’adaptation de l’individu aux difficultés de la vie (CYRULNIK, 2000). La résilience s’explique par quatre catégories de facteurs : individuels, familiaux, communautaires et sociétaires. Ainsi la microsociété de crise, dans sa temporalité immédiate c’est-à-dire dans la situation d’urgence à proprement parler, peut représenter la forme sociale par laquelle les individus trouvent un moyen de se maintenir en faisant appel surtout à la famille et aux proches. La solidarité constitue alors le support principal des interactions.
L’acteur peut décrire ses actions (principe de descriptibilité) ce qui permet par la même de prendre du recul par rapport à ses actes (principe de réflexivité).
De ce fait, les groupes sociaux peuvent alors se définir comme des systèmes qui intègrent, domestiquent et socialisent le désordre qu’entraîne une catastrophe, considérée comme une perturbation extérieure venue de l’environnement par exemple (MORIN, 1994 [1984]). Nous l’avons déjà dit, cette microsociété de crise (DUCLOS, La construction sociale des risques majeurs, 1987) se fonde en partie sur une rupture des distinctions sociales préexistantes et se distingue par une activité qui n’est pas coordonnée en vue de réguler la communauté en général, mais simplement de subvenir aux besoins immédiats du groupe. Les premières causes justifiant son apparition sont le partage d’une menace commune concernant la survie, la souffrance commune produite par la catastrophe, et les besoins humains communs. Ses manifestations sont la générosité, l’altruisme, l’aide spontanée (FRITZ & WILLIAMS, 1957). Une forte cohésion sociale peut aussi, dans certains cas favoriser la mise en place d’une sorte de réseau d’alerte local (RUIN & LUTOFF, 2004). Les liens familiaux constituent le vecteur principal de l’entraide, considérée comme une nouvelle fonction de la famille étendue (QUARANTELLI, A Note on the Protective Function of the Family in Disasters, 1960). Les autres sphères de la solidarité sont la sphère des amis et la sphère « publique » (État, Armée, Église, Associations caritatives) pour l’hébergement, l’aide à la reconstruction, la distribution de vivres, la contribution financière, distribution de matériel de nettoyage… Cette forme d’organisation spontanée a pour effet une récupération sociale et personnelle des individus sinistrés, les motivant pour participer aux actions de secours et de soutien, les intégrant ainsi à une organisation sociale stable.
Après l’événement et sans une menace persistante de nouveau sinistre, la solidarité tend à s’effacer progressivement. Le processus de différentiation revient et les standards de référence changent les valeurs de survie en valeurs de continuité et de stabilité, mais ce changement est toutefois inégal selon les pertes et le degré de destruction des biens. Les personnes ne se situent plus dans un présent immédiat et pensent à plus long terme : les conflits peuvent alors apparaître.
|
Table des matières
INTRODUCTION
CADRE ET ENJEUX DE LA RECHERCHE
PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
METHODOLOGIE
PLAN DU TRAVAIL
PARTIE 1. QUAND LA CATASTROPHE FABRIQUE DU SOCIAL ET VICE-VERSA PREAMBULE
INTRODUCTION
CHAPITRE 1. LES « META-CATASTROPHES »
CHAPITRE 2. LES CATASTROPHES ET LEURS HOMMES MODELISATION DES INTERACTIONS PENDANT LES CATASTROPHES
PARTIE 2. LE QUOTIDIEN FACE A LA CATASTROPHE OU LA MANIFESTATION DE L’ « EXTRA » ORDINAIRE DANS LES INTERACTIONS
INTRODUCTION
CHAPITRE 3 : L’INONDATION VECUE
CHAPITRE 4 : LA SOCIABILITE D’INONDATION
EVOLUTIONS HISTORIQUES D’UNE SOCIABILITE TEMPORAIRE
PARTIE 3. L’ENTRAIDE FACE A LA CATASTROPHE OU LA REALITE VECUE DU SECOURS ET DE LA SOLIDARITE
INTRODUCTION
CHAPITRE 5 : L’INONDATION ORGANISEE
CHAPITRE 6 : LES REGIMES INTERACTIONNELS DE L’ENTRAIDE
CONCLUSION : UN PORTRAIT DE LA SOCIABILITE EVENEMENTIELLE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet