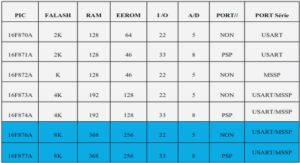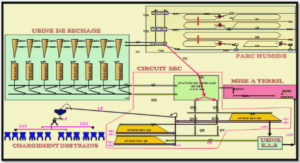« La pourriture, l’infection, dans les rues » : les lieux de la misère.
« La ville de Brest est en train de justifier mieux que jamais son surnom de « pot de chambre de la France ». Partout c’est la pourriture, l’infection, dans les rues et les coins des places, le long de promenades. Personne ne s’occupe d’empêcher le dépôt d’ordures dans les endroits indus, personne ne s’occupe de faire le nettoyage, personne ne s’occupe davantage des urinoirs publics dont le trop plein déborde sur les trottoirs. » En 1918, Le Courrier du Finistère dénonce la situation de la ville de Brest, envahie par la pourriture. Pour le quotidien, c’est une « ville sale, abandonnée sous tous les rapport». Au sein des cités de l’Ouest de la France, la presse s’inquiète de l’existence de poches de pauvreté et de leurs conséquences. Elle souligne ces bas-fonds qui se distinguent par le dénuement de leurs habitants, leur délabrement, les risques sanitaires qu’ils représentent pour la ville et sa population. L’article du quotidien brestois révèle une préoccupation partagée par les observateurs sociaux, les municipalités, et reprise dans la littérature. L’étude de ces textes permet de mettre au jour les lieux de pauvreté et de misère. Ils sont une caractéristique des grandes villes. Les récits démontrent principalement leur présence à Saint-Malo, Brest, Lorient et Nantes. Ils existent en parallèle à une image noire des campagnes de l’Ouest, englobant les petites cités de cette région. Dès 1826, Étienne de Jouy dénonce la marginalisation de Recouvrance par les habitants de Brest. Après avoir stigmatisé la population de la classe inférieure, « laide et malsaine », il valorise les habitants du quartier : « Les habitants de Douric et de Recouvrance, séparés seulement par une rivière sont d’un aspect plus agréable ; leurs formes sont moins disgracieuses, et leurs vêtements ne portent pas l’empreinte de la misère ; cependant les habitants de Brest les traitent avec une comique supériorité que rien ne me parut autoriser. » Sa description témoigne de la pauvreté des habitants, même s’il la relativise. Elle démontre surtout le sentiment de supériorité de la part des Brestois envers leurs voisins de l’autre rive et l’image négative qui les englobe. Recouvrance, quartier de Brest sur la rive droite de la Penfeld, apparaît comme une poche de pauvreté, digne du mépris de ses contemporains. En 1835, André Guépin et Eugène Bonamy enquêtent dans les bas quartiers nantais, et définissent les « rues riches et rues pauvres». Leur objectif est de « pénétrer un peu dans l’existence des diverses classes qui composent la population de Nantes. » Pour cela ils veulent étudier « le milieu où chacune d’elles s’agite avec plus ou moins de bonheur. Cherchons à connaître ses logements, sa nourriture, ses joies, ses peines, ses abus, ses privations, et voyons quelle influence ces conditions d’existence peuvent avoir sur la santé. » Leur inquiétude envers les espaces de la pauvreté est liée aux effets qu’ils ont sur les hommes. Les deux médecins enquêtent sur des rues du centre, notamment le quartier du Marchix, la rue des Fumiers et la rue de la Bastille dont l’insalubrité est la cause d’une plus grande mortalité. Les lieux menacent les habitants et présentent des risques pour l’ensemble de la ville. C’est dans cette logique qu’ils veulent les combattre. L’angoisse sanitaire est l’élément principal qui établit l’existence des bas-fonds. Elle est particulièrement présente pendant la première moitié du XIXe siècle et constitue le seul critère déterminant des mauvais lieux des villes de l’Ouest. En 1849, le docteur Bonamy signale au maire de la ville les foyers potentiels d’épidémie de variole et de choléra à Nantes. Il met en évidence un espace circonscrit, habité par les migrants bretons installés en ville: « Nous devons noter, avant tout, que le lieu choisi par l’épidémie pour son premier siège a été le même en 1832 et en 1849. Le quartier assez circonscrit comprenant la rue de la Piperie, la Grenouillère de Chantenay, le quai d’Aiguillon, les rues de l’Hermitage, Baco, des Perrières, les Garennes, les grands jardins de l’Hermitage, est habité généralement par une population indigente, mal nourrie, mal vêtue, mal logée. » La crainte envers ces poches de pauvreté se double d’une dimension xénophobe. A Brest, le quartier de Recouvrance se marginalise. Il accueille une importante population d’origine bretonne, constituant presque un groupe indigène au sein d’une ville française. En 1851, la commission nantaise pour l’assainissement des logements insalubres établit un lien direct entre les risques sanitaires et la provenance des habitants. Les lieux d’immigration deviennent les bas-fonds des villes : « […] nous devons le reconnaître, nos espérances se décourageraient si les quartiers misérables, dont nous poursuivons l’assainissement, devaient être régulièrement infectés, le mot n’est pas trop fort, par ces invasions de mendiants qui nous viennent des campagnes de Bretagne10. » A Lorient, la municipalité incrimine également le manque d’hygiène de la ville comme cause de l’épidémie de 1851. Elle dénonce « l’usage hideux de verser les déjections urinaires et autres dans les ruisseaux où elles croupissent » qui « font des rues de Lorient de véritables foyers pestilentiels. » En 1855, des lieux se dessinent comme foyers d’infections, « la mort est sélective socialement et géo-socialement » et « la rue de Brest, extra-muros, semble être un vrai mouroir. » La première moité du XIXe siècle est marquée par la primauté des quartiers pauvres et des populations « malsaines » dans la construction de bas-fonds qui n’en portent pas encore le nom. La menace sanitaire qu’ils représentent pour la ville en est le critère déterminant. Ces mauvais lieux sont les rues les plus misérables de la ville, celles du centre comme celles des quartiers spécifiques comme Chantenay et le Marchix à Nantes, Recouvrance à Brest, les rues extra-muros à Lorient. Dans la seconde moitié du siècle les références aux quartiers misérables augmentent. Le thème des bas-fonds rencontre le succès avec Les Mystère de Paris en 1842 et les romanciers mettent en scène le « troisième dessous » des « sociétés humaines13 ». Le phénomène, initialement parisien, s’étend aux villes de province. La littérature détermine à son tour les bas-quartiers des villes de l’Ouest. En 1866, quatre ans après Les Misérables, Victor Hugo décrit dans Les Travailleurs de la Mer une ruelle de Saint-Malo, qui n’existe plus depuis quarante ans : « C’était une double rangée de maisons de bois penchées les unes vers les autres, et laissant entre elles assez de place pour un ruisseau qu’on appelait la rue. On marchait les jambes écartées des deux côtés de l’eau, en heurtant de la tête ou du coude les maisons de droite et de gauche. Ces vieilles baraques du Moyen Age normand ont des profils presque humains. De masure à sorcière il n’y a pas loin. Leurs étages rentrants, leurs surplombs, leurs auvents circonflexes et leurs broussailles de ferrailles simulent des lèvres, des mentons, des nez et des sourcils. La lucarne est l’œil, borgne. La joue c’est la muraille, ridée et dartreuse. Elles se touchent du front comme si elles complotaient un mauvais coup. Tous ces mots de l’ancienne civilisation, coupe-gorge, coupe-trogne, coupe-gueule, se rattachaient à cette architecture. » Pour l’auteur, l’histoire des lieux est décisive et la référence au passé est déterminante pour leur singularisation. Ils sont le réceptacle des pratiques anciennes et d’acteurs issus de temps normalement révolus. La description de Saint-Malo construit l’image d’une cité de l’ancien temps, infestée par la pauvreté et les mœurs du Moyen Age. L’habitat est à l’image des hommes qui vivent en ces lieux. L’évocation des agissements de l’ancienne civilisation renvoie à la misère et aux dangers du monde médiéval autant qu’à l’identité de Saint-Malo, cité corsaire bretonne. L’histoire de la ville définit la spécificité des ses bas-fonds. Dans la continuité de l’œuvre de Victor Hugo, la littérature développe l’image de quartiers délaissés. En 1883 à Brest, Pierre Loti confirme l’image misérable du quartier de Recouvrance, situé face au centre de la ville, sur les rives de la Penfeld. Dans Mon Frère Yves, Pierre Loti décrit « les premières maisons de Brest et de Recouvrance » « d’où sortaient de petites fumées blanches ; elles criaient leur misère humide et froide, et le vent s’engouffrait partout avec un bruit triste. » Le lieu abrite les marins de l’État et les ouvriers du port, les classes les plus basses des gens de mer brestois. Cette différenciation est exacerbée par la littérature. A Nantes, René Bazin décrit en 1897 le quartier de Chantenay comme un ramassis de « masures » où « pullulent » de jeunes enfants : « C’était un monde étendu et incroyablement peuplé, que limitaient d’un côté la rue de l’Ermitage, de l’autre la ruelle du Roi-Baco. La première ligne de maisons, à peu près régulière, cachait un second plan de cours bâties, de masures étagées sur l’échine du coteau, entourées de jardins minuscules, défendues par des palissades, et où régnait toujours une odeur de lessive. Les vieux ne manquaient pas, les enfants pullulaient. Il y avait la population ancienne et aristocratique, occupant le quartier depuis un demi-siècle ou même davantage, et les colonies vagabondes que l’huissier lève et relance, comme un limier, de place en place dans le champ de misère des villes, troupe lamentable qui n’a point d’amis, qui n’a pas eu le temps de s’en faire et pas le temps d’en pleurer. » A partir des années 1860, la littérature définit les lieux des bas-fonds, ceux du centre aussi bien que les quartiers spécifiques des villes. Elle participe au développement de leur représentation en y associant des thèmes propres à cet imaginaire, l’humidité, la paupérisation des hommes, l’abandon et la tristesse. En parallèle, la crainte de la contagion perdure et la presse s’en fait le relais. En 1884, à Nantes, Le Phare de la Loire signale « les odeurs infectes » de la ville, rue du ChevalBlanc : « Il suffit de la traverser, sans même entrer dans les maisons pour sentir les plus malsaines exhalaisons de latrines19. » Le quotidien remet en cause la présence d’un dépôt de peaux, quai Penthièvre : « Il y a deux mois, la puanteur répandue dans tout le quartier par ce foyer d’infection devint tellement intolérable que les habitants résolurent d’en finir 20. » En associant manque d’hygiène et crainte du choléra, la presse dénonce ces foyers d’insalubrité. Journalistes et médecins continuent de s’inquiéter pour les quartiers pauvres : centres de contagion pour l’ensemble de la ville. Cette démarche se poursuit après la Première Guerre mondiale. En 1909, le docteur Alix constate les conséquences sur les habitants, de la vie dans les taudis du quartier de Kéravel dans le centre ville de Brest : « Anéantis, désespérés, ils prennent vite en dégoût leur foyer misérable et vont demander à l’alcool l’oubli de leur misère. L’alimentation de ces malheureux se réduit à quelques pommes de terre, parce que le salaire va presque en entier à l’assommoir. La tuberculose arrive et, trouvant un terrain tout préparé, moissonne l’un après l’autre, tous ces dégénérés. » En réaction, la municipalité entame dans les années 1925-1929, la construction d’un quartier d’habitations ouvrières à Kerigonan. A Lorient, les mesures ciblent les conditions de vie des ouvriers, notamment ceux de l’arsenal. Malgré cela les taudis demeurent à Keravel et Recouvrance au sein de la ville de Brest. Dans le Nantes de l’entre-deux-guerres, les craintes persistent envers les foyers de rougeole ou de dysenterie. Dans La Lèpre de Nantes, en 1925 le journaliste Pierre Rocher relativise le danger du quartier du Marchix tout en rappelant la source d’infection qu’il peut représenter : « N’exagérons rien, mais convenons qu’il y a pire taudis que ceux du Marchix. Le service d’hygiène a pénétré un peu partout et derrière lui l’eau courante. Nous sommes en effet à une époque où se laver est un signe de civilisation. Au 4… de la rue du Marchix, la carte indique que la tuberculose, la rougeole, la dysenterie ont fait des ravages. Le caniveau de la cour est rempli d’immondices. L’eau s’élève de chaque côté en flaques noires. » En 1924, un quotidien nantais constate qu’au cœur de la ville, il « reste toujours la vieille bicoque avec ses murs lépreux, sa cour sordide, ses draps et autres linges plus ou moins sales qui pendent aux fenêtres. » La misère urbaine, composante de l’imaginaire des bas-fonds, est régulièrement dénoncée par les observateurs sociaux. Elle s’appuie sur la figure du pauvre, objet romanesque mais également cible de l’enquête sociale. Cette dernière se préoccupe également des lieux qui l’abritent, cloaques au cœur des villes et quartiers miséreux. Dans l’entre-deux-guerres, la presse publie les investigations de ces enquêteurs « dans les quartiers les plus tristement réputés de la ville ». A Brest, La Dépêche, dévoile dans une série d’articles en 1921 « la misère qui se cache. » Les textes décrivent les habitations et les populations les plus vulnérables, les « mansardes à peine meublées » du centre sans forcément préciser leur localisation. Le quotidien distingue le quartier de Recouvrance : « La misère sévit partout, à Brest et dans ses faubourgs : mais nous signalons spécialement la détresse de Recouvrance… Si l’on veut (c’est pour ceux qui demeureraient sceptiques) si l’on veut toucher du doigt le fond de la souffrance aux formes diverses et infinies, c’est là qu’il faut aller, il faut (en plein jour) s’armer d’une lampe de poche afin de découvrir cette chose sans nom qui sert d’escalier et qui serait plutôt une sorte de casse-cou : il faut entrer dans une salle, basse, noire, qui prend jour sur une espèce de puits que l’on ne peut appeler cour : il faut aller visiter cet enfant malade qui souffre dans un recoin de l’atroce et unique chambre et qui n’a pas d’air parce que, à quelques centimètres de la fenêtre, on trouve la paroi d’un rocher qui suinte de l’eau. » En décrivant la descente dans les bas-fonds de la misère, l’article reprend des éléments constitutifs de l’imaginaire des cloaques de la pauvreté. Cette description et cette exagération servent leur dénonciation. Elles contribuent à détacher l’importance des bas quartiers de la ville de Brest, associés ici à celui de Recouvrance. En 1925, l’ensemble d’articles intitulé La Lèpre de Nantes détermine les taudis de la ville. Le journaliste décrit les lieux de misère du quai de la Fosse, du quartier Chantenay et de ses « Marches de Saint-Anne », surnommé « le grenier des miséreux », du quartier du Marchix. Ces cloaques apparaissent comme des vestiges de l’ancien temps. C’est le cas de la Vallée du Bois-Hardy, aux limites de Nantes : « C’est là à cinq cents mètres de la rue Chevreuil, dans la vallée tondue du Bois-Hardy, que le « village noir », image trouble et chancelante de cauchemar, assemble en deux camps séparés par un fossé et des ronces, une cinquantaine de baraques. Disjointes, affaissées, construites en planches que les pluies ont pourries, maçonnées de mâchefer creux, couvertes de carton goudronné ou de fer blanc, elles semblent avoir été renversées sur la tourbe du terrain par les tombereaux des boueurs, parmi les détritus et les immondices de la ville. C’est puéril, misérable, désespérant. » A la pauvreté est associée l’image d’une contre-société, peuplant ces lieux dangereux et misérables. L’endroit est humide, boueux, rempli d’immondices. L’enquête sociale définit les poches de pauvreté et leur perception comme bas-fonds. Leur évocation se double d’une dimension romantique. Pierre Rocher affirme s’aventurer « … Dans le Nantes des ruelles, des venelles, des passages, dans le Nantes des bas-fonds épris d’un désespérant romantisme, des gens se sont fait un trou à la manière des bêtes. » L’extrême misère n’est plus seulement associée à la maladie et à la contagion. La description relève aussi d’une dimension plus poétique. La littérature confirme la vision de ces lieux spécifiques au cœur des deux grandes villes de l’Ouest. En 1943, Gilbert Dupé décrit les habitations sordides du quai de la Fosse : « […] en s’arrêtant devant une bâtisse malsaine, pareille à une cave bâtie en hauteur. La porte semblait celle d’un égout. […] C’était ça l’asile, le repos de la terre. On y devait crever sans air et sans clarté. […] Ils trébuchaient dans l’escalier, jurant de manquer les marches usées, branlantes dans l’ombre moite qui collait à la peau . » La vision de l’auteur confirme la localisation et la représentation des lieux de pauvreté, humides et malsains. La fascination pour les bas-fonds entraîne le romancier à en reprendre les codes d’écriture et à développer l’image misérable des quartiers les plus pauvres. Dans l’Ouest de la France, leur existence augmente avec le développement de l’enquête sociale et la croissance des villes. L’inquiétude se déplace des espaces ruraux aux poches de misère des grandes cités. Les dénoncer obéit à des motifs hygiénistes, l’objectif est de sauvegarder la salubrité publique. C’est également une source d’inspiration pour les romanciers qui attire leur lecteur grâce à la fascination que cet univers exerce. L’ensemble de ces sources contribue à déterminer la localisation des endroits les plus misérables. Ceux-ci coexistent avec les lieux du vice et du crime. A la fin du XIXe siècle, le thème devient un motif commercial dans les quotidiens. L’objectif est de capter l’attention du lecteur en présentant la presse comme capable de dévoiler et combattre ces mauvais lieux. La dimension portuaire est quasiment absente malgré la présence de quartiers associés à l’identité maritime de la ville. Misère et débauche des marins sont dénoncées séparément par les observateurs de la vie maritime, souvent extérieurs aux villes bretonnes ou normandes.
Les ports de l’Ouest : de la misère aux bas-fonds
« les bas-fonds sordides de la ville230 ». En 1883, Pierre Loti associe dans Mon Frère Yves l’univers des bas-fonds et l’Ouest de la France, en l’occurrence la ville de Brest. Cette association se met en place au XIXe siècle, en dépendant d’un cadre général, celui de l’écriture des ports mal famés. Au début du XIXe siècle, les cités portuaires de l’Ouest occupent une place marginale dans le roman maritime. Dans l’imaginaire de la province, la représentation d’une région recluse, à la population déviante, domine. Cette « image noire » englobe l’ensemble de la province sans rupture nette entre population terrienne et maritime. Seuls, les îliens ou les naufrageurs se distinguent. Dans les écrits des voyageurs, les inquiétudes sur le comportement des marins et la tenue des ports transparaissent. Ces notations éparses traduisent une préoccupation réelle, mais secondaire. La vision orientée des auteurs s’attarde sur ces phénomènes dans le but de signaler un frein au progrès ou de vilipender l’Ancien Régime. Il en résulte les premiers éléments déviants propres aux ports bretons dans la littérature. A l’échelle de l’Ouest, ceux-ci sont surreprésentés. La Bretagne est une région intrigante pour les observateurs extérieurs, beaucoup plus que la Normandie, marquée par sa proximité avec Paris. La représentation des ports évolue pendant le XIXe siècle. Elle intègre les apports extérieurs, les images provenant du roman maritime français, américain et anglais et les codes d’écriture issus des mystères urbains. L’image de Brest décrite par Pierre Loti trouve ses origines autant dans les descriptions des cités bretonnes que dans les bas-fonds parisiens, rouennais, londoniens et new-yorkais. A la fin du XVIIIe siècle, le port attire l’attention des voyageurs et des observateurs de la province. L’intérêt pour le dynamisme qu’il représente n’occulte pas les craintes face au développement urbain. En 1780, pour Louis Desjobert, « la ville de Nantes est une des plus belles du royaume », particulièrement grâce aux maisons sur les quais. Mais il s’inquiète aussi pour l’insalubrité de la ville, la comparant aux maux que connaît Paris : « Il y a aussi, comme à Paris, d’anciennes rues et bien plus affreuses, entre autres, celle de la Poissonnerie dont les maisons sont hideuses et bâties en bois et de manière que le haut se touche presque, ce qui nuisait autrefois beaucoup au jour et à la salubrité de l’air. » Les quais ne constituent pas un motif d’inquiétude. Au contraire, l’auteur loue l’architecture qui leur est associée. Les préoccupations sont celles de la croissance urbaine et de ses maux qui deviennent, dans la comparaison avec Paris, un marqueur de progrès. A Brest, c’est le rôle économique du port et de ses aménagements qui est mis en évidence. La vision du quai est initialement positive, il est « marchand, presque toujours couvert de vins, d’eau-de-vie, des objets nécessaires à la consommation ; on y débarque avec facilité. » Mais l’auteur dénonce les défauts d’organisation, obstacles au dynamisme économique : « […] Il règne dans le port un embarras, une confusion, une malpropreté que les temps orageux, que la pluie continuelle augmente encore. Les querelles se multiplient sur les cales étroites et serrées. Les bâtiments pressés se touchent ; un incendie en dévorerait la presque totalité. » L’hygiène devient aussi une préoccupation et le port un foyer de pourrissement. Le voyageur souligne à Brest « la malpropreté générale des quais, où des copeaux de bois pourrissent sans que jamais on les enlève […]236 ». A Douarnenez, l’ordre fait défaut, on « laisse jeter sur les quais, dans les rues, les sardines pourries, des saumures corrompues ; il est impossible, même en hiver, de sentir des odeurs plus infectes que celles qu’on respire en approchant de la ville […] 237 ». Malpropreté, insalubrité et querelles ne sont considérées du point de vue pratique, comme obstacle au développement. Pour les observateurs les ports devraient incarner le dynamisme économique de la province bretonne. Les discours visent à dénoncer l’inefficacité de certains aménagements. Malgré les conséquences économiques de la politique internationale française au tournant du XVIIIe siècle, Brest et Lorient apparaissent encore comme des « villes champignons, qui se désolidarisent de la péninsule ». La modernité de leur développement suscite l’admiration des auteurs et voyageurs. Lors de son Voyage en France entre 1787 et 1790, Arthur Young distingue Brest, « ville bien bâtie, avec plusieurs rues régulières et belles », et remarque que son « quai, où il y a plusieurs vaisseaux de ligne, et d’autres navires, a beaucoup de ces mouvements et de cette activité qui animent un port de mer ». A Lorient, c’est l’urbanisme qu’il met en évidence. « La ville est moderne et régulièrement bâtie ; les rues partent en rayons de la porte, et sont croisées par d’autres à angles droits : elles sont larges et bien pavées, avec plusieurs maisons qui ont fort bonne mine ». Ces aménagements sont associés au dynamisme économique de la Compagnie des Indes, avec son port qui contient « tous les vaisseaux et magasins de la compagnie […]240 ». La représentation du port se construit dans la dualité, il est le signe du progrès autant que le révélateur de son retard. En parallèle de cette représentation des ports, les observateurs et les auteurs soucieux du modernisme s’alarment du comportement des marins. Leur présence devient un frein supplémentaire au développement économique et à la moralité. En 1794, Jacques Cambry s’inquiète de voir à Brest le nouveau quartier et les bâtiments qui cernent la place d’Arme, contraster avec « les rues étroites, obscures, infectes, toujours couvertes d’un pied d’ordures, qui font de Brest une des villes les plus sales de la République ». Brest, ville militaire se doit d’incarner la République. Les progrès de son urbanisme sont altérés par les ruelles « infectes » et le manque d’hygiène. Pour l’auteur, cette situation s’explique par le comportement des habitants de Brest et de la population de passage, conséquence de son rôle de cité portuaire : « Le désordre, l’ivresse habituelle des ouvriers, des matelots ; ce mélange de sang que l’Amérique, l’Inde, l’Afrique et l’incroyable dépravation des mœurs ont corrompu, ces excès, suivis d’une misère profonde ; l’absence de toute espèce de tenue, de moralité ; les maladies contagieuses dont les germes renouvelés ne sont jamais anéantis, dégradent au dernier degré l’espèce humaine dans cette commune et dans les campagnes voisines. Quelle forme, quelle pâleur, quel teint livide, quelle maigreur chez ces enfants presque nus, chez ces femmes ivres d’eau-de-vie ! Ajoutez à ces malheureux, cette multitude d’estropiés que la guerre dépose à Brest, et vous aurez l’idée, le tableau le plus vrai de la misère de l’espèce humaine […]242 ». Dans l’analyse de l’auteur ce sont les hommes qui affectent les lieux. Le caractère des matelots est la cause d’une misère humaine néfaste pour la cité. Ivresse, immoralité, excès à terre, Jacques Cambry ne dénonce pas tant les pratiques des marins que leurs conséquences sur Brest et ses environs. A leurs excès, s’ajoute la contagion morale des continents visités lors des traversées. Pour l’auteur, le marin porte en lui les germes de la perversion. Il affecte les femmes et les enfants de la ville. La figure du marin au port inquiète par les répercussions pour l’hygiène et la morale. Le Voyage dans le Finistère de Jacques Cambry préfigure les enquêtes sociales sur les villes et les ports, qui se développent au XIXe siècle. Par la présence des marins, les villes bretonnes deviennent également le territoire de l’illicite. A la misère et à l’immoralité se rajoutent les trafics de contrebande. Jacques Cambry constate le passé de Roscoff qui « était devenu l’entrepôt d’un commerce très considérable avec l’anglais. Des vaisseaux interlopes venaient avant la révolution y prendre des vins, des eaux de-vie, du thé, qui s’introduisaient en fraude en Angleterre. » Les faits tiennent plus de la description que de la condamnation. L’auteur ne s’étend pas sur les pratiques de fraude utilisées par les marins. Mais sa description associe le port aux « vaisseaux interlopes » qui viennent y chercher leurs marchandises. La vocation du port l’amène à accueillir des navires interlopes aux activités illégales. Cette dénonciation des mœurs maritimes et de leurs méfaits sur la ville et ses habitants revient régulièrement dans les écrits des observateurs. Pour Lavallée, en 1793, c’est le corps de la Marine Royale, qui sous l’Ancien Régime « régnait en souverain dans cette commune ». Par leur présence, Brest devenait « le séjour moralement le plus détestable pour un homme de bien. » : « Tout ce que l’insolence peut offrir de plus repoussant, l’immoralité de plus avilissant, le libertinage de plus révoltant, se réunissait pour en écarter l’homme vertueux. Il eût été également dangereux d’y conduire sa femme, ou sa fille, ou son fils : et les vices publics en défendaient l’entrée aux vertus privées245. »
« la vie sauvage » : les dangers du littoral
« […] nous rentrions dans la vie sauvage ». En 1847, lors de son Voyage en Bretagne Gustave Flaubert éprouve le sentiment de découvrir une « région primitive » loin de la « vie civilisée». L’atténuation de l’image noire bretonne n’empêche pas la persistance d’une vision péjorative. Elle se fixe sur les endroits reculés « où peuvent se voir tous les anciens usages, coutumes, superstitions, particularités et caractéristiques des populations isolées». Au sein de cet ensemble, le littoral se distingue. Majoritairement son influence est positive, il représente l’ouverture, les échanges et le développement économique. Pour Fortuné du Boisgobey, la terre est « encore barbare et pauvre », alors que la mer fait bénéficier de « ses richesse, ses débouchés, son commerce». Mais c’est aussi un lieu réputé pour accueillir « une peuplade avide et brutale», celle des naufrageurs. Au XIXe siècle, leur représentation est devenue « quasiment mythologique », ce sont « des pilleurs d’épaves attirant les navires en difficulté vers les roches dévastatrices, grâce aux feux trompeurs qu’ils allumaient alors. » Le succès de cette figure est concomitant à « l’âge d’or des grèves » et à l’obsession du naufrage qui l’accompagne. Le regard se focalise sur ces populations marginales, auréolées de récits légendaires et de coutumes barbares. Leur perception hérite de ces pratiques anciennes. Pour Émile Souvestre, en 1836, « Maintenant encore, c’est un spectacle curieux que celui d’un naufrage de nuit dans ces baies. » Les littoraux reculés portent le poids du mythe des naufrageurs. Cet héritage se structure à la fin du XVIIIe siècle, ravivé par les écrits de Jacques Cambry. Le rivage éloigné devient, par la présence de ces hommes misérables et criminels, un lieu potentiellement dangereux et immoral. Cette vision perdure dans la première moitié du XIXe siècle avant de s’estomper progressivement devant les effets de la modernité. Mais après cette date le littoral reste un objet de condamnations et de moqueries. Les héritages de l’image noire sont repris par des auteurs qui stigmatisent ces lieux et leurs habitants. En 1794, Jacques Cambry fournit le modèle de « l’impitoyable habitant de ces rives » qui « s’arme de crocs, de cordes, va se cacher dans les rochers pour y saisir ce que la mer transportera sur le rivage ; il attend sa proie, accroupi pour échapper à l’œil des surveillants. Jadis, il assommait le malheureux qui lui tendait les bras, en échappant au courroux des flots, il l’enterrait et le dépouillait sans pitié ; il est plus humain à présent, il accorde la vie, ne tue que rarement, mais il vole […]». Dans ses écrits, le rivage breton accueille une population inhumaine, des animaux « accroupis » pour guetter leur « proie ». C’est la caractéristique première des ces populations du littoral, leur humanité s’estompe de par leurs pratiques et leur mode de prédation. Par leur dénuement et la dureté de leur cadre de vie, ils incarnent les inquiétudes envers une population isolée, réticente au progrès et à l’ordre. Fortuné du Boisgobey explique ainsi « l’effroi qui s’attache » au nom de la baie d’Audierne à la pointe de la Bretagne : « […] tout ici est lugubre, tout parle de mort et de deuil : partout le ciel, l’eau et le sable ; […] J’ai fait plus de deux lieues sans approcher d’un être humain. On voit des têtes qui vous regardent au niveau de la levée de sable et disparaissent à votre approche. Certes j’ai compris la terreur des habitants qui racontent de sanglantes histoires d’assassinats sur ce désert maritime. Il n’y a même pas là pour rappeler quelques idées de la civilisation et d’autorité le pacifique douanier, le fusil sur l’épaule. C’est ici que la mer a vraiment l’air d’une implacable ennemie qui attend une proie […]10 ». Sur ce rivage « on hâte le pas et on se dit qu’heureusement il fait jour ». Ce rivage éloigné et hostile échappe à la civilisation et à son autorité. Propice aux « assassinats », aux crimes, c’est une « baie maudite » où le naufragé se verra confronté « à la rapacité des habitants des côtes ». Les observateurs associent la rudesse du rivage à un tempérament et un comportement déviants. Émile Souvestre, constate que « la vue de ces côtes terribles » a « une grande influence sur le caractère des habitants », leur tempérament « aventureux et sauvages ». Ils sont aussi capables d’utiliser ce paysage à des fins illicites. Les Kernewotes, habitants des grèves ou des montagnes, savent « comment on cache un cadavre dans une lande ou dans une carrière abandonnée 14 ». Pour Jules Michelet, sur les côtes bretonnes, « la nature est atroce, l’homme est atroce, et ils semblent s’entendre ». Les marges du territoire, jugées peu propices à l’habitat ne peuvent qu’abriter une population déviante. La difficulté de sa condition de vie sur ce littoral inhospitalier explique ses pratiques et le recours au pillage : « Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes et enfants ; ils tombent sur cette curée. N’espérez pas arrêter ces loups, ils pilleraient tranquillement sous le feu de la gendarmerie. Encore s’ils attendaient toujours le naufrage, mais on assure qu’ils l’ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache, promenant à ses cornes un fanal mouvant, a mené les vaisseaux sur les écueils. Dieu sait alors quelle scène de nuit ! On en a vu qui, pour arracher une bague au doigt d’une femme qui se noyait, lui coupaient le doigt avec les dents. » La vision de Michelet constitue, avec celle de Cambry, la seconde confirmation du thème des naufrageurs et contribue à pérenniser la réputation d’un littoral déviant. La population entière est marginalisée, foule de « loups » pilleurs. La société du rivage dans son intégralité est susceptible de piller. « Au premier coup de canon de détresse ; au premier signal, hommes, femmes, enfants, se précipitent vers la mer avec des lanternes et des fascines allumées. On voit courir sur les grèves, descendre le long des promontoires, ces milles clartés qu’accompagnent des cris d’appel bizarres et terribles. » Si « l’image romanesque des naufrageurs se réduit le plus souvent à un clan, ou plus simplement encore, à un couple », l’ensemble de la population riveraine des côtes est enclin au pillage. Elle est réfractaire à l’autorité et au respect des lois, ce n’est « qu’avec le sabre et le mousquet que l’on peut empêcher le pillage ». Dans les environs d’Audierne, « il n’est pas de naufrage où la gendarmerie et la douane ne soient obligés de faire feu ». Tous, y compris les femmes, sont prêts à profiter de la détresse du naufrage et à braver la loi. La femme incarne le paroxysme de l’immoralité. Dans la description de Michelet, il convoque le spectre du cannibalisme pour renforcer son récit. Quarante-deux ans auparavant, Fortuné du Boisgobey relate la même scène dans la baie d’Audierne : « Un fait est à la connaissance de tout le monde dans Guisseny, et on en a parlé je crois, dans des livres : un navire venant des Antilles, chargé de passagers, se brise sur les rochers de la côte : les cadavres vinrent au rivage : une jeune fille de Guissey qui cherchait quelque butin aperçoit une dame noyée qui avait un brillant au doigt : elle veut l’arracher, le doigt enflé résiste ; elle cherche son couteau, ne le trouve pas et coupe le doigt avec les dents22. » La symbolique d’un peuple barbare, animal, est plus poussée dans cette version du récit. Ici, c’est une jeune fille qui commet l’acte. Symbole traditionnel de pureté et de morale, elle déchiquette avec ses dents le cadavre d’une autre femme, noyée, pour récupérer son anneau. La référence à l’anthropophagie est évidente. La violence du contraste avec l’ignominie de l’acte et son naturel pour la jeune fille renforce la condamnation envers cette société du littoral. Les textes des années 1830- 1850, s’ils se réfèrent à une pratique ancienne, parfois révolue, dresse le portait d’hommes d’une société dangereuse et inhumaine. En 1848, dans Les Bretons d’Auguste Brizeux, le chant « Les Pilleurs des Côtes » stigmatise cette population. Pour lui c’est une « race cruelle », « Que la mer a rendue aussi féroce qu’elle ». A l’approche d’un naufrage, ils perdent toute morale et s’apparentent à des animaux :
« Semblables à des loups qui vont manger les morts,
Hommes, femmes, poussant des hurlements de joie,
Et, comme souteneurs de leurs affreux dessins,
O profanation ! ils invoquent les Saints 24 ! »
L’accusation d’anthropophagie est toujours présente. Elle s’associe au blasphème et aux actes criminels. Les « malheureux » qui abordent la rive se font tuer par cette « affreuse horde ». La sauvagerie des hommes se mêle au danger du naufrage pour transformer le rivage en un lieu de mort : « La Mort ! La Mort partout ! Ouvrant sa double serre, elle était sur la mer, elle était sur la terre. » La figure du pilleur naufrageur transforme la représentation des sociétés sur ces rivages reculés. Le littoral éloigné, celui de la Bretagne septentrionale, abrite ainsi aux yeux des observateurs une population meurtrière, cruelle et sauvage. Marginalisées géographiquement, ces franges du territoire deviennent le lieu de vie d’une contre-société, encore barbare, rétive au progrès et aux valeurs de la civilisation. Dans les environs d’Audierne, c’est dans des « marécages presque inextricables qu’habite une population aussi farouche que misérable. Là, végète entassée sous d’horribles huttes creusées dans le sol, loges immondes dont ne voudraient pas des cannibales de la Nouvelle-Zélande, une foule d’êtres hâvés, à peine vêtus, couchant sur des litières de jonc humide et dévorant avec avidité des aliments sans nom » Misère, immoralité expliquent le penchant criminel de ces populations qui transforment les franges isolées du littoral en lieux de l’immonde. Les doutes sur l’origine du naufrage accentue la dénonciation de ces populations et renforce leur identité criminelle. Dans le texte de Jules Michelet, l’ambiguïté demeure sur l’origine du naufrage et les intentions initiales de ces pilleurs. « […] mais on assure qu’ils l’ont souvent préparé » : les pilleurs deviennent naufrageurs, criminels actifs des côtes bretonnes. La figure du naufrageur remonte au texte de Cambry, qui évoque « les temps reculés » où « ils pendaient un fanal à la tête d’une vache, pour attirer les vaisseaux éloignés27. » Si l’accusation de naufrageur n’est pas évidente envers les habitants du rivage, ils ont au minimum souhaité l’accident. Pour Fortuné du Boisgobey, un fait caractéristique et « avéré » est que les habitants de la commune de PlouénourTrèz font des « vœux et des offrandes pour obtenir des bris sur la côte. » S’ils ne sont pas directement des naufrageurs, leur comportement est à ses yeux « effrayant de monstruosité ». En 1867, Gabriel de La Landelle est plus radical dans sa dénonciation. Pour lui les naufrageurs sont des « monstres qui savent parfaitement quel crime ils commettent » et « on ne leur doit aucune indulgence »
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I : L’EMERGENCE DES BAS-FONDS DE L’OUEST
1) Les bas-fonds de l’Ouest
a) « la pourriture, l’infection, dans les rues » : les lieux de la misère
b) « entrons dans la Fosse » : les lieux de la débauche et du crime
2) Les traditions constitutives
a) « On n’entend parler que d’inconduite parmi vous » : la marginalité du port et des marins
b) La vogue du roman maritime : les ports mal famés deviennent objet d’écriture
3) Traits singuliers
a) Les ports de l’Ouest : de la misère aux bas-fonds
b) L’importance du cadre régional et de l’image noire de la province
CHAPITRE II : LIEUX DE FIXATION
1) Au-delà des villes : les mauvais lieux du rivage
a) « la vie sauvage » : les dangers du littoral
b) Un monde du dessous, la cale
c) Un bas-fond légal en Bretagne : le Bagne de Brest
2) La transformation du port en quartier mal famé
a) L’ambivalence de la représentation portuaire : « c’est de règle »
b) L’errance des marins et la descente dans les lieux mal famés
c) Bouges, bordels et garnis
3) La condamnation des lieux du crime et de la pauvreté
a) « une blessure morale », lieux du crime et du vice
b) « Il faut entrer, il faut voir. », les lieux de la pauvreté dénoncés
CHAPITRE III : FIGURES
1) « L’homme de la mer »
a) Dualité de la représentation
b) Une « masse confuse de marins »
c) Virilité maritime et « secrets des mers »
2) Le port et les femmes de mauvaise vie
a) La perception des prostituées par la police et la presse
b) « Une fille des quais » : la prostituée du port dans la littérature
c) L’écriture de l’attente
3) Faune portuaire
a) Les criminels
b) Le pauvre dans l’imaginaire des bas-fonds
c) Livrées à l’incurie : l’image des soldats dans les villes portuaires
CHAPITRE IV : APPROPRIATION, NOSTALGIE ET MÉMOIRE
1) L’appropriation des bas-fonds
a) Les similitudes entre ports de l’Ouest et bas-fonds étrangers
b) « Les gars de la marine », la marginalité revendiquée
2) La disparition des bas-fonds
a) L’effacement des mystères de la mer
b) La nostalgie des bas-fonds
3) Mémoire et persistance des bas-fonds
a) La persistance des mystères du port
b) La persistance d’un lieu érotique
CONCLUSION
INVENTAIRE DES SOURCES
BIBLIOGRAPHIE
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet