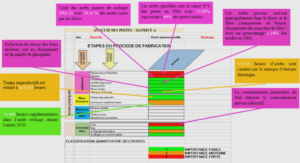Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les origines de la dépendance à l’électricité.
Aujourd’hui, nos sociétés sont régies par cet élément invisible, l’électricité. L’électricité est la seule énergie devenue essentielle à notre société. Elle dirige l’économie, le transport, la communication, l’alimentation, …. « Notre survie dépend de notre capacité à produire de l’électricité. »1. A l’heure actuelle, nous consommons 20 000 TWh à l’échelle mondiale dont environ 530 TWh rien qu’en France. Dans cette partie, nous tâcherons de remonter des débuts de l’électrification des villes jusqu’à l’omnipotence actuelle de l’électricité.
Depuis le premier abonné à un réseau électrique mis en place par Thomas Edison à New York en 1882, le courant électrique a su se rendre indispensable que ce soit au domicile des riches citadins ou dans les plus grandes sociétés de l’époque.
En effet, en 1882, on a enfin réussi à mettre au point un réseau électrique fonctionnel mais il faut le rendre populaire afin de le rentabiliser. Il est donc nécessaire de pousser les gens à souscrire à des abonnements au réseau électrique. Le fait de proposer un système d’éclairage beaucoup plus sûr, efficace et confortable que celui au gaz est déjà un argument pour convertir un grand nombre de personnes à l’électrique. Mais face au coût élevé des abonnements, il est nécessaire de donner à cette énergie des usages plus diversifiés et de ne pas la cantonner au simple éclairage public.
Pour cela, les industriels développent eux-mêmes des appareils offrant un regain d’utilité. On peut citer l’exemple de la «General Electric» descendante de «l’Edison General Electric Company» qui commercialise, en 1909, le D-12 alors le premier grille-pain de l’histoire. Dix ans plus tard, en 1919, Charles Strite dépose un brevet pour le premier grille-pain capable d’éjecter les toasts.
L’électricité s’est invitée progressivement dans nos quotidiens jusqu’à devenir indispensable aujourd’hui. On la retrouve partout autour de nous, dans les domaines des transports, de la communication ou encore de l’électroménager.
Nous illustrerons chacun de ces domaines à l’aide d’un onbjet, à savoir le tramway pour le transport, le téléphone portable pour la communication et le réfrigérateur pour l’électroménager. Commençons par le domaine des transports. L’électricité a permis de développer et de révolutionner de nombreux modes de déplacements notamment dans les transports en commun. Une multitude de système de traction mécanique sont expérimenté à travers le monde mais c’est en 1879, lors de l’exposition industrielle de Berlin, qu’est présenté le tout premier chemin de fer électrique construit par Siemens.
Cette première ligne permet à 26 voyageurs de parcourir 2,45 km.
Inventée et testée par Fyodor Pirotsky, la première ligne de tramway électrique du monde a été construite à Sestroretsk près de Saint-Pétersbourg en Russie en 1880.
En mai 1881, la ville de Paris vit l’expérimentation du tramway à accumulateur qui relie Montreuil à la place de la Nation.
En 1889, Jean Claret met en place la première ligne de tramway à Clermont-Ferrand. Ce tramway est conduit par le « Wattman »2 et un receveur chargé de distribuer les tickets et signaler le départ en actionnant une cloche. Les Clermontois viennent en masse pour accueillir ce nouveau symbole du progrès profitant, pour cette première journée, d’un service gratuit. Il s’agit du premier tramway alimenté par des câbles aériens.
En 1896, Fulgence Bienvenu, un ingénieur parisien, est chargé d’un projet de tramway électrique sous-terrain.
C’est la naissance du métropolitain parisien. Contrairement au métro de Londres, Athènes, ou bien Istanbul qui circulent à l’époque grâce à des locomotives à vapeur, la ville de Paris décide d’opter directement pour l’énergie électrique. C’est donc avec cette technologie que le métro parisien a innové. Aujourd’hui, le réseau métropolitain rend hommage à son géniteur avec la station « Montparnasse Bienvenu ».
Cette technologie s’est ensuite exportée dans d’autres villes comme à Nantes où le réseau de tramway construit depuis 1879 a été électrifié entre 1911 et 1917
Dans le domaine ferroviaire, l’électricité a su faire la différence pour augmenter les vitesses de circulation des trains diminuant de fait les temps de trajet. Cette quête de vitesse a commencé en 1903 quand un train tracté par une locomotive électrique Siemens a atteint les 213 km/h en Allemagne. Le record est battu en 1955 par deux motrices électriques, la BB9004 et la CC7107 de la Société Nationale des Chemins de Fer français. Le record est une nouvelle fois battu par la société française en 2007 par un de ses TGV lancé alors à 574,8 km/h.
Un autre domaine où l’électricité a révolutionné notre façon de vivre en société est la communication. La première vraie utilisation de l’électricité dans ce domaine remonte à 1838 avec l’invention du télégraphe. Cette technologie a été mise au point par Charles Winston pour relier Londres Clermontois viennent en masse pour accueillir ce nouveau symbole du progrès profitant, pour cette première journée, d’un service gratuit. Il s’agit du premier tramway alimenté par des câbles aériens.
En 1896, Fulgence Bienvenu, un ingénieur parisien, est chargé d’un projet de tramway électrique sous-terrain.
C’est la naissance du métropolitain parisien. Contrairement au métro de Londres, Athènes, ou bien Istanbul qui circulent à l’époque grâce à des locomotives à vapeur, la ville de Paris décide d’opter directement pour l’énergie électrique. C’est donc avec cette technologie que le métro parisien a innové. Aujourd’hui, le réseau métropolitain rend hommage à son géniteur avec la station « Montparnasse Bienvenu ».
Cette technologie s’est ensuite exportée dans d’autres villes comme à Nantes où le réseau de tramway construit depuis 1879 a été électrifié entre 1911 et 1917
Dans le domaine ferroviaire, l’électricité a su faire la différence pour augmenter les vitesses de circulation des trains diminuant de fait les temps de trajet. Cette quête de vitesse a commencé en 1903 quand un train tracté par une locomotive électrique Siemens a atteint les 213 km/h en Allemagne. Le record est battu en 1955 par deux motrices électriques, la BB9004 et la CC7107 de la Société Nationale des Chemins de Fer français. Le record est une nouvelle fois battu par la société française en 2007 par un de ses TGV lancé alors à 574,8 km/h.
Un autre domaine où l’électricité a révolutionné notre façon de vivre en société est la communication. La première vraie utilisation de l’électricité dans ce domaine remonte à 1838 avec l’invention du télégraphe. Cette technologie a été mise au point par Charles Winston pour relier Londres offre 30 minutes d’autonomie pour 10 heures de charge.
On dispose déjà d’un petit choix de personnalisation. En effet, il existe 3 coloris : gris anthracite, gris et blanc ou blanc crème. Cette innovation aura nécessité 15 ans de recherche et pas moins de 100 millions de dollars.
Les premiers téléphones mobiles fonctionnent sur la première génération de réseau ( 1G ), ancêtre de notre réseau actuel. Chez nous, l’entreprise France Telecom
Mobiles a déployé son premier réseau de 1G sous le nom de Radiocom 2000, faisant référence au second millénaire ce qui avait une connotation très futuriste pour l’époque.
Au début des années 90, le réseau 2G ou GSM (Groupe Spécial Mobile qui devient finalement Global System for Mobile communications) en Europe fait son apparition signant progressivement la fin de la 1G. Cette nouvelle génération signe également l’explosion de la téléphonie mobile. Cette nouvelle norme GSM a par la suite fait l’objet d’extension afin de prendre en charge de plus haut débits avec le GPRS (General Packet Radio Services) puis EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution).
Progressivement, le nombre de lignes mobiles a même dépassé le nombre de lignes fixes. En France, cette bascule a eu lieu en 2001.
Des années 90, on retient plusieurs appareils. Motorola commercialise le «Startac» en janvier 1996. Il s’agit à l’époque du premier téléphone à clapet, il a également marqué pour son apparition dans le film Star Trec. Nokia commercialise le «3310» en 1997. Il est alors un des premiers mobiles équipés d’un port infrarouge, de jeux et d’une calculatrice. De la même marque, le «5110» initie le principe de téléphone customisable avec des coques interchangeables et le vibreur arrive en option.
Toujours chez Nokia le «7110» fait son apparition en 1999. Il s’agit du premier téléphone capable de naviguer sur internet. Sony Ericsson sort le «T68M» en 2001, innovant avec le premier écran couleur et la fonction du Bluetooth. Samsung commercialise le «SPH-M100» en 2000 proposant le premier téléphone à embarquer un lecteur MP3. La marque Sharp sort en novembre 2000 le «J-SH04» considéré comme le premier mobile à avoir un appareil photo. Chaque constructeur y va de sa petite innovation jusqu’à se rendre aujourd’hui pratiquement indispensable au quotidien.
L’apparition de la 3G sonne réellement le gla du téléphone ne servant qu’à téléphoner. En 2003, Nokia sort le premier téléphone fonctionnant sur la technologie 3G avec son «6650». Cette dernière est rapidement devenue la norme permettant ainsi un réel accès à internet.
La prochaine entreprise à révolutionner le monde de la téléphonie mobile est Apple qui fait le buzz en janvier 2007 avec la sortie en grande pompe de son tout premier Iphone. Il ne s’agit pourtant pas du premier smartphone, le tout premier étant l’IBM Simon en 1992, mais c’est alors le tout premier à être équipé d’un écran tactile multipoint.
Ce mobile est un véritable succès commercial qui ne tardera pas à être proposé chez les concurrents.
Cette course à la nouveauté technologique a fini par se rendre intrinsèque à notre quotidien.
Dans les foyers, l’électricité va également améliorer les conforts des familles en mettant à l’honneur tout un tas d’objets aujourd’hui indispensables aux tâches ménagères.
Aujourd’hui, l’appareil domestique le plus répandu, le réfrigérateur a su s’imposer dans près de 100% des foyers français. Aujourd’hui intégré dans nos intérieurs, cela n’a pas toujours été aussi simple de conserver des denrées alimentaires.
Le premier réfrigérateur moderne a été imaginé par la propriétaire du domaine de Baltimore à Asheville aux Etats-Unis, aux alentours de 1895. C’est Carl Von Linde qui est chargé de réaliser cette invention qui ressemble alors aux réfrigérateurs que l’on connaît aujourd’hui.
Le premier réfrigérateur domestique grand public, le «Domeire» est imaginé par Fred W. Wolf à Chicago en 1913. Sur le même principe que l’invention de Linde, cette version produite en usine permet ainsi de réduire les coûts.
Sans doute la marque de réfrigérateur la plus connue, au moins de nom, a été inventé en 1916 ; il s’agit du fameux Frigidaire. Cette marque bien qu’américaine est tombée dans le langage courant. Ce n’est qu’a la seconde moitié du XXème siècle que le réfrigérateur s’est démocratisé. En effet, jusque-là, le coût était encore un frein pour beaucoup de foyers. Après quelques décennies de mise au point, le réfrigérateur domestique se popularise rapidement.
En 1944, la société Sibir, basée en Suisse, met au point le premier réfrigérateur à absorption. Grace à son principe de transformation de gaz en liquide, cela permet de ne plus avoir besoin de compresseur qui créé une pollution sonore.
Au cours des années 60, les nouveaux réfrigérateurs disposent d’une meilleure isolation sous l’impulsion des progrès technologiques réduisant ainsi la consommation d’énergie.
Avec une offre de produits surgelés de plus en plus présentes, les fabricants de réfrigérateurs adaptent leurs produits d’un compartiment avec une température abaissée à -18°C dès 1969.
En 1971, les réfrigérateurs gagnent encore en performance et atteignent le -32°C permettant ainsi aux utilisateurs de congeler eux mêmes leur nourriture.
A partir des années 70, le réfrigérateur voit de plus en plus d’accessoires avec notamment des rangements spécialisés et l’ajout d’éclairage.
Durant les années 80, l’Europe se relève de deux chocs pétroliers à la suite. On voit alors la prise de conscience du besoin de faire des économies et pour la première fois ce sont les consommations d’énergie des ménages qui sont pointées du doigt. Le frigidaire représente alors 30% de la consommation des foyers. Le nouveau défi des fabricants va donc se tourner vers cette contrainte. Plus tard, la réglementation imposera même l’étiquetage des performances énergétique de chaque appareil vendu. La première directive à ce sujet est appliquée en 1995. Les réfrigérateurs, congélateurs et combinés doivent alors porter une étiquette sur laquelle la consommation est affichée par des lettres allant de A à G, poussant ainsi le consommateur à acheter le plus efficace. Ce classement évolue en 2004 avec les lettres A+ et A++, cette dernière correspondant à une économie de consommation de 40% par rapport au A. Poursuivant les efforts vers une moindre consommations en 2011, c’est la classe A+++ qui fait son apparition.
Face à cette succession d’inventions utilisant l’électricité, le réseau français va devoir se structurer davantage. En effet, en France, la période de l’Entre-deux guerres marque un ancrage de l’énergie électrique dans le quotidien des ménages et devient un symbole éclatant de la modernité en court à l’époque. Dans cette période, on passe de 20% des communes raccordées au réseau électrique à 97%.
Le mot électroménager fait également son apparition dans le vocabulaire francophone. Cependant, les programmes d’électrification sont interrompus à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale. Si la majorité des communes est desservie en électricité, et plus précisément les centres bourgs, les campagnes sont, quant à elle, encore dans le noir.
Ces programmes d’électrifications ne reprennent qu’à partir de 1948 après la nationalisation des 1450 entreprises de production, de transport et de distribution d’électricité en 1945 et la création d’EDF. Le réseaux français est alors centralisé, basé sur des installations de production de grande capacité et des lignes électriques permettant le transport et la distribution de l’électricité sur l’ensemble du territoire.
« L´invention de l´électricité a façonné notre univers comme aucune autre découverte. Aujourd´hui on ne la remarque même plus tant elle est indispensable à notre vie quotidienne » 3
En France, on a tous en tête la référence de la « fée électricité » qui illustre dans l’esprit collectif cette quête de confort et de progrès recherché dans le développement de l’énergie électrique.
Aux Etats Unis, le rêve américain s’est aussi incarné à une époque par cette énergie, chaque foyer devant avoir jusqu’à l’ouvre-boîte électrique.
Aujourd’hui, nous sommes face a une réalité, après avoir placé autant d’enjeux dans cette énergie que se passe-t-il quand on s’en retrouve privé ?
Des grands exemples de coupure de courant.
L’histoire est jonchée d’exemples montrant les faiblesses des réseaux de production et de distribution ainsi que les répercutions que celles-ci ont pu avoir sur nos sociétés.
Dans cette partie, nous parlerons de trois coupures de courant de grande ampleur qui ont marqué notre société moderne ainsi que les évènements concomitants à ces moments de crise. En effet, bien que la coupure la plus longue, évoquée ci-après, n’ait duré que 48 heures tout au plus, les dégâts ont été importants. On peut citer les mouvements de paniques, les accidents en tout genre ou encore la perte d’importantes réserves de nourriture, sans oublier la paralysie des moyens financiers et de communication. Aujourd’hui, bien plus qu’un élément de confort, l’électricité est nécessaire au mode de fonctionnement de notre vie contemporaine. La perte, même provisoire, de cette énergie soulève un certain nombre de questions.
Afin de mieux comprendre comment peut se produire une coupure de courant généralisée, autrement appelée blackout, il est primordiale de s’intéresser à la structuration d’un réseau électrique. De plus, les conséquences peuvent être lourdes aussi bien sur le plan sociétal et humain que sur le plan financier. En effet, l’impact économique peut se chiffrer en fraction de pourcentage du PIB journalier.
Nous commencerons par expliquer comment est organisé un réseau électrique. Le réseau électrique est composé d’un certain nombre de composants qui, mis bout à bout, ont pour but de fournir aux usagers de l’énergie en fonction de leur besoin.
Le tout premier composant de ce réseau est le générateur dont le rôle est d’injecter dans le réseau une certaine quantité de puissance à destination des consommateurs.
Cette puissance est gérée en fonction des capacités des générateurs, des prévisions de consommation, de la disponibilité des ressources primaires, du coût de production et enfin des besoins du système électrique à un instant donné. Il existe plusieurs types de générateur.
Tout d’abord, les générateurs alternateurs synchrones qui peuvent être directement reliés au réseau comme les grosses centrales de production. Leur vitesse de rotation est proportionnelle à la fréquence du réseau électrique (50 Hz sur l’ensemble du réseau électrique européen), de ce fait sur un même réseau tous les générateurs synchrones suivent la même vitesse. Ensuite, il existe tout un tas d’autres générateurs, en général associés aux énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire qui ont des rendements plus faibles et ne peuvent être raccordés au réseau que par l’intermédiaire de convertisseurs électroniques.
L’énergie ainsi produite est ensuite acheminée jusqu’au consommateur grâce aux infrastructures de transport (haute tension), de répartition (moyenne tension) et de distribution (basse tension). Ce réseau est structuré en sous parties en fonction du niveau de tension qu’il transporte. Chaque niveau dispose de sa propre architecture. Par exemple, les pylônes des lignes à très haute tension doivent permettre de garantir une certaine distance par rapport au sol ou même entre les fils pour éviter la formation d’arcs électriques. Ils seront donc plus hauts que les lignes à moyenne ou basse tension.
Le réseau de transport permet d’acheminer l’électricité sur de grandes distances, le courant est en très haute tension afin de limiter les pertes. Ce réseau est maillé, le courant peut donc suivre plusieurs chemins entre deux noeuds du réseau de telle sorte que si une ligne déclenche, le réseau
peut continuer de fonctionner. C’est le principe du N-1 qui garantit le fonctionnement du réseau même avec un élément en moins.
Vient ensuite la partie de la moyenne tension qui elle est bouclée. Le courant ne peut suivre qu’un seul chemin à la fois mais en cas de besoin, il existe des connexions qui permettent de réorganiser rapidement le réseau.
Le réseau de basse tension a, quant à lui, une topologie radiale. Il distribue l’électricité directement aux consommateurs. Le courant n’a donc qu’un chemin possible.
|
Table des matières
Chapitre 1 / L’électricité, du rêve au cauchemar, de la lumière à l’obscurité.
a / L’histoire de l’électricité.
b / Les origine de la dépendance à l’électricité.
c / Des grands exemples de coupure de courant.
Chapitre 2 / L’électricité, une vie avec, une vie sans, de la réalité à la fiction.
a / D’une coupure ponctuelle…
b / … à une coupure permanente.
Chapitre 3 / Le blackout, de la fiction à la réalité.
a / Le journal de bord d’une semaine sans électricité.
b/ Vers une vies moins dépandante.
Conclusion /
Télécharger le rapport complet