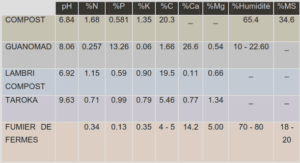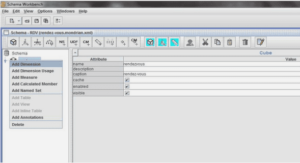Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Histoire du cinéma en Afrique de l’ouest
L’Afrique a été très tôt un lieu d’images, mais le rapport entre les populations autochtones et les occidentaux est très inégal. Les opérateurs lumière s’intéressent à ce continent, ils partent à la recherche d’images exotiques pour célébrer les bienfaits civilisateurs de la France. La deuxième guerre mondiale explose et les colonies sont alors utilisées à des fins politiques, pour montrer que l’Empire ne fait aucune distinction entre ses enfants. Dans tous les cas les Noirs sont présentés comme une forme innocente de civilisation primaire qu’il faut protéger et éduquer. Le cinéma occidental ignore la culture propre aux peuples présents sur le continent et recyclent les clichés d’une Afrique sauvage, éternellement innocente avec des décors somptueux propice à la mise en valeur des grandes stars occidentales. D’ailleurs on ne voit presque pas de noir devant la caméra, ou en tant que figurant, et surtout pas derrière la caméra. Très peu de techniciens africains sont formés et le pouvoir colonial garde un droit de regard très strict sur ce qu’il s’y produit. Cette mainmise se durcit après la deuxième guerre mondiale à mesure que la volonté d’indépendance née dans de nombreux pays. Il faut attendre 1955 pour voir apparaitre les première réalisateurs Africains. Paulin Soumanou Vieyra et Mamadou Sarr, deux Sénégalais passent derrière la caméra et filment « Afrique sur seine », un moyen métrage de 21 minutes. Il leur était interdit de tourner sur leurs terres, le film se passe donc à Paris et montre la vie d’un immigré d’Afrique Sub Saharienne dans cette grande ville occidentale.
En Afrique de l’ouest, les années soixante sont marquées par d’importants mouvements sociaux suivis par la déclaration d’indépendance de nombreux pays (Congo, Gabon, Sénégal, Cameroun…). Cela entraine l’apparition de réalisateurs africains qui tournent des films dans l’urgence dont les messages, les personnages et les histoires correspondent aux impératifs du moment. Cette période voit la naissance du cinéma Malien à proprement parler et du cinéma Mauritanien peu après. D’abord anticolonialiste, le cinéma africain tend rapidement à endosser le rôle d’éducation de masse. Des figures marquantes voient le jour, comme Sebène Ousmane (Sénégal) qui fait un cinéma très engagé. Avec une structure classique, il aborde des sujets forts et engagés. Pour lui le cinéma est une arme (politique) et un outil (pédagogique). Il réalise « Borom Sarret » (1963), « La Noire de… » (1966), « Le mandat » (1968) qui s’inscrivent dans un cinéma militant. D’autres réalisateurs importants voient le jour, en Mauritanie Med Hondo utilise tous les outils du cinéma pour servir ses propos engagés. Au Mali, Cheik Oumar Sissoko, après des études en France à l’école Louis Lumière, utilise l’humour et des micros intrigues pour traiter des réalités du pays.
Les mouvements d’indépendance des années soixante se voient entachés par les évènements politiques, l’Afrique de l’ouest est freinée, encore aujourd’hui mais dans une moindre mesure, par des régimes politiques autoritaires. Le cinéma est également touché. Certains pays se démarquent par leur production de films. Sept d’entre eux sont particulièrement marquants. La Côte d’Ivoire est l’un d’eux. Le Burkina Fasso produit une diversité intéressante de sujets traités dans les films. Certains thèmes reviennent souvent dans le cinéma ouest Africain, on retrouve beaucoup de films qui traitent des mêmes sujets (comme la confiscation du pouvoir par les pères ou les figures en marge de la société par exemple) mais des réalisateurs se démarquent de ce modèle et utilisent d’autres moyens pour porter un regard sur la société. Idrissa Ouedraogo est un nom important du cinéma burkinabé. Il dresse un paysage différent de ce qui se fait à ce moment dans le cinéma classique, en mettant en scène des situations de vie fortement inscrites dans le réalisme social. Le but est d’interroger la responsabilité de chacun dans le collectif, avec par exemple « Samba Traoré » (1992). Le Niger et la Mauritanie font partie des pays d’Afrique de l’ouest dont la production cinématographique se détache, de plus en plus de réalisateurs se lancent dans la production d’oeuvre. Le Mali est un lieu important du cinéma, des cinéastes importants y travaillent. Il est représenté par les réalisateurs Souleymane Cissé, réalisateur entre autres de, « Baara » (1978), « Fynié » (1982), et « Waati » (1995) et Abderrahmane Sissako, réalisateur de « La vie sur terre » (1998), « Heremakono » (2002) et « Bamako » (2006). Le Sénégal occupe une place de choix, son cinéma est l’un des plus anciens et des plus vivants d’Afrique. Ses représentants les plus connus sont les réalisateurs Djibril Diop Mambéty et Ousmane Sembène.
Au Nigeria, l’industrie cinématographique est un cas à part, en plein essor depuis les années 90. Elle est appelée « Nollywood ». C’est un mot-valise évoquant l’importance du cinéma de ce pays. Depuis 2009, le Nigeria est la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par an. Après l’Inde (Bollywood) mais devant les États-Unis (Hollywood), le Nigéria produit chaque année 2 000 films vidéo, dont le coût total estimé ne dépasse pas 20 millions d’euros. Son public est estimé à 150 millions de spectateurs réguliers. Nollywood est née dans les rues de Lagos grâce au commerce informel des vendeurs de rue à la fin des années 1980. Il a pris de l’importance dans les années 1990, au moment où la télévision nationale a été victime des tensions politiques mettant de nombreux artistes et techniciens au chômage. Ils se sont alors mis à produire des films indépendants à petit budget.
Le cinéma Africain a donc eu une naissance mouvementée, des réalisateurs ont vus le jour dans une volonté commune de porter un regard sur eux-mêmes, un moyen d’éducation de masse, de comprendre les mécanismes de sociétés déchirées par des gouvernements autoritaires. Il prend de l’ampleur au niveau international dans les années 2000 où trois films ont été nommés à Cannes. « Moolaadé » de Sembene Ousmane (Sénégal) est projeté à Cannes en 2004. Cet évènement marque le retour sur scène depuis quelques années du cinéma Africain dans la sélection du festival le plus prestigieux du monde. Le film ne passe pas inaperçu aux yeux du public et de la critique. Cela démontre également qu’aucun film d’Afrique de l’Ouest n’est présenté dans les autres catégories en sélection officielle depuis 7 ans (depuis « Kini et Adams » de Idrissa Ouedraogo, Burkina Faso). Depuis la deuxième moitié des années 90, dans les grands festivals, le cinéma d’Afrique de l’ouest est comparable à un désert d’où émergent de temps en temps des oasis. Constat étrange alors que leur visibilité fleurissait dans les années 80. Des organismes d’appui cinématographiques voient le jour pendant cette période, comme le Fonds Sud Cinéma (voir annexe 2) 1984, les aides de l’UE ACP 1986, les Fonds Hubert Bals (Pays Bas) 1988, etc. Certains films de cette région sont diffusés par des chaines de TV européennes. On voit une certaine quantité de coproductions ou d’achats de films par Canal+ et par d’autres chaines européennes. Aujourd’hui, des festivals comme le FESPACO au Burkina Faso participent au développement du cinéma en Afrique et à l’international. Il s’agit d’un grand festival de films qui a lieu une fois tous les deux ans dans la capitale, Ouagadougou et qui diffuse des films provenant de beaucoup de pays d’Afrique.
Le son direct « à la française » aujourd’hui
Dans ce mémoire nous allons nous concentrer sur la prise de son direct sur le plateau de tournage. La France est connue – ou du moins l’a été – pour son attachement au son direct. On utilise même fréquemment le suffixe « à la française » pour le qualifier.
Au début du cinéma parlant, l’enregistrement du son se fait avec des appareils imposants, des microphones très peu sensibles et peu directifs. L’ingénieur du son est enfermé dans une cabine insonorisée pour écouter les prises, ce qui le coupe entièrement du plateau et des autres membres de l’équipe. Ce matériel encombrant et lourd freine les tournages en extérieur, il faut attendre les premiers enregistreurs portatifs, les Nagra, inventés pas Stefan Kudelski, qui apparaissent sur les plateaux en 1951. L’ingénieur du son qui a maintenant plus de libertés, peut être présent avec le reste de l’équipe sur le plateau derrière la caméra. Les tournages en extérieur se démocratisent. Malgré cela, il reste le problème de la synchronisation de l’image et du son qui est réglé au début des années soixante. L’utilisation d’un dispositif de prise de son léger, portatif et synchrone à l’image chamboule la profession. L’allégement du matériel (micros et enregistreurs), l’amélioration des contrôles de la pureté du son, et surtout l’écoute immédiate de l’enregistrement (son magnétique) sont des progrès très importants. Le magnétophone et la caméra sont reliés par un câble qui assure la synchronisation. A partir de là, les documentaires, et de plus en plus de fictions, utilisent le son direct qui devient, en France, le moyen privilégié de construction de la bande sonore d’un film. Là où les cinéastes d’Amérique, de Grande Bretagne ou encore d’Italie usent beaucoup de la post-synchronisation en studio, le cinéma français accorde une grande importance au son direct. La matière provenant du tournage est gradée et utilisée au montage son et au mixage. Outre une économie certaine, cela permet de garder l’authenticité du jeu des acteurs. Les faire revenir en studio pour la postsynchronisation implique qu’il faut les payer pour le temps des enregistrements, qu’il faut faire des prises jusqu’à ce que la synchronisation labiale soit satisfaisante et que le jeu soit bon. Enfin, il faut réintégrer les répliques dans le film. En effet, l’enregistrement se fait généralement dans un environnement traité acoustiquement et en proximité. Une étape de mixage est nécessaire pour intégrer les voix dans la bande sonore du film. Un traitement en fréquence, en acoustique et en dynamique est appliqué sur les prises en studio. Ce travail est long et dénature la performance originelle des acteurs. Pour ces raisons, vers la fin des années cinquante, la nouvelle vague s’empare du son direct et en fait une de ses caractéristiques. Ce mouvement et les cinéastes qui le compose ont beaucoup contribué à l’image du cinéma français à l’étranger et en particulier au cinéma du direct. La volonté de casser les codes et les manières de faire ont fini par imposer le son direct sur la majorité des projets, même après le déclin de la nouvelle vague. Le son direct « à la française » était donc réputé à l’international par les autres grands producteurs de films pour qui la prise de son sur tournage se résumait en général à du son témoin. Les ingénieurs du son français ont, dans ce contexte, donné une réelle place au son sur le plateau, dans l’équipe et dans la discussion artistique autour du film. Aujourd’hui, le rapport de l’équipe son aux autres membres du plateau et à la mise en scène a encore évolué, notamment avec la révolution numérique.
Le son numérique s’est généralisé près de vingt ans avant l’image numérique. Dans les années 1980 les CD remplacent les microsillons puis le cinéma profite des techniques développées dans le secteur musical. À partir des années 90, plusieurs marques proposent un système numérique complet depuis l’enregistrement jusqu’à la diffusion en salle. Le numérique a, petit à petit, été accepté par les professionnels du son, non sans réticence. Même s’il permet le stockage d’un grand nombre d’informations sur un petit support et qu’il rend possible un grand nombre d’évolutions technologiques (la liaison HF, enregistrement multipiste, possibilités d’édition inédites, etc.), les ingénieurs du son ne l’ont pas adopté tout de suite. Fatalement, les avantages économiques et ergonomiques ainsi que les possibilités de la post-production numériques ont eu raison du Nagra à bande. Aujourd’hui la plupart des films sont tournés avec du matériel numérique, il s’est imposé un peu partout et la majorité mélange son direct, c’est-à-dire pris au moment du tournage, et postsynchronisation. Pour les dialogues, on essaie au maximum de garder ceux pris sur le tournage pour conserver l’intensité du jeu des acteurs. Mais des accidents sonores peuvent perturber l’enregistrement sans que soit demandée une nouvelle prise. Il faut alors refaire les répliques après le tournage. Dans quelles mesures ces modifications changent la manière d’exercer le métier de preneur de son ? C’est sûr qu’il y a un impact, l’utilisation des micros HF, des micros canon et la systémisation du tournage en multi-caméras entraine des méthodes de travail différentes et change la place de l’équipe son sur un plateau. J’ai eu la chance de pouvoir parler de cela avec un ingénieur du son français, Pierre Carrasco. Avec une longue carrière dans le son, il a travaillé sur des courts et longs métrages de fiction avant de se consacrer aux films documentaires. Cela lui a permis de beaucoup tourner à l’étranger et notamment en Afrique de l’ouest. En évoquant le sujet de la place du son direct, Mr Carrasco m’a dit qu’ « Avec la nouvelle vague, le son direct a été privilégié mais les techniques sont les mêmes un peu partout dans le monde. La place du son sur un film en fiction s’est dégradée, est passée au second plan. Le plus important c’est l’image maintenant. Avant, le son avait un réel pouvoir de détermination des décors, de dire « c’est possible » ou « ce n’est pas possible », « là le cadre il ne sera pas plus large que ça parce que mon micro il faut qu’il soit à telle hauteur ». Ça c’était au début du cinéma et après petit à petit, la technologie évoluant, avec l’utilisation des micros HF et des micros hyper directionnels, il s’est avéré que le son est passé derrière. D’autant plus qu’avec les techniques de post-production, beaucoup se sont dit que même si le son n’est pas bon on tourne et on le fera après. ». Les micros-cravates HF permettent une prise en proximité malgré un plan large. C’est ce que recherchent beaucoup de réalisateurs aujourd’hui. Il est donc compliqué, voire impossible, d’imposer une modification du plan ou de la lumière pour bien placer une perche, qui reste toujours le meilleur moyen pour faire une prise de qualité. « La place s’est dégradée du fait des évolutions techniques et du fait qu’on peut refaire le son après. Aux Etats-Unis ils le refont beaucoup, sur les blockbusters par exemple ils s’en foutent du son, ils refont tout après. En France, c’est de plus en plus souvent le cas, ils se disent « bon on va postsynchroniser ». » Il semblerait alors que, malgré l’amélioration qualitative constante du matériel de prise de son ces dernières années, l’exigence de qualité manifestée par l’équipe mise en scène ai significativement baissée sur le tournage. La qualité de la prise n’est plus la priorité, c’est la prise de vue et l’optimisation du temps de travail qui prévaut. Des économies sur le budget mais qui doivent se rattraper en post-production à quel prix ? Ces enjeux économiques se retrouvent également dans le documentaire. Pierre Carrasco, qui a réalisé la prise de son de nombreux films documentaires, témoigne que sur ce genre de production aujourd’hui : « les gens partent tout seuls, comme il y a de moins en moins d’argent pour les productions de documentaires, les réalisateurs sont amenés à partir seuls avec un micro-caméra. De plus en plus, les gens viennent pour que je nettoie leurs sons, que je fasse docteur Carrasco, « voilà je suis parti avec le micro sur la cam c’est pourri… arrange moi ça ». C’est de plus en plus le cas. Donc les moyens à la prise de son et sur le son en général sont souvent dérisoires, on se dit qu’après on peut récupérer sur la post-production ». L’héritage de la nouvelle vague se dilue dans une multitude de problèmes économiques et la technologie, de plus en plus performante, disponible en post-production (avec le plug-in de nettoyage des sons Isotope RX notamment), sert d’excuse à la mise en marge des preneurs de son. Le son direct « à la française » a-t-il laissé derrière-lui une empreinte identifiable dans les méthodes de travail appliquées en Afrique de l’ouest ?
Le son direct en Afrique de l’ouest, un lieu d’échange
En raison de leur passé commun, la France et l’Afrique de l’ouest ont connu un certain nombre d’échanges. Longtemps l’hexagone a gardé un contrôle sur la production cinématographique de ces anciennes colonies. On observe une aide très massive des pays du Nord aux principaux réalisateurs locaux, mais force est de constater l’absence du public africain dans la majorité des pays concernés. Ce n’est pas nécessairement la conséquence d’un désintérêt du public (il y a une énorme affluence de gens au Fespaco, à Ouagadougou), mais le signe de la mainmise d’une poignée de compagnies occidentales sur la distribution et les salles africaines. En effet, la colonisation a installé un contrôle total des films diffusés dans les salles d’Afrique de l’ouest ainsi que la gérance de ces dernières. La dissolution du Consortium africain de distribution des films (CIDC) en 1984, a laissé la distribution entre les mains de l’AfrAm (African American Films), tête de pont de le MPEAA (Motion Picture Export Association of America) qui détient dans 14 pays d’Afrique le quasi-monopole sur la distribution des films avec jusqu’à 87% des principaux « marchés » de cette zone (Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal, Burkina Faso). Aujourd’hui elle partage le marché avec la CFZAO, une filiale du groupe Pinault-Printemps-La Redoute. Les cinéastes africains doivent passer par ces organismes étrangers pour financer et diffuser leurs films, faute d’aide des états. Ces coproductions sont soumises à certaines conditions. Lors de notre entretien, Mr Yiriyé Sabo, ingénieur du son malien, m’a dit : « nous avons tourné la première et la 2eme saison les rois de Ségou en Français parce que l’AIF, la francophonie, avait participé au financement. Leur condition était que les dialogues soient en français. Mais comme ça parle de l’épopée de Ségou, le royaume Bambara, on devait tourner en Bambara. Mais bon, on a essayé de faire un doublage après ». Il y a également des conditions dans la composition des équipes de tournage, comme l’a évoqué Aboubacar Gakou, réalisateur et distributeur malien « C’étaient des coproductions occidentales. Les boites de productions européennes qui arrivaient à mobiliser beaucoup de fonds venaient avec leurs exigences. Donc ils amenaient les directeurs photos etc. tous les responsables étaient amenés d’Europe. Les maliens étaient sur les postes d’assistanat. ». Les productions Françaises engagent les ingénieurs du son et tous les chefs de poste sur le continent et les techniciens locaux occupent les postes d’assistants ou de réalisateur. Cette tendance n’existe pas uniquement au Mali. Mr Michel Tsagli, ingénieur du son Sénégalais, m’a accordé un entretien. Il s’est formé et a passé la plus grosse partie de sa carrière sur les plateaux de tournage en Amérique et, depuis quelques années, travaille dans son pays d’origine. Lors de notre discussion, il m’a dit que « C’est toujours la même situation, malheureusement le financement vient souvent d’ailleurs, que ce soit du Canada, des Etats-Unis ou de la France. Automatiquement, le système français impose des techniciens français sur certains postes, comme cadreur, ingénieur du son etc. Ils financent à hauteur de 70% même parfois 100% du budget total. Du coup il y a pas mal d’échanges de techniques, de décisions, d’approche du son, de discutions avec le réalisateur. » Dans ce contexte, il est clair que des échanges se font entre les français et les sub-sahariens. Des échanges de connaissances techniques et théoriques, des échanges de savoir-faire. A quelle point l’exercice de la prise de son « à la française » a-t-elle déteint sur les techniciens locaux ? Et inversement ?
La collaboration entre ingénieurs du son français et ingénieurs du son ouest-africains s’est perpétrée durant de nombreuses années. Aujourd’hui, de plus en plus de techniciens qualifiés sont engagés sur place pour mener à bien les prises de son, mais le modèle de production -et donc les conditions des productions françaises- changent peu. Le manque de structures de formation techniques rend la connaissance professionnelle des ingénieurs du son venant d’Europe utile pour les ingénieurs du son locaux. Mais l’échange est nécessaire dans les deux sens selon Mr Tsagli : « Il y a un échange. On apprend toujours de chacun. Un ingénieur du son français qui vient à Dakar ne sait pas qu’à 15h il y a la prière par exemple. Il y a pas mal de choses comme ça. Ce sont des petites choses que nous, ingénieurs du son en Afrique, connaissons et qu’il faut prendre en compte. ». Pierre Carrasco a été dans ce cas, il a tourné des films à gros budget au Burkina Faso sur lesquels il a travaillé avec des assistants burkinabés, il raconte : « Quand j’ai tourné en Afrique de l’ouest les chefs de postes venaient de France. C’est souvent le cas. C’est-à-dire qu’il n’y a pas beaucoup d’écoles de cinéma en Afrique. J’ai tourné une fiction à Ouaga2 et j’avais un assistant burkinabé, il ne savait pas très bien percher, mais ça allait. C’est souvent un peu la démerde là-bas en Afrique, il y a des métiers mais en général tout le monde sait tout faire, c’est un peu l’école du bien formel. Le savoir-faire existe, celui que j’ai eu à la perche sur la fiction était ingénieur du son, mais il travaillait à la télé, il était habitué à faire du son télé et ce n’est quand même pas le même travail. Comme il touchait à tout il savait un peu faire. Obligatoirement je suis un peu formateur du coup. C’est super intéressant, moi j’adore faire ça. ». Ainsi, dans ce contexte de coproduction avec les occidentaux, les techniciens locaux, peu formés faute d’écoles dédiées, apprennent les méthodes et techniques des techniciens étrangers. Cet échange est presque le seul moyen de formation technique pratique pour la majorité des techniciens d’Afrique de l’ouest. Il existe quelques écoles de cinéma dans certains pays de cette région d’Afrique. Au Burkina Faso, à Ouagadougou il y a deux écoles, une au Mali, à Bamako et une en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Très peu de gens y sont formés et, pour des raisons de subventions, certaines d’entre elles forment aux métiers du multimédia. Yiriyé Sabo, un des rares ingénieurs du son vraiment en activité au Mali, s’est beaucoup formé sur le tas. Il a fait le Centre International de Radio Rurale de Ouagadougou où il a appris la prise de son radio, mais pour les techniques de plateau, « j’ai un ainé, Bakari Sangaré. Il a tourné un peu partout en Afrique, il a même été invité sur un plateau en France. C’est un ingénieur du son vraiment confirmé sur tous les plans. Les techniques de prise de son sur plateau, je les ai apprises avec Bakari en ayant déjà des notions de prise de son. ». C’est un cas représentatif de la formation aux métiers du son en Afrique de l’ouest, comme le confirment les propos de Mr Tsagli « Beaucoup ont appris sur le tas, ce ne sont pas de gens qui ont faits des écoles. Moi j’ai fait une formation de 4 mois en Amérique mais beaucoup n’ont pas les moyens, ils apprennent sur le tas. D’où l’importance d’avoir des gens comme nous, moi ou d’autres de la diaspora qui reviennent en Afrique pour former ces gens-là. Ça fait de très belles collaborations, des rencontres, ça fait travailler et surtout monter l’expérience. On a des gens qui sont vraiment capables, il y a de très très bons techniciens qui vont très vite, qui sont très pointus. Non il y a vraiment des équipes très béton. ».
L’aspect financier
Être ingénieur du son en Afrique ou en Europe ne change pas grand-chose au niveau des techniques de prise de son. A part éventuellement une bonnette en plus sur la perche pour lutter contre le vent dans le désert, le principe reste le même. Une perche, un perchiste et éventuellement des cravates HF. Cependant, certains points au niveau de l’approche de la prise de son changent, comme l’explique Mr Tsagli : « Il y a toujours du bruit qui arrive de n’importe où, n’importe comment, c’est quand même une approche différente. Comme une spirale, ça tourne, il y a toujours un bruit qui arrive et qui n’est jamais le même. C’est donc très difficile d’avoir un bon raccord. C’est à l’ingé son de savoir s’il faut reprendre la prise, s’il faut faire une ambiance raccord, un son seul. Il faut arriver à faire en sorte que l’équipe laisse faire les sons, s’il faut refaire la prise etc…. C’est très rare, quasiment impossible, d’avoir cinq minute -et encore c’est beaucoup- une minute de silence avec un son qui varie peu. Quand on est ingénieur du son en Afrique, une fois qu’on connaît ces failles là on peut les contourner. En même temps je pense qu’on a une richesse pas possible. ». Ce n’est pas du côté purement technique que les ingénieurs du son ouest africains se démarquent. Il est question ici de voir comment s’exerce le métier dans un contexte économique, culturel différent du nôtre. Quelle place le son occupe sur les plateaux, quels moyens sont alloués à l’équipe son. Dramane Traoré m’a expliqué que, dans le contexte d’une boite de production aux moyens limités, il faut déjà disposer d’un budget suffisant pour engager des techniciens. Selon lui, « le son c’est 50% d’un film, si tu as de belles images mais que le son n’est pas audible tu n’as pas fait de film. », le problème d’argent persiste « il y a toujours le problème économique. On te fait faire un film avec 1000 euros, 2000 euros, ce n’est pas grand-chose. Tu calcules le budget, le voyage etc. en plus, tu dois prendre quelqu’un pour le son, tu dois prendre quelqu’un pour le cadre, toi tu dois réaliser, tu dois prendre un assistant… ça fait que tu n’as rien à la fin. Pour pouvoir gagner un peu, tu es obligé de tout faire. Donc tu travailles beaucoup pour finalement gagner peu. ». Il semble alors difficile pour des techniciens du son de gagner leur vie en pratiquant leur métier, en tout cas au Mali. Le problème d’argent est récurrent dans toutes les productions cinématographiques, il l’est d’autant plus en Afrique de l’ouest. Les aides de l’état sont minimes, celui-ci est bien souvent trop occupé par d’autres problèmes internes ou peu intéressé par le cinéma. Le Mali, par exemple, traverse actuellement une crise politique conséquente, l’industrie du cinéma en subit fatalement le contre-coup. Il y a beaucoup moins de subventions d’organismes européens, l’état tente de continuer à produire via l’ORTM (Office de radiodiffusion télévision du Mali) ou le CNCM (Le Centre national de la cinématographie du Mali) « Le CNCM est un centre national, étatique qui fonctionne sur budget national. C’est un centre qui s’occupe de la production cinématographique du Mali. Donc, comme les financements extérieurs sont plus ou moins inexistants maintenant et, étant donné que le Mali est un pays à fort potentiel culturel, la production devient nationale. Tant bien que mal, ils essayent de produire au moins un long métrage par an ou tous les 2 ans pour pouvoir participer au Fespaco. » m’a confié Yiriyé Sabo. Il m’a relaté plusieurs cas de tournages qui se sont éternisés ou stoppés par manque de budget de l’état. Le Mali se détache un peu de ses voisins à cause des problèmes qui explosent à l’interne. Il en va un peu différemment pour les autres pays, comme le Sénégal par exemple. La production audiovisuelle y est en meilleur état. Michel Tsagli explique qu’ « En ce moment il y a pas mal de boîtes qui sont en train d’ouvrir en ce qui concerne la post-production son. Des gens sont en train de venir s’installer, en tout cas ici au Sénégal. C’est très bien, parce que on en a besoin. Pouvoir faire toute la post production à Dakar serait vraiment bien. Il y a pas mal de productions qui viennent de l’extérieur, surtout avec tous ces nouveaux styles de télévision, de cinéma et avec les séries. Avec Canal+ et Netflix, il y a une grande demande audiovisuelle. Après des longs métrages je pense qu’il y en a entre trois et quatre par an qui se font au Sénégal. »
J’ai dit plus tôt que le nombre d’ingénieur du son vraiment formés qui tournent sur les gros projets est très réduit en Afrique de l’ouest. Comment, dans ces conditions, espérer vivre du métier de preneur de son ? Comme le dit Mr Sabo, « Pouvoir vivre uniquement de son métier d’ingénieur du son est vraiment problématique. Je suis employé à l’ORTM comme ingénieur du son, et même là le problème de budget se fait sentir. ». Il est très compliqué de vivre uniquement du métier d’ingénieur du son cinéma (assistant son également) tant les projets se font rares et maigres en budget au Mali, il faut combiner cela avec d’autres jobs. Il est donc indispensable de se démarquer des autres et d’occuper les rares places disponibles dans le réseau professionnel. En France, le métier d’ingénieur du son est défini et protégé par la législation du pays. Un salaire minimum et un nombre d’heures de travail maximal sont fixés. En Afrique de l’ouest, ce n’est pas le cas. Le salaire dépend de l’ingénieur du son qui fixe le montant de sa rémunération avec son employeur. Mr Tsagli soulève ce problème : « Du côté du salaire, un ingénieur du son ici ne gagne pas autant qu’un ingénieur du son en France ou aux Etats-Unis. De manière générale, au Sénégal, il gagne 15 euros la semaine, peut-être même moins. Du coup, il n’y a pas d’évolution au niveau du métier en Afrique de l’ouest. Malheureusement il n’y a pas encore de réseau entre tous les ingénieurs du son d’Afrique de l’ouest. Pourquoi pas créer une sorte de syndicat ici et s’expandre en Afrique de l’ouest. Déjà pour protéger les droits des techniciens, pour que les salaires soient au même niveau. Pour l’instant y’a pas de barème sur les salaires. On peut proposer un salaire de 2000 euros comme un salaire de 500 euros. Le métier d’ingénieur du son n’est pas précaire, c’est juste qu’il n’y a pas de barème fixe pour les salaires comme en Europe. Par exemple moi quand on m’appelle pour un boulot on me dit « on aimerai bien te prendre mais tu es trop cher ». Du coup ils prennent quelqu’un qu’ils vont payer 10 fois moins. Après il n’a pas la même expérience, le même matos, s’il s’en sort tant mieux. J’ai investi beaucoup dans le matériel et je considère que je dois avoir un certain minimum au niveau des salaires, c’est normal. ». A la difficulté de se former vient s’ajouter la question du matériel.
La question du matériel et la place sur le plateau
Le matériel utilisé est sensiblement similaire en Afrique de l’ouest et en France. Bien sûr, peu de moyen oblige, on n’y trouve pas de grosse machine onéreuse tel le Cantar x3 par exemple dans la majorité des pays, mais il y a de quoi mener à bien une prise de son. Il n’existe pas d’importante boite de location de matériel professionnel en Afrique de l’ouest. Soit les ingénieurs du son sont équipés, soit le matériel provient des organismes de production. Pour garder l’exemple du Mali, Mr Sabo raconte « Comme matériel aujourd’hui, nous disposons de mixettes. A l’ORTM nous avons des SQN-4S mini. Comme je te l’ai dit, avec les évolutions technologiques, avec la vidéo, les mixettes peuvent bien faire le travail. En plus nous avons des Sound Devices série 5 qui sont arrivés, là ce sont des enregistreurs numériques. Au niveau du centre national cinématographique du Mali, ils sont vraiment mieux équipés puisqu’ils s’occupent exclusivement de cinéma. Tout ce dont on a besoin pour un tournage, ils l’ont sur place. Que ce soit en termes d’équipement vidéo et son, perches, micros HF, micros-cravates, micros-canons… ». Avoir son propre matériel représente donc un vrai avantage dans « la course au travail » de ce côté de la méditerranée. Là où en France la grande majorité des ingénieurs du son ne possèdent pas de dispositifs complets de prise de son -en tout cas pour les longs métrages importants- et louent le matériel, en Afrique de l’ouest, l’accès aux équipements professionnels est limité, ceux qui possèdent un kit complet de tournage se voient appeler plus souvent. « Un gros problème qui se pose pour les ingénieurs du son ici c’est l’accès au matériel. Moi j’ai eu la chance et le privilège de travailler au Etats-Unis où tu gagnes quand même plutôt bien ta vie. Du coup tu peux acheter du matos. Après quand tu viens ici avec ton matériel, c’est vrai que tu es prioritaire. Quand tu as le matos qu’il faut, les gens ils se demandent pourquoi louer en France ou ailleurs. Bon, personnellement j’ai quand même investi sur des micros de pointe, comme des Schoeps, des DPA, des Sennheiser et ça coute très cher. Alors beaucoup de gens n’ont pas les moyens. Je connais beaucoup de petits jeunes ici qui font du son, qui sont capables mais qui n’ont pas les moyens. Un micro Schoeps ça coute entre 1600 et 2000 dollars, ici ça vaut une fortune, 1 million de francs CFA, c’est énorme. » explique Mr Tsagli.
Sur le plateau, d’après les entretiens avec les différents ingénieurs du son, j’ai l’impression que les problèmes rencontrés sont sensiblement les mêmes qu’en France. La place de l’équipe son est réduite au profit de l’image. Comme en France avec l’utilisation des HF ou du multi-cam, on laisse peu de marge de manoeuvre aux ingénieurs du son de l’autre côté de la méditerranée. Le son est négligé et passe après la composition des plans ou l’installation lumière. Yiriyé Sabo raconte : « J’avoue que ce n’est pas facile, l’image est reine sur un plateau de tournage. Mais le son à son importance, on n’est plus à l’époque du cinéma muet. Le métier de preneur de son c’est un métier délicat et ingrat. Quand ça marche on oublie le son, c’est quand il n’est pas bon qu’on s’en rend compte. Ce n’est pas facile mais on se bat pour gagner sa place. Il y a beaucoup d’anecdotes en la matière. J’ai plusieurs fois eu des prises de bec avec la réalisation et surtout avec le directeur de la prise de vue car on a tendance à vouloir marginaliser le son. Par exemple, j’ai dû me battre pour que mon assistant, le perchiste, puisse avoir sa place. Quand l’éclairage est mal fait tu n’arrives pas à entrer la perche, alors que c’est une erreur d’éclairage. Il faut se battre, c’est comme sur tous les plateaux. Mais ici c’est plus accentué car on ne cherche d’abord qu’à sauvegarder la bonne image. Une fois que l’image est bonne on fait attention au son. ». Comme une règle universelle ces paroles résonnent avec celle de Pierre Carrasco concernant la prise de son directe en France. Elles sont confirmées par Mr Tsagli « C’est compliqué de se faire entendre quand on est sur le plateau. Quand un ingénieur du son fait trop de bruit il dérange. Quand je parle de bruit c’est qu’il la ramène trop parce qu’il y a trop de gens qui parlent sur le plateau. Tu dérange. Cette mentalité-là, qui est en train de changer car je vois qu’il y’a de plus en plus de gens qui comprennent l’importance, qui prennent le temps d’écouter l’ingénieur du son, fait que c’est très difficile, ici en tout cas. ». L’importance accordée à l’équipe de prise de son est discutable et il faut réussir à s’imposer, aujourd’hui plus que jamais, pour que la qualité de la prise de son n’en souffre pas trop. Le métier d’ingénieur du son en Afrique de l’ouest n’est pas très prisé. Peu de gens, parmi tous les métiers du cinéma, portent leur choix vers la prise de son. Cette tendance explique en partie le nombre limité d’ingénieurs du son. Durant notre entretien, Michel Tsagli m’a expliqué que : «Ce n’est pas vraiment que les autres métiers sont mieux payés, mais il y a moins de casse-tête et le côté reconnaissance joue aussi. Le réalisateur est souvent beaucoup plus respecté qu’un ingénieur du son, en tout cas ici en Afrique. Aux Etats-Unis ou en Europe, tu as un pouvoir en tant qu’ingénieur du son, tu es quand même le 3eme sur le plateau, après le réalisateur et le chef opérateur. Ici c’est une bataille quoi, quand tu dis « silence » ou « taisez-vous » ils ne comprennent pas, ils n’ont pas encore la notion de l’importance de notre métier. Beaucoup vont vers la réalisation parce qu’ils pensent qu’il y a plus de pouvoir à être un réalisateur, on est mieux vu, mieux respecté qu’un ingénieur du son. »
Dramane Traoré m’a raconté une anecdote que je trouve très parlante : « On a fait un court métrage de fiction, on s’est dit qu’on allait allouer un budget au son. On a pris un ingénieur du son qui est au CNCM du Mali. Malheureusement, à la fin le son n’était pas bon. Le matériel faisait défaut je pense. On a eu un souci, dans les réglages de la caméra il y avait deux options : son extérieur ou son intérieur. Par défaut, ou quelqu’un l’a modifié, le son était comme un son intérieur. La caméra n’avait pas pris le signal provenant des entrées, d’où arrivait l’équipement du son. Donc on n’a pas eu un bon son à la fin, le film était fini, on a été obligé de doubler les voix. Je me suis dit que si les gens étaient réellement pros, on aurait pu éviter le problème. Le problème n’était pas uniquement au niveau de l’ingénieur du son, mais au niveau de toute l’équipe. Je me suis dit si que l’ingénieur son avait été qualifié, peut-être il aurait tout vérifié et on aurait évité le problème. A tous les niveaux, avoir un retour quand même. ». Le cas typique d’un problème technique lié au manque de matériel et de formation. Il semble que dans ce cas de figure le son et l’image étaient enregistrés dans la caméra. Cette histoire fait écho avec les paroles de Yiriyé Sabo « Il y a ce problème de formation et, avec la technologie, le net et autre, de plus en plus de formations se font de manière autodidacte. Les ainés essayent aussi de transmettre leurs connaissances aux jeunes. Quand tu m’as contacté pour cet interview je t’avais dit que je n’étais pas disponible parce que j’encadrais des jeunes qui veulent faire du cinéma. Donc ce sont des petites initiatives comme ça qui essayent de maintenir la flamme pour former des jeunes dans les métiers du cinéma. ». Face au manque cruel de réelle formation professionnalisante dans les pays d’Afrique de l’ouest, le rôle de l’ingénieur du son est aussi porté vers la transmission de ses connaissances, de son expérience. « L’expérience vient avec la pratique, la formation par l’exercice du métier. Mais la relève est toujours assurée puisqu’il y a des jeunes qui s’intéressent aux métiers et qui sont en train petit à petit d’acquérir de l’expérience et qui vont être prêts à prendre la relève. ». Les places de preneur de son sont limités et le passage de relai à la nouvelle génération se fait assez tard en raison du départ très tardif à la retraite. « Comme dans le métier y’a pas de retraite, administrativement on est en retraite mais dans les métiers du son, tant qu’on est bien portant qu’on peut subir les exigences du plateau on continue toujours à produire. ».
Le cas particulier du Nigéria
Intéressons-nous maintenant au cas du Nigéria. Dans une industrie où les films sont le fruit d’initiatives personnelles de cinéastes motivés avec des budgets très serrés, dans quelles conditions les preneurs de son exercent-ils leur métier ?
A l’issue des différentes discussions que j’ai eues avec des professionnels du cinéma au Nigéria, le bilan semble positif. Je me suis surtout entretenu avec des réalisateurs/producteurs, tous m’ont affirmé que le son est très important sur les plateaux de tournage et que l’équipe son est bien considérée : « Les producteurs considèrent le son direct comme très important. Ils s’assurent que tous les tests sont effectués et que le son est propre. L’équipe son est importante sur le plateau, ils peuvent travailler en toute liberté. » m’a assuré Temidayo Adeyemo. Tous les gens avec qui je me suis entretenu sont dans les métiers du cinéma mais pas ingénieurs du son. La fameuse tendance des réalisateurs à dire qu’ils accordent beaucoup d’importance au son pour, finalement sur le tournage, mettre l’équipe son de côté est connue en France. En va-t-il de même au Nigéria ? Malheureusement, le seul échange que j’ai eu avec un ingénieur du son local se résume à un message vocal transmis par un réalisateur. Dans celui-ci, concernant la place de l’équipe son, il a tenu ces propos : « Une chose est sûre, tous les métiers du cinéma sont liés. On ne peut donc pas dire que l’un est indépendant des autres, nous sommes une équipe. Professionnellement, on ne peut enregistrer que ce qui est permis par les choix du réalisateur. ». Il semble difficile avec ces éléments de définir avec certitude la place de l’équipe son. Toutefois, un point a été soulevé par Mr Adeyemo qui semble pencher en faveur des preneurs de son : « Bien sûr, pour nous le son direct est très important et rentable aussi ». Dans beaucoup de productions cinématographiques des pays historiquement influents du cinéma occidental, le son en tournage est mis entre parenthèse au profit de la postsynchronisation en studio. Les budgets permettent de faire revenir les acteurs pour doubler leurs répliques. Cette tendance se développe également en France. Au Nigéria, les budgets limités obligent les producteurs et réalisateurs à faire des choix. Il semble que, dans ce contexte, les problèmes financiers et la recherche d’économie profite au son direct.
Pour pouvoir rentabiliser une production et payer les gens qui travaillent dessus, il faut que ce soit fait vite et à moindre coût. Le contre coup de cela se ressent sur le matériel. Au niveau du son -comme pour les autres départements- les moyens techniques sont très limités. Temidayo Adeyemo témoigne : « Ils sont limités en termes d’équipements, donc ils ne sont pas libres du tout de ce côté-là. ». Seuls les éléments vraiment essentiels sont présents sur les plateaux de tournage ; une perche et une mixette (quand le son n’est pas enregistré directement dans la caméra). C’est encore plus l’école de la débrouille sur les tournages de Nollywood. Il faut être inventif, efficace et maîtriser son domaine d’expertise : « En termes de moyen de subsistance, il est possible de gagner de l’argent en tant que preneur de son si tu es bon. Si tu n’es pas bon, tu ne travailles pas. » m’a confié l’ingénieur du son. Selon les réalisateurs/producteurs, « Il est possible de vivre du son, c’est le cas de nombreuses personnes ». Le poste d’ingénieur du son au Nigéria demande de se démarquer des autres par ses compétences techniques et son savoir vivre. En effet, pour des raisons de gain de temps de temps et d’argent, beaucoup d’équipes de tournage vivent ensemble dans le même appartement pendant la durée du tournage.
|
Table des matières
10 – Introduction
13 – Partie I : Le cinéma d’Afrique de l’ouest aujourd’hui
I.1) Point historique de l’Afrique de l’ouest
I.2) Histoire du cinéma en Afrique de l’ouest
17 – Partie II : Le son direct
II.1) Le son direct « à la française » aujourd’hui
II.2) Le son direct en Afrique de l’ouest, un lieu d’échange
23 – Partie III : Le travail d’un ingénieur du son ouest-africain
III.1) L’aspect financier
III.2) La question du matériel et la place sur le plateau
III.3) Le cas particulier du Nigéria
27 – Conclusion
28 – Annexes
41 – Bibliographie/ Netographie/ Filmographie
Télécharger le rapport complet