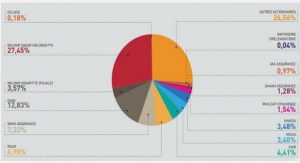Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Entre dehors et dedans, les formes du lien
Lors de l’arrestation et/ou de la mise en garde à vue d’une personne, sa famille n’est pas obligatoirement informée. Mais le détenu « doit être immédiatement mis en mesure d’informer sa famille de son incarcération » (art. D. 284 du Code de procédure pénale). S’il s’agit d’un mineur et s’il n’informe pas lui-même sa famille, le chef d’établissement a l’obligation de le faire. Par la suite, les personnes incarcérées et leurs proches peuvent s’écrire, voire bénéficier de parloirs et de communications téléphoniques, et les détenus peuvent recevoir de l’aide matérielle et financière de leurs proches.
Condamnation et droit de la famille
Jusqu’au décret (n°75-402) du 23 mai 1975, les prévenus devaient obtenir une autorisation pour se marier, soulignant bien l’incongruité de vouloir s’unir à une personne avec qui, au contraire, il conviendrait de rompre tout lien. Le droit au mariage a été reconnu par l’article 12 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il figure désormais à l’article 424 du Code de procédure pénale. Le tribunal de grande instance d’Agen a pris, le 29 décembre 1993 (Bordas v. Mouvion, épouse Bordas), une décision révélatrice du moindre conformisme actuel à l’égard des droits et devoirs des époux : il a refusé d’accorder un divorce pour rupture de la vie commune du fait d’une incarcération puisque le couple s’était marié en prison. Estimant que la rupture de vie commune doit être analysée comme cessation de toute communauté de vie affective et matérielle, le tribunal a considéré que les époux, en se mariant en prison, ont volontairement privilégié l’aspect affectif de leurs rapports (Nicoleau, 1994). Pourtant, le maintien de la peine criminelle comme cause péremptoire du divorce est un indice de la représentation sociale de l’incompatibilité entre délinquance et vie familiale. L’article 243 du Code civil prévoit en effet que le divorce pour faute « peut être demandé par un époux lorsque l’autre a été condamné à l’une des peines prévues par l’article 131-1 du Code pénal », c’est-à-dire à une peine criminelle.
L’autorité parentale a été crée par la loi du 4 juin 1970. Depuis 1996, la « déchéance » a été remplacée par le « retrait d’autorité parentale » et le placement de l’enfant en dehors de sa famille ne signifie pas obligatoirement le retrait de l’autorité parentale. Celui-ci est prononcé par le juge civil qu’en cas de mauvais traitements sur l’enfant, et par le juge pénal qu’en cas de culpabilité (ou complicité) de délit/crime à leur encontre. Le législateur a reconnu cette vérité : les délinquants ne sont pas – forcément – de mauvais parents. Toutefois, les contraintes inhérentes à l’incarcération ne sont pas sans conséquences sur l’exercice des droits familiaux. Comment, par exemple, exercer, lorsqu’on est parent, détenu et divorcé, un droit – maintenu – de visite à son enfant ?
Dans beaucoup de pays d’Amérique latine ou d’Asie, la rencontre entre les personnes détenues et leurs proches s’effectue par un accès libre, à certaines heures, aux cellules (par exemple en Bolivie). Dans d’autres pays, les visites sont attribuées de façon arbitraire et collective, comme à Cuba : ainsi, la visite peut s’effectuer dans un parc où plusieurs milliers de prisonniers reçoivent en même temps leurs visiteurs (Valladares, 1986, 120). Hérité des couvents où les moniales pouvaient, une fois par an, rencontrer leurs proches parents dans un parloir », le système des visites au « parloir » dans les prisons occidentales contemporaines permet le contrôle des personnes rencontrées et de la visite elle-même.
Pour les prévenus, les permis de visite sont accordés par le juge d’instruction, et par le chef d’établissement pour les condamnés (art. D. 403-2 du Code de procédure pénale). L’alinéa 3 précise que les permis établis par le chef d’établissement sont tantôt permanents, tantôt « valables pour un nombre limité de visites ». Ces autorisations, appelés dans la pratique parloirs exceptionnels », sont généralement accordées pour une seule visite ou pour une journée. Leur intérêt est de permettre à des personnes de rendre visite au détenu sans attendre les trois à quatre mois nécessaires à l’enquête de personnalité, souvent exigée pour l’attribution des permis de visite permanents. La direction se contente alors de demander une copie d’une pièce d’identité, voire une copie intégrale de l’acte de naissance. Cependant, certains directeurs refusent de prendre la responsabilité d’une telle décision sans attendre les résultats de l’enquête. L’attribution d’un permis à une personne sans liens de parenté avec un prévenu est exceptionnelle, mais elle n’est pas rarissime lorsque le détenu est condamné.
Lorsque ses parents ont divorcé, le droit de visite de l’enfant à son parent incarcéré est régi par l’article 288 du Code civil. Celui-ci accorde au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale le droit de surveiller son entretien et son éducation, ainsi que d’être informé des choix importants relatifs à sa vie. Selon la jurisprudence, seuls des « motifs graves » peuvent alors justifier la décision d’un juge de refuser tout droit de visite (Moine Dupuis, 1999, 251-254). Si, par exemple, la cour d’appel de Dijon (6 mai 1994) a estimé qu’un enfant de deux ans n’avait pas d’intérêt particulier à voir son père qui purgeait une longue peine de réclusion criminelle, la jurisprudence ne reconnaît pas l’incarcération comme justifiant la non-représentation, ni d’ailleurs le sentiment d’aversion de l’enfant à l’égard du parent qui le réclame (Moine Dupuis, ibid., 253). Reste le problème (déjà difficile pour une personne libre) d’obtenir l’application de ce droit de visite.
AMENAGER SA PEINE, PREPARER SA SORTIE
Comprendre les relations familiales des personnes détenues nécessite également de prendre en compte les modalités d’exécution de la peine. Nombre de mesures de sécurité (comme le placement à l’isolement) et de modes de gestion des détenus (comme les transferts) intéressent la question des liens familiaux. En outre, on ne peut se désintéresser certaines pratiques qui constituent des atteintes (répétées) à l’intégrité humaine et qui modifient durablement le rapport au corps et à l’intime.
Lorsqu’une peine est prononcée, une date est certes fixée avant laquelle le détenu ne peut sortir et – excepté pour les personnes condamnées à la perpétuité – une date à laquelle il sera impérativement remis en liberté (sous peine de détention arbitraire). Entre ces deux échéances et une fois purgée une éventuelle « période de sûreté », le condamné peut bénéficier de réductions et/ou d’aménagements de peine. Or les proches sont à la fois pris à partie (pour constituer les dossiers, être « garants », etc.) et bénéficiaires, à part entière, des libérations anticipées et des aménagements de peine (telle la semi-liberté). D’après Kensey et Tournier (2000), les mesures de placement extérieur, de libération conditionnelle et de semi-liberté – qui deviennent de plus en plus des « mesures d’exception » – diminuent objectivement les risques de récidive. Le rapport de causalité entre les mesures d’aménagement de peine et la moindre récidive est pourtant incertain. L’observation peut simplement rendre compte de l’aptitude des juges de l’application des peines à attribuer ces aménagements à ceux qui sont les moins susceptibles (pour d’autres raisons) de récidiver : moins les juges attribuent ces mesures (moins ils prennent de risques), plus ces mesures sont corrélées à des résultats positifs de réinsertion.
Sortir… quand ?
Sarcastiquement et pertinemment, les détenus disent souvent : « La prison, on sait quand on y entre et pas quand on en sort. » Certes, la Justice française ne prononce pas, comme aux États-Unis, des peines dites « end-opened » (« de deux à vingt ans », par exemple). La durée exacte de toute peine demeure toutefois indéterminée. En effet, une fois la peine purgée, la détention peut être prolongée par une « contrainte par corps », en cas d’amende douanière (dans les affaires de stupéfiants). À l’inverse, sa durée peut être abrégée par l’attribution de Remises de Peine Ordinaires (R.P.O.) et de Remises de Peine Supplémentaires (R.P.S.) ou par les décrets de grâces. Celles-ci sont une prérogative du Président de la République. Elles sont exceptionnellement des mesures individuelles : elles sont traditionnellement octroyées collectivement lors de son élection et de la fête nationale du 14 juillet.
La libération conditionnelle est une libération anticipée – et conditionnée au respect d’obligations (contrôle judiciaire, injonction thérapeutique, etc.) – d’un condamné présentant des « signes sérieux de réadaptation sociale ». Elle peut être accordée aux personnes primaires ayant accompli la moitié de leur peine1. Pour celles en état de récidive légale, le temps est porté aux deux tiers de la peine. Pour les condamnés à la Réclusion Criminelle à Perpétuité (R.C.P.), en l’absence de période de sûreté fixée par la cour d’assises, le temps d’épreuve est de quinze ans. La condamnation à une perpétuité réelle n’existe pas dans l’échelle des peines applicables en France. Néanmoins, la peine peut s’accompagner d’une « période de sûreté » (jusqu’à trente ans), durant laquelle tout aménagement de peine (et a fortiori de libération conditionnelle) est interdit. Depuis le 1er janvier 2001, le Juge de l’Application des Peines (JAP) est compétent pour accorder les libérations conditionnelles, lorsque les peines sont inférieures à dix ans : il n’était auparavant compétent que pour les peines inférieures à cinq ans. Pour les condamnés à des peines supérieures, la Juridiction régionale de libération conditionnelle (composée d’un magistrat de la cour d’appel et de deux juges de l’application des peines) est désormais compétente, après avis de la Commission d’Application des Peines (CAP). La compétence antérieure du ministre de la Justice (sur avis d’un Comité consultatif de la libération conditionnel) est donc supprimée.
Malgré un certain consensus sur la « nocivité des sorties sèches » (Warsmann, 2003), celles-ci augmentent. Le taux d’admission à la libération conditionnelle des condamnés relevant de la compétence des juges de l’application des peines est ainsi passé de 29% en 1973 à 14% en 1998 (Farge, 2000). De 1970 à 1999, celui des détenus relevant de la compétence du garde des Sceaux a diminué de moitié : il est passé de 64% à 30%. Bien que le législateur ait retenu le délai de la moitié de la peine subie, les détenus condamnés à de longues peines et admis à la libération conditionnelle par le garde des Sceaux sortent, dans 60 % des cas, après avoir purgé plus des trois quarts de leur peine.
Le préjugé, particulièrement tenace, selon lequel les condamnés (notamment les délinquants sexuels) n’exécutent « que » la moitié de la peine prononcée est faux. Selon Kensey (2003), la part de la peine effectuée sous écrou par les auteurs de crimes sexuels est supérieure (68,8%) à celle effectuée par les autres criminels (62,6% en cas d’homicides volontaires, 65,5% en cas de vols). En revanche, parmi les auteurs de délits, les personnes condamnées pour agressions sexuelles font en moyenne 66,6% de leur peine sous écrou, ce qui, mis à part les auteurs d’escroquerie (66,3%), est le plus faible ratio. Exclus des remises de peines, les auteurs de délits liés aux stupéfiants sont donc particulièrement défavorisés, accréditant l’opinion de nombreux détenus selon laquelle les délinquants sexuels sont les privilégiés du système pénal.
La « loi Kouchner » (l’article 10 de la loi du 4 mars 2002, insérant dans le Code de procédure pénale l’article 720-1-1) permet une « suspension de peine » pour « les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ». Selon un communiqué de presse du garde des Sceaux, D. Perben (4 mars 2004), 83 personnes ont bénéficié d’une suspension de peine (20 en 2002 et 63 en 2003) et une cinquantaine de dossiers sont en cours d’instruction. Bien que d’application très marginale (comme d’ailleurs les grâces médicales présidentielles, de l’ordre d’une dizaine par an), elle a rapidement été remise en cause. Dès le 7 mai 2003, le garde des Sceaux avait demandé aux parquets de prendre en compte le « risque de trouble à l’ordre public » dans leur décision. D’ailleurs, le 8 octobre 2003, lors du débat sur le projet de loi sur
les évolutions de la criminalité », au Sénat, M. Zocchetto a présenté, au nom de la Commission des lois, un amendement la conditionnant à l’absence de dangerosité du détenu. De plus, certaines décisions de suspension de peine ont été dénoncées par les parties civiles : la suspension de peine de Didier Tallineau, en décembre 2004, a ainsi fait l’objet d’une véritable bataille juridique1. Le JAP a d’abord confirmé la décision de suspension de peine le 17 mars 2005, mais D. Tallineau a été réincarcéré le 16 septembre, après une demande d’expertise émanant du ministère de la Justice.
Les aménagements de peine
Les mesures d’aménagement de peine (les permissions de sortir, la semi-liberté, le placement en chantier extérieur ou la mise sous bracelet électronique) sont accordées par le juge de l’application des peines, selon les « gages de réinsertion » du détenu : promesse d’embauche, certificat de logement, entourage familial « positif », etc.
Les permissions de sortir permettent à un condamné de s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période déterminée, qui s’impute sur la durée de la peine exécutée. Le juge de l’application des peines peut l’attribuer aux détenus (résidant légalement en France) pour un des motifs suivants : maintien des liens familiaux, visite à un employeur, examen scolaire ou universitaire, visite médicale ou circonstances familiales graves. Le juge de l’application des peines décide de la durée des permissions de sortir (de quelques heures à plusieurs jours), ainsi que d’éventuelles mesures de sécurité, comme l’accompagnement du détenu par la Police (« sortie sous escorte »). En 2002 (Les Chiffres clés de l’Administration pénitentiaire, 2004b, 7), sur plus de 31 000 permissions de sortir accordées, 74% l’ont été pour le maintien des liens familiaux et 13% pour présentation à un employeur. Seuls 262 détenus ne sont pas revenus de permission, soit un taux de non-retour de 0,8%.
Il existe une restriction importante à l’attribution des permissions de sortir : l’article D. 146 du Code de procédure pénale prévoit que le condamné, en centre de détention, peut obtenir une permission de sortir, pour le maintien de ses liens familiaux, au tiers de sa peine. Or, à ce moment de leur peine, beaucoup de détenus sont encore en maison d’arrêt. Le 29 août 2000, le tribunal correctionnel d’Evry a confirmé la décision d’un juge de l’application des peines accordant une permission de sortir à un détenu, parvenu au tiers de sa peine et qui aurait dû (selon les textes) être en centre de détention. Le procureur de la république avait formé un recours contre la décision du juge de l’application des peines.
La semi-liberté peut être octroyée aux condamnés ayant un reliquat de peine inférieur à un an. Elle peut être accordée pour suivre une formation professionnelle, exercer une activité professionnelle, apporter une participation essentielle à sa famille ou suivre un traitement médical. Le condamné en semi-liberté doit retourner dans l’établissement – un Centre de Semi-Liberté (C.S.L.) – à l’expiration du temps nécessaire à l’activité, par exemple le soir ou le week-end. En 2002 (idem), plus de 6 500 mesures de semi-liberté ont été prononcées.
Le chantier extérieur est un régime d’exécution d’une peine ou d’un reliquat de peine qui permet à des condamnés d’être employés, à l’extérieur de la prison, à des travaux contrôlés par l’Administration pénitentiaire. En 2002 (idem), 2 550 décisions de placement en chantier extérieur ont été prononcées.
Malgré son caractère récent et le peu de recherches la concernant, il faut évoquer la mise en place du bracelet électronique, appelé, en termes juridiques, le Placement sous Surveillance Electronique (P.S.E.). La loi du 19 décembre 1997 l’a prévu pour les condamnés à une peine de prison d’un an maximum et ceux dont le reliquat de peine est inférieur à un an. La première expérimentation, concernant une vingtaine de détenus, a débuté en septembre 2000 dans quatre établissements : Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône), Agen (Lot-et-Garonne), Loos (Nord) et Grenoble (Isère). Depuis le 10 avril 2002 et le décret d’application de l’article 62 de la loi du 15 juin 2000, le juge des libertés et de la détention peut faire exécuter une détention provisoire sous surveillance électronique. Cette mesure est prise au vu de « la situation familiale de l’intéressé, notamment s’il exerce l’autorité parentale à l’égard d’un enfant ayant sa résidence chez lui et dont l’age est inférieur à deux ans ». Le bracelet électronique sert donc d’aménagement des courtes peines et des détentions préventives.
Un an après le début de l’expérimentation (Le Monde, 27 décembre 2001), et alors qu’elle touchait désormais une cinquantaine de personnes, seules deux « évasions » ont été rapportées : elles étaient le résultat de problèmes familiaux (dispute conjugale, différent familial et médicamentation massive), et non d’une volonté délibérée de se soustraire à la mesure. En avril 2003 (Etapes, 2003, 99), le retrait n’avait été demandé que vingt-cinq fois pour non-respect des obligations et cinq fois pour « évasion ». Au 1er juin 2003, 171 personnes étaient placées sous surveillance électronique (dont 9% de femmes) et au 1er août 2004, 679 personnes. La volonté des juges d’éviter les séparations des mères et de leurs enfants explique la forte proportion de femmes placées sous surveillance électronique. Nous reviendrons sur ce préjugé tenace dans l’institution pénale et judiciaire selon lequel un enfant a plus besoin d’une mère que d’un père.
La peine après la peine
L’expression « purger une peine » est trompeuse. Outre la stigmatisation et les conséquences psychologiques d’une incarcération, la peine se termine en effet rarement à la porte de la prison. Certes, la relégation a été supprimée par la loi du 17 juillet 1970, mais le régime des libérations conditionnelles ne cesse d’engendrer des Jean Valjean, qui n’en finissent pas de « payer leur dette à la société ». Assorties de longues périodes de contrôle judiciaire (jusqu’à dix ans pour les condamnés à perpétuité), les libérations conditionnelles sont aujourd’hui débattues, car jugées par d’aucuns trop peu contraignantes.
Le casier judiciaire est également un élément de la peine. Composé de trois parties, appelés bulletins », il recense les condamnations. Le bulletin 1 (B1), qui comporte l’ensemble des condamnations et des décisions, n’est consultable que par les juridictions. Le bulletin 2 (B2) comporte la plupart des condamnations figurant au B1, à l’exception des contraventions de police, des condamnations à l’encontre des mineurs et des condamnations avec sursis (lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans décision de révocation du sursis). Ce bulletin peut être consulté par les administrations, notamment pour l’accès à la fonction publique. Sur le bulletin 3 (B3), ne figurent que les condamnations prononcées pour crime ou délit (et lorsque les peines sont supérieures à un emprisonnement de deux ans sans sursis ou dont le sursis a été intégralement révoqué), les décisions de suivi socio-judiciaire et les interdictions d’exercer une activité au contact des mineurs. Ce bulletin n’est consultable que par l’intéressé. Il est demandé par certains employeurs. Pourtant, la Cour de cassation a clairement exprimé que le salarié « n’avait pas l’obligation de faire mention de ses antécédents judiciaires » (arrêt du 25 avril 1990).
La privation des droits, qui peut accompagner une condamnation, interdit d’exercer de nombreuses professions (fonction publique, professions commerçantes, libérales, etc.), de voter, d’exercer certains droits familiaux (comme d’être tuteur) ou de témoigner devant la Justice. Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994, les condamnés en matière criminelle perdaient automatiquement et définitivement leurs droits et les condamnés en correctionnelle en étaient privés pour dix ans. Désormais, la privation des droits est prononcée par la juridiction et ne peut excéder dix ans.
Or les mesures permettant d’éviter ces peines complémentaires sont peu connues et rarement sollicitées par les condamnés. Une dispense d’inscription des condamnations aux B2 et B3 peut être demandée. Le relèvement (qui prive d’effet les interdictions professionnelles, les déchéances et les incapacités) peut être accordé, à la demande du condamné, par le juge de l’application des peines. En outre, la réhabilitation permet l’effacement de la condamnation et d’interdire à toute personne pouvant connaître le passé pénal de l’intéressé d’en faire état (art. 133-16 et 133-11 du Code pénal). Il existe en fait deux types de réhabilitation. La réhabilitation légale est automatique : trois ans après le paiement d’une amende, cinq ans après l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement, dix ans après une peine de dix ans. Elle n’est pas possible pour les peines correctionnelles supérieures à dix ans et pour les peines criminelles. En revanche, la réhabilitation judiciaire peut être demandée à la chambre d’accusation, en saisissant le Procureur de la République, au moins un an après l’exécution d’une peine de police, trois ans après une peine correctionnelle et cinq ans après une peine criminelle. Elle s’obtient après enquête. Il faut un délai de deux ans avant de pouvoir réitérer la demande en cas de refus.
AU NOM DE LA SECURITE
Beaucoup de mesures, prises au nom de la sécurité, ont des conséquences sur les conditions d’exercice des liens familiaux : sont en effet visées les possibilités de soutien et de réconfort extérieurs. Elles ont aussi des conséquences indirectes sur ces liens en atteignant l’intime, le rapport au corps, etc.
Le statut de D.P.S. et la gestion des détenus
Depuis 1967, existe un fichier des détenus dits « D.P.S. », c’est-à-dire « Détenu Particulièrement Signalé » – et non pas « Détenu Particulièrement Sage », comme le disent, railleusement, certains détenus concernés par cette dénomination. En moyenne, 400 personnes sont inscrites à ce fichier : une partie (moins d’une centaine), sont des détenus répertoriés au fichier du grand banditisme tenu par l’Office Central de Répression du Banditisme (O.C.R.B.), les autres sont inscrits à l’initiative de l’Administration pénitentiaire en raison de risques pour l’ordre public, notamment à partir des renseignements donnés par le Bureau de Liaison Police Pénitentiaire (B.P.L.P.P.).
Début 2003, il a été procédé à une réorganisation et à un déploiement du B.P.L.P.P. (Etapes, juin 2003, 100). Cela s’est traduit par la mise en place d’un état-major de sécurité à la Direction de l’administration pénitentiaire, rattaché au directeur et chargé des questions liées à la sécurité pénitentiaire, notamment du suivi des détenus dangereux et de l’analyse de la situation des établissements au regard des risques d’incidents graves (évasions, intrusions et mouvements collectifs). Les effectifs du B.P.L.P.P., renommé Bureau du Renseignement Pénitentiaire (B.R.P.), sont passés à dix agents et ses échanges d’informations avec les services centraux de la police et de la gendarmerie ont été améliorés.
Les permissions de sortir tendent à être refusées aux détenus classés D.P.S. Pourtant, la circulaire (n°88-06) du 10 mai 1988, rappelant le risque d’évasion élevé pour ce type de détenu, signale que l’inscription au fichier des D.P.S. ne peut « constituer en tant que telle un motif de rejet systématique et a priori de toute demande ». Le 16 juillet 1983, une note du directeur de l’Administration pénitentiaire rappelait, en outre, que cette inscription n’est « qu’une simple mesure d’ordre intérieur sans caractère disciplinaire ou discriminatoire visant à assurer avec plus d’efficacité la surveillance des détenus réputés dangereux » : elle ne doit « en aucun cas entraîner l’application d’un régime particulier plus défavorable ».
Hormis la recherche de Cirba (1992), les D.P.S. n’ont jamais été étudiés spécifiquement. Sans doute la confidentialité qui entoure – plus largement – la gestion des détenus « dangereux » ou difficiles » explique le peu de publications à leur sujet : à l’exception de la contribution de Faugeron (« The Problem of ‘‘Dangerous’’ Offenders and Long-Term Prisoners in France », in Vagg, s.d.), la seule recherche notable est le rapport de 1993 de l’Inspection Générale de l’Administration (I.G.A.) et de l’Inspection Générale des Services Judiciaires (I.G.S.J.) sur L’Emprisonnement prolongé des détenus difficiles et dangereux. Il est donc très difficile de connaître les caractéristiques de cette population.
La gestion par l’Administration de ces détenus est également largement dissimulée et inexplorée. Nous aurons l’occasion d’évoquer l’une des façons par lesquelles elle entend punir et prévenir les comportements rebelles : les transferts, punitifs ou dissuasifs, et leurs conséquences, les « balluchonnages », c’est-à-dire les transferts inopinés au petit matin – les préparatifs dissimulés au détenu pour mieux s’en saisir, à l’aube, rappellent d’ailleurs les précautions prises auparavant avec les condamnés à mort. Ces transferts réguliers nourrissent un « tourisme pénitentiaire », rarement évoqué dans les recherches sociologiques – signalons toutefois l’exception de Marchetti (2001, 33).
L’interdiction de communiquer et placement au Q.I
Le juge d’instruction peut prononcer, à l’encontre d’un prévenu, une « interdiction de communiquer » (art. 145-3 du Code de procédure pénale). Elle conduit concrètement l’intéressé au Quartier d’Isolement (Q.I.), sans aucun contact avec les autres détenus. Mais la mesure vise essentiellement les contacts extérieurs : le prévenu ne peut recevoir ou écrire des lettes, ni bénéficier de visites (hormis celles de son avocat). Elle est toutefois limitée à dix jours, mais elle est renouvelable une fois. Elle peut cependant être prolongée par des moyens extrajudiciaires. Le magistrat instructeur peut ainsi tarder à accorder à la famille un permis de visite. Même s’il finit par lui accorder, il faut souvent à la famille se rendre au Palais de Justice, le rendez-vous correspondant étant retardé autant que possible. Cela prive donc de facto le prévenu de visites et aussi souvent de linge. Quant au courrier, le magistrat peut repousser de dix jours à plusieurs semaines la communication pourtant autorisée et laisser le prévenu sans nouvelle des siens.
A leur abolition en 1982, les Quartiers Haute Sécurité (Q.H.S.) – nom couramment employé pour les Quartiers de Sécurité Renforcée (Q.S.R.) – qui avaient été créés par le décret du 23 mai 1975, faisaient l’objet de multiples critiques. Ils avaient été brillamment mis en accusation par Jacques Mesrine (1977) et Roger Knobelspiess (1980). Pourtant, ils perdurent aujourd’hui, souvent dans les mêmes lieux, simplement rebaptisés Q.I. et rénovés, comme à Fresnes (Val-de-Marne), à La Santé (Paris) ou à Saint-Joseph (Lyon). Cesare Battisti (1998, 146) dresse ainsi cette acerbe comparaison entre les Q.H.S. et les Q.I. : La différence se trouvait dans les lits de contention détrônés par des appareillages électroniques, tandis que les habituels matons brutaux et analphabètes étaient supplantés par de jeunes gardiens tout imbus de psychologie criminelle. J’étais maintenant locataire d’une cellule blanche aseptisée, tout entière à ma disposition avec douche, matelas ignifugé, table et tabouret anti-chocs, nourriture aux normes du ministère de la Santé.
L’affectation des détenu(e)s et leurs transferts
Selon l’article D. 53 du Code de procédure pénale, l’affectation en maison d’arrêt est du ressort du siège de la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle le prévenu doit comparaître, mis à part pour les délits/crimes qualifiés de « terroristes », instruits et jugés à Paris. Cette situation obéit aux contraintes liées à l’instruction de l’affaire, l’autorité judiciaire pouvant demander l’extraction du prévenu chaque fois qu’elle l’estime utile ou que le prévenu dépose une demande de mise en liberté.
Or nombre de personnes sont inculpées de délits/crimes commis loin du lieu de résidence de leurs proches. Ainsi, beaucoup de prévenus, résidant habituellement à l’étranger ou dans les départements et territoires d’outre-mer, sont incarcérés en métropole, où ils sont particulièrement isolés. La situation contraire existe aussi : français détenus à l’étranger et métropolitains incarcérés dans les DOM-TOM. Notre recherche n’évoquera pas davantage leur cas, mais signalons ici le soutien que leur apporte l’association Français Incarcérés au Loin (FIL). Les contraintes de l’instruction sont généralement comprises et admises par les proches et les prévenus. L’attente, parfois longue, du procès, une fois l’instruction terminée, est, à l’inverse, souvent contestée : l’éloignement du lieu de résidence des proches est vécu comme une mesure punitive à part entière, c’est-à-dire une condamnation avant la condamnation.
Une fois la peine prononcée, les détenus peuvent demander l’affectation à un établissement pénitentiaire à proximité de leur famille et/ou de leurs proches. Mais la surpopulation carcérale et la carte pénitentiaire limitent, de fait, le « rapprochement familial ». Ce problème est particulièrement aiguë pour les femmes, puisque les seuls établissements pour peines les recevant se situent dans le nord de la France (Rennes, Joux-la-ville et Bapaume). En cas de rapprochement familial », la carte pénitentiaire peut aboutir à des situations aberrantes. Noël, détenu au centre de détention de Caen, raconte ainsi : « L’absurde, c’est que j’ai été mis ici pour le rapprochement familial. Mais ça fait tout de même que je suis à 450 kilomètres de chez mes parents, soit 900 aller-retour… » Les procédures d’affectation sont, dans tous les cas, compliquées et longues, suivant la voie hiérarchique. D’autre part, l’absence de motivation des décisions d’affectation diminue leur légitimité auprès de la population carcérale et beaucoup de détenus en sont insatisfaits. Ainsi, en 2001, 20% des détenus des centres de détention nationaux et 10,9% des détenus des centres de détention régionaux ont demandé un changement d’affectation. Or ces demandes ne sont pas forcément prises en compte, comme le raconte Alain (maison centrale de Clairvaux), réclamant pour la troisième fois un rapprochement familial. Nombreux sont les témoignages de détenus confirmant les propos de Pascal (maison centrale de Clairvaux), qui déclare que « tous [ses] transferts ont été faits au détriment de la famille ».
On apprenait, le 16 mars 2001 (Libération), qu’un détenu de la maison centrale de Saint- Maur (Indre) avait incendié le bureau des surveillants car il demandait depuis sept mois un transfert pour être rapproché de sa famille. Sept jours après l’incendie, sa demande de transfert était acceptée. Ce fait divers, rapporté par la presse, confirme les propos de beaucoup de détenus rencontrés qui expliquent que l’obtention d’une affectation à proximité des proches est « affaire de stratégie », dans laquelle le recours à la violence a sa place et parfois son efficacité, « pour la bonne cause » : Quand ils ont voulu me transférer à R***, je l’ai dit à la juge que je ne voulais pas. R***, c’est trop loin de chez moi… Alors, ce que j’ai fait, quand je suis arrivé au greffe, c’est que je me suis dit : « Il faut que je frappe quelqu’un. » Y avait un détenu libérable, j’lui ai défoncé la tête. Ils se sont dit : « Il fout le bordel, on n’en veut pas. » Et c’est comme ça que je suis reparti à V***. J’ai fait ça à un libérable parce qu’il s’en fout, demain, il est dehors, il se recoud la lèvre, et voilà ! En plus, l’Administration, elle s’en fout quand c’est un détenu… Si c’est un surveillant, c’est pas la même ! (Fayçal, centre de détention de Bapaume)
le C.N.O. ET L’E.P.S.N. F. : Fresnes, un outrage aux familles
Le centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) mérite une attention particulière. Il est composé de plusieurs bâtiments : une Maison d’Arrêt des Femmes (MAF) où sont incarcérées une petite centaine de détenues, un Hôpital pénitentiaire, de 216 places, dont une dizaine pour des femmes, et le « Grand Quartier ». Ce dernier est l’une des plus grandes maisons d’arrêt pour hommes de la région parisienne (avec environ 1 500 détenus) : elle abrite en outre le Centre National d’Observation (C.N.O.).
La répartition des condamnés s’est longtemps limitée à la nature juridique de leur peine. Les condamnés à une peine criminelle de travaux forcés perpétuelle ou à temps étaient dirigés vers les bagnes, d’abord situés en France, puis à partir de 1854, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. En deçà de ces peines, les condamnés se répartissaient entre les « maisons de force » (pour les criminels) et les « maisons de correction » (pour les auteurs d’actes relevant du correctionnel). Au terme de « classification » (Fulrat, 1992, 287), s’est substitué, pour les courtes peines, celui de « répartition » et, pour les longues peines, celui « d’orientation » (art. D. 69-1 et D. 77 du Code de procédure pénale).
Créé en 1950, le Centre National d’Observation (C.N.O.) – qui s’appelait à l’origine Centre National d’Orientation – est situé dans la deuxième division du Grand Quartier du centre pénitentiaire de Fresnes. Le personnel (psychologues, assistantes sociales, surveillants, etc.) procède à l’observation et à l’orientation de 124 détenus par sessions de six semaines. Le passage au C.N.O., qui n’a pas d’équivalent chez les femmes, est obligatoire pour les condamnés dont le reliquat de peine est égal ou supérieur à dix ans au moment où la condamnation devient définitive. Il arrive aussi que, en raison de la personnalité du détenu, il soit dérogé à cette limite. Se retrouvent donc au C.N.O. des condamnés originaires de la France entière (y compris des DOM-TOM).
Mais à la session de six semaines, s’ajoutent, pour les détenus et leurs proches, les mois d’attente à Fresnes, avant et après la session (souvent douze à dix-huit mois pour un transfert en maison centrale ou en centre de détention). La commission d’enquête du Sénat (Hyest, Cabanel, dir., 2000) suggérait d’ailleurs la suppression du C.N.O., considérant que celui-ci a « plus d’inconvénients que d’avantages ». Ainsi, Noël qui est passé par le C.N.O. avant d’être affecté au centre de détention de Caen, raconte : « L’attente au C.N.O. est insupportable. Je suis resté près de deux ans à Fresnes. On doit attendre comme si on n’existait pas… On a le droit de rien, c’est épouvantable. » La frustration est certainement d’autant plus grande que les souhaits d’affectation formulés par les détenus sont rarement satisfaits, confirmant l’impression de temps perdu. D’ailleurs, les avis donnés par le personnel du C.N.O. sont souvent ignorés par le ministère de la Justice, qui décide, en dernière instance, des affectations. Cela renforce le sentiment des détenus d’être l’objet d’une mystification.
Lors du passage au C.N.O. (et plus généralement de l’attente à Fresnes), les détenus ont beaucoup de difficultés à maintenir les liens avec leurs proches vivant loin de la région parisienne, d’autant que les parloirs sont réputés y être « les pires de France ». Ainsi, Alban, qui a passé onze ans en prison, raconte le délitement des liens avec ses proches, lors de son passage à Fresnes : Je vois, quand j’étais à la maison d’arrêt de B***, j’avais plein de parloirs… J’avais 26 permis de visite ! Ça allait… Et puis, quand je suis arrivé au C.N.O., bah, ils ne m’ont plus trop écrit. J’leur en veux pas, je sais que c’est pas facile d’écrire, mais c’était dur. En plus, je savais qu’ils viendraient pas jusqu’au parloir… Ça faisait quand même plus de mille bornes aller-retour… Et vu que je suis resté pas mal de temps là-bas, j’ai douillé…
Les carences de la Justice et de l’Administration pénitentiaire
L’obtention d’un permis de visite pour une proche incarcéré n’est pas automatique. Les démarches sont rarement simples : pour les personnes ayant des problèmes d’écriture, la rédaction d’une lettre à une administration est déjà un obstacle. Les autorités compétentes (le directeur de l’établissement ou le juge d’instruction dans la plupart des cas) sont en outre souvent surchargées. Ainsi, pendant l’été 2003, la direction de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), où sont incarcérées plus de 4 000 personnes – dont plus d’un tiers de condamnés –, annonçait que 1 600 demandes de permis de visites pour des condamnés étaient en souffrance et le délai minimum d’obtention était de trois semaines (Dedans dehors, juillet 2003, 38, Le Parisien, 14 juillet 2003). La présentation d’un certain nombre de documents (voir Annexes, doc. 3.a) est exigée, afin notamment de faire valoir les liens avec le détenu. Quand la personne est prévenue, il est rare qu’un permis soit délivré à des personnes extérieures à la proche famille. Le Conseil d’Etat, par sa décision du 9 août 2001 (aff. Aït-Taleb), a confirmé le bien-fondé d’un refus de permis de visite à une personne n’appartenant pas à la famille (voir Annexes, doc. 3.b), décision contre laquelle il n’existe pas de recours tant que le détenu est prévenu. Le problème se pose aussi lorsque les liens n’ont pas été officialisés par un mariage : des compagnes « de fait » se voient refuser le permis, contrairement à l’épouse légitime. En outre, les enfants n’obtiennent pas toujours le droit de visite au parent incarcéré. Ainsi, début 2002 (Dedans dehors, mai 2002, 31), le Parquet général de la cour d’appel de Versailles refusait systématiquement d’accorder des permis de visite pour les enfants des détenus âgés de sept à seize ans, « sauf circonstances particulières ».
Les éléments pris en compte pour l’attribution du permis de visite interdisent généralement aux ex-détenus l’accès au parloir. Le combat d’Annie, pour obtenir un droit de visite à l’ami avec qui elle vivait, avant leur incarcération, maritalement (et avec qui elle s’est depuis mariée, en prison), est exemplaire : Quelques mois avant, j’étais incarcérée à R*** pour finir ma peine. J’ai eu plusieurs permissions pour aller voir M*** [son ami], qui était déjà en centrale, L***. Quand j’ai été libérée, juste à ce moment-là, la prison de L*** a eu un nouveau directeur. Et alors que mon permis aurait dû être valable en permanence, puisqu’il datait de l’arrestation de M*** cinq ans avant, le directeur a décidé de le supprimer. Pendant plusieurs mois, je n’ai pas pu le voir. Il a entamé une grève de la faim et déjà nous avons « menacé » de nous marier médiatiquement. Le directeur a alors décidé que je pourrais venir le voir de temps en temps, mais qu’il faudrait que je lui demande une autorisation spéciale chaque fois. Cela a duré deux ans je crois. Un autre directeur l’a remplacé. Et quand je l’ai appelé pour lui demander l’autorisation spéciale, il est tombé des nues en me disant : « Mais vous avez un permis permanent, pourquoi m’appeler ? »
Une fois l’attribution du permis notifiée (voir Annexes, doc. 3.c), les personnes doivent réserver leur « tour » de parloir, à part dans quelques établissements où les visiteurs se présentent sans rendez-vous (surtout dans des maisons centrales, comme à Poissy) ou qui laissent aux visiteurs la possibilité de venir sans rendez-vous s’il reste des places (comme à Perpignan). La prise de rendez-vous s’effectue généralement sur place ou par téléphone, parfois par minitel, et désormais, dans beaucoup d’établissements, par borne électronique. La multiplicité des moyens mis en œuvre a peu réduit les difficultés des proches à obtenir ces rendez-vous, notamment dans les maisons d’arrêt (en particulier dans les plus grandes).
Ainsi, la saturation des lignes téléphoniques permettant la réservation des parloirs de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) est légendaire : la presse s’en fait régulièrement l’écho (Le Parisien, 28 janvier 2003, 16 juin 2003). Début 2001, 243 proches de détenus de la prison Saint-Michel à Toulouse (Haute-Garonne) avaient signé une pétition pour protester contre un système de réservation se faisant le jour même pour l’après-midi par téléphone (Dedans dehors, juillet 2001, 26). En décembre 2001, des détenus des quartiers Saint-Paul et Saint-Joseph de la maison d’arrêt de Lyon (Rhône) ont adressé au directeur une pétition protestant contre un délai d’attente pouvant aller jusqu’à deux heures lors des réservations de parloir par l’unique ligne téléphonique existante (Le Progrès, 28 décembre 2000). Sans doute que la réservation des parloirs souffre, dans de nombreux établissements, du nombre insuffisant de personnels au standard. Ainsi, en l’an 2000, une seule personne répondait aux appels des proches pour réserver les parloirs à la maison d’arrêt des Baumettes, où 1 600 personnes sont détenues (Dedans dehors, juillet 2000, 20). En 2000, à la maison d’arrêt de Toulouse (Haute-Garonne), la surpopulation et l’encombrement du standard téléphonique rendaient difficile l’exercice du droit de visite (Dedans dehors, septembre 2000, 21).
|
Table des matières
INTRODUCTION
I. La genèse dun objet
II. Les problématiques de la recherche
III. Lenquête : méthode et difficultés
PREMIERE PARTIE : LEPREUVE DE LA SEPARATION
I. Le système pénitentiaire et le maintien des liens familiaux
II. Des obstacles à la solidarité des proches
III. Le « choc carcéral » et les premières ruptures
IV. Isolements subis et solitude choisie
DEUXIEME PARTIE : LES INFORTUNES DE LA SEPARATION
I. Des relations ordinaires et singulières
II. Le parloir : entre joies, chagrins et galères
III. Le courrier, le téléphone, les messages radio et laide financière
TROISIEME PARTIE : LA PRISON EN PARTAGE
I. Tomber
amoureux
II. La parentalité et lincarcération
III. Deuils irréels, deuils impossibles
QUATRIEME PARTIE : PRATIQUES, IDENTITES ET REPRESENTATIONS SEXUELLES
I. Lidentité sexuelle, le désir et les frustrations
II. Les formes dune pseudo-hétérosexualité
III. Pratiques homosexuelles, discours hétérosexistes
CINQUIEME PARTIE : LA LIBERTE DEVANT SOI
I. Un dehors si loin
II. Sort-on jamais de prison ?
SIXIEME PARTIE : LA PRISON, UN PROJET POLITIQUE
I. La prison et les mobilisations collectives
II. La modernité et le dévoilement de la fonction carcérale
CONCLUSION
I. Les principales conclusions de lenquête
II. Lenquête face aux contraintes carcérales
BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES
Télécharger le rapport complet