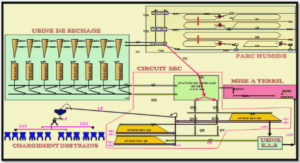DESCRIPTION ET INTERPRÉTATION DES BASES IMPÉRATIVES AI- ET SOI-
L’ancien français, prenant le relais du latin où ces tournures étaient devenues courantes, a maintenu l’emploi du subjonctif en proposition indépendante, avec des effets de sens s’apparentant à l’injonction, au souhait80. Toutes ces tournures, assez diverses, ne relèvent pas de notre étude. Cependant, de façon à établir précisément la continuité systématique dont les bases impératives ai- et soi- sont le signe dans la langue, nous nous intéresserons ici préalablement à un cas particulier de ces tours. Il s’agit des propositions indépendantes à la troisième personne engageant le plus souvent le sujet « Dieu » et un verbe transitif direct ou indirect au présent du subjonctif. Ces formules de sens optatif sont bien attestées et relativement variées en ancien français ; en voici trois exemples, tirés respectivement des trois premières coupes synchroniques de notre période : Roland, 3358 Dient Franceis : « Damnedeus nos aït ! » Robin, 12, le chevalier à Marion : Bergiere, Diex vous doinst bon jour ! Ovide 531, Jason à Médée : Si gart Dieux mon cors de meschief / Et si me doinst il traire à chief / Ceste besoigne à sauveté, / Com je sans nulle fausseté / Vous prendrai à feme et à per, / Se Diex vif m’en done eschaper. 80 Martin et Wilmet, 1980, p. 51, caractérisent pour le moyen français le lien entre l’emploi du subjonctif dans des propositions indépendantes et l’effet de sens injonctif ou optatif. Leur analyse peut tout à fait sur ce point être étendue en amont de l’histoire de la langue. Le sujet « Dieu » apparaît ici sous différentes formes. Ce qui, du strict point de vue linguistique, nous semble fonder essentiellement la possibilité qu’il apparaisse comme sujet dans de telles formules, ce n’est pas tant son nom ou son identité, qui peuvent varier, que sa qualité universellement reconnue, dans l’univers de croyance considéré, de garant de l’efficacité pragmatique de la formule. D’autres personnages ou puissances spirituelles peuvent à l’occasion remplir ce rôle pragmatique de garant, et, par suite, la fonction syntaxique de sujet dans ces formules. En vertu de la nature référentielle du prédicat verbal au subjonctif, événement sur lequel la volonté humaine individuelle n’a pas de prise, et dont par conséquent, dans l’univers de croyance médiéval, seule une puissance surnaturelle peut décider, nous pouvons toutefois induire que l’ensemble de ces garants possibles est fortement déterminé et limité en langue même. La théologie médiévale, qui distingue absolument le Créateur des créatures, le monde invisible du visible81 , s’incarne donc en quelque façon dans la langue. A l’intérieur de l’ensemble des substantifs désignant en ancien français un être animé (pourvus du trait structural <+A>), convenons donc d’isoler ceux qui peuvent en effet assumer la fonction de sujet dans ces formules optatives à la troisième personne : nous dirons qu’ils sont pourvus du trait <+G>, trait qui les rend aptes en langue, et dans l’univers de croyance propre à cette époque, à être considérés comme les garants/sujets de telles formules, parce que l’être auquel il réfèrent est très littéralement pensé comme l’auteur possible de l’événement qu’exprime le prédicat verbal. Ainsi, « Dieu » ou « l’aversier » (le Diable) sont pourvus en ancien français du trait <+G>, alors que « Roland », « une bergiere », sont eux absolument dépourvus de ce trait, et ne peuvent remplacer de façon pertinente les substantifs <+G> dans ces formules. Une étude particulière pourrait certainement montrer que ces propositions indépendantes engageant un sujet <+G> et un verbe transitif au subjonctif sont également bien représentées en amont dans l’histoire de la langue, en latin, en proto-français. Nous en voulons seulement pour preuve un indice tiré de l’un des textes les plus anciens de notre corpus, Li quatre livre des Reis, traduction en ancien français de la Vulgate. Voici la version latine d’une parole que Saül adresse à Jonathan, suivie de sa traduction en français du XIIe siècle : Liber primus Samuhelis XIV, 44, et ait Saul haec faciat mihi Deus et haec addat / quia morte morieris Ionathan Reis XIV, 44, Respundi Saül : « Icel mal vienge sur mei ki venir deit sur tei, si tu n’en muerz, dan Jonathas ! » Nous tirons de ce simple exemple deux enseignements. D’une part, ce genre de propositions indépendantes optatives à sujet <+G> et à verbe au subjonctif est en effet attesté en latin chrétien du Ve 81 Duby, 1996, p. 319 à 347 précise en historien comment cette distinction proclamée dans le Credo a pu fonder très précocement, dans la mentalité médiévale, un réseau d’analogie et d’harmonie. siècle, au moins sous la plume de Saint Jérôme. Qu’il ait ou non été attesté auparavant dans la langue latine classique, il répond en tout cas au besoin de traduction non seulement d’imprécations comme celle-ci82, mais aussi de bénédictions ou malédictions bibliques, récurrentes83 dans le texte hébraïque dont disposait Jérôme pour établir la version latine. D’autre part, on peut remarquer que l’ancien français ne traduit pas explicitement, dans cette occurrence, le sujet <+G> « Dex », ce qui tendrait à confirmer son statut particulier en langue : le garant pragmatique de l’imprécation est de référence si évidente qu’il en vient à être sous-entendu. L’étude thématique que J. Trenel a consacré, sur une très large diachronie, au « rôle de l’élément biblique dans l’histoire de la langue des origines au XVe siècle »84 tâche d’étayer de façon générale l’hypothèse d’une influence lexicologique précoce et durable des différentes manifestations cultuelles et culturelles médiévales du texte biblique sur la langue vernaculaire. Il est en particulier hautement probable que ce type de formules optatives est devenu (ou resté) vivant et fréquent de façon continue pendant tout le Moyen-Age, y compris celui dont nous n’avons pas d’attestation écrite. Le statut culturel du texte biblique, son emploi liturgique universel dans l’Occident latin permettent d’induire que ces formules ont pu être assimilées de façon continue par les langues vernaculaires filles du latin (ce qui limitait les efforts de transposition), ou, du moins, si elles n’en sont pas l’origine unique, qu’elles les y ont accompagnées très favorablement, et en ont, pour une part, permis le développement. Cette hypothèse s’accorde au moins avec l’attestation statistique incontestable de ce genre de formules dans les contextes d’énonciation les plus banals (et non spécifiquement religieux) de l’ancien français classique (XIIe et XIIIe siècles). Ces formules ont tout à fait pu se maintenir inchangées au sein d’une langue qui évoluait par ailleurs. Elles sont, par essence, conservatrices. L’on pourrait prendre comme argument d’appoint le cas de l’évolution diachronique d’un langue comme l’arabe sur, non plus sept, mais quatorze siècles. L’arabe nous est en effet une illustration vivante et incontestable de la possibilité linguistique d’une permanence continue, fortement attestée, et de la sécularisation de ce genre de formules optatives engageant un sujet <+G>. Des énoncés comme « Allah sallâm ealak » (« Dieu te garde, te protège »), ou encore « Allah hôd bétak », (littéralement : « Dieu prenne ta maison », le sens moderne est celui d’une désapprobation affaiblie, souvent 82 La Bible de Jérusalem, 12è éd., Paris, Editions du Cerf, 1988, signale dans une note à propos de Ruth, I, XVII, p. 309 toutes les occurrences dans le texte biblique de cette même formule : « C’est la formule du serment imprécatoire, cf. Nombres 5, 21 ; 1 Samuel 3, 17 ; 14, 44 ; 20, 13 ; 25, 22 ; 2 Samuel, 3, 9 ; 3, 35 ; 19, 14 ; 1 Rois, 2, 23 ; 2 Rois, 6, 31. En le prononçant, on précisait les maux qu’on appelait sur la personne visée, mais, l’efficacité des malédictions étant redoutable, le narrateur use pour les rapporter de cette formule indéterminée. » 83 Citons simplement les formules neutres du type « Dieu te bénisse » dans des contextes aussi variés que Genèse 28, 3, Nombres, 6, 24, Ruth, 2, 4, Psaume 67, 8, Jérémie, 31, 23. 84 Trenel, 1904. On se reportera en particulier aux p. 37 à 58 dans l’introduction de cette thèse, qui évoque très généralement les expressions bibliques passées dans la langue courante, ainsi qu’aux p. 268, et 318-320, où certaines expressions au subjonctif engageant <+G> sont relevées en diachronie. même amusée, envers une faute vénielle), sont très courants et vivants aujourd’hui encore dans l’arabe de la rue. Toutes proportions gardées, ils nous donnent une idée de ce que pouvaient signifier pour l’homme du Moyen-Age les formules équivalentes, aujourd’hui rares ou disparues, de l’ancien français. Or, un énoncé vivant en langue n’est précisément jamais isolé, tant qu’il reste vivant, du reste du système de la langue. Ces formules optatives sont des tournures actives engageant un sujet (<+G>) fortement déterminé. On peut supposer, de la même manière, qu’auront été vivantes et fréquentes, dans toute la période de transformation du latin en français, les différentes tournures passives85 correspondant à ces formules. Or voici, tirées de la coupe synchronique du XIIe siècle, quelques-unes de ces tournures. On reconnaîtra des traductions de la Vulgate, et, pour peu qu’on suive le même raisonnement, pareilles attestations culturellement marquées tendent à confirmer l’hypothèse du maintien continu, du latin au français, de l’usage de ces formules passives : Reis XV, 13, E cume il vit Samuel, erranment li dist : « Beneit seies tu de nostre Seignur Deu, kar jo ai acumpli sun cumandement » Perceval 1672, De toz les apostres de Rome / Soiez vos beneoiz, biau sire, / Qu’autel oï ma mere dire. Roland 1045, Seignurs Franceis, de Deu aiez vertut ! / El camp estez, que ne seium vencuz ! La langue marque ici la correspondance entre les tournures optatives actives à la troisième personne engageant un sujet <+G> et ces tournures passives à la deuxième personne par la conservation formelle du mode subjonctif86 . Certaines propriétés syntaxiques ou pragmatiques évidentes auraient pu cependant la déterminer à imposer dans ces tournures une base impérative, dérivant directement des étymons es(te), habe(te) : une apostrophe est le plus souvent adjointe au syntagme verbal ; la situation est celle d’une interlocution stricte, ce qui induit formellement une deuxième personne. Tous ces faits semblent indiquer que ces formules instituent elles-mêmes le sujet de leur procès. Ces tournures se distingueraient donc essentiellement de leurs équivalents optatifs actifs à la troisième personne évoqués plus haut.
DESCRIPTION ET INTERPRÉTATION DES BASES VERBALES PARTIELLEMENT OU SPORADIQUEMENT SUBJONCTIVES
Les trois bases impératives ai-, soi- et sach- ne sont pas absolument les seules que le mode impératif ait empruntées historiquement au subjonctif tout au long de notre diachronie. Mais c’est sans doute leur emploi précoce et définitif comme bases d’impératif qui a pu entraîner par analogie des emprunts morphologiques plus tardifs et moins exclusifs de l’impératif au subjonctif. Certains autres verbes fonctionnellement proches de ces trois bases auront également recours à l’emprunt morphologique au subjonctif pour former leur impératif. C’est en particulier et d’abord le cas des verbes vouloir, pouvoir,faire et venir, dont les morphologies, sans l’être exclusivement, sont tout de même assez régulièrement et parfois très continûment empruntées au subjonctif. Nous relevons ainsi, dès la première moitié de notre diachronie, une hésitation de ces quatre bases verbales entre la morphologie subjonctive et une morphologie génétique ou indicative. Nous suivrons le fil linéaire de l’évolution de ces quatre bases siècle après siècle, de façon à bien faire apparaître les nuances diachroniques. Au XIIe siècle, l’impératif de pooir n’est pas attesté dans notre corpus, contrairement à celui de voloir :
Adam 1470, Jérémie : Oëz de Deu sainte parole, / Tot vus qui estes de sa scole, / Del bon Judé la grant lignee, / Vus chi estes de sa maisnee ! / Par ceste porte volez entrer / Por nostre seignor aourer.
Cette forme volez est la forme P5 d’indicatif présent la plus fréquente à cette époque. Le subjonctif équivalent n’apparaît jamais sous cette forme en synchronie. Force est donc de reconnaître que l’impératif de voloir apparaît de façon privilégiée sous une morphologie indicative à cette époque, et ce, sans qu’on puisse la rattacher à un sens plus particulier, comme ce peut être le cas en français moderne. Dans la même coupe synchronique, le verbe venir apparaît lui clairement sous deux morphologies :
Erec et Enide 387, Biax sire, fet il, bien vaingniez.
Erec et Enide 827, Bele, fet il, avant venez, / L’oisel a la perche prenez, /Car bien est droiz que vos l’aiez.
Perceval 941, Biau sire, bien vaigniez.
Perceval 1743, Et dient : « Sire, venez anz. »
L’on doit noter que le verbe apparaît dans les mêmes textes sous deux morphologies différentes, ce qui exclut d’emblée une explication de la nuance par des faits dialectaux. La base vien/ven- est une base impérative étymologique, tandis que la base palatalisée vai(n)gn- est empruntée au subjonctif. Manifestement, celle-là correspond à l’emploi impératif le plus général du verbe, tandis que celle-ci paraît réservée à un seul type d’emploi, la formule de bienvenue bien vai(n)gniez. Cette répartition correspond clairement à une nuance d’ordre modal. Venez institue réellement un procès non avéré, et relève donc exclusivement de la modalité d’institution. En revanche, la formule (bien) vai(n)gniez, en antéposant l’élément axiologique, institue surtout les conditions favorables d’un procès déjà avéré que par ailleurs elle commente, dont elle dit quelque chose, selon l’équivalence :
1 Prédication : (je constate que) vous venez )
2 Institution : venez dans de bonnes conditions ) => 3 A. F. Bien vaigniez
Cette formule semble donc ambivalente, intermédiaire entre les deux modalités, institution et prédication. L’emprunt au mode subjonctif peut donc très simplement s’interpréter dans ce cas comme l’effet d’une analogie fonctionnelle avec les formules similaires engageant la base soi-. Les formes contemporaines les plus proches qu’il relève sont voliez (3 occurrences) et vuliez (1 occurrence). Cette double morphologie est notamment signalée par Le Goffic, 1997, p. 127, et rapportée à une différence d’usage. Nous aurons l’occasion de revenir sur l’interprétation systématique de ce genre de tournures dans notre partie de syntaxe. Le placement devant le verbe, dans le syntagme verbal, d’un élément conjoint, en est en effet caractéristique. également montré l’ambivalence modale. On est ici à la limite systématique du mode impératif, et l’on pourrait parler, pour caractériser ces tournures hybrides, de tours optatifs. Comme les bases ai- et soi-, la base veign- constitue donc un indice de la continuité toujours possible entre les deux modalités. Cette interprétation paraît largement confirmée par la prise en compte d’occurrences qui, à la même époque, engagent formellement à la fois la base impérative soi- et une forme participiale du verbe venir :
Cligès 361, Amis, fet il, ne refus mie / Ne vos ne vostre conpaignie, / Mes bien veignant soiez vos tuit.
Renart 772, Tybert, par vostre male joie / Et par vostre male aventure / Soiez venus en ma pasture !
Renart 780, Tybert, ce dist Renart, welcomme ! / Se tu venoiez or de Rome / Ou de seint Jaque frescement, / Bien soiez venus hautement / Comme le jor de pantecoste.
Comme dans les formules passivées citées plus haut104, un élément axiologique (bien, mal) est engagé. La nuance entre les deux participes induit ici dans les formules résultantes celle de l’aspect : immanent pour la première, transcendant pour les secondes. Cet aspect transcendant du participe venus n’est pas ici engagé dans une tournure passive, contrairement à ce qui se passait avec beneit : l’effet de sens accompli est donc davantage sensible, et l’on peut considérer que venir est l’un des rares verbes de la langue dont l’impératif accompli est très régulièrement attesté jusqu’en moyen français. Nous relevons aussi à la même époque une occurrence où l’impératif du verbe faire emprunte sa morphologie radicale au subjonctif : Reis III, 3, Fachum venir l’arche Deu de Sylo, é seit od nus que Deu nus salved de noz énemis. Sans doute faut-il également entendre dans cette formule une nuance optative (et donc ambivalente du point de vue modal) plutôt que strictement jussive : cette particularité la rapprocherait fonctionnellement des formules précédentes. Au XIIIe siècle, cette base fac(h)- n’apparaît plus à l’impératif qu’en contexte de subordination : Tristan 101, Adont se tourne Lanselos vers le signeur du castel et li dist : « Je te conmant sour la foi que tu m’a donnee que, se tu as prisons en ton castel, que tu tot maintenant les faces delivrer. » Villehardouin 84, Seignor, je avoie de ceste ville plait a ma volonté, et vostre gent le m’ont tolu ; et vos m’aviez convent que vos le m’aideriez a conquerre, et je vos semon que vos le façoiz. Manuscrits BCDE : faciez Villehardouin 68, Nos vos proions por Dieu que vos l’otroiez et que vos le façois et que voz en viegnés avec nos. A une époque où l’on observe de nombreux cas de syntagmes impératifs subordonnés, le problème spécifique que pose ce genre d’occurrences de sens clairement jussif est précisément de déterminer s’il s’agit bien d’impératif105, malgré l’exacte coïncidence de la forme et de l’emploi avec le subjonctif. La langue n’a pas encore développé à cette époque une conception vraiment exclusive des différents paradigmes verbaux
PRESENCE DIACHRONIQUE DU FORMANT /J/ DANS LES FORMES FAIBLES D’IMPERATIF
Le concept de « formant » a été forgé par Maurice Molho, qui s’en explique dans au moins deux articles. Dans le premier, plaidoyer théorique en faveur du principe très guillaumien de la confiance a priori envers le signifiant, il caractérise les formants comme « des cellules signifiantes en travail dans l’organisation du tissu systématique constitué par l’indissociation du physisme et du mentalisme»136. Il précise cette image dans le second article, et formule notammment le trait différentiel spécifique qui permet de définir le formant : C’est précisément signifié propre, si général soit-il, qui fait la différence du formant et du phonème phonologique. Même si le formant se présente (…) sous l’espèce d’un phonème, il n’appartient pas à la même articulation du langage : le phonème ne signifie qu’au négatif, par opposition ; le formant, quant à lui, est porteur d’un signifié positif, intrinsèque, générateur par voie d’analogie d’un champ de signifiance dont il est la cause diffluente.137 Ce concept, à la charnière de la phonétique et de la sémiologie, a été récemment repris et élargi par Christiane Marchello-Nizia pour rendre compte du constituant -i- qui apparaît dans des morphèmes grammaticaux d’ancien français a priori aussi divers que il, li, cist, cil, si ou ci138 . Olivier Soutet l’évoque 135 Notamment Molho, 1986, p. 49-50 et Molho, 1988. 136 Molho, 1986, p. 50. 137 Molho, 1988, p. 292. 138 Marchello-Nizia, 1995, p. 178. avec prudence à propos du parallélisme sémiologique entre les couples se/si et ne/ni en ancien français139 , et de façon plus affirmative à propos du /j/ d’origine palatale qui intervient dans les formes subjonctives anciennes sachiez et veuilliez : concernant les formes d’impératif, qui, comme on sait, se distingueront des formes du subjonctif en devenant historiquement sachez et veuillez, il en vient même à parler de « soustraction de formant »140 . Nous souhaitons précisément approfondir ici cette dernière question dans le détail de notre diachronie. Nous considérerons nous aussi que ce /j/ qui apparaît puis disparaît dans les formes faibles d’impératif est un formant, c’est-à-dire, en diachronie, un phonème apparemment non signifiant à l’origine, mais appelé à devenir morphème. Nous examinerons d’abord le premier tiers de notre période (XII-XIIIe siècles), qui constitue comme on verra une synchronie significative et cohérente. L’élément /j/ apparaît en ancien français dans certaines bases verbales seulement, et il concerne toujours la syllabe tonique des formes faibles, dont l’accent porte sur la désinence. On distingue ainsi, dès le terminus ad quem de notre période, des formes faibles sans /j/ : Cligès 1829, Seignor, fet il, sanz contredit, / Se vos volez m’amor avoir, / Ou face folie ou savoir, / Creantez moi ma volanté. Renart 506, Qar, sire Brun, vos ne savez, / L’en dit a cort : « Sire, lavez » / A riche home, quant il i vient. Roland 1976, Sire cumpaign, a mei car vus justez ! Et des formes faibles qui voient se développer, entre la base et la désinence, un /j/, le plus souvent orthographié « i » : Le Charroi 659, Sire Guillelmes, por Dieu, ne vos targiez. Guillaume 1234 – Ha ! fait il, bele douce amie, / Por Dieu, ne vos despisiés mie, / Ne çou ne recuidiés vos pas, / Que rien vos aie dit a gas. Renart 1837, Sire, dist Ysengrin au roi, / Por amor Deu, bailliez le moi, / Et j’en prendrai si grant venchance / Qu’en le saura par tote France. Ces formes sont à rattacher aux étymons tardicatis, despicetis141, cogitatis, bajulatis : toutes ces bases, du fait de leur composition consonantique, se sont palatalisées dans l’évolution phonétique, ce qui a induit ensuite une modification en ié du timbre de la voyelle désinentielle à tonique conformément à la loi de Bartsch. N. Andrieux et E. Baumgarnter142, considèrent que -ié ou -é sont des morphèmes qui marquent 139 Soutet, 1992b, p. 240. 140 Soutet, 1997, p. 120. 141 Cette forme, qui ne relève pas de la première conjugaison latine, a été soumise en ancien français à de forts effets analogiques. Voir Fouché, 1967, p. 171. 142 Andrieux et Baumgartner, 1983, p. 52 et 53. spécifiquement que le verbe relève de la première conjugaison (-ier < -are) ; elles interprètent ainsi la présence ou l’absence du /j/ (marquées respectivement à l’écrit par -ié ou -é) dans les formes verbales de l’ancien français : A l’infinitif, au participe passé et au passé défini P6, c’est, selon les verbes, ou é ou ié qui apparaît, aucune alternance ne se produisant entre ces deux formes pour un verbe donné. D’où la question : é et ié sont-ils deux morphèmes différents ou deux réalisations d’un même morphème ? L’opposition é vs ié est toujours corrélée à celle de ez vs iez à P5 des indicatif et subjonctif présents, à celle de ons vs ons//iens à P4 du subjonctif présent. Cette convergence répond au phénomène phonétique dit « loi de Bartsch » où s’opposent l’évolution en /je/ du /a/ latin accentué et libre derrière palatale et celle du même phonème en /e/ ailleurs. De ce fait, l’hésitation ne semble pas permise quant à l’interprétation du i notant /j/ dans ié : /je/ étant l’aboutissement phonétique du seul /a/ latin, origine commune donc à /e/ et /je/, le /j/ noté i est un constituant du morphème ié. Il serait, d’autre part, non seulement inutile de supposer que i graphique note le trait palatal de la consonne finale de la base, mais faux, comme suffit à le prouver la forme en iens qui, ne s’opposant pas à *ens, ne peut s’analyser en B + ens.é et ié sont deux réalisations d’un même morphème, variantes combinatoires l’une de l’autre. Elles sont toujours en distribution complémentaire, ié s’adjoignant aux bases à finale palatale, é aux autres.Ces formes sont toujours toniques. Nous devons adapter à l’impératif cette analyse pertinente pour les formes d’infinitif, de participe ou de la P6 de passé simple. Les groupes graphiques finaux d’impératifs faibles -(i)ez ou -ons, iens ne peuvent être tenus, comme (i)é, pour des morphèmes démarcateurs du type de conjugaison, ceci pour deux raisons. Tout d’abord, ces groupes finaux incluent des désinences de P4 ou de P5 communes à tous les types : sans négliger la solidarité phonétique historique qui lie dans ces formes le /j/ à la voyelle qui suit, nous devons toutefois le distinguer analytiquement de la désinence, -ons ou -ez, morphèmes généraux dans les paradigmes de présent. D’autre part, la « corrélation » universelle ou la « convergence » évoquées cidessus entre l’apparition du /j/ dans les formes quasi-nominales et son apparition dans les formes verbales personnelles n’est pas bilatérale. Lorsqu’il apparaît synchroniquement dans les terminaisons de formes faibles -iens ou -iez de l’impératif, /j/ en est en effet le seul constituant non universel, particulier à certains verbes. Il n’est pas pour autant toujours corrélé (même si l’inverse est vrai) au morphème spécifique -ié dans les formes d’infinitif, de participe passé et de passé défini P6 du même verbe ; malgré une origine mécanique commune et l’évidente parenté phonologique, il ne joue donc pas dans le système sémiologique de la langue exactement le même rôle de « morphème démarcateur » du sous-groupe particulier de verbes palatalisés à infinitif en -ier au sein du premier type de conjugaison. En effet, on retrouve cet élément /j/ dans des formes faibles personnelles qui correspondent à d’autres types143 de conjugaison. Il apparaît en fait tout à fait mécaniquement dans tous les paradigmes impératifs dont les désinences de formes faibles sont susceptibles d’avoir été soumises historiquement à l’effet de Bartsch. Et cette condition phonétique est 143 Voir ci-dessus la forme despisiés. C’est de façon générale le cas aussi, indépendamment de leur infinitif, pour les formes en – iss-. Nous relevons ainsi en Guillaume 652 la forme reconnissiés. notamment réalisée aussi dans le cas des morphologies empruntées au subjonctif dont la base s’est palatalisée historiquement et qui relevaient d’un type de conjugaison autre que le premier (la voyelle modale tonique est alors a, support favorable de l’effet de Bartsch) : sachiez <*sapyatis, mais aussi vaingniez, veuilliez, puissiez, etc. Les occurrences suivantes attestent cette réalité morphologique dans le premier tiers de notre période : Perceval 242 – Sire, sachiez bien antreset / Que Galois sont tuit par nature / Plus fol que bestes an pasture. Erec et Enide 387 Biax sire, fet il, bien vaingniez. Garçon 21, l’aveugle : A ! mere Dieu, veuillié me aidier ! La perspective synchronique mise en œuvre ci-dessus doit en fait, s’agissant du /j/ des formes faibles d’impératif, être complétée par la prise en compte de son destin diachronique : elle seule sera vraiment apte à déterminer quel est réellement son statut sémiologique dans l’économie générale du système. En effet, à la différence de ce qui se passera pour l’infinitif ou le participe passé des verbes à base palatalisée de premier groupe, /j/ ne disparaîtra pas totalement du système des formes faibles des paradigmes de présent dans la langue, mais y acquerra au contraire une signification sémiologique particulière. Nous considérerons donc que ces groupes impératifs finaux -iens, -iez, observables en synchronie, sont constitués analytiquement d’un morphème désinentiel et d’un formant, /j/ : non encore morphématique, /j/ finira par le devenir dans le système d’oppositions modales de la langue
LA DESINENCE -ONS D’IMPERATIF
Nous retiendrons ici par commodité la forme classique et moderne de cette désinence, pour désigner l’ensemble de ses manifestations tout au long de notre période. Cette forme d’impératif en -ons est une production historique du français. Le paradigme d’impératif présent latin ne connaissait en effet que deux formes, excluant l’équivalent de la forme française en -ons. Cet ajout français au paradigme binaire de type latin a sans doute eu lieu à époque prélittéraire, puisqu’on en retrouve une trace ancienne dans l’un des plus anciens textes français : Cantilène de Sainte Eulalie 26 Tuit oram que por nos degnet preier / Qued avvisset de nos Christus mercit / Post la mort et a lui nos laist venir / Por souue clementia. Il est difficile en revanche de dater précisément cet ajout paradigmatique, faute de témoignages écrits. Plus d’ailleurs que la question de sa date d’apparition, c’est celle de la nécessité paradigmatique de cette forme nouvelle qui se pose d’emblée. Si le système morphologique du latin ignorait une telle forme, celui du castillan moderne l’ignore encore : l’occultation ponctuelle du principe d’économie des formes et l’effort consenti par le français dans la conception de ce nouvel élément du paradigme obéissent probablement à la nécessité de transformer en profondeur le système latin, en conférant à l’ensemble des deux termes faibles le statut de base significative du paradigme. Il nous faudra bien sûr interpréter cette nécessité, ce à quoi ne saurait parvenir qu’une présentation problématique et terminale de l’ensemble du paradigme impératif du français. Afin justement de rendre possible cette interprétation d’ensemble, nous devons d’abord analyser cette désinence en Ŕons en elle-même, tout au long de la période diachronique retenue. L’origine de ce nouveau terme en -ons du paradigme français d’impératif n’est pas mystérieuse : la plupart des spécialistes de morphologie historique s’accordent à y voir un emprunt analogique au mode indicatif, qui a toujours connu depuis le latin un paradigme à six formes personnelles. L’emprunt, caractéristique de certains verbes, d’une forme verbale au subjonctif, n’a pas concerné que la base, mais également l’ensemble des morphèmes ou signes extérieurs à la base : dans ces cas, la désinence -ons provient donc directement du subjonctif. Cet emprunt d’un terme des différents paradigme qui relèvent de la modalité de prédication pour constituer un nouveau terme du paradigme impératif (modalité d’institution) nous est un indice supplémentaire de la continuité systématique des deux modalités. Au XIIe siècle, le terme en -ons du paradigme impératif se présente sous trois types de formes : des désinences en -mes, et des désinences à timbre « on » (sous diverses orthographes), les unes asigmatiques, les autres sigmatiques. Le premier type de désinences est assez rare et probablement caractéristique du tout début de la période. L’exemple le plus significatif en est le suivant :
Roland 450 Dient paien : « Desfaimes la meslee ! »
Pareille forme en -mes peut être reliée directement à la morphologie latine ; c’est l’évolution phonétique qu’indique G. Zink : « faimes < *fag(i)mus ». Ces désinences semblent caractéristiques d’un très petit nombre de séries verbales, faimes, mais aussi dimes (distribution parallèle aux formes faites/dites), et est à rattacher aux formes indicatives contemporaines du verbe être, somes et esmes (cette dernière forme est rare, mais elle aussi comparable à estes). L’exemple de La Chanson de Roland est unique dans notre terminus a quo, ce qui tend à établir la rareté et le caractère résiduel de cette forme -mes à l’impératif. Ce genre de finale réalise déjà le timbre moderne de la désinence, et apparaît donc intermédiaire entre le type ancien -mes et les types incluant le timbre « on » : la variante plus moderne (alons) manifeste cette affinité avec le second type de désinences. Les spécialistes des dialectes français du Moyen-Âge associent en général cette désinence -onmes (également notée -omes, -ommes) au picard ou au wallon. Nous retrouvons cette finale jusqu’au XIIIe siècle, sollicitée sans doute par la rime :
Mahomet 1428 Mahommés a dit a ses hommes : / « Devotement Diu requerommes / Que, s’il li plaist, en ceste plache / Auchun signe certain nous fache / U auchune senefïanche, / Par coi soions en esperanche / De la loy k’il a a donner. »
Notre corpus comprend des occurrences beaucoup plus nombreuses de formes d’impératif concurrentes et contemporaines des verbes auxquels s’appliquent ce type ancien de désinences. Nous avons relevé la variante de l’occurrence du Charroi de Nîmes. Notons aussi l’autre morphologie correspondant à (des)faimes qu’atteste le corpus, dans laquelle on reconnaîtra une base subjonctive : Reis III, 3 Fachum venir l’arche Deu de Sylo, é seit od nus que Deu nus salved de noz énemis. Si le type en -mes est donc ancien et voué à disparaître, nous relevons en revanche assez souvent au XIIe siècle ce type asigmatique qui engage le timbre « on ». Les orthographes en sont diverses : Roland 229 Cunseill d’orguill n’est dreiz que a plus munt ; / Laissun les fols, as sages nus tenuns ! Adam 1074, Abel à Caïn : Preom lui qu’il nus doinst s’amor / E nus defende de mal noit e jor. Reis XI, 14 Dunc parla Samuel al pople, si lur dist : « Alum ent en Galgala é renuvelum noz afaires endreit del regne. » Renart 1169 Alon nos ent, je sui toz prest
Toutes ces graphies notent probablement le même son, qui diffère encore cependant à cette époque de sa réalisation phonique moderne. Le XIIe siècle est précisément, rappelons-le, l’époque de la nasalisation du groupe /on/ en français, en tout cas quand il provient d’une évolution phonétique régulière. Quelle que soit l’hypothèse explicative retenue pour la formation française de cette désinence -on(s), la présence systématique dans les graphies d’une consonne nasale (m/n) derrière la voyelle (o/u) semble un indice convaincant, d’une part de la prononciation effective de cette consonne, d’autre part de la progressive nasalisation de la voyelle, probablement achevée à la fin du XIIe siècle. Cette voyelle soumise à nasalisation est encore très fermée, ce que trahit sans doute la graphie u : elle s’ouvrira au cours du siècle suivant pour prendre son timbre moderne.
ETAT DU SYSTEME EN ANCIEN FRANÇAIS
Nous avons déjà observé que la langue, au cours du XIIe siècle, avait généralisé les désinences -ons sigmatiques. Ce même mouvement de sigmatisation (« s » signifiant sémiologiquement la deuxième personne) aura, en ce qui concerne la forme d’impératif singulier, pris beaucoup plus de temps pour se généraliser. Les terminaisons (non désinentielles) de l’impératif singulier se présentent dans la grande majorité des cas au XIIe siècle comme asigmatiques. Nous examinerons d’abord de façon générale ces terminaisons asigmatiques du terminus a quo, les vocaliques, puis les consonantiques, puis nous étudierons plus en détail les terminaisons sigmatiques, appelées à devenir désinences. Nous pourrons alors établir un premier bilan synchronique, qui servira de base aux suivants, pour le moyen français et le français classique. Les terminaisons vocaliques d’impératif fort en ancien français peuvent se classer selon leur destin phonétique jusqu’en français moderne. Les codes orthographiques du XIIe siècle sont le plus souvent phonétiques, un graphème y note en général un phonème. La terminaison -e, attestée par les exemples suivants, est à la fois la plus fréquente dans les relevés et la plus ténue sémiologiquement : Manières 159 Quant aucun le vilain menace / qu’il a fet qui a Dé ne place, / « Dex aïe ! » fet il en place, / « Je ne faz que li reis ne face. » Reis XX, 29 Pur ço, si grace vers tei ai truvéd, suffre que jo i alge e veie mes freres. Reis XVI, 1 Deus reparlad a Samuel, si li dist : « Purquei plures é plains Saül puis que jo l’ai degete qu’il ne regne sur Israel ? Mais emple un corn de ulie é vien, si te enveierai a Ysaï de Bethléém, kar jo ai purveü entre ses fiz un ki reis iert. » Renart 595 Cuverz, fait il, ovre ta boce ! Les morphologies historiques expliquent en général que cette famille très fréquente de formes d’impératif singulier correspond dans l’ensemble à la première conjugaison latine, le -a final latin évoluant phonétiquement en -e. Cette équivalence doit cependant être nuancée. D’une part en effet, les trois dernières occurrences ci-dessus sont l’exemple dans notre corpus d’impératifs singuliers réalisés au XIIe siècle en -e, mais qui ne dérivent pas d’étymons latins de la première conjugaison : ovre et suffre ont conservé, jusqu’en français moderne, cette terminaison d’impératif singulier ; emple au contraire (latin imple) apparaît ici comme une terminaison provisoire dans l’histoire de la langue, la conjugaison du verbe ayant été reconstituée par la suite sur le modèle de la deuxième conjugaison du français (emplissons, emplis). D’autre part, nous le verrons, certains impératifs dont l’étymon appartient à la première conjugaison latine se réalisent au XIIe siècle sous d’autres formes. La voyelle finale Ŕe présente parmi toutes les autres cette particularité morphologique de ne pas faire stricto sensu partie de la base verbale, puisqu’elle disparaît régulièrement à l’imparfait, au passé simple de l’indicatif, à l’imparfait du subjonctif ; elle représente en fait un morphème démarcateur d’un certain groupe de verbes (ceux de la première conjugaison en -er, et quelques autres). Ce caractère particulier d’extériorité par rapport à la base, joint à la fréquence des formes qui l’engagent, explique en grande partie que la finale -e d’impératif fort, à défaut de représenter une véritable désinence, en vienne malgré tout à constituer dans le système un solide pôle de régularité, capable d’attirer des formes moins régulières en diachronie. Les formes ci-dessous présentent d’autres terminaisons vocaliques, qui pour l’essentiel se sont maintenues phonétiquement jusqu’en français moderne, avec parfois un changement dans la prononciation moderne. Elles sont classées par ordre de fréquence croissante de la série verbale à laquelle elles se rapportent : Reis XV, 18 Enveiad tei sur Amalech, si te dist : « Va, oci les pecheürs de Amalech, é quanque i ad destrui ! » Reis XXX, 8 Respundi nostre Sire : « Pursiu les, senz dute les prendras, sis ociras. » Le Charroi 249 Ber, ne m’oci, se tu Guillelmes iés ! Cligès 192 Biax filz, fet il, de ce me croi / Que Largesce est dame et reïne / Qui totes vertuz anlumine, / Ne m’est mie grief a prover. Erec et Enide 213 – Fui ! fet Erec, nains enuieus, / Trop es fel et contralïeus, / Lesse m’aler. Reis XXVI, 16 Véi ore u est la lance le rei é la cupe ki fud a sun chief ! Erec et Enide 903 Voi la cele gente pucele / Qui por toi plore et Dieu apele ! Reis XXV, 24 Abigaïl à David : Suffre que jo puisse od tei parler é oi laparole de ta ancele. Guillaume 999 – Or me di, Gui, que ses tu faire ? Renart 30 Et Ysengrin qui pas ne l’eime, / Devant toz les autres se cleime / Et dit au roi : « Baux gentix sire, / Car me fai droit de l’avoutire / Que Renart fist a m’esposee, / Dame Hersent, quant l’ot serree / A Malpertuis en son repere, / Quant il a force li volt faire, / Et conpissa toz mes lovaux : / C’est li dels qui plus m’est noveax. »
Adam 1151, Caïn : Or va avant, jo irrai aprés / Le petit pas, a grant relais. Ce deuxième groupe de terminaisons vocaliques, plus durables phonétiquement, ne relève pas de la première conjugaison latine. Les formes di et fai correspondent à l’évolution phonétique des formes atypiques latines dic et fac, seules formes (avec duc) terminées en latin par une consonne236. Toutes les autres formes correspondent à des étymons latins à terminaison vocalique (*destruge, *proseque, occide, crede, *fugi, vide, audi, vade), auxquels l’évolution phonétique a fait perdre d’abord la voyelle finale et ensuite la consonne qui la précédait, souvent après transformation de la voyelle pénultième latine. La série correspondant à vide est représentée par deux formes ou graphies au XIIe siècle : véi, puis voi237: cette dernière graphie s’est maintenue jusqu’en français moderne, même si la prononciation de oi a pu évoluer. De la même façon, la terminaison de pursiu, sans disparaître, s’est modifiée, dans l’écriture comme dans la prononciation. Toute ces formes monosyllabiques à terminaison vocalique comptent parmi les formes d’impératif les plus fréquemment employées en ancien français.
|
Table des matières
INTRODUCTION GÉNERALE
I MORPHOLOGIE ANALYTIQUE DU VERBE IMPERATIF
INTRODUCTION
1. BASES VERBALES PROPRES A L’IMPERATIF
2. OPPOSITIONS MORPHEMATIQUES PROPRES AUX FORMES FAIBLES D’IMPERATIF : ETUDE MORPHOLOGIQUE ET SEMANTIQUE
3. MARQUAGE MORPHEMATIQUE DES FORMES FORTES D’IMPERATIF : ETUDE DIACHRONIQUE
CONCLUSION
II ETUDE LEXICO-SEMANTIQUE DU VERBE IMPERATIF ISOLE
INTRODUCTION
1. ECHELLE THEMATIQUE DES VERBES IMPERATIFS ISOLES
2. DEFINITION ET FORMALISATION INDICIELLE DE RELATIONS D’HYPONYMIE ET DE VICARIANCE IMPERATIVE A PARTIR DE L’ECHELLE THEMATIQUE
3. VERBES IMPERATIFS ISOLES DONT LA SIGNIFICATION ABOLIT UN OU DEUX SEUILS THEMATIQUES
4. INDICE 0 DE PROCES : EMPLOIS INTERJECTIFS DU VERBE IMPERATIF ISOLE
CONCLUSION
III SYNTAXE ANALYTIQUE DU SYNTAGME VERBAL IMPERATIF ISOLE
INTRODUCTION
1. SVI ISOLES ENCLITIQUES
2. EVOLUTION DIACHRONIQUE DE CONTRAINTES SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER LA SYNTAXE PROCLITIQUE DANS LE SVI ISOLE
3. INCIDENCE SPECIFIQUE DE CERTAINS ADVERBES CONJOINTS AU VERBE IMPERATIF
CONCLUSION
CONCLUSION GENERALE
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet