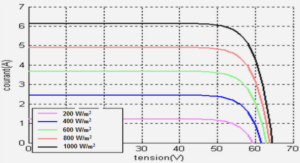Dans les années 1970 l’état des réseaux techniques urbains commence à préoccuper sérieusement les responsables aux Etats-Unis et en Angleterre. De nombreuses publications font l’état de la dégradation des équipements urbains et soulignent, aux Etats-Unis la crise des infrastructures qui touche l’ensemble des villes, en Angleterre la vétusté des installations de réseaux d’égouts dans les centres des grandes villes (inner-cities). Présentée comme le résultat d’un vieillissement avancé et/ou d’un mauvais entretien, la dégradation des réseaux est illustrée dans les deux pays par des chiffres alarmants et perçue comme une menace pour le développement futur des villes. C’est dans ce contexte que de nombreuses recherches sont engagées et que des mesures sont prises visant à enrayer les manifestations de ces phénomènes. La réhabilitation occupe une place centrale dans ces mouvements. De nouvelles techniques de rénovation sont développées et expérimentées afin de faire face aux anomalies détectées.
En France la situation générale des réseaux urbains semble plutôt meilleure que dans les deux autres pays. Mais des insuffisances apparaissent, notamment en ce qui concerne l’assainissement. Depuis 1982 la faible performance des équipements d’assainissement préoccupe les responsables. Certains expriment aussi leurs inquiétudes sur l’avenir des installations les plus anciennes. Un intérêt grandissant se développe alors autour de la réhabilitation des réseaux qui devient ainsi thème d’actualité.
Le réseau d’assainissement – Le modèle dominant
La structure physique du réseau
Le modèle du réseau d’assainissement qui est actuellement utilisé dans le monde occidental, consiste en un ensemble de conduites, liées entre elles, parcourant sous terre les zones urbanisées et communiquant avec la surface par des ouvrages tels que les branchements, les avaloirs et les bouches. Les branchements assurent la liaison du réseau avec la surface bâtie (logements privés, manufactures), tandis que les avaloirs et les bouches donnent issue à la surface libre. Cet ensemble de conduites communique avec le milieu naturel par les déversoirs d’orage et les exutoires.
D’autres ouvrages, qui s’interposent entre les différents types de canalisations (secondaires, primaires, émissaires), font aussi partie du réseau d’assainissement, tels _que les regards de visite et d’accès, les stations de pompage, les bassins de retenue et de décantation, et les stations d’épuration. Telle est la structure actuelle d’un réseau d’assainissement qui est dimensionnée, et qui résulte des principes définissant son mode -de fonctionnement et ses fonctions (écoulement gravitaire, évacuation des eaux immédiate sans stagnation, épuration avant rejet dans l’exutoire). Les effluents transportés par le réseau, de par leurs caractéristiques (débit, composition), déterminent la forme et l’emplacement des ouvrages qui le composent.
La structure physique de l’ensemble des collecteurs, qui constitue le corps central du réseau, est définie en particulier par trois types d’éléments relatifs à :
– sa localisation géographique par rapport au milieu urbain ou par rapport aux autres infrastructures (en particulier la voirie). Les canalisations d’évacuation d’eaux usées se situent, en général, au dessous de la voirie à une profondeur moyenne de 2 à 2,5m ;
– la géométrie et l’aspect physique de ses parties composantes (la forme des canalisations, la nature des matériaux de construction) : . la forme de la section des canalisations est, en général, circulaire ou ovoïde ; . les dimensions des tuyaux sont directement déterminées par le débit des effluents transportés. Les diamètres sont de l’ordre de 150mm (branchements) jusqu’à 2.000-4.000mm (grands émissaires) ; . les matériaux utilisés à nos jours pouf la fabrication des canalisations sont le béton (armé le plus souvent), l’amiante ciment, le grès, le polychlorure de vinyle et la fonte ductile. Par contre, la plus grande partie des réseaux construits au XIXème siècle et au début du XXème siècle sont en maçonnerie de briques ou de pierres ;
– les liaisons et les relations existantes, entre les différents tronçons qui composent le réseau et les autres ouvrages qui s’y interposent .
Le fonctionnement du réseau
a) La fonction du réseau d’assainissement urbain consiste à recueillir les effluents produits dans la ville et à les transporter vers la station d’épuration et, après traitement (pour les eaux usées), à les déverser dans le milieu naturel ; c’est-à-dire dans le réseau hydrographique de surface (ruisseaux, rivières, fleuves, mer), le sol, et les nappes souterraines (cas d’épandage souterrain, de bassins et de puits d’infiltration).
b) L’objet du réseau d’assainissement est constitué par les effluents urbains qui comprennent :
– les eaux pluviales ou de ruissellement (E.P.) ;
– les eaux usées ménagères (E.U.) ;
– les excréta humains (E.H.) ;
– les eaux industrielles ayant ou non subi un prétraitement.
Les eaux usées ménagères, les eaux vannes et les eaux industrielles, sont actuellement considérées comme des eaux polluées, qui doivent donc être traitées avant d’être déversées dans les exutoires. Par contre, les eaux pluviales sont tenues pour des eaux propres, ou plus exactement pour des eaux non polluées. Cette considération est de plus en plus révisée étant donné que la pollution atmosphérique dans les grands centres urbains, de même que la saleté des surfaces imperméables, contribuent fortement à la pollution des eaux de ruissellement. Mais la pollution due aux eaux pluviales étant un phénomène encore mal connu et en plus difficile à saisir, en raison de la complexité des dispositifs d’expérimentation nécessaires, la mise au point et la diffusion de moyens de traitement de cette pollution restent encore limitées (*).
Selon la nature des effluents transportés par le réseau, on peut distinguer trois systèmes de collecte actuellement utilisés :
– le système séparatif qui consiste à réserver un réseau à l’évacuation des eaux usées domestiques (et souvent aussi aux effluents industriels), alors que l’évacuation des eaux pluviales est assurée par un autre réseau (canalisations, fossés, caniveaux, écoulement superficiel…) ;
– le système unitaire qui consiste à évacuer l’ensemble des eaux usées et pluviales par un seul réseau, généralement pourvu de déversoirs, permettant en cas d’orage le rejet direct par surverse d’une partie des eaux dans le milieu naturel ;
– le système pseudo-séparatif qui consiste à réaliser un réseau séparatif particulier pour lequel il est admis que le réseau d’évacuation des eaux usées peut recevoir certaines eaux pluviales (toitures, caves…) en provenance des propriétés riveraines. Dans ce cas, la fonction du réseau d’évacuation des eaux pluviales est réduite à la collecte et à l’évacuatio n des eaux ruisselant sur la chaussée et les trottoir s .
Les caractéristiques du réseau d’assainissement
Caractéristiques liées à la structure du réseau
Nous distinguons trois caractéristiques du réseau d’assainissement qui découlent de sa structure physique : c’est un investissement lourd; c’est un ouvrage collectif ; il est souterrain.
C’est un investissement lourd : un réseau d’assainissement est un investissement lourd à cause de son mode de fonctionnement et de son emplacement. Sa structure physique doit être apte à répondre aux contraintes mécaniques et physico-chimiques exercées à l’intérieur et à l’extérieur de ses canalisations. Par ailleurs, le fait qu’il est souterrain et, par conséquent difficile d’accès, renforce cette caractéristique.
Cette propriété du réseau, directement liée à sa structure, induit trois types de conséquences. Elle implique précisément :
– L’exigence d’une certaine permanence de l’ouvrage : toute intervention sur la structure du réseau (remplacement, transformation) se traduisent par une opération difficile, la nécessité d’une durée limite de sa vie effective a été imposée ; ou autrement, l’adoption parmi les objectifs du service d’exploitation de la pérennité des ouvrages (11 ). Comme nous le verrons par la suite, la durée de vie minimum accordée au réseau varie selon les pays et dépend de la structure des équipements (canalisations visitables ou non, nature de leurs matériaux de construction).
L’exigence de permanence des ouvrages impose par ailleurs la prévision de l’avenir et de l’urbanisation comme une action indispensable à la conception et la réalisation des équipements d’assainissement. D’autant plus que de nos jours le cadre bâti évolue continuellement, en transformant parallèlement la quantité et la qualité des eaux sales produites dans le milieu urbain. Bien sûr, la sensibilisation des responsables à la nécessité de la pérennité des ouvrages varie, selon les différents contextes socio-économiques où s’intègre le réseau, suivant les priorités des programmes politiques correspondants.
– Le coût élevé de la construction des réseaux : les coûts liés au réseau d’égouts représentent la plus grande partie (plus de 80%) du coût total des investissements en assainissement (12). Fait qui est aussi confirmé par la Figure 1 qui illustre les coûts de remplacement concernant les équipements d’adduction d’eau potable et d’assainissement (système unitaire), correspondant à une maison typique, tels qu’ils sont présentés dans la littérature anglaise (13). Mais, les coûts de l’installation des réseaux varient selon la densité des villes (plus la commune desservie est petite, plus il en coûte aux habitants). L’adoption de la technique du réseau ne peut donc se justifier que dans des zones urbanisées, avec une certaine densité de population.
Le fait que l’implantation des réseaux demande des investissements considérables et, par conséquent une capacité de mobiliser les sommes nécessaires dont les villes seules, en général, ne disposent pas, impose l’adoption de méthodes de financement qui offrent des possibilités d’appui sur l’extérieur ; notamment des aides de l’Etat et des systèmes d’emprunt (par exemple, le système d’obligations aux Etats-Unis). Mais ces types d’engagements financiers impliquent souvent l’intervention des acteurs étrangers à l’organisation locale avec, bien évidemment, toutes les conséquences induites (développement des rapports de dépendance, influence sur le mode d’organisation et la gestion du service d’assainissement).
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I : LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COMME ELEMENT COMPOSANT D’UN SYSTEME
§ 1. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT – LE MODELE DOMINANT
1. La structur e physiqu e du résea u
2. Le fonctionnemen t du résea u
3. Le rôl e du résea u d’assainissemen t
§ 2. LES CARACTERISTIQUES DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
1. Caractéristique s liée s à la structur e du résea u . »
2 . Caractéristique s liée s a u mode d e fonctionnemen t d u résea u
3 . Caractéristique s liée s a u rôl e d u résea u
§ 3. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
1. Définitio n du système d’assainissemen t
2. Les fonction s du servic e d’assainissemen t : le s agents concerné s
3 . L’organisatio n d u système d’assainissement, u n élémen t
déterminan t d e l’éta t d u résea u
CHAPITRE II : LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT EN FRANCE
§ 1. HISTORIQUE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EN FRANCE
§ 2 . LES AGENTS DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
1 . Les collectivité s locale s
2. L’Eta t
3. Les Agences Financières de Bassin
4. Les sociétés exploitantes
§ 3. LES FONCTIONS DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT
1. Le financement du service
2 . L’entretien des équipements
3. L’utilisation des équipements : le rôle des usagers
§ 4. CONDITIONS DETERMINANTES DE L’EVOLUTION DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT EN FRANCE : UN NOUVEAU CONTEXTE APRES 1982
CHAPITRE III : LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT EN ANGLETERRE
§ 1 . HISTORIQUE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EN ANGLETERRE
§ 2 . LES AGENTS DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
1. La situation antérieure à 1974
2 . La situation postérieure à 1974
§ 3. LES FONCTIONS DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT
1. Le financement du service
2. L’entretien des équipements
§ 4. LE CONTEXTE ANGLAIS AVANT ET APRES LA REFORME DE 1974
CHAPITRE IV : LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT AUX ETATS-UNIS
§ 1. HISTORIQUE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT AUX ETATS-UNIS
§ 2 . LES AGENTS DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
1. Les collectivités locales
2 . Les districts spéciaux
3. Les Etats – l’Etat Fédéral
§ 3. LES FONCTIONS DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT
1. Le financement du service
2 . L’entretien des équipements
3. L’utilisation des équipements : le rôle des industriels
§ 4. LE CONTEXTE AMERICAIN : L’ACTION FEDERALE DEPUIS 1972
CONCLUSION
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet