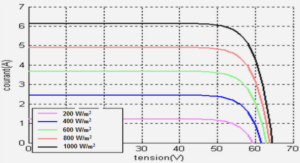Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Objectifs spécifiques
Identifier les causes et les manifestations des inondations
Analyser les conséquences qu’elles causent aux populations sur le plan économique, social et sanitaire voir politique.
Analyser les actions des différents acteurs pour atténuer sinon s’adapter à ce fléau des inondations
Pour atteindre ces objectifs nous nous sommes fixés quelques hypothèses de recherche.
Hypothèses de recherche
Les inondations ont des causes naturelles et humaines.
Malgré une prise de conscience des populations et des politiques, les inondations reviennent chaque hivernage avec des dommages considérables.
Un dialogue inclusif entre populations concernées et les différents acteurs pourra permettre à la banlieue Dakaroise d’atténuer l’ampleur visible d’impact des inondations.
Analyse des concepts
Elle est en d’autres termes une clarification conceptuelle qui nous permet de spécifier et de définir les concepts. En ce sens Emile Durkheim disait que « tout discours scientifique doit utiliser des concepts clairs et précis afin de se démarquer de la confusion qui caractérise le sens commun ». Ainsi dans ce travail des termes clés ont été utilisés et doivent être clarifiés pour une bonne compréhension de notre étude. Il s’agit des termes d’inondations, d’impact, de banlieue et en fin de ville.
Inondation : Selon le professeur Mame Demba Thiam l’inondation est un apport exceptionnel d’eau qui entraine une catastrophe avec des victimes qui sont submergées (ou leur habitat, infrastructures ou autres biens et sites particuliers). Elle peut être bénéfique lorsqu’elle contribue à l’apport fertilisant du sol.
Gautier (2010), la définit comme l’envahissement par eau douce ou salée, de lieux habituellement submergés. Selon le dictionnaire hachette, une inondation est un débordement des eaux qui submergent un terrain, et s’étend sur des dizaines de kilomètres carrés. Pour le dictionnaire le robert de poche, une inondation peut être définie comme « le débordement d’eau qui inonde une région. Elle peut être causée par la pluie, la fonte des neiges, la crue d’un torrent, les hautes eaux d’une rivière ». Concernant notre étude, les inondations qui nous intéressent sont celles causées par les eaux pluviales, qui se produisent en période estivale dite saison des pluies ou « hivernage ». Ainsi les inondations peuvent survenir avec des variations d’un pays à l’autre. De ce fait une typologie des inondations peut être faite. Selon le document introductif au dialogue entre les acteurs sur les inondations à Dakar, rapport provisoire (UNESCO, BREDA et Commission Nationale pour l’UNESCO Rapport provisoire, octobre 2011), il s’agit :
Impact : Concernant le concept d’impact, c’est un mot utilisé dans de nombreux domaines. Pour le dictionnaire hachette, c’est un choc, une collision, un heurt. Il peut aussi être un effet produit par quelque chose. Selon le petit robert il renvoi à des traces laissées par une action, donc dans le cadre de notre étude des pluies estivales. Il peut être la mesure des effets tangibles et intangibles, positifs et négatifs qu’un incident, un changement, un problème ou un mouvement a, ou pourrait avoir, sur son environnement.
Pour l’intérêt de notre thème, nous pouvons l’assimiler à l’ensemble des conséquences engendrées par les inondations.
Banlieue : Concernant le concept de banlieue, il renvoie à une concentration d’habitations à la périphérie d’une ville. Le petit robert le définit comme un « ensemble d’agglomérations qui entourent une grande ville et qui dépendent d’elle pour une ou plusieurs de ses fonctions ».
En effet, le développement de la banlieue dakaroise est intimement lié à celui du centre ville et aux moyens de communications qui permettent de les relier.
Méthodologie
Cette partie résume les grands axes permettant la réalisation de ce travail.
Les zones et les populations ciblées par l’étude :
Le choix de Guédiawaye n’est pas un hasard. Il s’explique par l’omniprésence du phénomène des inondations dans cette partie de la banlieue, l’importance du nombre de ménages concernés directement dans la ville et surtout les impacts qu’il produit.
Nous avons visité les cinq Communes d’Arrondissement de Guédiawaye, avec plusieurs entretiens, différents avec les autorités locales : le Président chargé de la gestion des inondations à Guédiawaye, le Préfet de la ville, le Sous-préfet, les secrétaires municipaux des différentes zones et les chefs de quartiers touchés par les inondations.
Notre population-mère concerne les populations résidant dans les cinq Communes d’Arrondissement de Guédiawaye en plus des personnes recasées à Keur Massar grâce au projet Jaxaay. C’est un plan de relogement à des conditions financières très favorables pour les populations de la banlieue dakaroise sinistrées par les inondations.
Analyse du cadre physique
La plupart des quartiers de la ville de Guédiawaye ont été bâtis sur des zones dunaires et marécageuses appelées Niayes (Aw Ciré, 2007).
Les Niayes constituent un écosystème, situé sur la Grande Côte, de Saint Louis à Dakar, dont la particularité réside dans sa topographie, sa structure géomorphologique et sa biodiversité : Il s’agit en fait de dépressions inter dunaires généralement humides. Les sols des dépressions sont souvent argileux à sablo-argileux.
Avec l’installation de la sécheresse qui n’a pas laissé indifférente cette zone dans les années 1970-1980, son potentiel hydrique a connu une forte baisse, allant même vers un assèchement dans certaines zones comme Médina Gounass et favorisant son occupation de manière anarchique par des populations surtout immigrées. Celles-ci viennent surtout du milieu rural et ont tendance à vivre comme tel.
Ainsi avec le retour à une bonne pluviométrie, un bon nombre de ménages ont été confrontés à des inondations, jusque-là inconnues.
Alors que certains quartiers comme les HLM Baye Gaindé ou les « Parcelles Assainies » ont fait l’objet de travaux d’aménagement qui ont permis d’aplanir les dunes et de combler les dépressions argileuses. Ce qui n’a pas été le cas à Guédaiwaye et qui favorise les écoulements vers les zones basses et donc les inondations.
Concernant le climat, Guédiawaye est, dans la zone climatique sahélienne et au domaine climatique de la grande côte, marquée par une alternance saisonnière : une saison sèche avec des températures qui varient entre 15°C et 25°C et d’une saison des pluies avec des températures qui varient entre 25°C et 33°C.
Les paramètres climatiques
L’analyse climatique est interpolée à partir des données de la station de Dakar-Yoff, faute d’une gestion régulière de la station de Guédiawaye par l’ANACIM.
La circulation générale de l’atmosphère au Sénégal est régie par les hautes pressions tropicales(les anticyclones des Açores, de Sainte-Hélène et de la cellule maghrébine), dont le fonctionnement entraine les migrations saisonnières de l’équateur météorologique qui détermine des flux et les types de temps qui en résultent.
A Dakar, en hiver boréal, l’équateur météorologique connait une fluctuation vers le sud sous l’influence de l’anticyclone des Açores et de la cellule maghrébine. Ainsi deux circulations d’Alizé se mettent en place : il s’agit de l’Alizé Maritime et de l’Alizé Continental.
L’Alizé Maritime y déverse fraicheur et humidité d’où la baisse des températures. Ce flux domine de Décembre à Mars et n’engendre pas de pluies.
L’Alizé Continental ou Harmattan, domine à partir du mois de Mars. Ce flux apporte la chaleur le jour et la fraicheur la nuit.
En été, affaibli, l’anticyclone des Açores migre vers le nord et la cellule magrébine disparait, remplacée par une dépression thermique centrée sur le sud-ouest algérien et qui aspire le front intertropical (FIT). La circulation aérienne s’inverse alors durant cette période. De ce fait Dakar passe du régime d’alizé au régime de mousson issu de l’anticyclone de Sainte-Hélène. Ce vent chaud et humide est à l’origine des pluies.
Le climat de la Région de Dakar se caractérise ainsi par une alternance d’une saison sèche et une saison des pluies dite « hivernage ». Il est de type sahélien et du domaine de la grande côte, adouci par les flux d’alizés maritimes issus de l’anticyclone des Açores. Ces vents de direction Nord dominent. Durant la saison des pluies, les vents de mousson, de secteur Ouest, dominent la circulation atmosphérique.
Vents
Le vent c’est de l’air qui se déplace et il se caractérise par sa direction et sa vitesse. Le régime des vents est caractérisé par une variation saisonnière des directions dominantes. La vitesse moyenne mensuelle de 1981 à 2011 est de 4,23m/s. Les vents du nord ou alizés et les vents du Nord-Est ou harmattan dominent la circulation de Novembre à Juin avec des vitesses moyennes mensuelles de 4,82 m/s durant cette même période. A partir de Juillet, c’est les vents de mousson de secteur Ouest-Nord-Ouest ou Ouest qui s’installent avec des vitesses moyennes mensuelles faibles de l’ordre de 3,31 m/s durant cette normale considérée.
Insolation
L’insolation est la durée pendant laquelle le soleil a brillé au cours d’une journée sur un lieu donné. Elle est exprimée en heures et minutes. Les fortes valeurs d’insolation correspondent à des températures très élevées et les faibles valeurs à des températures basses (figure n°1).
Sur la période de 1982 à 2012, l’insolation moyenne est de 7,80 h/j. Elle varie de 7,18 h/j pendant la saison pluvieuse où le ciel est toujours nuageux à 7,80 h/j pendant la saison sèche où le ciel est bien dégagé.
Températures
La température est une grandeur physique mesurée à l’aide d’un thermomètre. L’échelle de température la plus répandue est le degré Celsius, dans laquelle l’eau gèle à 0 °C et bout à environ 100 °C dans les conditions standard de pression. Dans le domaine de la météorologie, la température s’écrit souvent T° : c’est la température éolienne. Durant une journée, cette température fluctue. Les stations météorologiques recueillent donc les températures minimales, maximales, de la journée.
La température maximale annuelle à la station de Dakar a varié dans le sens d’une augmentation irrégulière depuis 1960 (figure n°2).
Dans le graphique de cette série on constate une période allant de 1960 à 1990, pendant laquelle les températures varient sur une moyenne de 27,4°C, alors que la moyenne générale de la série gravite autour de 27,7 °C. La moyenne sur cette période est légèrement plus faible que la moyenne générale.
La moyenne de la seconde période de 2000 à 2012 est de 28,4°C. La dernière décennie est donc plus chaude. Le pic de température maximale annuelle est observé en 2010 avec 29,3°C. Dans cette seconde période de 2000 à 2012, la température moyenne annuelle est supérieure à la moyenne générale (27,7°C). Il est évident que la température augmente réellement d’année en année. Cependant malgré cette nette tendance à la hausse de 0,9°C, la température de Dakar reste relativement fraiche par rapport aux stations de même latitude à l’intérieur du pays et avec sa proximité avec l’océan Atlantique.
Pluviométrie
La pluie désigne généralement de l’eau à l’état liquide tombant des nuages vers le sol. C’est le paramètre climatique le plus important compte-tenu de sa grande variabilité spatio-temporelle. L’analyse des valeurs moyennes de la pluviométrie (1960-2012) fait apparaitre une évolution irrégulière, ou plutôt en dents de scie à Dakar-yoff (figure n°3).
Cette situation montre que Dakar, à l’image des autres Région du sahel, n’est pas épargné par la tendance générale à la baisse des pluies observée.
La première décennie de l’indépendance du Sénégal se caractérise par de fortes pluies à Dakar-yoff avec une moyenne de 584,1 mm. Cette tendance s’est considérablement réduite dans la série allant de 1970 à 1999 avec 338,7 mm coïncidant avec la période de sécheresse dans les pays du Sahel, alors que la dernière décennie de notre série présente un retour irrégulier des pluies est passé à une moyenne annuelle de 435,8 mm.
L’étude comparative des saisons des pluies (juin, juillet, aout et septembre) durant la série 1960-2012 permet de distinguer trois types de période pluvieuse à Dakar :
– Des mois à faible pluviométrie, avec des hauteurs moyennes mensuelles inferieur à 35 mm. Il s’agit notamment des mois de Juin avec 9,9 mm et d’Octobre avec 31,6 mm. Ces périodes font apparaitre des quantités insignifiantes de pluie.
– Une période à pluviométrie moindre, coïncidant au mois de Juillet présente une hauteur moyenne mensuelle de l’ordre de 60,6 mm qui annonce généralement l’arrivée de grande période pluvieuse (Aout- Septembre).
Humidité relative
L’humidité relative est le rapport entre la quantité d’eau présente dans une particule d’air et la quantité d’eau que peut contenir la particule d’air.
L’humidité relative moyenne annuelle à la station de Dakar-Yoff tourne autour de 75%, alors que la moyenne mensuelle n’est jamais descendue au-dessous de 65%. Elle montre une variation nette durant cette série considérée (figure n°4).
Analyse du cadre humain Cette analyse porte, sur l’historique, sur des données démographiques et des activités socio-économiques de la ville de Guédiawaye.
Historique
Guédiawaye, est une agglomération dont l’implantation humaine date de très longtemps :
En 1883, la colline de Ndingala située dans la Commune d’Arrondissement de Golf Sud, fut le lieu originel de la confrérie layenne créée par le guide religieux Seydina Limamoulaye (Mairie de Guédiawaye, Profil Présentation, projet d’Agenda 21 de la ville, 2006).
Selon Amdy Moustapha Wade (chargé de communication de la Mairie de la ville de Guédiawaye), l’évolution actuelle de la ville vient surtout du recasement des déguerpis de Dakar entre 1952 et 1972 dans le cadre du réaménagement de la capitale.
Certains quartiers comme les HLM Baye Gaindé ou les Parcelles Assainies ont fait l’objet de travaux d’aménagement qui ont permis d’aplanir les dunes et de combler les dépressions argileuses. Ce qui n’a pas été le cas pour Guédiawaye et qui favorise les écoulements vers les zones basses et donc les inondations.
A partir de 1960, le quartier spontané de Médina Gounass va se développer dans les parties du domaine national qui abritaient des terrains maraîchers (Niayes) qui seront asséchés par la sécheresse des années 70-80.
De 1967 à 1971, les déguerpis de quartiers centraux de Dakar (champ de course, Fith Mith, etc.) sont recasés dans le secteur occidental de la ¨ville¨ appelé « premier Guédiawaye ».
Toujours selon la municipalité, suite à ce développement spatial de la ville, une série de mutations institutionnelles a abouti à la création de la ¨ville¨ dénommée ¨ Guédiawaye¨:
– Le 08 octobre 1990, érection en Commune par le décret 90-36
– Le 22 mars 1996, création de la ville de Guédiawaye
– 2002, érection en Département autonome, subdivisé en cinq Communes d’Arrondissement :
La Commune d’Arrondissement de Golf Sud La Commune d’Arrondissement de Médina Gounasse La Commune d’Arrondissement de NdiarèmeLimamoulaye La Commune d’Arrondissement de Sam Notaire La Commune d’Arrondissement de WakhinaneNimzatt.
Analyse démographique et socio économique :
Analyse démographique :
La Région de Dakar représente 0,3% du territoire national et concentre 25% de la population, soit 3.329.629 habitants en 2010 (Rapport justificatif – Plan Directeur d’Urbanisme de Dakar «horizon 2025 »). Aujourd’hui un Sénégalais sur deux est urbain et un urbain sur deux est Dakarois (Oumou Khairy Diouf, 2011).
Dakar est l’une des plus grandes villes d’Afrique. Sa croissance démographique est forte voire très forte. D’une population de 400.000 habitants dans les années 70, l’exode rural a fait plus que quadrupler le nombre d’habitants de la capitale sénégalaise en 20 ans (Mairie de Guédiawaye, Profil Présentation, projet d’Agenda 21 de la ville).
A l’image de la Région, Guédiawaye est peuplée de 568 089 habitants en 2010 avec un rythme d’accroissement naturel de l’ordre de 2,9% les projections estiment qu’en 2025 on comptera 864.942 habitants.
Cette évolution démographique très rapide est due à plusieurs facteurs notamment (Mairie de Guédiawaye, Profil Présentation, projet d’Agenda 21 de la ville, 2006).
– Le rôle de capitale politico- économique que joue Dakar
– Un afflux des ruraux causé par un échec de développement rural et la puissance de l’attraction de la ville.
– Un accroissement naturel élevé qui résulte de l’augmentation des naissances et de la réduction de la mortalité.
– Un transfert de populations issues d’autres quartiers de Dakar (Angle Mousse, Nimzath, Alminkou, Fith Mith, Champ de course, etc.) dans le cadre des opérations de déguerpissement
Cette urbanisation s’est faite au dépens de tous les espaces disponibles, dunes et dépressions argileuses.
Par ailleurs, Guédiawaye se caractérise par la jeunesse de sa population : 65% de celle-ci à moins de 25 ans. Cela s’explique par une baisse de la mortalité (surtout celle des enfants de moins de cinq ans résultant des campagnes de vaccination) et du maintien de la fécondité à un niveau relativement stable. En effet le quotient de mortalité infantile à Guédiawaye est passé de 120 pour mille pour la période de 1974-1975 à 68 pour mille en 1999 (Oumou Khairy Diouf, (2011), in Audit Urbain Guédiawaye).
Analyse socio-économique
En réalité, Guédiawaye est un « quartier » de Dakar dont la vocation est surtout résidentielle. Cela s’explique par l’inexistence de zones d’activités industrielles et l’insuffisance des services qui font que la « ville » est constituée par des activités de commerce et d’artisanat. Parmi les catégories socioprofessionnelles, on peut retenir les ouvriers, les retraités, les étudiants et élèves.
Alors que le secteur informel y est très développé (25%des actifs) et se compose essentiellement de commerçants (21%) et d’artisans (6%), (ANSD, 1999). Le secteur moderne regroupant l’ensemble des administrations d’Etat, des sociétés et entreprises publiques, privées et mixtes, des organisations non-gouvernementales reste faible mais est évolutif, il est passé de 6,3% à 13,6% des actifs entre 1996 et 2001(Mairie de Guédiawaye, Profil Présentation, projet d’Agenda 21 de la ville, 2006).
Le taux de chômage reste toujours élevé malgré la création par décret n°2008/1443 du 12 décembre 2008 de l’OFEJBAN (Office pour l’Emploi des Jeunes de la Banlieue). Cette structure administrative autonome, rattachée directement au Secrétariat général de la Présidence de la République du Sénégal est remplacée en mai 2012 par l’AJEB (Agence pour l’Emploi des Jeunes des Banlieues) et les centres de formations s’y installent de plus en plus.
Les équipements et les infrastructures
En dépit de l’installation irrégulière et précaire de certains quartiers Guédiawaye enregistre de plus en plus des équipements et des infrastructures au grand soulagement de sa population.
On peut voir certains comme :
– Le Centre Hospitalier Roi Baudouin.
– Hôpital Dalal Jamm (HDJ) à golf sud en cours de construction en renforcement de l’hôpital Roi Baudouin et les postes de santé
– En plus du lycée Limamoulaye, le lycée Cheikh Anta Mbacké et du lycée des Parcelles Assainies, il existe des CEM, des écoles primaires et de plus en plus des écoles privées d’enseignement général, des écoles de formation, des écoles franco-arabes, des garderies d’enfants, etc.
– Le secteur Bancaire est bien présent dans la ville SGBS, Bank of Africa, BICIS, et les structures de microcrédit (PAMECAS, CMS…).
– Le réseau électrique couvre toute les CA de la ville de Guédiawaye, mais il connait 31.159 abonnés (Sénélec Guédiawaye)
– Le réseau routier de la ville de Guédiawaye en 2006 est composé de :
10,150 kilomètre de voiries classées (route des Niayes, nouvelle route de Cambéréne) ; entièrement bitumées (ADM, 2006).
30,400kilomètrede voiries communales revêtues (ADM, 2006).
– Le nombre de branchement en eau potable est passé de 27.167 en 2004 à plus de 32.000 en 2012 (SDE). Cette extension du réseau est rendue possible grâce au programme PELT lancé en 2005 pour un montant de cent millions de francs CFA (100.000.000 FCFA).
|
Table des matières
Liste des sigles et acronymes
Introduction générale
I. Synthèse de la bibliographie
I.1- Problématique
I.1.1 Justification
I.1.2 Objectifs
I.1.3 Objectifs spécifiques
I.1.4 Hypothèses de recherche
I.1.5 Analyse des concepts
I.1.6 Méthodologie
Première partie : Présentation de la « ville » de Guédiawaye
Chapitre I : Analyse du cadre physique
I. Les paramètres climatiques
I.1 Vents
I.2 Insolation
I.3 Températures
I.4 Pluviométrie
I.5 Humidité relative
Chapitre II : Analyse du cadre humain
2.1 Historique
2.2 Analyse démographique et socio économique :
2.2.1 Analyse démographique
2.2.2 Analyse socio-économique
2.2.2.1 Les équipements et les infrastructures
Deuxième partie : Causes et impacts des inondations à guédiawaye
Chapitre I : Causes des inondations à Guédiawaye
1.1 Causes naturelles
1.1.1 Cause pluviométrique
1.1.2 Causes topographiques
1.1.3 Causes hydrogéologiques
1.2 Causes anthropiques
1.2.1 Causes institutionnelles
1.2.2 Causes démographiques
1.2.3 Causes urbanistiques
Chapitre II : Les impacts des inondations à Guédiawaye
2.1 Impacts sanitaires et environnementaux
2.1.1 Impacts sociaux
2.1.2 Impacts économiques
2.2 Impacts politiques des inondations
Troisième partie : Moyens mis en place contre les inondations
Chapitre I : Moyens mis en place par les populations et par les autorités
1.1 Moyens mis en place par les populations
1.2 Moyens mis en place par les autorités
1.2.1 Le plan ORSEC
1.2.2 L’Opération « Fendi »
1.2.3 La sensibilisation
1.2.4 Le plan Jaxaay
1.2.5 Le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique dans les zones périurbaines de Dakar (PROGEP)
1.2.6 Plan décennal
1.2.6.1 La phase d’urgence (2013-2014)
1.2.6.2 La phase court terme (2014-2016)
1.2.6.3 La phase moyen et long terme (2017-2022)
Chapitre II : limites des moyens mis en place
2.1 Limites des politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire
2.2 Limites des politiques d’urbanisme et d’habitat
2.3 Limites des politiques d’assainissement
2.4 Limites des actions entreprises par les populations
Conclusion générale
Bibliographie
Télécharger le rapport complet