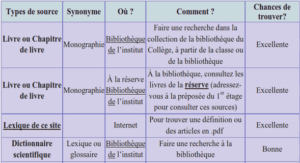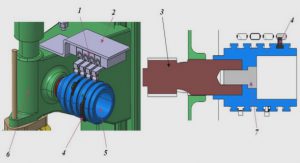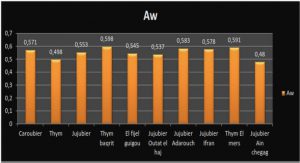Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Villes sud-africaines : du modèle au terrain
L’histoire des villes sud-africaines mêle ségrégation et résistance, applica-tion brutale des idéologies raciales et poches de mixité (Houssay-Holzschuch, 1996 [64] ; Lemon, 1991 [81] ; Smith, 1992 [126]). Les villes actuelles ont été fondées par les colons blancs : même si une certaine tradition urbaine existait à l’époque pré-coloniale, notamment sur les hauts plateaux, Durban, Johannesburg, Bloemfontein, Kimberley, etc. sont des créations relativement récentes. D’emblée, ces villes ont été vues comme le domaine réservé de l’homme blanc même si le besoin de main-d’œuvre à bon marché ouvre les villes aux Noirs. Ce paradoxe de leur présence non souhaitée, mais nécessaire, va déboucher sur les premières lois de contrôle de la population africaine et sur les premières formes spatiales ségrégatives originales des villes sud-africaines. la suite de Ron Davies (1981 [33]), on peut distinguer grossièrement trois phases dans la construction des villes sud-africaines. La première, dite phase co-loniale, va de l’arrivée des colons blancs en 1652 au Cap aux premières années de l’Union. Elle est caractérisée par une ségrégation de facto mais incomplète et dans la majeure partie des cas, non inscrite dans un cadre législatif. La fin de cette période est marquée par la Révolution minière—la découverte de mines de dia-mants et d’or à Kimberley, puis à Johannesburg—et l’industrialisation du pays. Le contrôle de la main-d’œuvre noire devient alors indispensable et l’on élabore les premiers compounds, casernes ouvrières dont le plan même est dessiné à de telles fins (cf. page 94).
La seconde phase, ségrégative, concerne la première moitié du XXesiècle. L’adoption du Native (Urban Areas) Act en 1923 caractérise bien les progrès de l’idée de ségrégation (cf. page 118) : elle devient consciente, volontaire, voire vo-lontariste. Cependant, elle concerne surtout les Noirs : Métis et Indiens sont moins touchés. De plus, des zones mixtes subsistent.
La troisième phase concerne l’apartheid proprement dit et débute en 1948, avec l’arrivée au pouvoir du Parti national et sa législation. On retiendra en par-ticulier le Group Areas Act de 1950. La séparation des races devient le premier objectif du gouvernement et il met en place un véritable système législatif pour y parvenir. C’est là que les villes sud-africaines deviennent originales dans leur forme, portant l’empreinte d’une idéologie appliquée coûte que coûte. Cette phase se terminera au début des années 1990, avec l’abolition de la législation d’apar-theid et les premières élections démocratiques d’avril 1994.
Cette distinction ne doit pas masquer les très fortes continuités existant entre ces trois phases. J’ai montré ailleurs (Houssay-Holzschuch, 1996 [64, chapitre 4]) les racines anglaises de la politique d’apartheid. Nous verrons aussi comment la ségrégation des Noirs au Cap est en place dès 1901 (cf. chapitre 4).
Ce schéma général permet de rendre compte de l’évolution des villes sud-africaines. Néanmoins, le cas du Cap est un peu particulier et il importe de voir quelles en sont les spécificités. En effet, c’est au Cap que les Européens ont pour la première fois posé le pied en Afrique australe. La longueur de la colonisation, plus de trois siècles, différencie fondamentalement cette ville des autres : Durban ne date que la moitié du XIXe, Johannesburg a vu le jour en 1886. Cette ancienneté se voit dans le patrimoine historique et architectural de Cape Town, mais aussi dans l’importance symbolique qui lui est accordée dans l’imaginaire sud-africain : c’est la ville-mère ou Mother City.
De plus, la composition de la population du Cap est différente de celle des autres grandes villes sud-africaines : les Noirs n’y sont pas en majorité. En ef-fet, le groupe le plus important numériquement est celui des Métis, puis celui des Blancs : la population africaine ne vient qu’en troisième position. La raison d’une telle situation, exceptionnelle, est à chercher dans l’histoire. Lorsque Jan van Rie-beeck et ses hommes débarquèrent, ils ne rencontrèrent pas de tribus de langue bantoue, mais des Khoisan (cf. chapitre 4). Ce fait a bien sûr été exploité idéo-logiquement, par la propagande de l’apartheid, pour montrer que Noirs comme Blancs étaient des arrivants récents dans le pays et que leur présence y était également légitime. Il reste cependant exact qu’il n’y avait pas de présence permanente des Africains dans cette région du pays. Les Métis, population majoritaire, sont en fait les descendants des Khoisan et des esclaves importés par les Hollandais.
Tout cela fait du Cap une ville exceptionnelle dans le cadre sud-africain. Par ailleurs, la ségrégation y a longtemps semblé moins systématique qu’ailleurs, l’at-mosphère plus libérale. En fait, la ségrégation y a été précoce, même si elle a pris des formes parfois différentes et si elle était tempérée par un certain mélange des races (miscegenation) et une tradition politique non-raciale (Bickford-Smith, 1995 [10, 11]). Nous en verrons les modalités concernant les Noirs au cours de cet ouvrage.
Remarques sur l’utilisation des statistiques
L’utilisation des statistiques officielles sud-africaines pose problème : elles sont d’une fiabilité douteuse pour des raisons politiques et méthodologiques.
Sous le régime d’apartheid, les Noirs étaient soumis à toutes sortes d’obliga-tions légales. Les restrictions étaient particulièrement sévères dans la province du Western Cape et dans la ville du Cap elle-même (cf. chapitre 5.2, p. 129) : peu d’entre eux étaient légalement autorisés à résider en ville. Aux yeux des autori-tés, ils devaient résider dans leur homeland. La nécessité poussait cependant un grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants à braver ces règlements pour venir trouver du travail en ville. Le nombre de ces « illégaux » était loin d’être négligeable, en particulier à partir de la fin des années 1960. Bien entendu, cette population noire n’était pas inclue dans les recensements.
Philippe Guillaume, intervention à la conférence « Jeunes chercheurs », Institut Français d’Afrique du Sud, Johannesburg, 1er juillet 1997, et communication personnelle.
D’autre part, le gouvernement d’apartheid voulait limiter la présence des Noirs en ville : pour des raisons politiques, il était donc important de souligner le succès de la législation de contrôle. Pour le public, l’exode rural devait sembler contrôlé et la population noire urbaine stabilisée.
Enfin, les méthodes adoptées par le gouvernement, notamment lors des recen-sements, ne pouvaient permettre d’obtenir des évaluations fiables. De nombreux quartiers noirs—comme de nombreux villages dans l’ensemble du pays—n’ont pas été comptés sur le terrain en 1991, date du dernier recensement avant la démo-cratisation. À partir de photos aériennes, le nombre de logements était obtenu. Le nombre moyen d’habitants par logement provenait de projections réalisées grâce des données démographiques des années 1970 et 1980 (taux de mortalité, de fécondité, etc.). Les défauts de cette méthode sont évidents. Il faut aussi souligner que la population noire sud-africaine sort de la transition démographique : le taux de fécondité a donc énormément changé depuis les années 1970 (Mears et Le-vin, 1993 [99]). Pour ajouter au flou, les migrations internes réelles sont très mal comptabilisées. La surestimation de la population rurale est donc une hypothèse raisonnable.
Présence d’« illégaux » et volonté politique conduisent inversement à une générale sous-estimation de la population noire présente en ville dans les statis-tiques officielles. De plus, avant le recensement de novembre 1996, les données de terrain étaient ajustées pour se conformer au modèle démographique théorique adopté. Les conséquences de ces erreurs apparaissent : alors que les estimations pour 1996 de la population totale sud-africaine, calculées par projection à par-tir de données des anciens recensements, s’élevaient à 42,1 millions d’habitants, les premiers résultats du recensement n’en comptent que 37,8 millions (Central Statistical Services, 1996 [17]).
Devant de pareils problèmes, le chercheur doit faire un choix : faut-il aban-donner l’outil statistique? Pourtant, malgré ses défauts, il donne une indication des tendances et des ordres de grandeur. J’ai donc choisi de m’en servir, mais à titre indicatif. Il convient donc de les lire avec précaution.
Pour minimiser ces problèmes de fiabilité autant que faire se peut et en ce qui concerne la population des différents townships, j’ai utilisé les rapports annuels du Medical Officer of Health, c’est-à-dire des services de santé municipaux4 (voir fi-gures 4.1, 5.2, 5.3 et 5.4). Ces données ont plusieurs avantages. Tout d’abord, elles sont annuelles et permettent donc de retracer avec une plus grande précision les évolutions démographiques. De plus, les chiffres annuels de l’entre-deux-guerres ont été obtenus en faisant une moyenne des comptages mensuels.
4Les rapports annuels du Medical Officer of Health des deux conseils municipaux responsables de Cape Town, Cape Town City Council et Cape Town Divisional Council, sont disponibles à la South African Library.
La fréquence des comptages est donc le premier avantage. Par ailleurs, c’est un comptage fait localement, par des services municipaux connaissant le terrain, contrairement aux statistiques nationales. Enfin, ces évaluations sont faites pour des raisons de gestion sanitaire. Elles sont donc moins influencées par des consi-dérations idéologiques.
Questionnaires d’enquête, cartes mentales et entretiens : sources
Les sources de ce travail sont diverses. Outre la consultation de la littérature se-condaire existant sur le sujet5, j’ai utilisé un certain nombre de sources primaires. Le matériel compilé par le Western Cape Oral History Project de l’University of Cape Town m’a permis d’accéder à un certain nombre d’histoires de vie complé-tant celles que j’ai moi-même recueillies. En particulier, ces archives contiennent les récits d’anciens résidents de Ndabeni, le premier township pour Noirs du Cap, détruit en 1936, et des camps de squatters de l’immédiat après-guerre. Ces témoi-gnages sont précieux car ils mettent fin à un type de recherche trop fréquemment pratiqué. En effet, l’absence de données a longtemps conduit à l’utilisation ex-clusive des archives municipales et gouvernementales, au détriment de l’histoire sociale et populaire. Enfin, j’ai systématiquement dépouillé la presse et notam-ment le Cape Times, le Cape Argus et le Mail and Guardian (ancien Weekly Mail) des années 1990. Je me suis également référée à des journaux plus anciens de façon ponctuelle.
J’ai choisi d’effectuer mon terrain sous la forme d’une série d’enquêtes qua-litatives dans les différents townships et camps de squatters de Cape Town. L’ap-proche culturelle est traditionnellement qualitative; elle a besoin d’entretiens faits en profondeur, ce qui, pour un chercheur individuel, est difficilement compatible avec un grand nombre de questionnaires.
J’ai sélectionné un certain nombre de quartiers selon différents critères. Bien sûr, leur accessibilité a joué un grand rôle : ma sécurité et celle de mes assistantes étaient essentielles. D’autre part, mon réseau de relations s’est agrandi au fur et à mesure du terrain, par effet « boule de neige », me donnant ainsi accès à d’autres lieux. L’éventail des lieux choisis inclut les différents types d’environnements où vivent les Noirs au Cap, à l’exception des plus riches. Les anciens townships sont représentés par des enquêtes effectuées à Langa, Gugulethu et Mfuleni. À Khaye-litsha, j’ai enquêté à la fois dans le quartier des maisons formelles (core houses) et dans des quartiers de sites viabilisés (Macassar, Harare). Les camps de squatters sont représentés par Crossroads et Mfuleni. Quelques incursions dans les hostels
5Les bibliothèques les mieux fournies à Cape Town sont la South African Library, bibliothèque de dépôt légal et la bibliothèque du Centre for African Studies, à l’University of Cape Town. Je tiens à remercier le personnel de ces deux institutions, dont la compétence et la disponibilité m’ont été d’une grande aide.
Dans chacun de ces quartiers, 25 à 30 questionnaires d’enquête ont été remplis. Les personnes interrogées étaient sélectionnées au hasard. L’entretien avait lieu en xhosa grâce à la présence d’une assistante. Pour les quelques Métis interrogés dans les quartiers mixtes, anglais ou afrikaans étaient utilisés. Le questionnaire cherchait dans un premier temps à recueillir des données socio-économiques et démographiques : structures familiales, histoire migratoire, éducation, revenu, en-gagement dans des associations à but économique, politique ou religieux, étaient ainsi déterminés. Dans un second temps, j’ai cherché à connaître la perception des lieux qu’ont les habitants de ces quartiers. Ils devaient exprimer leurs senti-ments quant à leur maison, leur quartier et la ville du Cap. De plus, les problèmes d’identité étaient abordés : identité locale, liens avec la région d’origine, percep-tion de la « nouvelle Afrique du Sud », sentiment d’appartenance à une nation. Ces questions étaient couplées avec d’autres questions plus politiques, cherchant
savoir les sympathies des personnes interrogées, mais aussi leur analyse du ré-gime d’apartheid, du gouvernement Mandela et des changements apparus dans leur vie quotidienne depuis les élections d’avril 1994. Ces questions, auxquelles la personne était invitée à répondre le plus librement possible, étaient très ou-vertes. Enfin, pour compléter ces réponses, il lui était demandé de dessiner une série de cartes mentales.
Les cartes mentales permettent d’analyser l’espace vécu par chaque per-sonne (Downs et Stea, 1973 [39] ; Jackson, 1992 [67] ; Lynch, 1960 [87] ; Steele, 1981 [130]). En demandant aux habitants des townships et des camps de squatters de dessiner leur quartier, leur lieu d’origine et le centre-ville du Cap, j’espérais dé-terminer l’ampleur de leur savoir géographique, les lieux fréquentés, les chemins suivis et les frontières respectées. En bref, saisir les représentations mentales de l’espace vécu par chacun. Cette entreprise s’est révélée plus difficile que prévu. Il a fallu convaincre bien des gens qu’ils pouvaient dessiner, même s’ils n’avaient que quelques années d’écoles. Ensuite, le concept de carte était difficile à com-prendre, malgré les efforts de mes différentes traductrices. J’ai néanmoins essayé d’exploiter et d’interpréter les résultats obtenus (cf. chapitre 6.3.2, page 192).
Enfin, recherches bibliographiques, étude des sources primaires et question-naires d’enquête ont été complétés par une série d’entretiens avec des person-nalités locales : entrepreneurs, prêtres, élus locaux, membres d’associations reli-gieuses ou de cercles d’épargne, membres de comités de rue, etc.
La résistance des Noirs
Les débuts d’une résistance politique
Dans son Vukani Bantu ! : The Beginnings of Black Protest Politics in South Africa to 1912, André Odendaal a étudié la transformation d’une résistance ar-mée, sur le terrain, à une résistance politique (Odendaal, 1984 [104]). Il distingue deux réponses au contact avec les Européens : une réponse traditionaliste, qui re-jette l’ensemble de la société et des valeurs occidentales, et une réponse moderne cherchant une participation active à cette nouvelle société5. Celle-ci est le fait de gens éduqués, christianisés, et entrés dans l’économie de marché. Les débuts de la résistance politique sont marqués par un transfert du leadership des chefs vers cette nouvelle élite.
Sa taille est loin d’être négligeable : dans les années 1860, il y a quelques 500 000 convertis africains en Afrique du Sud. Quant aux Africains ayant béné-ficié de l’éducation élémentaire dispensée par les missions, ils sont 9 000 dans les années 1850 et 100 000 à la fin du siècle, surtout dans la Colonie du Cap. Le nombre des Africains avec une éducation secondaire et supérieure ne cesse également d’augmenter. Conformément à l’idéal assimilationiste, ils souhaitent participer à la vie politique.
Dès 1836, une participation africaine restreinte aux élections locales au Cap est acquise. Le droit de vote sans distinction de race (colour-blind) est inscrit dans la constitution de la colonie en 18536. Parmi ces nouveaux électeurs, les Mfengu sont les premiers à voter en masse, dès les années 1860. En 1872, l’année de l’instauration d’un gouvernement responsable, plus de 100 Mfengu s’inscrivent sur les listes électorales à Oxkraal près de Queenstown. Dès lors, la classe éduquée renonce à la guerre comme moyen de lutter contre les Blancs et se tourne vers la politique et la presse, comme le souligne Odendaal : Dans les années 1880, à une époque qui coïncide approximative-ment avec la fin de la résistance militaire, une augmentation considé-rable de l’activité politique africaine eut lieu. Les inscriptions sur les listes électorales s’accélérèrent, les Africains commencèrent à fonder des organisations, politiques ou autres, un journal africain fut lancé et l’on assista à la montée en puissance de la première génération de responsables politiques africains non tribaux. La population de cette nouvelle classe instruite augmenta au point que ces Africains furent identifiés comme une nouvelle couche sociale distincte et bien défi-nie. » [104, p. 6]
Ainsi, le Kaffir Express (futur Isigidimi Sama Xhosa, premier journal com-prenant un éditeur africain, John Tengo Jabavu) est créé à Lovedale en 1870. L’Imbumba Yama Nyama est fondé à Port Elizabeth en 1882, avec un but ex-plicitement politique : unir les Africains et combattre pour leurs droits nationaux.
La résistance noire, de 1912 aux années 1980 Le rôle de l’ANC, 1912–1960
On peut, à la suite de Tom Lodge, établir la périodisation suivante des mouve-ments de résistance (Lodge, 1983 [83, p. viii]) :
– Pendant l’entre-deux-guerres, l’ANC est un mouvement de faible ampleur, soutenant un certain nombre de manifestations—dont le mouvement contre les passeports intérieurs de 1919—mais profondément réformiste. Pétitions, délégations, déclarations sont les outils utilisés : on cherche à convaincre. À côté de l’ANC, le syndicat Industrial and Commercial Workers’ Union (ICU) et le parti communiste (Communist Party of South Africa) regroupent un certain nombre de Noirs.
– Les années 1940 voient une prolétarisation et une industrialisation crois-santes, ainsi qu’une crise socio-écologique des campagnes. La réponse des mouvements de résistance traditionnels est hésitante, mais la classe ouvrière urbaine réagit spontanément aux problèmes immédiats (coût de la nourri-ture, des transports, crise du logement, faibles salaires). Cette période est un véritable tournant, la résistance se radicalisant dans le contexte d’une montée du syndicalisme noir.
– Les années 1950 sont caractérisées par un certain nombre de campagnes politiques de masse, résultat de la phase précédente de radicalisation.
– Pendant la décennie suivant l’interdiction des partis de résistance en 1960 a lieu la transformation difficile d’organisations de masse peu structurées en une élite révolutionnaire clandestine.
– Enfin, des années 1970 à 1983-85, révoltes et répressions se combinent pour faire glisser la société sud-africaine vers une crise généralisée (cf. page 48).
La radicalisation des années 1940 passe à l’ANC par deux démarches : la fon-dation en 1944 de la Youth League et le rapprochement avec les communistes. La League, dirigée par Anton Muziwakhe Lembede, compte Mandela, Sisulu et Tambo parmi ses membres principaux. Elle souhaite donner au mouvement « l’es-prit du nationalisme africain » et veut se rapprocher de la résistance populaire (cf. page 45). À ce titre, elle mettra donc l’accent sur l’importance du leadership indi-gène et sur l’auto-détermination nationale. Des membres de la Youth League ac-céderont au bureau national de l’ANC après la guerre. À la même époque, le parti communiste (CPSA) change de direction politique et professe désormais que la révolution socialiste doit passer par le combat nationaliste et décolonisateur. Il se rapproche de l’ANC et plusieurs communistes participent au bureau national. Devant les premières mesures du gouvernement du Parti national (cf. ta-bleau 2.1 et page 38), un Programme of Action est adopté à Bloemfontein en 1949. Il préconise une stratégie plus revendicatrice, basée sur la non-violence, la déso-béissance civile et les démonstrations de force. Cette tactique sera adoptée lors de la Defiance Campaign de 1952, dont Walter Sisulu est l’idéologue. Pendant des mois, des milliers de volontaires seront arrêtés pour avoir volontairement et paci-fiquement transgressé les lois de ségrégation. La campagne sera particulièrement suivie dans le Cap oriental, et aura pour conséquence durable le renforcement de l’ANC : Lodge [83, p. 33–66] estime que quelques 100 000 personnes soutien-dront l’ANC à la suite de la Defiance Campaign.
La consolidation du pouvoir nationaliste aux élections de 1953 va lui permettre d’accélérer la mise en place de l’apartheid. Pourtant, l’ANC ne lance pas de cam-pagne majeure ; il faut dire que le harcèlement policier s’ajoute aux difficultés organisationnelles pour lui rendre la vie difficile : en 1952, 11 des 27 membres du National Executive Council sont « bannis »7 ; à partir de 1953, le procès (Trea-son Trial) de la majorité des leaders les retire pour de long mois de la vie politique active. Cependant, l’ANC rédige avec quelques alliés la Charte de la liberté (Free-dom Charter), qui lui servira de programme dans les décennies suivantes.
Enfin, en 1959, un petit groupe fait sécession de l’ANC pour former le Pan-Africanist Congress (PAC) autour de Robert Sobukwe : ils contestent en effet le rôle et l’influence des sympathisants blancs de l’ANC et souhaitent que les Noirs se libèrent par leurs propres forces.
1985-1994 : état d’urgence et négociations
L’insurrection des années 1980 marque un véritable tournant : les townships se soulèvent, obéissant au mot d’ordre lancé par Oliver Tambo sur Radio Freedom pour le Nouvel An 1985 : « Make the country ungovernable ». Dans un contexte de crise économique, le pays va connaître dix années de guerre civile larvée et la pire violence de son histoire. Au milieu de la période, le président de la Ré-publique sud-africaine, Frederik Willem de Klerk décidera de prendre le chemin d’une certaine démocratisation en levant l’interdiction de l’ANC et en libérant les prisonniers politiques, dont Nelson Mandela. Les négociations qui s’ensuivirent entre l’ANC et le Parti national aboutiront aux élections démocratiques d’avril 1994.
La crise du début des années 1980
Depuis 1978, P. W. Botha est au pouvoir. Il montre quelques velléités réfor-mistes, en abolissant par exemple le Prohibition of Mixed Marriages Act, sans doute pour tenter de prévenir une vague de mécontentement. Il est également res-ponsable de la réforme constitutionnelle de 1983, mettant en place un parlement tricaméral : une assemblée de Blancs, une de Métis, une d’Indiens, dont les élec-teurs figurent sur des listes séparées11.
Mais ces réformes restent de l’ordre du cosmétique et ne remettent pas en cause les principes du « grand apartheid » : si « l’apartheid mesquin » (petty apar-theid) est réformé, avec un assouplissement du Separate Amenities Act, le grand dessein des homelands se poursuit (cf. infra). En fait, ces tentatives réformistes sont tout juste suffisantes pour aliéner l’extrême-droite. Les Afrikaners les plus conservateurs cessent de soutenir le Parti national et rejoignent soit le Parti conser-vateur (Konserwatiewe Party) de Treurnicht soit l’Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), mouvement de résistance afrikaner mené par Eugène Terre’Blanche.
Le gouvernement sud-africain sous P. W. Botha est surtout caractérisé par une concentration et une militarisation du pouvoir. Il est concentré entre les mains de Botha, notamment après la réforme constitutionnelle de 1983 qui confond les postes de président de la République et de Premier ministre. La militarisation est marquée par l’entrée au gouvernement du général Magnus Malan, ancien chef des armées, au ministère de la Défense. Le gouvernement diffuse l’idée du total onslaught (littéralement assaut global) : l’Afrique du Sud est assaillie de tous côtés par le terrorisme d’inspiration communiste, et il faut contrer ces attaques par une stratégie globale (total strategy), faisant la part belle à la répression. Les grandes décisions politiques sont prises par un cabinet réduit, le State Security Council, où siègent les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la Justice et de l’Intérieur (Police, Law and Order).
En même temps, la politique des homelands atteint son apogée : jamais les expulsions n’ont été aussi nombreuses. Elles auront concerné 3,5 millions de per-sonnes entre 1960 et 1982 (Surplus People Project, 1983 [133])… Le gouverne-ment sud-africain cherche à consolider les homelands pour les rendre viables. Après le Transkei en 1976, le Bophuthatswana, le Venda et le Ciskei obtien-dront leur indépendance. La population africaine du Ciskei passera de 357 801 personnes en 1970 à 630 353 personnes en 1980 (Davenport, 1991 [32, p. 405]).
Le contexte économique sud-africain des années 1980 est marqué par une crise d’importance, déclenchée par une crise agricole : en effet, les années 1982-1984 connaîtront une sécheresse exceptionnelle. Les fermiers en faillite seront soutenus par des subventions gouvernementales, alors que les dépenses militaires croissent de façon spectaculaire à cause des conflits dans les pays frontaliers et que la poli-tique de grand apartheid coûte cher à l’État. Il frôle la faillite et une crise monétaire aggravée par l’effondrement du cours de l’or touche l’ensemble du pays.
C’est dans ce contexte que la résistance noire trouve un nouvel élan. Le lance-ment de l’United Democratic Front (UDF) en 1983 lui donne une façade politique, la première depuis l’interdiction de l’ANC et du PAC en 1960. Dans un premier temps, l’UDF mené par Allan Boesak, Mohamed Valli Moosa et Trevor Manuel fait campagne—avec succès—pour le boycott des élections de 1984, les premières après la réforme constitutionnelle de 1983 : dans le Western Cape, la participation des Métis ne sera que de 11 % et la moitié seulement des électeurs potentiels s’est incrite sur les listes (Seekings, 1992 [123]). Il lancera par la suite de nombreuses campagnes, sur des problèmes locaux comme nationaux. Par ailleurs, l’UDF dans sa majorité se réclame de l’ANC. Le mouvement syndical noir se reconstitue lui aussi : la COSATU (Congress of South African Trade Unions), fédération de syn-dicats, est fondée en novembre-décembre 198512. Enfin, une nouvelle vague de protestation lycéenne, aux griefs variés, commence au début des années 1980 : écoliers et lycéens boycottent leurs écoles pour protester contre l’immoralité ou l’incompétence des enseignants, les bas salaires dans le secteur de l’éducation, le manque d’infrastructures et le système de la Bantu Education.
L’insurrection
C’est donc dans ce contexte extrêmement volatile que l’insurrection com-mence. Ce sont les quelques concessions cosmétiques accordées par P. W. Botha qui vont déclencher la révolte : la réforme de l’éducation, la construction de lo-gements, l’accès des Noirs à des emplois qualifiés ne sont que des améliorations
Sur l’histoire de la COSATU, voir The Shopsteward, vol. 4, no6, décembre 1995. Ce numéro anniversaire, intitulé Ten Years of Worker’s Unity and Struggle peut également être consulté sur le World Wide Web, http ://www.anc.org.za :80/cosatu/shop/shop0406.html.
Le domaine du politique reste fermé ou, pire, moqué. Les lois Koornhof, du nom du ministre de la Coopération et du Développement13, mettent en place des conseils municipaux noirs, les Black Local Authorities (BLA), chargés des affaires des townships. Mais ces conseils ne sont ni légitimes ni populaires : les organi-sations anti-apartheid ayant appelé au boycott des élections, les BLA sont élus par une fraction infime de la population. Dans l’East Rand, 20 % seulement des inscrits ont voté ; à Soweto, 5 %. De plus, les BLA ne sont pas indépendants : le ministre pouvant en nommer ou renvoyer les membres à volonté, ils suivent ses directives. Enfin, et c’est le principal grief de la population, ils doivent être finan-cièrement autosuffisants : pour cela, ils augmentent dramatiquement les loyers et en profitent pour s’enrichir.
L’insurrection commence sur l’East Rand, dans les townships de Sharpeville, Bophalong, Sebokeng et Evaton : c’est là que les loyers sont les plus élevés. La foule s’attaque surtout aux conseillers des BLA, brûlés vifs par le supplice du collier14. Grâce à la répression policière et au mécontentement général, l’insur-rection s’étend rapidement dans tout le pays : Soweto, les camps de squatters de Cape Town autour de Crossroads, les townships du Cap oriental, Inanda et Umlazi
Durban et même les townships des petites villes sont en flammes. La présence fédératrice de l’UDF fait que, pour la première fois dans l’histoire du pays, l’en-semble de la population noire prend parti contre le gouvernement : anciens acti-vistes de l’ANC, leaders des émeutes de 1976, syndicats, étudiants, églises, mou-vement de la Conscience noire (Black Consciousness) et même quelques Blancs participent à la révolte. Elle durera trois ans, fera plus de 3 000 morts. Plus de 30 000 personnes seront arrêtées, l’armée sera mobilisée et P. W. Botha devra im-poser l’état d’urgence (Sparks, 1990 [127, p. 328 sq.]).
Pendant ces trois ans, les townships vont fonctionner comme des zones libé-rées malgré la poursuite du conflit. Les Black Local Authorities, premières vic-times de la violence, seront remplacés par des associations locales, les civics, qui prendront en charge la gestion municipale. L’arbitrage des conflits et le système judiciaire seront assurés par des cours de justice populaire, les people’s courts15. Pour la première fois aussi, l’armée et la police sont confrontées à une guérilla urbaine organisée, menée par les comrades, comme en février 1985 à Crossroads et Alexandra. En même temps, une certaine terreur s’abat sur les townships pris entre la répression policière et le zèle révolutionnaire des comrades.
Les négociations
C’est alors qu’interviennent un certain nombre de changements, notamment extérieurs. La perestroïka de Gorbatchev change la donne géopolitique. Des ac-cords de paix sont conclus en Namibie et en Angola. Le total onslaught a vécu. L’unité des Afrikaners, qui s’était faite dans les années 1970–1980 selon le prin-cipe de la survie et du combat contre le communisme, est remise en cause. L’Union soviétique encourage ANC et gouvernement sud-africain à négocier. Dès 1986, Oliver Tambo, conscient de l’impasse, fait la liste des conditions nécessaires pour que l’ANC accepte de négocier : libération des prisonniers politiques dont Nelson Mandela, levée de l’interdiction de l’ANC et des autres organisations po-litiques, abolition de quelques lois-clefs de l’apartheid et autorisation du retour des exilés. Le gouvernement sud-africain entame des négociations secrètes avec Mandela, accélérées par le remplacement de P. W. Botha par de Klerk en 1989 (Sparks, 1994 [128]).
En même temps, la société civile évolue vers plus d’intégration raciale : des « zones grises » où Noirs, Blancs, Métis et Indiens habitent côte à côte apparaissent dans le centre des grandes villes et notamment à Johannesburg (Guillaume, 1997 [57]). La mobilité sociale ascendante des Noirs est réelle et en-couragée par le patronat, qui agit ainsi soit par intérêt, soit à cause de la politique d’affirmative action18 proposée par l’ANC. Tout cela est renforcé par le nombre croissant de Noirs ayant une éducation supérieure : à la fin des années 1980, les non-Européens constituaient 40 % de la population étudiante (Sparks, 1990 [127, p. 376]). Ces jeunes cadres sont ensuite recrutés par les grandes entreprises et quittent souvent les townships pour aller habiter dans les banlieues blanches.
C’est dans ce contexte que le nouveau président, F. W. de Klerk, monte à la tribune parlementaire le 2 février 1990. Après avoir annoncé son intention de développer les relations extérieures de l’Afrique du Sud, notamment avec les pays d’Afrique australe, de faire respecter les droits de l’homme et de les inscrire dans la constitution, de suspendre les exécutions, il annonce des réformes politiques de grande ampleur. Son discours vaut la peine d’être cité longuement :
« Les décisions qui ont été prises sont les suivantes :
– L’interdiction de l’African National Congress, du Pan Africa-nist Congress, du South African Communist Party et d’un cer-tain nombre d’organisations auxiliaires est levée.
Cette politique vise à encourager la mobilité sociale des Noirs en leur donnant une préférence l’embauche.
– Les personnes emprisonnées simplement parce qu’elles étaient membres de l’une de ces organisations ou pour avoir commis un autre délit qui n’était un délit que parce que l’interdiction de l’une de ces organisations était en vigueur seront identifiées et libérées. Les prisonniers condamnés sous d’autres chefs tels que meurtres, actes de terrorisme ou incendies volontaires ne sont pas concernés.
– La législation d’urgence concernant les media et l’éducation est totalement abolie.
– La législation d’urgence sur la sécurité sera amendée afin de continuer à permettre un contrôle effectif des documents vi-suels relatifs aux émeutes.
– Les restrictions aux termes de la législation d’urgence concer-nant 33 organisations sont levées. Ces organisations com-prennent : le National Education Crisis Committee, le South African National Students Congress, l’United Democratic Front, la COSATU, Die Blanke Bevrydingsbeweging van Suid-Afrika. (…)
– La période de détention aux termes de la législation d’urgence sur la sécurité sera dorénavant limitée à six mois. Les détenus obtiennent de plus le droit d’être représentés par un avocat et soignés par le médecin de leur choix.
(…) Entre autres choses, [l]es objectifs [du gouvernement] com-prennent une nouvelle constitution démocratique ; le droit de vote pour tous ; l’absence de domination; l’égalité de tous devant une jus-tice indépendante ; la protection des minorités comme des droits indi-viduels; la liberté religieuse ; une économie saine basée sur des prin-cipes économiques sains et l’entreprise privée ; des programmes dy-namiques pour l’éducation, la santé, le logement et les conditions de vie de tous.
Concernant tout ceci, M. Nelson Mandela aurait un rôle important à jouer. Le gouvernement a pris note de ce qu’il s’est déclaré prêt à contribuer de manière constructive au processus politique pacifique en Afrique du Sud.
Je tiens à dire clairement que le gouvernement a pris la ferme décision de libérer sans condition M. Nelson Mandela. »19
Le 11 février 1990, Nelson Rolihlala Mandela était libéré de prison.
L’ensemble du discours de de Klerk est reproduit dans l’ouvrage de Willem de Klerk, FW de Klerk : The Man in his Time, 1991 [34, p. 34–46].
commencé bien avant ce discours historique. Dès 1985, Mandela, conscient de la détérioration de la situation, avait demandé à rencontrer P. W. Botha. Un séjour du leader de l’ANC à l’hôpital en 1985 avait permis d’établir des premiers contacts avec Kobie Coetsee, ministre de la justice et des prisons (Sparks, 1994 [128]).
Par ailleurs, les contacts entre des Sud-Africains blancs et l’ANC en exil se multiplient : le patronat et les intellectuels sont parmi les premiers, mais on compte aussi le Broederbond, société secrète afrikaner et tête pensante du Parti national et les modérés ou verligtes (litt. éclairés) de ce parti. Après février 1990, le dialogue entre les deux partis prend un tour plus for-mel. Les Minutes de Groote Schuur de mai 1990 sont un premier pas : il s’agit de rendre les négociations possibles en libérant les prisonniers politiques, en facili-tant le retour des exilés—ce qui veut bien souvent dire suspendre ou annuler les poursuites judiciaires dont ils font l’objet—et en amendant l’état d’urgence. Le 7 août 1990, Mandela annonce au nom de l’ANC la suspension de la lutte armée. Cependant, le Parti national est encore très loin d’accepter de donner le pou-voir au parti majoritaire : il n’accepte qu’un partage du pouvoir (power sharing). Il voit l’Afrique du Sud comme une nation constituée de minorités : en effet, chaque tribu noire est à ses yeux une entité ethnique à l’image des Afrikaners et les droits politiques de chaque minorité en tant que telle doivent être protégés. Ses propositions politiques reflètent cette vision : il suggère la mise en place de deux assemblée, l’une élue au suffrage universel et l’autre constituée de délégués régionaux (en pratique, représentants de la tribu majoritaire dans leur région) et de représentants des Anglais, Afrikaners et Asiatiques (background groups). Le gouvernement d’unité nationale serait constitué pour moitié de ministres choisis selon le même principes, les autres étant nommés par le président. Enfin, ce der-nier ne serait pas un individu, mais un collège (collegiate chairmanship) devant atteindre ses décisions à l’unanimité. Tout cela visant à garantir la prééminence politique des Blancs ne peut bien entendu être accepté par l’ANC.
Un autre conflit d’importance séparant les deux partis porte sur la rédaction de la nouvelle constitution. Pour l’ANC, elle doit être rédigée par une assemblée constituante élue au suffrage universel. Pour le Parti national, cette tâche revient à une assemblée paritaire de délégués de chaque parti politique.
Le Programme de Reconstruction et de Développement (RDP)
Une première phase de l’action gouvernementale a été marquée par le souci de reconstruire l’économie sud-africaine. La crise était profonde : un contexte de dépression s’ajoutait à des années de sanctions économiques internationales et au coût financier et économique de l’apartheid. L’appareil productif sud-africain est dans une large mesure ancien, avec une faible productivité. Son isolation a limité l’adaptation et l’emploi de nouvelles technologies, comme les investissements étrangers. Enfin , l’économie sud-africaine repose encore trop sur ses productions minières traditionnelles, ce qui la rend dépendante. Une relance économique est donc nécessaire. En même temps, l’ampleur des inégalités sociales est un facteur fragilisant. Pour des raisons politiques comme économiques, l’ANC a été conduit à élaborer une politique globale, intégrée, unissant croissance économique, développement et réduction des inégalités héritées de l’apartheid. Avec le souci de transparence typique des premières années de la démocratisation, cette politique a été élaborée en consultant aussi bien la population que des experts ou des ONG, avant d’être diffusée largement avant les élections de 1994 sous le titre The Reconstruction and Development Programme : A Policy Framework [3].
Le RDP est ainsi présenté : Le RDP est un cadre politique socio-économique intégré et co-hérent. Il cherche à mobiliser tout notre peuple et les ressources de notre pays pour l’éradication finale de l’apartheid et la construction d’un avenir démocratique, non-racial et non-sexiste. »(Reconstruc-tion and Development Programme, 1994 [3, § 1.1.1])
Le RDP est basé sur six principes (RDP [3, § 1.3]) : une approche intégrée et durable (sustainable); l’importance accordée et aux besoins des citoyens et leur participation; le rétablissement de la paix civile; la construction natio-nale ; la promotion conjointe de la reconstruction (sociale) et du développement (économique) ; la démocratisation de la société sud-africaine. Ces principes sous-tendent l’ensemble du RDP et trois d’entre eux sont fondamentaux dans la poli-tique du gouvernement : la participation des citoyens et la recherche systématique du consensus sont des traits marquants de la vie sud-africaine, hérités sans doute des idéaux démocratiques des mouvements anti-apartheid comme des modali-tés pratiques de la révolution négociée (Aji et Houssay-Holzschuch, 1997 [62]). Construction nationale et démocratisation de la société sont les buts que s’est fixé le président Mandela, avec celui, ô combien symbolique, de la réconciliation. Cette politique globale du RDP passe par cinq grands programmes (RDP [3, notamment § 1.4]) :
– Pourvoir aux besoins de la population. Cela passe par la création d’emplois, la réforme agraire et la mise en place d’infrastructures dans les zones qui en sont dépourvues (zones rurales, anciens bantoustans, camps de squatters, etc.) : eau, électricité, transports et télécommunications doivent être déve-loppés. À la crise du logement et à la multiplication des camps de squatters, le RDP répond par un plan de construction d’un million de maisons en cinq ans. La protection de l’environnement, des programmes de nutrition desti-nés en particulier aux enfants des écoles et le développement d’un système de santé et de sécurité sociale accessible à tous sont également parmi les objectifs.
– Développer les ressources humaines. Il s’agit ici de permettre à la popu-lation d’acquérir des qualifications, en développant le système éducatif de l’école primaire à l’université comme en insistant sur la formation continue. Dans le contexte de la politique d’affirmative action, les femmes et les po-pulations non-blanches seront les premiers bénéficiaires de ce programme. Le développement de la culture comme des sports est vu comme un moyen de développer les qualifications et capacités créatrices de la population.
– Construire l’économie. Forces et faiblesses de l’économie sud-africaine sont reconnues : les mines, l’industrie, l’agriculture, le commerce, les ser-vices financiers et les infrastructures sont vus comme des atouts—de façon un peu optimiste peut-être. Par contre, selon le RDP, il faut remédier rapi-dement à la faiblesse des investissements dans le domaine de la recherche-développement, à l’absence de qualification de la main-d’œuvre, aux coûts de production trop hauts, à la faible productivité et à la montée du chô-mage. Pour cela, l’Afrique du Sud doit resserrer les liens économiques qui l’unissent aux autres pays d’Afrique australe et participer à la création d’une zone de prospérité ainsi caractérisée : « a large stable market offering stable employment and common labour standards in all areas » (RDP [3, § 1.4.16]).
– Démocratiser l’État et la société. Ce processus est vu comme une condition nécessaire à la mise en place des autres programmes. La rédaction de la Constitution définitive, incluant une Déclaration des droits (Bill of Rights) en est une des étapes (cf. page 60).
– Enfin, le dernier principe du RDP est curieusement d’« appliquer le RDP » (Implementing the RDP, [3, § 1.4.21]). Il s’agit en fait de trouver les res-sources nécessaires à l’application de ce programme, soit en réattribuant une partie des ressources gouvernementales (celles consacrées auparavant aux dépenses militaires, par exemple), soit en rationalisant le budget, soit en trouvant de nouveaux financements, par la participation du secteur privé un certain nombre de projets ou la privatisation de certaines entreprises publiques.
Le patronat a plutôt bien reçu ce programme, en se félicitant de l’approche intégrée, de l’appel lancé à tous les secteurs de la société, du pragmatisme et de l’intervention de l’État (Godsell, 1994 [52]). Mais « l’irréalisme » du RDP l’inquiète.
Un an après le lancement du RDP, Jay Naidoo, le ministre qui en avait alors la charge, le qualifie de « succès majeur » (Cape Times, 25 mai 1995) :
– Le nombre de patients traités dans les zones rurales a quadruplé depuis que les plus pauvres sont soignés gratuitement.
– 172 dispensaires ont été construits ou rénovés.
– 378 171 logements ont été électrifiés, plus que les 300 000 prévus.
– Cinq millions d’enfants ont bénéficié des programmes de nutrition dans 12 800 écoles.
– Des plans de développement et de réhabilitation urbaine ont été préparés pour les zones en crise.
– Plus d’un million de personnes recevront l’eau courante en 1995-96 dans les zones rurales. Mais le problème majeur reste celui du manque de logements qui s’aggrave au moment où Naidoo parle : en 1994, il était évalué à 1,5 million de logements; il continue de s’accroître, au rythme de 200 000 par an.
En 1996, un remaniement ministériel place Jay Naidoo aux Télécommunica-tions et ferme le bureau du RDP. L’explication officielle est que chaque ministère applique ce programme dans son domaine de compétence. En même temps, le gouvernement se lance dans une politique économique libérale, insistant sur la croissance plus que sur le redressement des inégalités (cf. page 63).
La haie d’amandes amères
Une station de ravitaillement
Le succès de la colonisation hollandaise dans les Indes orientales et le déve-loppement du commerce avec Batavia entraînèrent une croissance de la circula-tion maritime autour de l’Afrique. Il devenait alors crucial de pouvoir assurer à mi-parcours le ravitaillement de cette flotte en eau, en bois, comme en nourriture pour l’équipage—en particulier en fruits et légumes frais, pour lutter contre le scorbut.
Une station idéale devait également offrir un ancrage sûr et abrité, un ravi-taillement en eau facile et de qualité, et des possibilités de commerce avec les Khoisan (Hottentots) pour se fournir en viande. La Baie de la Table (cf. carte 3.2) remplissait ces conditions.
Le Conseil des Dix-Sept, à la tête de la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales (ou VOC), opta pour la création d’une station de ravitaillement, « ren-devous and fort » (sic) dans la baie de la Table (Whittingdale, 1973 [149, chapitre 1]). Le 6 avril 1652, le Reiger, l’Oliphant, le Walvisch et le Drommedaris, com-mandés par Jan Van Riebeeck, jetaient l’ancre dans la baie.
Les premiers développements de la ville répondaient à deux critères : assurer la défense des employés de la compagnie et produire le ravitaillement demandé. Jan Van Riebeeck fit construire un fort aux murailles de terre le long de la Varsri-vier, à l’emplacement de l’actuelle poste centrale. Un jardin potager fut planté au sud et à l’ouest du fort de Bonne-Espérance (cf. carte 3.3)—les actuels Jardins de la Compagnie n’en sont que le reliquat. Enfin, en 1654, une jetée de bois fut bâtie près du fort et la Varsrivier fut canalisée. Dans un geste à l’importance symbolique extrême, Van Riebeeck érigea la première barrière physique entre les Européens et les Khoisan : il ordonna de planter une haie d’amandes amères, courant de la plage à la colline de Wynberg, autour de Devil’s Peak (cf. carte 3.3). Ainsi, les employés de la Compagnie s’isolaient de l’Afrique.
La petite colonie se développe dans les années qui suivent, principalement par accroissement naturel. Malgré la volonté explicite de la Compagnie, les bourgeois libres (vrij burghers) construisent des chaumières à l’extérieur du fort. Des routes pour chariots menant vers les jardins se forment de chaque côté du canal princi-pal—à la place de l’actuelle Adderley Street—et quelques « rues », bien visibles sur le plan de 1660 conservé aux Archives (cf. aussi carte 3.3) se développent perpendiculairement à l’axe nord-sud. Enfin, une autre piste à chariots relie les carrières de Signal Hill au fort (actuelle Wale Street), puis continue vers l’est sous le nom de « den Wagen pad na t’bos » (piste à chariot vers les broussailles), là où est aujourd’hui Main Road [149, 94].
Petit à petit, un hameau (Het Vlek) se construit par densification entre les rues Herrengracht (actuelle Adderley), Burg, Longmarket et Waterkant. Canaux (le long des rues Keisersgracht, Wale et Strand) et passages étroits créent une ville la hollandaise, où apparaissent, quelques manufactures (brasserie, briqueterie, moulins).
Het Vlek—Kaapstadt : du hameau à la ville
Un siècle de VOC : une consolidation urbaine et coloniale.
Le siècle qui suivit les premières décennies fondatrices fut une période de consolidation urbaine, toujours sous l’égide de la Compagnie des Indes Orien-tales. L’équipement urbain en bâtiments publics se poursuit, le port est aménagé. La population croît, par accroissement naturel comme par solde migratoire (cf. figure 3.1, page 78) : colons et esclaves abordent à Kaapstadt. Enfin, la logique isolationniste est brisée : la conquête et la colonisation de l’intérieur connaissent leur premier élan.
Outre la première église d’Afrique du Sud, la Compagnie fait construire un hôpital sur le Herrengracht, face à la Groote Kerk. Entrepôts, abris pour les ba-teaux, étables, se dressent sur la plage, de Rogge Bay à Grand Parade (Marshall, 1940 [94, p. 32 sq.]). Le plus important de ces nouveaux bâtiments est le hangar abritant des mâts de rechange.
Il s’agit donc de donner au hameau du Cap les moyens de remplir son rôle de station de ravitaillement et d’assurer la survie de ce comptoir. Dans le même ordre d’idées, le site de l’ancien fort est utilisé comme réservoir d’eau, collectant les eaux de ruissellement comme celles de la Varsrivier pour les redistribuer grâce des tuyaux de bois aux navires à l’ancre. L’irrigation des jardins est améliorée. Enfin, le déboisement des pentes de la montagne de la Table comme des Cape Flats, réduits à une plaine sableuse, faisait craindre des problèmes de ravitaille-ment en combustible et pièces de charpenterie. Pour y remédier, les gouverneurs de la Compagnie font planter des chênes entre Rondebosch et Wynberg.
Taverne des mers et glaive impérial
La route des Indes
La Compagnie des Indes Orientales fait banqueroute en 1794, mais les troupes françaises présentes au Cap assurent à la fois le gouvernement et les débouchés pour les productions locales. Dès 1795 pourtant, la Grande Bretagne en prend possession sans difficultés en se proclamant représentante des princes d’Orange. Cette première présence britannique sera brève : à la suite du Traité d’Amiens, la République batave retrouve son contrôle sur la colonie. Mais les Anglais ont noté l’importance stratégique du Cap, comme l’écrit le capitaine Blankett au secrétaire de la guerre (Secretary of War) en 1795 :
Tous les vaisseaux qui se rendent aux Indes ou en reviennent viennent en vue des côtes aux environs du Cap. Pour battre des croi-seurs qui y seraient basés il faudrait, par conséquent, organiser de puissants convois. Il importe pour nous de prévenir tout ce qui per-mettrait à la France de prendre pied aux Indes. Il serait vain d’ajouter quoi que ce soit pour souligner l’importance du Cap, sinon dire que ce qui était une plume aux mains de la Hollande serait un glaive aux mains de la France. »5
Barrer la route des Indes à la France : le grand mot est lâché. Il n’y a donc pas s’étonner que dès 1806 la Grande Bretagne reprenne le contrôle de la colonie. Elle lui sera formellement cédée par la Hollande, contre compensations, en 1814.
La première conséquence de ce changement de maître sera commerciale. En effet, la Compagnie exerçait un monopole sur les échanges commerciaux en pro-venance ou à destination du Cap, échanges qu’elle cherchait à limiter. La Grande Bretagne va, au contraire, encourager les marchands : ils profitent de la présence d’une garnison et d’une flotte britannique pendant les guerres napoléoniennes. Le commerce devient florissant, des banques s’ouvrent (Marshall, 1940 [94, p. 51]) et une courte prospérité s’installe. Cela est d’autant plus vrai que la métropole pra-tique des tarifs protectionnistes qui favorisent les produits agricoles, principales exportations de la colonie. Mais la fin des guerres napoléoniennes sonne le glas de ce traitement préférentiel.
L’influence britannique
Le Cap va connaître sous l’influence britannique une première série de chan-gements majeurs : le rôle de la ville comme l’échelle de son développement vont évoluer de façon radicale. Les Britanniques sont, on l’a vu, arrivés au Cap pour des raisons stratégiques. Le site du Cap en fait d’ailleurs un port facilement dé-fendable. À ces considérations géopolitiques s’ajoute un facteur économique : les nouveaux arrivants souhaitent transformer cette petite ville en un port impor-tant, exportant des matières premières vers l’Angleterre et ses industries en plein développement : en particulier, l’élevage ovin sud-africain va fournir l’industrie anglaise de la laine.
Pour cela, des programmes d’aide à l’émigration vers l’Afrique du Sud sont mis en place en Angleterre. Le plus connu est celui qui verra débarquer les Colons (Settlers) à Grahamstown en 1820, mais l’ensemble de la colonie—Le Cap y com-pris—en bénéficiera. Par ailleurs, on développe les infrastructures de transport : de nombreuses routes sont tracées ou élargies (cf. infra); Thomas Baines équipe d’ouvrages d’art (ponts, tunnels…) les routes et les cols de l’arrière-pays. Enfin, la Couronne rétablit les tarifs protectionnistes pour la laine et le vin.
Les derniers changements apportés par les Anglais seront d’ordre politique : pour contrôler le pays, ils réforment les systèmes politiques, administratifs et ju-diciaires en vigueur. La colonie du Cap bénéficiera d’une certaine autonomie po-litique (self-government), tout en s’intégrant dans l’empire colonial.
Avec l’arrivée des Britanniques, la ville du Cap va bénéficier d’un certain nombre de nouvelles technologies, nées de la Révolution industrielle. Il faut ce-pendant souligner que l’Afrique du Sud n’est pas encore en voie d’industrialisa-tion même si le chemin de fer, la vapeur, etc. s’installent : l’économie sud-africaine est agricole, coloniale et extravertie jusqu’en 1867, date de la découverte des dia-mants de Kimberley. Ce n’est qu’après cette Révolution minière—appelée locale-ment Mineral Revolution—que l’Afrique du Sud entrera dans l’ère industrielle.
La croissance urbaine
La prospérité des années 1870 a largement contribué à l’émergence décisive d’un Central Business District : de nombreux bâtiments résidentiels sont trans-formés en commerces dans les dix-huit pâtés de maison centraux (Whittingdale, s.d. [150, p. 87]). Adderley Street en est l’artère principale et les magasins s’y alignent entre la nouvelle gare et le bâtiment néo-classique de la Standard Bank. Les premiers grands magasins, Stuttaford et Markhams, des compagnies mari-times comme la Union Shipping Company, y ont également leur siège. Parallè-lement à Adderley, St George Street concentre de nombreuses banques, dont la South African Bank, et les sièges de nombreux journaux, dont le Cape Times.
Ce CBD est desservi à partir des années 1880 par le tramway électrique, qui amène une clientèle variée de Kloof Street, Camps Bay, Gardens, District Six, Sea Point et des banlieues sud.
La seconde phase de prospérité (cf. supra) va relancer la construction à partir de 1893, comme le décrit Noble en 1896 : Dans Adderley Street en particulier, le travail de reconstruction a été des plus importants. Les modestes bâtiments des précédents habi-tants ont laissé place à des édifices modernes et à des façades ornées, l’imitation du meilleur style de l’architecture des rues européennes. L’African Banking Corporation, la Colonial Mutual Buildings et sa tour d’horloge, les drapiers, habilleurs, bijoutiers, pharmaciens, li-braires, courtiers d’assurance ou de fret maritime et autres établisse-ments commerciaux sont nombreux d’un côté de la rue, tandis que de l’autre se succèdent les bureaux de l’administration portuaire, le ter-minus des chemins de fer, l’imposant immeuble de la Standard Bank, l’église réformée hollandaise et les bâtiments administratifs avec, en arrière-plan, les Chambres du Parlement. » [103, p. 95 sq.]
Cette période victorienne et edwardienne de l’histoire du développement de Cape Town, période de rapide croissance urbaine, se caractérise donc en centre-ville par l’introduction d’immeubles victoriens à plusieurs étages, abritant des commerces et formant un Central Business District (CBD). Dans les premières banlieues—ou les quartiers périphériques—le développement linéaire selon les axes de communication se poursuit. Des rangées de maisons mitoyennes se construisent le long de Caledon et Hanover Street. Ce développement a surtout lieu à District Six, de façon plus ou moins anarchique et spéculative. Vers l’ouest, Waterkant et Somerset Street connaissent une croissance similaire.
Il y a donc consolidation et densification des zones urbaines périphériques, habitées principalement par les classes moyennes et ouvrières. Les classes les plus favorisées, elles, profitent de la mise en place du tramway électrique pour bâtir des villas dans des banlieues plus lointaines : Upper Buitenkant, Orange, Kloof Street et dans le nouveau quartier d’Orangezicht, sur les pentes au sud-est des jardins. En 1905, ces nouveaux quartiers résidentiels commencent à s’étendre au sud de Camp Street (Whittingdale s.d. [150]).
Les Africains au Cap avant 1901
Lorsque Van Riebeeck est arrivé en baie de la Table pour installer le poste de ravitaillement qui allait devenir Cape Town (cf. chapitre 3, page 67), il y rencontra des Khoisan, et non des tribus de langue bantoue. Des siècles de migrations ban-toues avaient repoussé ces Khoisan dans les régions les plus arides du sud-est de l’Afrique australe. Le peuplement noir de l’Afrique du Sud actuelle se concentrait dans deux grandes régions : les hauts-plateaux entre le Limpopo et la Caledon étaient occupés par les Sotho ; les Nguni (Swazi, Zoulous, Xhosa…) s’étaient ins-tallés sur la plaine côtière orientale.
En conséquence, les premiers Africains résidant au Cap ont été les esclaves importés par la Compagnie des Indes Orientales pour répondre au besoin de main-d’œuvre. Ils viennent de Madagascar, du Mozambique ou d’Afrique orientale. D’autres esclaves sont amenés d’Asie (cf. chapitre 3, page 72).
Les premiers arrivants : aventuriers et prisonniers
Au début du dix-neuvième siècle, les carnets des voyageurs commencent à mentionner des petits groupes de « Cafres »1 migrant vers l’ouest. Mais jus-qu’en 1830, la population africaine de Cape Town sera constituée de deux types d’hommes : quelques individus aventureux et des prisonniers. En effet, les vain-cus de la guerre sur la frontière orientale de la colonie en 1819 sont ramenés à Cape Town pour être détenus sur Robben Island. Ils y rejoignent quelques cri-minels, des fous et des lépreux. Ce qui permet à Elijah Makiwane, catéchiste de l’église presbytérienne, de rendre compte de l’image de la ville du Cap à la fin du dix-neuvième siècle : Pendant des années, Cape Town était pour nous associé avec Robben Island et Robben Island avec ces malheureux chefs qui s’étaient rebellés contre le gouvernement, avec des condamnés à de longues peines dont on n’attendait plus le retour et avec des malheu-reux qui avaient perdu la raison. J’ai connu des cas où, quand quel-qu’un rentrait de Cape Town, ses amis faisaient des sacrifices aux an-cêtres tellement il semblait extraordinaire qu’il rentre. » (Cape Times, 5 mai 1899, cité dans [117, p. 33]) Cape Town est donc vu comme le lieu de l’homme blanc par excellence. On peut d’emblée remarquer que cette vision africaine datant de la moitié du XIXesera reprise par le gouvernement d’apartheid jusqu’à la fin des années 1980 : de nom-breuses dispositions législatives chercheront à « préserver » cette région pour les seuls Européens et Métis. Le Cap est aussi, pour les Africains, un lieu d’exil et de répression : dès cette époque, les chefs africains résistant à la colonisation sont in-ternés sur Robben Island. Les chefs xhosa Makanda et Maqoma y seront détenus ; Cetshwayo, dernier roi zoulou indépendant, sera déporté au Cap après sa défaite contre les Anglais. Nelson Mandela et Walter Sisulu leur succéderont.
Une petite communauté mfengu
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les premiers Africains venant s’installer à Cape Town soient des réfugiés : à partir de la fin des années 1830, quelques 1Ou Kafirs, terme employé pour désigner d’abord les Noirs du Cap oriental, Mfengu et Xhosa, puis progressivement l’ensemble des populations de langue bantoue habitant l’Afrique du Sud actuelle [117].
familles mfengu vivaient dans des huttes sur les pentes de la montagne de la Table. Les Mfengu font partie des populations déplacées lors du Mfecane. L’émer-gence de la royauté zouloue sous Chaka entre 1818 et 1828 est marquée par une série de guerres au cours desquelles les Zoulous soumettent leurs voisins. Cette politique belliqueuse engendre de nombreux fuyards, qui à leur tour déstabilisent les régions sur lesquelles ils se replient. Les Mfengu font partie de ceux-là : ils ont fui le Natal pour trouver refuge dans le Transkei, occupant souvent une position servile parmi les Xhosa.
Déracinés, mécontents de leur nouveau statut, les Mfengu seront les premiers s’occidentaliser. Partout, les missionnaires chrétiens ont recruté d’abord margi-naux et opprimés. Dans le Cap oriental, les Mfengu se sont convertis en masse au christianisme. Puis, ils se sont engagés dans l’armée anglaise comme auxiliaires dans les guerres de frontière menées pendant tout le dix-neuvième siècle contre les Xhosa. Enfin, ils ont été les premiers à acquérir une éducation à l’occidentale et à venir chercher meilleure fortune en ville.
En 1840, un rapport gouvernemental compte une demi-douzaine de huttes « dans la location fingo au pied de la montagne de la Table », regroupant vingt à quarante personnes [117, p. 19]. Ces huttes seront détruites la même année lors de l’épidémie de variole. Les Mfengu n’ont aucun mal à trouver des emplois au Cap, qui souffre d’un chronique manque de main-d’œuvre non qualifiée. Ils sont employés dans trois secteurs principaux : le port, le bâtiment ou la municipalité.
Attirer la main-d’œuvre
Une seconde vague de migrants, eux aussi réfugiés, arrive du Cap oriental en 1857. Il s’agit cette fois de Xhosa chassés par la famine due à l’« abattage du bétail » (cattle-killing).
Dans un contexte de guerres perpétuelles contre les Anglais, l’organisation so-ciale et politique des Xhosa subissait alors une crise : le pouvoir et le statut des chefs déclinaient au profit de ceux des leaders religieux. Aussi, lorsqu’en avril 1856, la jeune Nongqawuse dans une vision reçut un message des ancêtres, nom-breux furent ceux qui la suivirent. Ce que les ancêtres demandaient était l’abat-tage de l’ensemble du bétail, la destruction des réserves de céréales et l’arrêt de toute activité agricole—il s’agissait de purifier la nation des influences étrangères comme de celles des sorciers. À ce prix, les morts ressusciteraient et viendraient chasser les colonisateurs. Toute la nation ne se soumit pas à cette injonction mais des milliers de têtes de bétail furent abattues. La famine qui suivit fit entre 35 000 et 50 000 victimes.
Fuyant la famine, des milliers de Xhosa atteignent Le Cap, soit d’eux-mêmes, soit après condamnation : les vagabonds et petits délinquants cherchant de quoi se nourrir et arrêtés pour vol sont souvent condamnés à la déportation et à l’emprisonnement au Cap. À la même époque, de nombreux habitants du Ciskei signent des contrats de travail de trois ans dans la Colonie, formant la troisième catégorie d’arrivants africains au Cap. Si la majorité d’entre eux rentre au bout de quelques années dans leur lieu d’origine, certains resteront à Cape Town de manière défini-tive (cf. carte 4.1).
Il faut dire que depuis les années 1840 la ville du Cap connaît une impor-tante croissance économique : l’industrie textile britannique offre un débouché de rêve pour la laine des élevages ovins du Karoo. En conséquence, le réseau de communications de la colonie se développe : chemin de fer, routes et télégraphe sont construits, pour améliorer les communications à l’intérieur du pays. Un port moderne se met en place avec la construction du bassin Alfred en 1860. Des bâ-timents publics sortent de terre : South African Library, musées, etc. Pour tous ces travaux, Le Cap a besoin de main-d’œuvre et emploie des Africains : outre les travaux portuaires et les constructions citées plus haut, ils participeront à la construction de Victoria Road, menant vers Sea Point, et à celle du réseau ferro-viaire de banlieue. On entendra même un gouverneur encourager un chef xhosa à venir visiter la ville, dans l’espoir qu’il pousse les siens à venir y travailler.
|
Table des matières
Introduction
1.1 Espaces, représentations, discours
1.2 Villes sud-africaines : du modèle au terrain
1.3 Méthodologie
1.3.1 Remarques sur l’utilisation des statistiques
1.3.2 Questionnaires d’enquête, cartes mentales et entretiens : sources
1.4 Plan
2 De la colonisation à la fin de l’apartheid
2.1 La mise au point de l’apartheid
2.1.1 La victoire des nationalistes
2.1.2 La législation d’apartheid
2.2 La résistance des Noirs
2.2.1 Les débuts d’une résistance politique
2.2.2 La résistance noire, de 1912 aux années 1980
2.3 1985-1994 : état d’urgence et négociations
2.3.1 La crise du début des années 1980
2.3.2 L’insurrection
2.3.3 Les négociations
2.3.4 Les élections
2.4 Le gouvernement Mandela
2.4.1 Le Programme de Reconstruction et de Développement (RDP)
2.4.2 Créér la démocratie
2.4.3 La fin de l’état de grâce
3 Mother City
3.1 La haie d’amandes amères
3.1.1 Une station de ravitaillement
3.1.2 Het Vlek—Kaapstadt : du hameau à la ville
3.2 Taverne des mers et glaive impérial
3.2.1 La route des Indes
3.2.2 L’influence britannique
3.2.3 Différentiation sociale et fonctionnelle
3.2.4 Conclusion
3.3 La révolution minière
3.3.1 Or, diamants et prospérité
3.3.2 Fin de l’idéal assimilationiste
3.3.3 La croissance urbaine
4 La mise en place de la ségrégation
4.1 Les Africains au Cap avant 1901
4.1.1 Les premiers arrivants : aventuriers et prisonniers
4.1.2 Une petite communauté mfengu
4.1.3 Attirer la main-d’oeuvre
4.1.4 Le problème cafre
4.2 Le syndrome sanitaire
4.2.1 La ville et le sauvage à l’ère victorienne
4.2.2 Modèles invoqués
4.2.3 La peste de 1901 au Cap
4.3 Les principes planificateurs
4.3.1 Les recommandations
4.3.2 Principes d’administration
4.3.3 Le parc de logements
4.4 Ndabeni, 1901-1936
4.5 La vie à Ndabeni
4.5.1 Histoires
4.5.2 Le commerce
4.5.3 Shebeens
4.5.4 Éducation et religion
4.5.5 Stratification sociale
4.6 Résistance
4.6.1 Non-payement des loyers
4.6.2 Résistances ponctuelles
4.6.3 Destruction de Ndabeni
5 L’apartheid dans la ville
5.1 Langa : un premier modèle
5.1.1 Le Native (Urban Areas) Act de 1923
5.1.2 La construction de Langa
5.1.3 Urbanisation et stratification sociale
5.2 La loi au service de la partition raciale
5.2.1 Le Group Areas Act
5.2.2 Les Africains : du contrôle au rejet
5.3 Nyanga et Gugulethu
5.3.1 Lutter contre les squatters
5.3.2 Les différentes phases de la construction de Nyanga
5.3.3 Gugulethu
5.4 Les squatters
5.4.1 Windermere
5.4.2 En brousse
5.4.3 Crossroads et la multiplication des camps de squatters
5.5 Khayelitsha
5.5.1 Un changement de politique ?
5.5.2 Phases du développement
5.5.3 Histoires de vie
6 Les lieux du township
6.1 La maison
6.1.1 La maison et le lignage
6.1.2 Espace vécu, espace symbolique
6.1.3 L’image de la maison
6.2 Les lieux publics : deux cultures
6.2.1 Shebeens et gangs
6.2.2 Les espaces de la solidarité
6.3 L’espace noir
6.3.1 Hostels : l’espace ultime de l’oppression
6.3.2 Le quartier : espace dangereux, espace organisé
6.3.3 L’ailleurs
7 Un christianisme à l’africaine
7.1 Historique
7.1.1 Les églises missionnaires
7.1.2 Les églises indépendantes africaines
7.2 Saint Gabriel
7.2.1 Histoire de la paroisse
7.2.2 Un lieu de culte
7.2.3 Organisation de la paroisse et associations
7.2.4 Engagement social et politique
7.3 Bantu Congregational Church
7.3.1 Origines
7.3.2 Structure et sacrements
7.3.3 Une cérémonie
8 Le Cap aujourd’hui
8.1 La difficile redistribution spatiale
8.1.1 Mandalay : « Upper Khayelitsha » ou banlieue postapartheid ?
8.1.2 Delft South : la permanence de l’ancien modèle urbain
8.1.3 Cape Town après l’apartheid
8.2 Les problèmes de l’identité métisse
8.2.1 Le paradoxe du vote métis : « Better the devil you know »
8.2.2 Gangs et milices populaires : violence, état, légitimité
9 Conclusion
9.1 Le territoire volé
9.2 La ville post-apartheid
Bibliographie
Télécharger le rapport complet