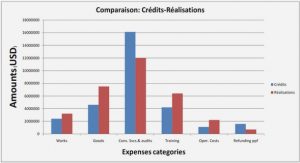Dans une lettre datée du 2 mars 1693, le savant dublinois William Molyneux soumet à son ami John Locke une question, qu’il qualifie d’ « amusante» :
Supposez un aveugle-né, à présent adulte, à qui l’on ait appris à distinguer par le toucher un cube et une sphère, disons en ivoire, à peu près de la même grosseur, de telle sorte qu’il puisse dire, quand il touche l’un et l’autre, lequel est le cube et lequel est la sphère. Supposez ensuite que le cube et la sphère soient posés sur une table, et que l’aveugle recouvre la vue. La question est de savoir s’il sera alors capable, avant de les toucher, de les distinguer par la vue et de dire quel est le cube et quelle est la sphère.
Dans la seconde édition de son Essai philosophique concernant l’entendement humain, publiée en 1694, John Locke inséra cette question, rapidement connue sous le nom de « problème de Molyneux », et y répondit. C’est ainsi que l’énoncé plaisant de William Molyneux quitta le domaine de la sphère privée et acquit un caractère public, ce qui autorisa sa diffusion dans toute l’Europe savante. S’y intéressèrent tour à tour la plupart des plus grands philosophes du XVIIIe siècle : Leibniz, Berkeley, Voltaire, La Mettrie, Condillac, Diderot, Reid, et, dans une moindre mesure, Synge, Lee, Hutcheson, Jurin, Boullier, Buffon, Priestley et Smith. L’émergence et les premiers traitements du problème de Molyneux sont donc contemporains du passage de l’âge classique au Siècle des lumières. Comment se fait-il qu’une question, présentée par son auteur comme une petite distraction pour hommes d’esprit, connut une telle postérité ? En somme, en quel sens l’énoncé du savant irlandais estil autre chose qu’une simple question, à savoir un authentique problème? En quoi doit-il faire l’objet d’un traitement discursif et argumentatif et ne peut-il admettre de résolution immédiate et univoque ?
D’ores et déjà, soulignons que parler de la postérité de la question de Molyneux suppose que ce soit un seul et même problème qui ait traversé tout ou presque le XVIIIe siècle. Or, ce qui frappe de prime abord, c’est bien plutôt la diversité des traitements dont la question du savant irlandais a fait l’objet. Penchons-nous sur le sens qu’elle revêtit pour Molyneux lui-même, lorsqu’il l’adressa à Locke, une première fois en 1688 puis une seconde fois, sous sa forme définitive, en 1693. La réponse que le savant dublinois apporte à sa propre question fournit de précieuses indications. D’après lui, l’aveugle-né ne sera pas capable de reconnaître les objets placés devant lui,
[…] car, quoiqu’il ait appris par expérience de quelle manière le globe et le cube affectent son attouchement, il ne sait pourtant pas encore que ce qui affecte son attouchement de telle ou telle manière, doit frapper ses yeux de telle ou telle façon, ni que l’angle avancé du cube que presse sa main d’une manière inégale, doive apparaître à ses yeux tel qu’il paraît dans le cube.
Manifestement, pour William Molyneux, l’enjeu d’une telle question réside dans l’existence de ce que l’on nomme, depuis Aristote , les « sensibles communs », c’est-à-dire les qualités sensibles communes à plusieurs sens, telle la figure, par opposition aux « sensibles propres », ou qualités qui ne peuvent être appréhendées que par un sens, telle la couleur pour la vue. Or, lorsque Locke s’y intéresse à son tour, ce n’est pas la question des sensibles communs qui motive sa réponse, mais, ainsi que l’atteste le titre du chapitre dans lequel il l’insère , celle des rapports entre perception et jugement . Quant à Berkeley, s’il répond lui aussi à la question de Molyneux quelques années après, c’est pour opposer aux cartésiens une théorie de la vision qui considère les objets de la vue comme strictement intérieurs à l’esprit, afin qu’elle soit compatible avec son ontologie immatérialiste . Un peu plus tard, David Renaud Boullier consacre au problème de Molyneux plusieurs pages de son Essai philosophique sur l’âme des bêtes, et déclare que sa théorie du sensible est la « clef » de sa pensée du vivant. La postérité de la question conçue par Molyneux paraît ainsi relative à la diversité de ses implications dans des domaines aussi variés que la théorie de la connaissance , la métaphysique et la science du vivant, mais surtout à la foncière singularité de chaque philosophie, qui lui conféra un sens particulier en fonction de l’objet qui était alors le sien.
Un tel constat paraît justifier la thèse de Gilles Deleuze, selon laquelle un problème philosophique est propre à la philosophie dans laquelle il s’inscrit : d’après lui, l’histoire de la philosophie n’a rien d’un « débat » autour de problèmes communs à plusieurs doctrines, mais constitue une succession de mondes dans lesquels s’inscrivent des questionnements qui leur sont propres . Pour Deleuze, le syntagme « problème de Molyneux » ne pourrait ainsi désigner que deux choses. Ou bien, pris au génitif subjectif, il désignerait uniquement le problème auquel se confronte William Molyneux, auquel cas il y aurait bien un problème de Molyneux, mais propre à la seule philosophie du savant irlandais . Ou bien, pris au génitif objectif, ce syntagme renverrait au problème posé par William Molyneux et auquel a répondu John Locke, mais aussi au problème auquel ont répondu Berkeley, Condillac, Diderot, etc., acception qui démultiplie les problèmes de Molyneux par le nombre de réponses qui lui furent apportées. Au demeurant, cette conception du problème de Molyneux permettrait de rendre compte du fait que l’écrasante majorité des papiers qui lui sont consacrés constituent , ou sont constitués de monographies.
À distance d’une telle approche, il nous semble légitime et requis de parler du problème de Molyneux, entendu comme problème commun à l’époque dans laquelle il s’inscrit. Car, de toute évidence, l’histoire de la philosophie ne se déroule pas de la façon dont Deleuze le prétend. Ainsi, les réponses que reçut la question du savant irlandais furent toujours corrélées à ses résolutions antérieures, jugées quant à elles insatisfaisantes . Berkeley prétend ainsi que Locke aurait dû, en vertu de ses propres principes, répondre par l’affirmative à Molyneux . Condillac, dans son Essai sur l’origine des connaissances humaines , oppose aux réponses négatives de ses prédécesseurs une résolution positive du problème. Quant à Diderot, il renvoie dos à dos ses contemporains, en affirmant que ceux qui ont soutenu que l’aveugle-né reconnaîtrait les objets ont répondu correctement au problème pour de mauvaises raisons, et que ceux qui ont prétendu le contraire ont vu juste sans s’en apercevoir . Quand il serait vrai que l’histoire de la philosophie ne prend pas la forme d’un « débat » autour d’un certain nombre de problèmes préconstitués, il n’empêche qu’elle ne consiste pas en une succession de systèmes ou de mondes philosophiques étanches et clos . L’on pourrait suspecter, cependant, que les multiples reprises et critiques des résolutions du problème de Molyneux ne traduisent qu’un dialogue de sourds, ignorant leurs intentions véritables et destinées uniquement à masquer l’égocentrisme de philosophies autoconstituées. Il est d’ailleurs indéniable que les fautes de lecture sont légion, et l’ignoratio enlenchi fréquemment pratiquée : dans son Essai de 1746, Condillac attribue à Berkeley une conception des objets de la vue qui n’est pas la sienne ; en 1728, Boullier confond la réponse de Locke avec celle de Molyneux, etc.
|
Table des matières
INTRODUCTION
La question de Molyneux : un problème philosophique historiquement daté
Un problème scientifique contemporain ?
L’opposition empirisme/rationalisme
Chapitre I : Les conditions d’émergence du problème de Molyneux
L’optique keplérienne : le partage de la sensation et du jugement
Le problème de Molyneux avant Kepler : l’illusion de l’atemporalité
Kepler et la dissociation vision/toucher
La théorie cartésienne de la vision : évincer le jugement, restaurer le sensible
Le premier degré du sens : les mouvements géométrisables
Le second degré du sens : les sensations de l’âme
Le troisième degré du sens : le jugement d’entendement
Du rationalisme à l’empirisme : l’aveugle aux bâtons à l’épreuve
Gassendi et La Mothe Le Vayer : premières critiques
L’Essai concernant l’entendement humain et la naissance de l’empirisme
Chapitre II : L’origine empirique du jugement perceptif
Locke : ancrer le jugement dans l’expérience
La théorie lockéenne de la vision
La théorie malebranchienne des jugements naturels
La critique lockéenne des jugements naturels
La démarcation Locke/Descartes
Leibniz critique de Locke ?
L’héritage de Locke sur la théorie leibnizienne de la perception
Les jugements perceptifs selon Leibniz : des figures trompeuses
Contre la simplicité de la sensation
Berkeley et la réduction de la sensation visuelle
La critique berkeleyenne des jugements géométriques
L’objet des sens comme produit du jugement
Chapitre III : Le refus du jugement perceptif
La Mettrie : le refus de l’institution de nature
Une critique indirecte de la géométrie naturelle
Une théorie matérialiste de la vision
Condillac face au défi de Molyneux
Le refus des perceptions inconscientes
L’inexistence des jugements inaperçus
Diderot et l’aveuglement de l’idéalisme
La critique de l’optique géométrique
Ce que l’œil donne à voir
Le jugement a posteriori
Chapitre IV : Le Traité de Condillac : la sensation comme fiction
La sensation visuelle dans le Traité des sensations
Le jugement naturel glissé dans l’Essai
La critique du jugement dans le Traité
« […] il se mêle des jugements à toutes nos sensations »
Un contrepoint à Condillac : Reid et l’analyse du sensible
CONCLUSION
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet