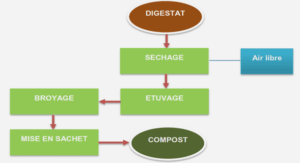Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Un aperçu des autres séries en cours
Comme pendant à ces deux séries en extérieur, Jean-François a réalisé plusieurs séries d’in-térieurs. L’une d’entre elle est celle des Bibliothèques. Dans chaque grande ville où il a été invité il a eu accès aux plus prestigieuses bibliothèques telles que celle du Vatican. À partir de ses clichés, il en a fait des bibliothèques idéales, renfermant l’intégralité du savoir humain.
Une autre de ses séries est celle des gares1. À l’opposé de ses extérieurs, les intérieurs de gare grouillent de monde, comme des petites fourmis, et ainsi il nous donne à voir un monde rempli de petites histoires et d’anecdotes. On voit ici sa fascination pour la société, pour ses travers et ses déviances (surtout si l’on recoupe avec ses images de casinos). On revient aussi au fondement de son envie génératrice du principe de l’Hyperphoto : dans la réalité, il nous serait impossible de voir toutes ces actions en même temps, il serait impossible de les analyser. Par le montage de l’image il fige donc l’intégralité d’une gare en une vision unique, irréelle et pourtant tellement vraisemblable. Certaines séries sont initiées par des rencontres au cœur des pays traversés. À Sao Paulo par exemple, il a été frappé par la beauté des tags sur les murs de la ville et a décidé d’en faire une série où ces tags deviendraient quasiment les murs fondateurs d’une nouvelle construction architecturale. Il n’est pas rare que ces découvertes viennent ensuite s’ajouter à sa liste d’intérêts. Ainsi depuis Sao Paulo, Jean-François photographie de manière plus systématique les tags sur les murs et a choisi d’en intégrer dans ses maisons cubaines.
Deux autres séries me semblent un peu à part dans son travail. Tout d’abord la série des Belles Endormies, inspirée par le livre éponyme de Kawabata. Dans ce livre, des vieillards se rendent dans une maison de repos d’un genre un peu particulier où des jeunes filles sont droguées pour qu’elles ne se réveillent pas. Ils payent pour passer la nuit à leurs côtés et ce que raconte le livre c’est que ces moment deviennent des moments d’introspection sur des questions existentielles face à la pureté et la beauté des jeunes filles. Dans l’interprétation de Jean-François, des jeunes filles sont étendues sur des divans pendant que des hommes les regardent avec en fond la mère maquerelle qui fume sa cigarette.
Les jeunes filles photographiées sont principalement des modèles amateurs et les hommes ses amis photographes, dont ses anciens collègues du studio. Je ressens dans cette interprétation une forme de métaphore à la fois du livre mais aussi de notre société. Et peut-être une forme de trans-cendance par l’art de certains fantasmes de l’artiste qui cherche vainement à capturer par l’image la beauté éphémère et surtout intouchable de la jeune fille. Il ne peut qu’être ramené à sa condition mortelle car jamais il ne la possédera, seul le souvenir reste car même l’image photographique ne rend pas compte de l’odeur de la peau et de la douceur des cheveux. Je vois aussi une forme de mise en abîme de sa propre personne dans le personnage masculin de l’image, comme une prise de dis-tance nécessaire au détachement pour justement ne pas tomber dans le fait de photographier cette jeune fille pour la posséder, mais au contraire pour montrer le processus fantasmagorique.
L’autre série n’en est pas vraiment une, mais je rassemble dans ce dossier toutes les images de Men in Black de Jean-François, ses images autour de 1984 de George Orwell, là où le texte est beaucoup plus présent, là où une forme d’inquiétude se fait sentir. Des pages entières de livres s’étendent sur des murs décrépis et Jean-François en Men in Black s’y balade la tête baissée. Dans certaines de ces images c’est lui qui a écrit les textes, des textes qui semblent tourner en boucle sur un questionnement lié à la place de l’humain sur Terre et dans notre société, comme ses Men in Black qui tournent en rond dans leurs minuscules cellules de prison.
Ces deux dernières séries sont pour moi révélatrices de cette quête de sens spirituel de Jean-François, elles dévoilent son questionnement métaphysique sur la vie terrestre et notre maté-rialité. Elles sont aussi l’expression de pulsions animales, sensorielles, canalisées et sublimées par la création.
Quelques références
Jean-François se nourrit d’images, il les ingurgite et elles forment le terreau de sa pratique. Il en consomme d’autant plus que sa production est énorme et le pousse à toujours chercher de nouvelles formes. Il est aussi attaché à ce point de vue historique, à ce retour aux origines. Il en parlait par exemple dans une interview1 à propos de son utilisation du panorama. Il y parlait des photo-montages de Gustave Legray, où il avait analysé la similitude de leurs pratiques à partir du ciel qui était le même sur les différents clichés, donc révélateur d’un assemblage.
Il est tellement habité par certaines démarches que celles-ci resurgissent sans qu’il ne s’en rende compte. Dans la série des Belles Endormies, une des jeunes filles reprend exactement la pause d’un personnage d’une des toiles de Balthus. Ce n’est qu’une fois imprimée et mise au mur que Jean-François s’en est rendu compte. Dans cette lignée, on peut aussi noter certaines ressemblances avec des photographies de Jan Saudek.
Des peintres tels que David Hockney font aussi partie de ses références, aussi bien du point de vue plastique que conceptuel dans le rapport à l’espace décomposé selon plusieurs angles de vue.
Comme nous avons pu le voir avec le film Blow-Up, la fiction est aussi essentielle pour Jean-François, il n’est donc pas étonnant qu’il soit aussi très influencé aussi bien par un peintre tel que Hopper ou un photographe tel que Gregory Crewdson. Dans le cas de ce dernier, il est fasciné par la puissance évocatrice d’une portière de voiture laissée ouverte au milieu d’une rue. La poésie n’est pas très loin dans l’affaire.
Ces quelques références sont loin d’être exhaustives mais elles donnent déjà une idée des centres d’intérêts picturaux de Jean-François. Ce point était à mon sens important à développer car au cours de ma formation aux Beaux-arts de Nantes, la question des références a été un leitmotiv. En effet, il est systématiquement demandé à l’artiste de se replacer dans une historicité à la fois plastique et conceptuelle. Au delà du fait que cela permet de mieux situer les enjeux du travail d’un point de vue externe, d’un point de vue personnel cela peut devenir une force, une source d’indices qui permettent de mieux comprendre sa propre pratique par observation de ceux qui ont suivi des voies similaires.
Une revendication du travail
Il y a dans la démarche de Jean-François une forme de revendication du travail effectué, que j’ai principalement découvert au cours de la réalisation d’une de ses pièces : la vidéo du tapis-pa-pillon dont je parle dans la deuxième partie de ce mémoire. J’en fais juste une petite description qui me permet d’illustrer mon propos : j’ai recomposé pour Jean-François un tapis oriental à partir de papillons de différentes couleurs et nous avons filmé l’intégralité du processus de création pour ensuite le monter en vidéo. On y voit donc une bonne partie du travail et l’aspect sysiphien de la tâche y est assez marqué.
J’entendais récemment un jeune peintre issu des Beaux-arts de Nantes me dire qu’il n’en pouvait plus d’entendre la même rengaine : « les artistes bah ça travaille pas, ça fout rien » alors qu’il était justement en train de travailler comme un forcené pour mener à bien un projet d’exposition. Certes nous sommes loin de l’homogénéité dans le monde artistique mais la petite phrase sans cesse répétée, même sur le ton de l’humour, agace et démoralise le travailleur. La vidéo de Jean-François est donc une forme de provocation vis-à-vis de cette assertion.
En fait, Jean-François cherche à valoriser le travail, l’action productive. Je fais le rapproche-ment avec ce que disait Nathalie Heinich dans Ce que l’art apporte à la sociologie, quand elle parlait du fait que pour se donner une légitimité les artistes se ramènent à la technique. Ils se qualifient ainsi d’artistes peintres, sculpteurs, graveurs… Mais artiste photoshopeur? Il y a là un néologisme légèrement barbarisant et cela pose problème pour plusieurs raisons.
D’une part, on se retrouve dans le cas de figure décrit par Sylvain Maresca où le spectateur, sait un peu la manière dont c’est construit, il devine un assemblage, en tout cas il croit en l’exis-tence des ficelles de l’image et pense plutôt au photomontage qu’à une réalisation par maquettes. S’il ne s’en sent pas forcement capable, il existe cependant une forme de mystique par rapport à ce photomontage, comme quoi ce serait rapide, vite fait, un jeu d’enfant, pour celui qui le maitrise. Jean-François, et ce assez clairement, maitrise cette technique. Ses images sont donc faciles et ra-pides. Presque. Si l’on ne prend en compte que la partie « assemblage », effectivement, la réalisation d’une image est relativement rapide, mais c’est oublier les heures de préparation des différents élé-ments qui viennent la composer.
D’autre part, le fait que Jean-François ne fasse qu’assembler des images préexistantes peut sembler comme une forme de non-transcendance car il n’y a pas métamorphose par la matière. La vision de l’artiste donnée à travers sa production agit donc de manière plus cérébrale, tandis que l’aspect sensible émerge à travers la technique d’impression choisie par Jean-François, avec la surface infiniment lisse du papier, la chatoyante des couleurs des encres de l’imprimante.
De plus, cette maitrise technique n’est pas comprise dans le cercle des techniques classiques des Beaux-arts (rappelons qu’au moment de la formation de Jean-François la photographie elle-même n’était pas enseignée aux Beaux-arts), il n’y a pas la forme de reconnaissance que l’on peut trouver dans la connaissance de la technique de peinture ou de sculpture. Cela se traduit notam-ment par le fait que les artistes photographes ne sont pas reconnus par la maison des artistes, ils cotisent à l’AGESSA.
Il n’y a pas cette part de travail physique, d’engagement du corps qui fait partie de la repré-sentation idéalisée de l’artiste. Je pense en disant cela aux images de Rodin récemment montrées sur Arte dans le documentaire « Et Rodin créa la porte de l’Enfer » où on le voit malaxer la terre, où l’on voit Camille Claudel exploser des blocs de plâtre. Cette physicalité fait partie de la représenta-tion populaire du travail et il y a peut-être une forme de dénigrement que Jean-François cherche a combattre.
Pas de poussière ni d’odeur dans son atelier, pas de corps à corps avec la toile, avec le châssis, les clous et les fils de fer. Sa posture quotidienne est proche de celle du salarié dans son bureau de-vant son ordinateur et de ce fait il ne peut pas revendiquer cette image de l’artiste debout, au travail, en avant. Ici le statique s’oppose à la dynamique. C’est par le mouvement de la vidéo qu’il trans-pose ce mouvement créateur cérébral, non physique, C’est dans l’accélération des déplacements des papillons qu’il le fait apparaître. En fait, il montre son geste, un nouveau geste à inclure dans le catalogue des gestes créateurs, il nous reste pour nous rassurer le crayon devenu stylet, qui devient objet de lien entre une pratique analogique et une pratique numérique. En y cherchant bien on est encore dans une forme de dessin.
Claire
Claire, dans son travail, ne se présente pas comme artiste mais clairement comme photo-graphe. Ce n’est donc pas la même revendication, la même relation au travail que Jean-François qui lui se revendique comme artiste. Tous les deux ont d’ailleurs des statuts légèrement différents à l’AGESSA puisque Claire est photographe-auteur et Jean-François photographe-artiste. Je me suis donc posé la question de ce qui différenciait une production purement artistique de celle de Claire qui refuse cette appellation.
Je me suis demandé si ce qui différencie fondamentalement les deux pratiques ne serait pas avant tout l’implication et l’état d’esprit dans lequel les images sont réalisées. Claire cherche une authenticité, une mise en image du monde alors que Jean-François ne recherche pas cette vérité mais plutôt une forme d’épiphanie d’une nouvelle image capable de condenser le temps et retenir la complexité de l’instant.
Le choix de l’interroger
Je ne pensais pas au départ interroger Claire au delà de son travail à l’atelier du boulevard Pershing. C’est en l’entendant parler du Kazakhstan, en comprenant qu’elle y avait été pour un projet personnel, que j’ai cherché à en savoir plus.
Mais voilà, il reste ce petit hiatus, cette distance entre ce que Claire propose, ce qu’elle montre, ce qu’elle énonce, et le départ de ce mémoire qui parlait de l’artiste en voyageur. Si Claire ne se définit pas comme artiste peut-elle faire partie intégrante de ce texte en tant qu’exemple ? Il y a là presque une question sur l’essence de l’art, et sur les modalités de l’art dans notre monde contem-porain. A savoir, si Claire présentait exactement le même travail, mais en enfilant la casquette de photographe-artiste plutôt que celui de documentariste je n’aurais pas à dériver de la sorte. Il est question des frontières de l’art, à partir de quand cela cesse d’en être pour passer du coté du docu-mentaire, du subjectif à une forme d’objectivité? Je regarde les images de Claire et je repense à une phrase de George Didi-Huberman.
« L’apparition d’une image, pour autant qu’elle soit puissante, efficace, nous saisit donc nous dessaisit. » 1
Cela m’a amené à me demander si le terrain de l’artiste voyageur était le bon, s’il ne fallait pas inventer une forme de néologisme, ou faire une périphrase pour parler du faiseur, du fabricants d’images en voyage.
Et là je me suis souvenue de la structure du livre de Christine Peltre. Le voyageur qui peint. Le peintre qui voyage. Je crois que la piste qui précise l’artiste voyageur et non le faiseur d’images est la plus juste. Le faiseur d’images n’inclut-il pas le touriste ? L’aquarelliste qui vend à ces touristes des vues stéréotypées de la ville ?
Finalement c’est probablement la rencontre avec son travail et la réflexion vers laquelle cela m’a amené par rapport au statut de l’image photographique, au rapport à l’argentique et à la pro-duction, qui m’a permis de redéfinir mon sujet autour de la pratique picturale et de son système de production, mais toujours en lien avec une pratique du voyage, du décentrement et de la recherche de l’inconnu.
Une gestion de l’argentique
Claire travaille à l’argentique. Elle photographie avec un appareil moyen format, le Rollei-flex. Elle travaille donc sur des pellicules de 12 prises de vues. A chacun de ses voyages, elle réalise entre 10 et 15 pellicules. Comme elle travaille en couleur, elle est obligée de les donner à dévelop-per. Elle connait la chimie nécessaire mais le matériel de développement est trop coûteux et trop toxique pour un usage domestique, et elle n’a pas d’atelier où elle pourrait le faire. Cette phase du développement est cependant un grand moment de stress car elle donne l’intégralité de son travail à une entreprise extérieure, qu’elle sait de surcroit parfois laxiste.
Claire dépose ses négatifs chez Négatif + à Paris. À plusieurs reprises, elle a retrouvé ses négatifs avec des traces imprévues. Sa connaissance du développement de négatifs ne laisse aucune place à l’approximation et elle sait parfaitement reconnaitre une erreur de prise de vue et une erreur de développement. Ils ont cependant cherché à lui faire croire que ce n’était pas de leur faute mais que c’était elle qui avait mal pris ses images. Rassurons nous, elle a bien payé le même prix que pour un développement parfait. « Ce sont des amateurs, ils sont négligents ». Voilà ce qu’elle me disait à leur sujet.
Face à ces reproches, je lui demandais pourquoi elle ne changeait pas d’interlocuteur. Comme elle est nantaise d’origine, je lui demandais pourquoi elle n’allait pas chez Store photo. J’avais moi-même fait développer chez eux des négatifs moyen format et acheté plusieurs pellicules. Je les avais trouvés professionnels et de bon conseil. Je suis cependant une photographe très amateur en terme d’argentique et mon expérience était loin d’être représentative de l’efficacité de leur tra-vail. En effet, sa question a été simple, combien de temps pour récupérer les négatifs? Plus de deux semaines. Donc ça veut dire qu’ils font sous-traiter, que les négatifs partent on ne sait où, qu’ils sont manipulés par on ne sait qui etc… « Je préfère savoir où ils sont » me disait Claire.
Par ailleurs, le fait de travailler à l’argentique représente un coup important à l’échelle de chaque image. Les appareils numériques de Jean-François coûtent plus de 1000 euros à l’achat mais si l’on compte qu’il fait en moyenne 300 000 clichés par boitier… Pour Claire, chaque image, entre la pellicule et le développement, coûte à peu près 2 euros. Et chaque image a une valeur en soi, une vie en soi, elle a été le réceptacle d’espoirs. Chaque cliché est porteur d’une histoire là où une image de Jean-François n’est qu’une petite pièce dans un grand puzzle.
Les sujets
Je viens de parcourir l’intégralité du site de Claire. Une chose est étonnante. De la Bre-tagne au Kirghizistan, en passant par le Kazakhstan et la Finlande, Claire nous propose une série de paysages entre déserts humains et espaces laissés à l’abandon. L’humain semble avoir déserté ses images, remplacé par des montons et des chiens. Quelques lueurs d’humanité demeurent dans les clichés du Moyen-Orient, dans des sourires d’enfants et dans les rides de certains travailleurs. Ces derniers semblent appartenir au monde post-soviétique dans lequel on ne sait si l’on doit dire qu’ils y sont englués ou si au contraire c’est l’espoir de sauvegarder un patrimoine face à la mondialisation déferlante. Pour les enfants, les clichés ne nous diront pas s’ils maintiendront cette vie ou s’ils sont les futurs ambassadeurs de la modernité dans ces espaces inhabités.
Quelques hommes parsèment l’ensemble du travail de Claire, regroupés dans le dossier «Les garçons». Entre amants et gardes du corps, ils semblent être ses passeurs sur les rives du lac Balk-hash.
Claire réalise la quasi totalité de ses clichés lors de ses voyages. Si jusqu’à présent elle partait armée de son seul billet d’avion pour une destination qui lui était étrangère, ce mode de fonction-nement est en train de se modifier. En effet, jusqu’à présent Claire travaillait plus sur une forme de déambulation, elle photographiait ce qu’elle croisait, comme le récit d’un déplacement au cours duquel elle aurait recueilli le témoignage de vies au travers des restes laissés sur place. Elle nous pro-pose des traces et des instants. C’est peut-être pour cette raison que l’humain a disparu, il ne reste que la marque de son influence sur Terre.
Depuis son dernier voyage l’été dernier au Kirghizistan, Claire a décidé de focaliser plus sa recherche sur un lieu en particulier qui l’a marqué : la mer d’Aral. Elle organise actuellement son voyage pour s’y rendre cet été. On peut voir ici un changement fondamental dans sa pratique car elle passe dans une relation beaucoup plus professionnelle vis-à-vis du travail photographique. Ce n’est plus un voyage qu’elle documente, voyage qui se passait finalement de façon presque fortuite dans tel ou tel pays, mais c’est un lieu précisément qui devient son sujet.
Elle m’a dit qu’elle avait eu très peu de retour sur cette série, mais je me demande si les cli-chés qu’elle a réalisé dans une ancienne prison au Kazakhstan n’ont pas été un déclencheur. C’est en effet le seul lieu précisément nommé sur son site, le seul à qui plusieurs images soient dédiées et qui est séparé du reste du groupe des images du même voyage.
Jade
Je vais dans un premier temps me concentrer de manière synthétique sur les projets que j’ai menés jusqu’à mon diplôme de fin d’études aux Beaux-arts de Nantes. Je parlerai ensuite de mon dernier projet, lié au voyage, qui a initié ma motivation pour aborder ce sujet. Je ne vais pas approfondir tous les projets que j’ai pu mener, je joins mon dossier plastique en annexe pour que vous vous fassiez une idée plus ample de ma pratique. L’idée ici est de vous donner des pistes de compréhension de mon intérêt pour le travail de Jean-François.
Projets antérieurs
Mon travail plastique se décompose principalement autour de trois médiums : la peinture, le dessin et la porcelaine. J’utilise ces différents moyens pour créer des images, remplies de symboles, qui racontent des histoires, au travers desquelles je cherche à toucher une forme d’humanité parta-gée.
La notion de jeu est essentielle dans mon travail, comme une forme d’ironie. Le jeu existe aussi bien au niveau du maniement des symboles, des références plastiques et littéraires, que des préceptes biologistes du XIXème siècle comme dans le cas de ma fausse étude zoologique des Co-chonneries.
Chaque médium exprimant pour moi un aspect différent, les pièces que je propose prennent tout leur sens en les confrontant les unes aux autres. Ainsi elles se répondent et se complètent, voire s’éclairent. Je vous donne un exemple : afin de composer mes toiles, j’utilise des bouts et des mor-ceaux, c’est à dire que chaque partie à son sens propre et vient participer de la composition. Vous me direz il y a là quelques liens avec la pratique de Jean-François…Toujours est-il que je pousse cette logique de composition jusque dans la chair des corps représentés, faisant fi d’une anatomie parfaite au profit d’une monstruosité englobante comme le corps de mes Madones.
Cette pratique du démembrement, j’ai eu envie de la mettre en évidence dans un faux jeu de construction : c’est ainsi que sont nés mes objets de collection. Ils parlent à la fois d’une forme de réification du corps de la femme dans notre société contemporaine, mais aussi de cette pratique picturale de composition. C’est comme donner faussement la possibilité au spectateur d’avoir une marionnette à composer pour l’utiliser comme modèle pour une prochaine toile. Je dis «fausse-ment» car les liens de porcelaines qui relient les membres, malgré leur fragilité, ne laisse aucun doute quant au fait qu’il ne sont pas faits pour être rompus.
Je cherche souvent à lier ces deux aspects, à la fois une réflexion sur la pratique en tant qu’artiste et une réflexion personnelle sur la société toujours à travers le prisme de mon propre vécu, ressenti ou rêvé.
Projet Romain
Le Projet Romain est la résurgence d’une envie de longue date de partir en Italie. Cette en-vie est l’écho de plusieurs de mes axes de recherche. En effet, je parlais de références mais cela s’étend jusqu’à la manière de produire, la manière de peindre, et maintenant la manière de se déplacer. Partir en Italie c’était partir sur les traces des peintres qui m’ont précédés, comme une manière de se re-projeter dans l’histoire. Et reproduire le voyage mythique d’un jeune homme de bonne famille : le Grand Tour.
Au delà de ce retour aux origines d’une peinture issue de la Renaissance que j’affectionne tout particulièrement, c’était aussi une manière de retourner aux origines de notre société contem-poraine, au sein de la ville éternelle plus précisément. Dans la lignée de mes projets précédents autour de la question de la représentation de la femme j’ai donc choisi d’y incarner deux femmes iconiques : Sainte Blandine au Colisée et Anita Ekberg dans la Fontaine de Trevi.
La matière, un paradoxe avec le stage
Je vous ai jusque là parlé beaucoup de matière mais très peu de photographie. Il y a dans cette envie de stage un paradoxe par rapport à ma pratique. Ayant passé l’intégralité de ma forma-tion aux Beaux-arts à revendiquer une non pratique de médiums numériques, pour me concentrer à plein temps sur les médiums les plus traditionnels, c’est un comble pour moi de me retrouver dans cet atelier à la pointe de ce genre de pratique d’autant que les logiciels de 3D semblent pointer le bout de leur code dans les fichiers de Jean-François.
Je pense que cette méfiance était liée au fait que le monde de la retouche d’image me parais-sait incompatible avec ma manière de fonctionner. La fin de ce stage arrivant, je peux quand même affirmer qu’il reste des écarts et que ce n’est toujours pas un médium vers lequel je me tournerais di-sons naturellement. J’en connais cependant maintenant les possibilités et les étapes d’apprentissage étant franchies, je me sens relativement à l’aise avec l’interface logicielle.
Si je n’ai pas le même plaisir à travailler sur Photoshop que celui que je peux avoir à peindre, j’envisage plus sereinement son utilisation. Et si je soulève ce point c’est bien que la notion de plaisir est loin d’être étrangère à la création, elle en est même probablement l’un de ses moteurs. Plaisir de la composition infinie chez Jean-François, jouissance des couleurs, puissance de la maitrise de la lumière. Et que gicle la peinture sur la toile dans mon atelier.
Références
Si le travail de Jean-François m’a autant touchée c’est que nous partageons beaucoup de références communes, en plus d’un goût pour le baroque et l’exubérance de la représentation. Pour n’en nommer que quelques uns, Jan Saudek, Joel-Peter Witkin, David Hockney, un peu plus loin nous avons Balthus, Hopper, des anglais tels que Fox Talbot, des flamands tels que Rembrandt et si l’on remonte plus loin on ne va pas se priver de sortir les grands dinosaures de notre chapeau comme Caravaggio et de Vinci, Botticelli et Bosch.
D’autres références sont plus directement liées à mon travail personnel mais en en parlant avec Jean-François je me suis rendu compte qu’il connaissait parfaitement le travail de deux artistes qui sont pour moi fondamentales : Cindy Sherman et Sophie Calle. Et en même temps je me dis : Jean-François aussi se grime comme Cindy quand il interprète son Men in Black…
L’atelier
Découverte
La petite porte
La première fois que je suis entrée dans l’atelier, je suis passée par l’appartement. En bas de l’immeuble j’ai pris la grande porte qui fait l’angle, monté les escaliers couverts de moquette, sonné
à la porte de l’appartement. Anne m’a ouvert, et Jean-François est descendu pour venir me chercher. Comme dans tout bon appartement bourgeois, nous sommes passés par les cuisines pour emprun-ter l’escalier de service et gravir les étages jusqu’aux chambres de bonne.
Par la suite je n’emprunterai plus ce chemin, Claire et moi avons chacune une clé et nous descendons tout en bas de l’escalier de service, puis encore un petit escalier en pierre, une autre vo-lée de marches qui remonte et enfin une petite porte au bout qui devait permettre à la domesticité d’entrer et sortir sans jamais emprunter les parties communes dites « nobles ». Je dois dire que cette configuration m’amuse, nous passons simplement par le passage des artistes, par les coulisses. Je vois cela comme une forme de métaphore du travail de l’ombre que nous fournissons avec Claire.
L’espace interne
L’atelier en lui-même est donc une ancienne chambre de bonne réaménagée. Parquet au sol, canapé, grand miroir qui cache un petit lavabo et un frigo. Anne prend soin de le remplir régulière-ment de bouteilles d’eau car l’eau du robinet a un atroce goût de calcaire. Une bibliothèque remplie de livres et une grande image de Jean-François complètent le décor, sans oublier une épaisse couche de dessins et petits mots de ses petits-enfants et anciens stagiaires, maintenus par des aimants sur la porte d’entrée.
Mais maintenant venons-en aux choses sérieuses et parlons matériel. Le bureau de Jean-Fran-çois se situe d’un coté de la pièce, avec son nouvel iMac trônant fièrement dessus, de l’autre coté nous travaillons avec Claire sur des PC, quatre sont alignés mais finalement seuls deux fonctionnent. Ils sont rangés par ordre d’arrivée dans l’atelier, je travaille principalement sur le plus récent, après l’iMac bien sûr. Je dis principalement car en fait il arrive que nous échangions nos postes en fonc-tion des actions que nous menons.
Ainsi au retour de Cuba, Autopano, le logiciel permettant l’assemblage de photographies pour générer des panoramas, tournait à plein régime sur mon poste habituel, avec Jean-François aux commandes pour vérifier les actions du logiciel, je me suis donc décalée sur celui de Claire qui n’était pas présente. D’autres fois j’ai utilisé l’iMac pour filmer en qualité 4k la réalisation d’une image sur l’écran, là où le PC ne permet qu’une capture en HD. Tour cela est rendu possible par le fait que l’ensemble des ordinateurs fonctionne en réseau. Nous avons tous accès aux mêmes fichiers et aux disques-durs externes.
Le matériel
Au départ, j’ai été étonnée de voir que Jean-François travaillait sur PC, là où la majeure par-tie de graphistes, artistes, publicitaires et autres manipulateurs d’images travaillent principalement sur Mac. Il m’a cependant expliqué que jusqu’à récemment c’était le moyen le plus fiable qu’il avait trouvé car il a choisi chacun des composants de ses ordinateurs, en augmentant mémoires, RAM etc…
En effet, la puissance de calcul nécessaire pour ses images est colossale. Sachant qu’en moyenne une image pèsera entre 6 et 20 Giga, à l’idée même de l’ouvrir, mon MacBook Air pour-tant gonflé à bloc en a des sueurs froides. Les ordinateurs de l’atelier ont beau être extrêmement puissants, il ne se passe pas une journée sans que chacun bloque au moins une fois. Celui de Claire en a fait une habitude toutes les trois heures en moyenne. Seul l’iMac ne faiblit pas encore, les tech-nologies se sont améliorées et Jean-François pense renouveler son stock prochainement.
Cette dépendance au matériel technologique entraine parfois certains énervements. Quand la moindre chose prend entre 5 et 10 minutes, pour ouvrir l’image, pour ajouter un calque ou tout autre action basique de ce genre, cela devient exaspérant car finalement on exige un fonctionnement optimum de la machine et son insuffisante est inadmissible. Ce que je ressens à ce niveau là par exemple c’est que cette contrainte est quasiment inévitable dans le cas du travail de Jean-François, c’est une capacité de patience dont il faut vite se munir car il pousse aux limites les capacités d’or-dinateurs personnels avec la réalisation de ses images. En effet, vers la fin du stage, Jean-François m’a fait part du fait que l’iMac devenait de plus en plus lent et il suppose une dégradation interne peut-être liée à l’utilisation forcenée des logiciels. Mais cela personne ne peut le lui confirmer.
Il a été pendant un temps testeur pour Apple, il devait leur envoyer les rapports de fonction-nement. Il a cependant été très déçu du total non retour sur son investissement puisque Apple, après plusieurs mois de partage des données, n’a fait aucun commentaire et n’a pas non plus donné de 29 visibilité sur les points que cela allait permettre d’améliorer. Jean-François a donc cessé de participer à cette activité qui lui demandait finalement un certain temps pour la gestion et transmission des informations.
Cette contrainte technologique est différente de celle liée à la matière. Il faut du temps pour dompter la peinture par exemple, de la patience, ou encore de la patience pour attendre entre deux couches de peinture à l’huile. Mais ce temps est à mon sens moins frustrant car il dépend de choix et de volonté personnels. Il y a donc dans cet atelier un découpage du temps particulier à admettre et à prendre en compte, qui structure le déroulement de la journée.
Rappel du corps
La présence d’autant d’ordinateurs dans une même pièce n’est pas sans conséquence, en raison du fait que nous ne les éteignons quasiment jamais, soit parce que nous lançons des calculs sur Autopano ou encore des exportations de vidéos pour lesquelles la nuit est à peine suffisante, soit parce que selon certaines théories, il vaut mieux éviter les allumages trop fréquents, la pièce chauffe.
Aucun chauffage n’est nécessaire, pire que ça, au cœur de l’hiver nous allions régulièrement ouvrir la fenêtre pour ramener un peu de fraicheur tellement l’atmosphère devenait étouffante.
Cette physicalité particulière est quelque chose qui m’intéresse tout particulièrement, com-ment un corps est changé par son milieu, comment il s’y adapte? Car mon corps a dû s’adapter, apprendre à encaisser la chaleur permanente qui a tendance à fatiguer modifier en quelque sorte le rapport au travail. De même, le fait de passer la journée entière assise devant un écran finit par brouiller la vision.
Les premières semaines, les douleurs dans le dos et les cervicales revenaient tous les soirs, les yeux brûlaient, la tête bourdonnait. À la fin du deuxième mois je me suis rendue compte que ce n’était presque plus du tout le cas. Il y avait donc bien eu adaptation de mon corps davantage habitué aux couleurs absorbantes de la toile ou à la posture debout face au chevalet, et sans vouloir véhiculer un mythe, dans un atelier pas forcement chauffé à bloc.
Symbiose entre l’espace et Jean-François
Pour Jean-François, l’atelier est une zone ambivalente. C’est à la fois un profond lieu de sé-dentarisation, de régularité, de stabilité et de sécurité. Il y vient tous les jours, que ce soit le weekend ou les vacances n’a pas d’importance. A toute heure du jour ou de la nuit il peut s’y rendre pour retoucher quelque chose, avancer une image, la finir afin de pouvoir passer le lendemain matin à une autre.
Je partage fondamentalement avec lui ce point, c’est une sensation presque d’impuissance que de devoir quitter le lieu de l’atelier juste avant la fin, quand il ne reste presque rien. Certes on peut se dire qu’on finira mieux à tête reposée, mais il y a presque cette défiance vis-à-vis de soi-même, de ses limites (physiques par exemple, comme la migraine peut s’inviter en fin de soirée), et l’appréhension de la difficulté à s’y remettre, à se « re-chauffer ».
Cette obstination tend vers l’irrationnel. Juste avant de partir à Cuba, nous échangions sur une image, en se demandant s’il fallait ou non introduire un certain nombre de détails. Les deux choix étaient devant nous, simples, avec ou sans. Deux possibilités donc, des pours et des contres assez rapidement évaluables. Claire en préférait une j’en préférais une autre. La phrase de Jean-Fran-çois a été la suivante : « au retour de Cuba je saurai », le fameux «à tête reposée». Mais il ne pouvait pas attendre. Il fallait que l’image soit mise dans le dossier « Travaux Faits » AVANT son départ.
La relation d’Anne à l’atelier
Le rapport qu’Anne entretient avec l’atelier est clair et net : elle déteste cet endroit. Elle y monte le moins possible et quand elle doit communiquer dans la journée avec Jean-François, elle l’appelle et lui demande de descendre.
Je ne pense pas que ce rejet soit lié au travail qui s’y fait, comme par exemple la symbolisa-tion d’un lieu qui lui « prendrait son mari » et qui par conséquent serait un lieu chargé négative-ment. Ce qu’elle affirme est d’ordre technique. Elle a simplement peur des pigeons. Süskind n’étant pas ici je développe : l’arrivée au 7ème étage se fait soit par un vieil ascenseur pouvant contenir deux personnes, enfin deux petites personnes, soit par un petit escalier. Une fois arrivée en haut cependant il n’y a qu’une mince rambarde entre la personne et le vide, le couloir est assez étroit et effectivement les pigeons légèrement agressifs. Je m’étais moi-même fait la remarque que c’était as-sez impressionnant d’arriver jusqu’en haut. Et qu’il ne fallait ni avoir peur du vide ni…des pigeons.
Cet atelier est toutefois une libération pour elle. « C’était un enfer », ont été ses mots quand elle a parlé du premier atelier de Jean-François ou plutôt l’aménagement qui avait été fait dans leur appartement au début. Il y avait en effet jusqu’à quatre personnes venant travailler tous les jours, chez eux. À ce moment là, les espaces de vie, d’intimité ou de repli étaient envahis par l’étranger, par des personnes n’appartenant pas au cercle familial ou en tout cas proche. Il y avait donc confusion entre ces cercles intimes et professionnels. Ce qui ne gênait pas Jean-François était un poids dans ce cas pour sa femme qui finissait par ne plus se sentir chez elle.
Limites spatiales
On voit ici l’importance de poser certaines limites notamment spatiales et de donner la fonction d’atelier à un lieu précis afin d’assurer une forme de stabilité. Il y a un lien qui se fait entre expansion invasive du travail de production et l’invasion de l’espace de vie. De plus, un espace dans lequel le travail est présent sollicite d’autant plus l’attention de l’artiste qui finalement ne décroche jamais. Alors déjà qu’il a du mal à décrocher dans sa tête !
D’ailleurs le téléphone portable est un nouvel outil à prendre en compte. C’est un nouvel outil qui brouille les tentatives de séparations spatiales. Jean-François et moi nous sommes rendus compte que chacun de notre coté nous passions notre temps à prendre nos travaux respectifs en photo, pour les montrer ou les regarder plus tard, les observer en cas de temps libre comme les trajets en métro, afin de trouver ce qui ne colle pas par exemple. Je m’amusais de voir dans le do-cumentaire « Et Rodin créa la porte de l’enfer » sur Arte, que Rodin déjà à l’époque utilisait des photographies qu’il retouchait à la plume pour améliorer les courbes de ses statues.
Or, le temps où l’on pense à autre chose que la production immédiate est essentiel. C’est un temps où l’on s’enrichit. Dans son rapport à la production, Jean-François a du mal à se détacher, du mal à prendre le temps et sortir de sa frénésie de réalisations. Il dit lui-même qu’il y a une forme de relation autistique au travail, dans l’accumulation et l’épuisement.
Anne agit comme un régulateur, qui le force a sortir, même très concrètement sortir pour se promener. Elle le maintient dans une stabilité fragile avec la réalité du quotidien. Sans elle, je pense qu’il y aurait presque un effacement du temps à l’atelier. Ce risque de perdition peut emmener à mon sens à une forme de désenchantement, d’épuisement et de désillusion par une forme d’achar-nement.
|
Table des matières
Introduction
Chapitre I – Le stage
I – Recrutement
1 – Première rencontre
2 – Premières pistes de recherche
3 – Chronologie en cercles concentriques
II – Les habitants du huis-clos
1- Jean-François
a – Parcours professionnel
b – Origines du travail plastique
2 – Claire
a – Parcours
b – Statut
c – Évolution
3 – Jade
4 – Anne
a – Rôle au sein de l’atelier
b – Participation au travail plastique
III – Les projets plastiques de chacun des habitants
1- Jean-François
a – Sa pratique
b – L’Hyperphotographie
c – Deux séries majeures : Vedute et Babels
d – Un aperçu des autres séries en cours
e – Quelques références
f – Revendication du travail
2 – Claire
a – Choix de l’interroger
b – Gestion de l’argentique
c – Sujets
3 – Jade
a – Projets antérieurs
b – Projet Romain
c – La matière, un paradoxe avec le stage
d – Références
IV – L’atelier
1 – Découverte
a – La petite porte
b – L’espace interne
c – Le matériel
d – Le rappel du corps
2 – Symbiose entre l’espace et Jean-François
3 – Relation entre Anne et l’atelier
4 – Limites spatiales
| Chapitre II – La mission I – Les différentes missions |
1 – Le tapis papillon
2 – La vidéo du tissage
a – Principes de montage
b – Réalisation
3 – Escapade
4 – Cuba
II – Le principe de construction d’une image selon Jean-François
1 – Les tâtonnements en autonomie
2 – Retour de Cuba, montage en commun et énumération des règles de construction
a – Les principes
b – Mise en oeuvre
3 – Mise en perspective
a – Les Becher
b – Sa transposition dans l’image
c – Tirage papier, retour aux Becher, arrivée du système de vente
4 – Liste des règles générales de la grande illusion du travail de Jean-François
III – Stagiaire d’artiste
| Chapitre III – L’industrie I – L’Art en Direct |
1 – L’entreprise
a – Présentation générale
b – Les directrices
2 – Le travail avec Jean-François
a – La rencontre
b – Travail courant
3 – Relations publiques
4 – La personne en charge direct du dossier «JFR»
a – Juliette
b – Ses tâches quotidiennes
II – Bertrand
1 – Parcours professionnel
a – Formation initiale et premiers liens avec le monde de la culture et de la l’art
b – Entreprise actuelle
2 – Rencontre et travail avec Jean-François
a – Rencontre, sa vision du travail de Jean-François
b – Mise en place du travail
c – Le voyage
3 – Relations avec le monde extérieur
a – Vision du public
b – L’Hypervision
III – Pierre
1 – Parcours
2 – Rencontre et relations actuelles
Chapitre IV – Le Voyage
I – Retour historique entre le Grand Tour et les orientalistes
1 – Les orientalistes
a – Témoins de l’histoire
b – Les artistes
c – Caprices et voluptés
2 – Le Grand Tour
a – Historicité
b – Les raisons du voyage
c – Les artistes
II – Nos manières de voyager
1 – Jean-François
a – Origines
b – Un voyage différé
2 – Claire
3 – Jade
4 – Le point de vue d’Anne
III – Le Divers
1 – Pistes de continuités et de discontinuités
2 – Le principe du Divers : Segalen
a – Définition
b – Une quête
3 – Le Divers à l’ère de la mondialisation : Tocqueville
a – Le dépaysement
b – Tocqueville
Chapitre V – Être contemporain
I – La technique
1 – Pour Jean-François
2 – Mon rapport à la technique
3 – Le rapport de Claire à la technique
II – Le public
1 – Les relations de Jean-François au public
a – Le Men in Black
b – Différentes paroles
c – Les réactions
2 – Rapport au kitsch
a – Le trivial
b – La méfiance
3 – Rapport au corps
a – Quel corps?
b – Fracture
c – Reconstruction
4 – Retour au kitsch
a – Kundera
b – Jean-François est-il un être kitsch ?
III – Le sujet
1 – Le rapport à la société et au sujet chez Jean-François
a – Barroco
b – Le rapport aux conflits, la question de la transgression
2 – Mon rapport au sujet
IV – Être contemporain
1 – Présence dans l’espace de la contemporanéité
2 – Vision baroque
Conclusion
Bibliographie
Télécharger le rapport complet