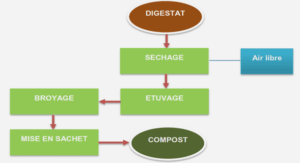Le mouvement Quantified Self
Le mouvement Quantified Self est apparu en 2007 dans la Silicon Valley sous l’impulsion de Kevin Kelly et Gary Wolf, deux journalistes du magazine Wired (Nafus, et al. 2014). En 2010, lors d’une conférence Ted, Gary Wolf présenta le Quantified Self comme une pratique qui vise à promouvoir « la connaissance de soi par les nombres » (Wolf, 2010). Ce mouvement s’organise autour de rencontres, les « Quantified Self Show & Tell », y compris en France, où il représente 500 utilisateurs. La communauté se réunit également autour d’un site web et d’un forum très documenté, qui exposent une diversité d’expérimentations personnelles qui font cas d’école pour le mouvement. Ces pratiques s’inscrivent dans une démarche volontaire et participative, dont l’objectif est, selon Gary Wolf, d’acquérir des connaissances sur soi pour améliorer sa condition physique par la collecte, l’analyse et le partage de données (Gadenne, 2102).
Ces pratiques que l’on nomme parfois « mesure de soi », « automesure » prennent leurs racines aux Etats-Unis dans le self-tracking. A l’origine de nature expérimentale, ces pratiques ont été initiées par des informaticiens tels que Gordon Bell qui a procédé à l’enregistrement et à l’archivage systématique de ses activités pendant plusieurs années, dans la cadre de son projet « MyLifeBits » soutenu par Microsoft. Depuis 2005, le Designer Nicholas Felton publie chaque année un rapport complet de ses données compilées sur ses comportements lus au travers de ses activités dans une perspective de réflexion sur soi. Si l’on pouvait considérer ces pratiques jusque-là comme marginales (Pharabod, 2013), réservées à quelques individus passionnés de nouvelles technologies ou à des artistes expérimentant les rapports à soi, elles se sont rapidement élargies à de nouvelles catégories de personnes qui doivent gérer une maladie chronique par exemple, et plus largement aux personnes soucieuses de leur santé qui souhaitent comprendre le fonctionnement de leurs comportements (Barcena, 2014). Au point que selon certains chercheurs, les prévisions du marché indiqueraient que ce qui constitue aujourd’hui des pratiques singulières va disparaitre au profit d’une généralisation qui ne permettra plus de décrire la totalité des « auto-trackers » (Epton, et al., 2015). On retrouve ainsi de nombreuses formes d’auto-suivi pour atteindre des objectifs de santé : arrêter de fumer, perdre du poids, faire une activité physique, avoir un meilleur sommeil, etc. On dénombre actuellement plus de 100 000 applications, dont environ 30 000 dans le domaine de la santé et de l’information médicale. Ces services sont développés aussi bien sur l’Apple Store que Google Play. Ces applications à usage individuel sont largement utilisées aux États-Unis, où 20 % des usagers de Smartphones ont téléchargé une application médicale ou liée à la santé .
Pour les promoteurs du mouvement Quantified Self, l’intérêt de ces outils est de permettre la génération de patterns, correspondant aux habitudes comportementales des individus, souvent non conscientes, car routinisées, à partir desquelles il est possible de rétroagir sur son comportement. Selon Mélanie Swan, l’émergence de ces patterns correspondrait à un « phénomène quantitatif-qualitatif » qui résulte de boucles de rétroaction liées à l’automatisation (Swan, 2013). Le monitoring en continu de ses activités favoriserait ainsi une certaine conscience de soi (Marcengo et Rapp, 2013) permettant un guidage souple dans le changement et la régulation de comportements (Licoppe, 2013).
Avant de poursuivre sur l’évolution des pratiques de mesure de soi dans le monde de la santé numérique, nous avons souhaité revenir sur les liens entre les mouvements du Quantified Self et celui du Transhumanisme, non pas pour faire l’éloge de ce dernier, mais parce qu’il permet de questionner les idéologies sous jacentes aux pratiques de quantification.
Quantified Self & transhumanisme
Le Quantified Self est issu de la contre-culture américaine dans laquelle les hautes technologies ont souvent été considérées comme des outils subversifs et de contrepouvoirs pour les individus (Turner, 2012). Mais elles sont aussi, par le fait même de leur technicité, emprunte d’un discours techno-utopiste visant l’amélioration de soi. En cela, le Quantified Self est souvent associé au transhumanisme. Ces deux mouvements ont en commun une longue tradition des hautes technologies, quelques personnages comme Kévin Kelly , et des affiliations avec des courants politico-idéologiques tels que les libertariens et les extropiens (Sussan, 2005).
Le terme « transhumanisme » , apparu dans les années 50, se fonde sur le postulat d’une inéluctable amélioration humaine passant par les technologies. Au début du XXIème siècle, le transhumanisme a pris de l’ampleur avec le développement des technologies NBIC et s’est organisé autour d’associations, de promoteurs intellectuels, scientifiques, et maintenant politiques, pour finalement asseoir son rayonnement au niveau mondial (Sussan, 2005). Les transhumanistes prônent l’usage des sciences et des techniques dans l’objectif d’améliorer l’espèce humaine. Ces promoteurs techno-utopistes tels que Marvin Minsky, Hans Moravec ou encore Ray Kurzweil, Directeur de l’ingénierie chez Google soutenu par la NASA et des groupes industriels (Jousset, 2016), entendent dépasser les limites de la nature humaine et en tout premier lieu celles du corps, de la génétique et de la cognition (Kutrweil, 2006). Il s’agit d’augmenter les capacités de réflexion et les performances humaines pour aller vers l’avènement d’un post-humain libéré de toute contingence corporelle (Jousset, 2016, p.11). L’individu pourrait modifier son corps, le rendre plus esthétique, le valoriser, le performer en se débarrassant des contraintes naturelles et matérielles liées à la vie. La condition humaine serait ainsi améliorée et le handicap, la maladie, le vieillissement ou la mort seraient évités. Le point central de cette théorie se fonde sur l’hypothèse de la singularité. Cette théorie est basée sur la loi de Moore qui prévoit un doublement de la capacité de calcul des ordinateurs tous les 18 mois. Autrement dit, selon cette théorie, d’ici 2035, l’homme aura créé une intelligence artificielle supérieure mettant fin à l’humanité, telle qu’on la connaît aujourd’hui. L’évolution exponentielle des technologies informatiques devrait ainsi atteindre un point culminant, au-delà duquel il ne sera plus possible d’appréhender la réalité (Kurzweil, 2006). La singularité incarnerait, de manière « non-anthropologique», l’intelligence future, i.e. débarrassée de ses limites corporelles (Jousset, 2016).
Cependant, face à cette vision fantasmée du monde, les recherches en neurosciences ont pu montrer ces 30 dernières années, que plus les chercheurs affinaient leurs connaissances sur le cerveau, plus ils étaient confrontés à sa complexité et à ses imbrications avec le corps (Anzieu, 2010). Des auteurs tels que Maurice Merleau-Ponty (philosophie), Didier Anzieu (psychanalyse) ou encore des neuroscientifiques comme Francesco Varela (1993) et Alain Berthoz (2011) ont montré que le cerveau n’était pas détaché du corps, et que la conscience s’inscrivait dans le corps. Comme le souligne Michel Besnier, « le transhumanisme a su tirer parti du travail de sape des behavioristes et des cybernéticiens ». Cette vision mécaniste du corps en procédant à « l’adieu au corps » (Le Breton, 1999) a banalisé l’idée d’un corps dissocié de la conscience : « l’idéal d’une fusion avec les machines a cessé d’être sulfureux, si l’âme n’est plus qu’une illusion archaïque réfutée par les sciences » (Besnier, dans Munier, 2013, p. 10). On voit combien les problèmes entre machine et organisme ne sont pas si simples à appréhender (Munier, 2013, p.83).
De nombreuses recherches menées ces dernières années sur la question de l’augmentation , qui portent essentiellement sur la réparation de fonctions physiques et cognitives, ont également montré que les modifications sur l’être humain restaient des opérations complexes (Kleinpeter, 2013, p.14). En effet, l’acceptabilité d’un implant cochléaire par exemple, implique une nouvelle « activation cérébrale qui définit à son tour un nouveau schéma corporel. » (Anzieu, 2009). Cette réinscription corporelle des schémas cognitifs est bien plus complexe qu’on peut le penser. Elle s’effectue par de nombreux ajustements sensori-moteurs entre le corps et le cerveau. De plus, les travaux récents sur l’implantation de dispositifs actifs comme les membres bioniques, les interfaces haptiques, l’informatique ubiquitaire et les systèmes de réalité augmentée, montrent que si ces dispositifs étaient « acceptés [c’était] principalement parce qu'[ils étaient perçus] comme un moyen de prolonger l’espérance de vie ou d’améliorer significativement la qualité de vie. » (Derian, 2013).
Si l’augmentation des capacités humaines par les moyens techniques, biologiques et chimiques est certainement plus spectaculaire, comme en témoigne l’expérience de l’homme « aux jambes d’argent », Oscar Pistorius, (Issanchou, 2013, p131) et qu’elle pose la question de l’hybride dans la société, il ne faut pas oublier comme le souligne Laurent Alexandre (2011), que « la révolution est déjà en marche ». Le « bricolage de l’humain » ou l’« anthropotechnie » (Goffette, 2006, 2013) existe déjà bien dans notre société : les fécondations in vitro (FIV), les technologies de procréation médicale assistée (PMA), comme la transplantation cardiaque constituent autant de technologies d’augmentation améliorant les possibilités humaines, et qui donnent la possibilité à la vie, là où il n’y en avait pas. Les travaux anthropologiques de Leroy Gourhan (1943) ou encore ceux de Jacques Perriault (2014) ont montré que l’augmentation des capacités humaines par la technique était un invariant humain, que de la machine à calculer de Pascal ou encore à l’invention du microscope, jusqu’à celle de l’ordinateur, « l’esprit humain a toujours tenté d’augmenter ses capacités de perception et de raisonnement par le recours à la technique. » (Perriault, 2013, p.37). Ceci nous renvoie à la question de savoir, quels types d’augmentation technologique, souhaitons-nous développer pour notre société? En 2016, l’exposition «Mecanhumanimal » d’Enki Bilal l’auteur de bande dessinée d’anticipation, posait la question en invitant non pas à se questionner sur l’hybridité, qui selon lui est déjà bien présente dans nos sociétés contemporaines, mais bien sur les conditions d’appropriation de cette hybridation : « pourquoi l’individu ne choisirait-il pas son propre futur avant qu’on ne le lui impose ? » (Bilal, 2013).
Partant de ce raisonnement, on peut ainsi considérer que le transhumanisme est « le symptôme le plus visible et lisible d’un glissement ou d’une transformation de la représentation de l’homme sous l’effet de la technologie » (Munier, 2013). En cela, on peut lui accorder le mérite de soulever des réflexions ouvrant le débat sur l’homme dans ses rapports augmentés aux technologies conduisant à ce qu’il convient d’appeler à un posthumanisme (Besnier, 2012). Rappelons que c’est en écho aux atrocités de la seconde guerre mondiale, qu’émerge le terme de posthumanisme chez certains philosophes tels que Heidegger. Selon Peter Sloterdijk (2000), l’humanisme qui reposait sur l’idée d’un homme autonome, s’éduquant par lui-même (et non plus en passant par un dieu) a disparu depuis la fin du XXème siècle avec l’essor des technosciences, laissant place à la « culture de masse » et à la « domestication de l’être » (Sloterdijk, 2000). Ceci implique pour Sloterdijk, que les technologies d’augmentation de l’être humain imposent également un nouveau système de valeurs (2000). Aussi dans une perspective dépassionnée du discours transhumaniste, il est possible comme le propose Marina Maestrutti, chercheuse en sociologie et en histoire des sciences et des techniques à l’Université de la Sorbonne, d’envisager le posthumanisme comme une nouvelle idée de l’humanisme basée sur une forme « non-anthropocentrée » de l’homme, considérant les changements technologiques comme des réalités nonhumaines étroitement impliquées dans la construction de l’humain (Maestrutti, 2011). La théorie de l’Acteur réseau de Bruno Latour développée depuis au moins une trentaine d’années ne dit rien d’autre. On retrouve également ici les thèses de Donna Haraway développées dans son célèbre Manifeste Cyborg (Haraway, 1985). Selon Haraway, les technologies sont avant tout un moyen d’émancipation et de libération pour mettre fin à la domination masculine, aux différences entre homme-femme, mais aussi plus largement à celles entre humain et non-humain. Les récents travaux de Philippe Descola, anthropologue de la nature au Collège de France, vont également dans ce sens. Descola montre que le concept de nature est une invention de l’Occident. Les rapports entre « nature et culture » ont été envisagés de façons différentes selon les époques et les civilisations. Les civilisations animistes par exemple sont intéressantes de ce point de vue. Comme l’écrit Descola, il faut envisager l’humain «par-delà nature et culture » :
« Il est désormais difficile de faire comme si les non-humains n’étaient pas partout au cœur de la vie sociale […] l’analyse des interactions entre les habitants du monde ne peut plus se cantonner au seul secteur des institutions régissant la vie des hommes, comme si ce que l’on décrétait extérieur à eux n’était qu’un conglomérat anomique d’objets en attente de sens et d’utilité. Bien des sociétés dites primitives nous invitent à un tel dépassement. […]. L’anthropologie est donc confrontée à un défi formidable […] : inclure dans son objet bien plus que l’anthropos, toute cette collectivité des existants liée à lui et reléguée à présent dans une fonction d’entourage. » (Descola, 2005, p. 18-19) .
Milad Doueihi a récemment apporté un éclairage sur la forme que pourrait prendre cet humanisme numérique. Considérant que la technique et l’humain sont entraînés dans un mouvement convergent. Le numérique, en tant que nouvelle culture, doit être pensé comme une dimension de l’humain, et amener à questionner la manière dont le numérique invite à une redéfinition du sens même de ce qu’est l’humain (Doueihi, 2011).
|
Table des matières
1. Introduction
1.1. Le mouvement Quantified Self
1.2. Quantified Self & transhumanisme
1.3. Du Quantified Self à la santé numérique
1.4. La quantification, entre savoir et biopouvoir
2. Problématique
2.1. Le Soi augmenté : vers une mutation anthropologique ?
2.2. Concevoir l’augmentation homme-données
3. Questions de recherche
4. Annonce du plan
Partie 1. Cadre théorique pour l’étude des pratiques de quantification de soi
1. Quantification & Société : réflexions épistémologiques sur les notions de quantification et de mesure
1.1. Ambivalence des notions de quantification et de mesure
1.2. De la Métrologie personnelle à la métrologie universelle
1.3. La quantification, une technologie cognitive
2. Quantification & Identité : socialisation, ajustement et médiation identitaire
2.1. De l’identité au Self : l’identité en action
2.2. Le Soi comme structure-action-signification
2.3. Les médiations temporelles du Soi : entre mêmeté et ipséité
3. Quantification & Médiation : les pratiques numériques de quantification de soi comme dispositif de médiation pour l’action
3.1. Les concepts de dispositif et de médiation
3.2. Donnée-information-Connaissance
3.3. Usages et Pratiques informationnelles
3.4. Modèles théoriques pour l’analyse de l’activité en situation
Partie 2. Cadre méthodologique, terrains & résultats
1. Démarche méthodologique générale
1.1. Objectifs & contraintes
1.2. Terrains de recherche
1.3. Méthodes et outils
2. Ethnographie des pratiques de la communauté du Quantified Self Paris
2.1. Contexte de la recherche
2.2. Objectifs de la recherche
2.3. Méthodes et outils d’enquêtes
2.4. Résultats
3. My Santé Mobile : étude qualitative sur les usages d’objets connectés en santé
3.1. Contexte et objectifs de la recherche
3.2. Méthodes et outils d’étude
3.3. Résultats de l’étude « My Santé Mobile »
4. Quantified Self & Big data : quelles implications dans les relations usagers et assureurs en santé ?
4.1. Contexte
4.2. Méthodes
4.3. Analyse exploratoire des dispositifs QS des assurances santé
4.4. Résultats
4.5. Conclusion : Limites et perspectives
5. Projet « objets connectés en santé » piloté par l’URPS AuRA – TSN PASCALINE : Evaluer le niveau d’appropriation des « objets connectés » dans les pratiques professionnelles des médecins généralistes et de leurs patients
5.1. Contexte général de la recherche
5.2. Projet « Objets connectés en santé » – Programme Pascaline – TSN
5.3. Résultats
Partie 3. Discussion & conclusion
1. Discussion des résultats
1.1. Modélisation des pratiques de quantification de soi
1.2. Dispositif de médiation numérique : distanciation symbolique et temporelle
1.3. Proposition de modèle de médiation temporelle pour l’action
2. Conclusion
2.1. Technologies de quantification de soi entre tension et innovation
2.2. Médiation numérique par et pour l’action
2.3. Perspectives théoriques et appliquées
Bibliographie