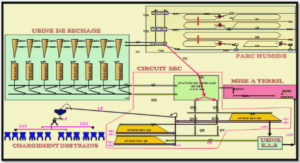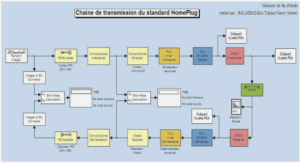PDR et Aléa moral
« Le risque de liquidité extrême ne se résume pas à une somme de risques indépendants de faible ampleur, mais à un risque de système signifiant une rupture majeure des relations statistiques habituelles entre les facteurs de risque. C’est un risque certes rare, mais inhérent au système de finance libéralisée où alternent les phases d’excès d’optimisme et les replis brutaux des marchés. » (Bervas, 2006). Cette description résume parfaitement l’importance de gérer un choc de liquidité par son pouvoir de propagation au reste de l’économie réelle. Dès lors, le rôle des Autorités nationales ou internationales (Banques Centrales, FMI) est de participer à cette gestion tout en essayant de contenir le risque moral.
Ce chapitre a donc pour objectif de mettre en avant cette nécessité d’intervention (partie I.1) et d’insister sur l’importance des modalités à respecter pour limiter le phénomène d’aléa moral (partie I.2).
De la Nécessaire Gestion
La récurrence des crises depuis les dernières décennies nous renseigne déjà sur la nécessité d’une intervention suprême. S’il était pertinent de centrer l’analyse sur les marchés émergents jusqu’à aujourd’hui dans le cadre des crises souveraines ou encore des crises de change, l’étude est désormais dépassée.
Les difficultés concernent désormais également les pays industrialisés à l’instar de la crise 2007-2008, et s’inscrivent véritablement dans le secteur financier. Ces complications sont d’autant plus importantes qu’elles sont accentuées par les nombreuses innovations financières (produits dérivés, titrisation, etc.) qui ne cessent d’augmenter (cf annexe n°1).
Nous comprenons que dans un tel cadre, les crises financières sont largement relayées par les banques. En effet, ces dernières jouent un rôle majeur dans l’économie puisqu’elles permettent de transférer des fonds depuis les agents en capacité de financement vers ceux en besoin de financement ( Mishkin, 2007). Ainsi, leur défaillance concerne toute l’économie ; la condition de leur bilan a beaucoup d’importance pour l’offre des prêts. Chaque banque peut créer de la monnaie à partir d’un prêt mais seule la Banque Centrale peut émettre de la monnaie « banque centrale » (Lacoste, 2009). Si les clients d’une banque k se ruent aux guichets pour retirer leur argent, celle-ci doit emprunter soit auprès des k-1 banques de second rang, soit auprès de la Banque Centrale. Ce marché entre banques centrale et commerciales est le marché interbancaire, marché qui se tarit lors d’une crise du crédit. La notion centrale de ce genre de crises est la liquidité puisque c’est elle qui permet de renouveler les dépôts et de transformer les actifs. Si les bilans des banques se détériorent, leur capital se contracte et par conséquent, les crédits sont amputés (tarissement du crédit) provoquant une baisse des dépenses d’investissement et donc une contraction de l’économie toute entière. De plus, ces détériorations affectent la confiance pouvant provoquer un phénomène de contagion d’une banque à une autre ; cet évènement au cours duquel les institutions financières refusent de se prêter entre elles par perte de confiance caractérise précisément la crise de liquidité. Ce risque d’illiquidité bancaire est à la base des phénomènes de run, soit une généralisation des retraits imprévus entraînant la liquidation des dépôts interbancaires. Ces mouvements de propagation d’un secteur à un autre, d’une banque à une autre et même d’un pays à un autre constituent ce que l’on appelle le « risque de système » illustré par un « effet domino ». C’est en cela que nous intervenons pour soulever l’importance d’un Prêteur en Dernier Ressort (PDR) justifié par son pouvoir d’endiguer ce risque systémique. Notons que ce risque est dual (De Bandt et Hartmann, 2000). Il peut être lié, d’une part à un choc idiosyncrasique où chaque individu ou institution réagit d’une façon qui lui est propre aux influences des divers agents extérieurs. Un exemple est celui d’une réaction par rapport à un discours ou une publication annonçant de mauvaises nouvelles concernant une banque. Ce choc peut être à l’origine de phénomènes contagieux.
D’autre part, il existe également une probabilité de choc macroéconomique touchant un grand nombre d’institutions de manière simultanée, provoquant ainsi des réactions en chaîne dans tous les secteurs.
Cette approche se retrouve également dans l’analyse de Diamond et Dybvig (2000). Un run se caractérise par des retraits massifs de capitaux de la part des investisseurs inquiets de voir la banque faire faillite mais ce sont justement ces retraits qui provoquent des liquidations prématurées donc une faillite potentielle. Face à ce run, les banques peuvent transformer des actifs illiquides dans le but d’obtenir des liquidités, proposant ainsi des garanties, mais si la confiance est entamée, les retraits sont inévitables. Ce genre de phénomène est coûteux et réduit le bien-être collectif puisque reconsidérer un stock de liquidités à la baisse induit un rationnement des crédits et, par conséquent, l’interruption de la production des entreprises ayant fait appel aux banques. On retrouve ici la notion de risque systémique avec la propagation de la crise à la sphère réelle. Dès lors, des solutions sont recommandées telles que la suspension de convertibilité des dépôts en monnaie ou l’assurance-dépôt ; protéger les déposants permettrait de limiter les retraits massifs et donc d’éviter les paniques bancaires. Partant, selon les auteurs, l’autorité d’un gouvernement fait de lui un fournisseur naturel d’assurance et son intervention sur le marché bancaire constitue un réel bénéfice en terme de bien-être collectif.
Notons que nous pouvons également comprendre ce phénomène de contagion par l’étude de la réaction des institutions financières aux variations des prix des actifs et des risques mesurés (Adrian, Shin, 2008). Concernant, par exemple, la crise du crédit de 2007, c’est la détérioration de la qualité des crédits hypothécaires qui en est l’origine. Le capital des institutions financières paraissait suffisant pour absorber les pertes et la titrisation, qui avait réparti les expositions au risque, réduisait la concentration du risque de crédit. Pourtant, la crise du crédit a pris une ampleur impressionnante du fait de son caractère contagieux.
L’analyse des bilans des institutions financières révèle que celles-ci réagissent aux variations des prix et des risques. Un surcroît d’offre de l’actif tend à faire diminuer son prix. Le bilan est, par conséquent, fragilisé, ce qui nécessite une hausse des ventes de l’actif donc une nouvelle baisse de son prix et une nouvelle fragilisation. Ce genre de réaction suit les fluctuations des bilans d’une façon amplificatrice. Dans le cas du marché des crédits hypothécaires à risque américains, ce genre de situation a été provoquée par un besoin de prêter résultant lui-même d’un excès de capitaux et de la recherche d’un meilleur effet de levier. Cette analyse nous permet de comprendre l’importance de la liquidité dans le bon fonctionnement d’une économie. « La liquidité agrégée peut se voir comme le taux de croissance des bilans agrégés ».
La crise du Baht de 1997 nous permet d’illustrer le phénomène de contagion. Début des années 90, la Thaïlande à l’instar des NPI devient un nouvel acteur de la finance internationale (Gilles, 2006). Ces économies émergentes ont poursuivi un processus assez régulier d’intégration financière mondiale, accédant de plus en plus aisément et massivement aux marchés de capitaux internationaux. Ces entrées massives de capitaux privés ont crée en quelque sorte une bulle spéculative à travers la surévaluation des monnaies locales. Les flux, ont, dans un premier temps, été de long terme avec un afflux d’IDE et donc un transfert de savoir-faire, mais sont très vite devenus des investissements de portefeuille par définition beaucoup plus volatiles. Un fort taux de croissance conjugué à une illusion d’une économie modèle et des rendements très élevés ont évidemment été des facteurs d’attraction. De plus, le haut niveau de risque associé à des rendements élevés est compensé par le faible risque de change garanti par la parité quasi-fixe du baht par rapport au dollar. Les investisseurs étrangers se représentent ainsi ces économies avec une certaine confiance et la bulle sur les marchés spéculatifs enfle tant que les anticipations se valident. Du côté thaïlandais, les banques locales empruntent en dollar pour prêter sur le marché national, ce qui représente un premier risque ; le risque de change auquel s’ajoute le risque de crédit avec l’orientation des crédits sur les marchés spéculatifs. Durant l’année 1996, la hausse du dollar provoque des tensions sur la parité baht / dollar mais dans un premier temps, les autorités thaïlandaises souhaitent maintenir l’ancrage. La baisse des réserves et le niveau élevé des taux d’intérêt altèrent la crédibilité. De plus, la hausse des prix de l’immobilier et des actions ainsi qu’un baht surévalué renforcent le déficit extérieur. Le portefeuille des banques se détériore du fait de manques dans les domaines de la gestion et de la réglementation. Cette évolution plutôt chaotique associée à un fort niveau d’incertitude pousse les non résidents à procéder à une première attaque spéculative en août 1996 et une deuxième en mai 1997. Les Autorités sont contraintes d’abandonner l’ancrage en juillet 1997 provoquant une dépréciation immédiate du baht ; en deux semaines, celui-ci perd 25% de sa valeur par rapport au dollar. Cette crise de change entraîne très rapidement une crise de liquidité puisque l’endettement des banques en devise alourdit la charge financière réelle. La crise de confiance est amorcée déclenchant un phénomène de panique se traduisant par un retrait (tout aussi massif que l’avaient été les entrées) de capitaux. La contagion s’étend à toute la zone du Sud Est Asiatique puisque la dévaluation thaïlandaise rend les autres pays de la zone moins compétitifs. La contagion est aussi externe puisqu’elle touche d’autres pays émergents comme le Brésil.
Aux Modalités d’Intervention
La nécessité d’intervenir de la sorte lors d’une crise à risque systémique parait triviale.
Cependant certaines modalités d’intervention doivent être respectées puisqu’en violant ainsi les règles du marché, des effets pervers peuvent apparaître. La principale externalité négative est celle du risque moral ou « aléa moral ». La notion d’aléa moral se réfère à une situation d’asymétrie informationnelle consubstantielle à l’activité financière et de crédit. L’agent donne une information inexacte à partir du moment où ses intérêts personnels ne coïncident pas avec les intérêts collectifs. On parle d’action cachée. Cette notion est née dans le domaine assurantiel, l’idée étant que le seul fait d’assurer un risque en augmente du même coup la probabilité. L’assuré est en effet moins enclin à prendre des mesures pour prévenir les risques. Concernant le secteur financier, la question qui se pose est la suivante : les facilités accordées par les Autorités aux établissements ou pays en crise ne risquent-elles pas d’encourager emprunteurs et prêteurs à adopter des comportements qui accentuent la probabilité de crise?
Une très bonne illustration d’aléa moral à la fois du créancier et du débiteur est le cas de la crise russe de 1998. A l’époque où la crise a lieu, la Russie a un marché des changes très instable, accueille des capitaux spéculatifs et est concernée par des réformes libérales qui lui sont imposées. En 1998, ses mauvais chiffres en terme de rentrées fiscales effraient les investisseurs internationaux, ce qui provoque une forte sortie de capitaux. La Russie se voit ainsi obligée de mobiliser ses réserves de change, ce qui entraîne un risque d’épuisement.
Ses différents mouvements débouchent finalement sur une dévaluation et un défaut sur sa dette. La crise russe se propage aux bourses latino-américaines. Face au risque de propagation, le G7 se réunit le 14 septembre 1998 et s’engage à soutenir les pays atteints par les retraits de capitaux.
Cette crise est révélatrice d’un aléa moral. En effet, les Autorités russes font semblant de respecter les conditions du FMI selon la stratégie du « Too big to fail », et le FMI, qui tient le rôle du Prêteur en Dernier Ressort International (PDRI) fait également semblant de les croire trop grandes pour sombrer (Gilles, 2006). Le principe du « Too big to fail » décrit une situation où un établissement (ou une institution) ne peut faire faillite, sous prétexte qu’elle est trop importante pour sombrer. Ces établissements profitent de cette couverture.
Conformément à cette description, il y a donc aléa moral dans le cas de la crise russe, dans la mesure où l’assistance du FMI en cas de crise entraîne un relâchement disciplinaire, voire incite la prise de risque dans les investissements.
Connaissant cet effet inhérent à l’intervention, il est parfaitement légitime de s’interroger sur les solutions qu’il existe pour le limiter. Pour certains, la réponse est radicale : selon les tenants du « free market » (Meltzer, 2000), s’il y a prêt en dernier ressort, il y a nécessairement aléa moral et celui-ci est irréductible. Pour d’autres, certes un cadre de régulation global est désincitatif à la prudence, mais son efficacité dépend de sa capacité à fournir les liquidités. Si certaines mesures sont prises pour contrôler les prêts, il est possible de réduire le risque moral. La question ne se situe donc pas entre intervention ou non selon la réductibilité de l’aléa moral puisque nous avons vu que la gestion des risques est primordiale pour la survie des marchés. Nous devons plutôt nous interroger sur les moyens de prévention qu’il faut mettre en œuvre pour accompagner cette gestion des crises. Dans un contexte de globalisation financière et de mobilité parfaite des capitaux, les économies sont fortement liées, ce qui occasionne un risque systémique élevé en cas de crise financière.
Ainsi, si le risque moral entraîne un coût social (du fait du risque de système) supérieur au coût de l’aléa moral lui même, alors l’existence d’un PDR(I) est légitime (Goodhart et Huang, 2000). En d’autres termes, un PDR(I) doit exister si la non intervention aggrave la situation économique en terme de croissance du PIB et d’emploi, et que ce coût est supérieur à celui d’un éventuel laisser-aller de la part des établissements bancaires, inhérent à l’idée de sauvetage en cas de crise. De plus, l’effondrement du système est d’autant plus probable qu’il existe un marché interbancaire, ainsi la présence d’un PDR(I) permet de fournir le complément de liquidité que le marché interbancaire ne parvient pas à fournir. Le PDR(I) permet donc de répondre au problème d’illiquidité tout en évitant la contagion internationale. L’aléa moral résulte du signal lié à cette intervention, par conséquent, la gestion des crises doit s’accompagner d’un volet « prévention » même si l’action simultanée des deux est moins efficace que les solutions exclusives, (Goodhart et Huang, 1999). Notons que nous entendons que le rôle de PDR(I) peut être joué par une institution à l’instar du FMI ou un réseau de Banques Centrales. En effet, pour certains, (Aglietta, De Boissieu, 1999), seule une Banque Centrale peut jouer le rôle de PDR puisque sa capacité de diagnostic de risque systémique est supérieure et par conséquent son action peut être immédiate. De plus, les ressources du PDR devant être illimitées, c’est-à-dire immédiatement mobilisables, une Banque Centrale paraît être un acteur crédible par sa possibilité de création monétaire ex nihilo. L’idée concurrente est que ce rôle peut être parfaitement rempli par une institution comme le FMI. Les détracteurs d’une telle proposition mettent en avant l’idée qu’une institution établie entraîne un risque moral et que la supranationalité implique un abandon de souveraineté. Mais cette proposition se justifie par l’amélioration de la diffusion de l’information et par conséquent une meilleure transparence donc une meilleure efficacité. Et puis, dans un tel cadre, le risque moral peut être réduit si l’Autorité impose certaines conditions ex ante (Meltzer, 2000). Notons aussi que la création monétaire par le FMI peut être envisagée avec les DTS (Droits de Tirage Spéciaux).
Se poser ainsi la question des modes d’intervention, c’est mettre en avant l’art du prêteur en dernier ressort, art qui fut déjà souligné dès le XIX° siècle par Thornton puis Bagehot. Thornton situe son analyse essentiellement autour des crises « d’overbanking », soit des crises fondées sur l’emballement du crédit (Gilles, Cartapanis, 2003). Cette étude est centrée sur les imprudences en terme d’octrois et de demandes de crédits. Face à ces crises, la Banque Centrale doit éviter les difficultés liées à une trop forte émission ou au contraire à une restriction excessive. L’une pouvant entraîner une dépréciation des titres et l’autre pouvant constituer un obstacle aux échanges commerciaux. La Banque doit donc adopter la bonne attitude pour garantir une plus grande confiance et une stabilité accrue du système bancaire. Nous pouvons souligner que les fonctions que Thornton attribue à la Banque Centrale correspondent parfaitement à la définition du Prêteur en Dernier Ressort, même s’il n’emploie pas ce terme. C’est en réalité Baring (1797) qui utilise ce terme pour la première fois.
Prix d’actifs et bulles
Ce chapitre a pour ambition de mettre en exergue une conséquence non voulue à un renflouement mal maîtrisé. Cette explication se fait par l’analyse du lien liquidité – prix des actifs. Ainsi, cette relation peut engendrer des effets, qu’elle soit considérée à la hausse ou à la baisse. Nous avons choisi d’expliciter les répercussions d’une augmentation des prix des actifs due à une hausse de la liquidité sur la formation d’une éventuelle bulle spéculative.
Dans un premier temps, nous analysons cette relation centrale en nous appuyant sur des analyses théoriques et des travaux empiriques. Ensuite, nous tentons d’exposer les principales théories concernant les bulles afin de mieux appréhender le risque qu’elles représentent.
De l’Analyse du lien Liquidité – Prix d’actifs
Nous venons de comprendre en quoi il est important d’intervenir lors d’un choc de liquidité. Cependant, un renflouement mal maîtrisé peut entraîner, par exemple, un phénomène de surliquidité qui peut impacter les prix des actifs et donc faire émerger la possibilité d’une bulle spéculative.
Analyse théorique
Avant de parler de surliquidité, revenons sur la notion de liquidité. La collecte des dépôts et l’offre de crédits constituent, traditionnellement, l’essentiel de l’activité bancaire dont la liquidité en est le produit. Les conditions nécessaires à la création de liquidité sont :
La capacité des banques à assurer le renouvellement des dépôts qu’elles reçoivent,
La capacité à transformer les actifs.
Depuis la déréglementation et le renforcement de la concurrence, les banques désirent acquérir des actifs seulement pour spéculer ce qui donne naissance à de nouvelles formes de création de liquidité laissant place à davantage d’opérations de marché, (Bervas, 2008). Les marchés de capitaux sont, en effet, une source croissante de liquidité endogène et les réserves de liquidité constituent un moyen de gestion du risque dans le sens où plus elles sont élevées, moins il est difficile de faire face à un choc. Alors qu’auparavant, le système bancaire fournissait de la liquidité par le seul biais de l’intermédiation monétaire, la production de liquidité peut se faire aujourd’hui par le biais d’opérations de marché ou par transformation d’actifs. Les différentes sources de liquidité peuvent se résumer dans le schéma suivant.
Analyse empirique
Au-delà d’une simple analyse théorique, Gouteron S. et Szpiro D. (2006) ont tenté d’établir un lien entre liquidité et prix d’actifs en abordant une démarche empirique. Ils ont essayé, dans un premier temps, de décrire l’évolution du prix des actifs et ensuite d’établir un modèle d’interaction entre liquidité et prix d’actifs. Les auteurs considèrent trois catégories d’actifs : les actions, les obligations et l’immobilier. D’après leurs résultats, on ne peut pas parler d’évolution commune des prix d’actifs, il n’existe pas de mécanisme global car les différents types d’actifs ne sont pas homogènes. Leur modèle met en scène trois variables : le prix réel des actifs, le PIB réel et la liquidité nette des besoins de l’économie réelle. Le nombre de données est faible puisque la période d’analyse est limitée. Les prix des actifs sont décomposés entre une valeur fondamentale et une éventuelle bulle spéculative. La valeur fondamentale, pour les actions, est la somme actualisée des dividendes futurs. Il semble raisonnable pour les auteurs de ne retenir que les bénéfices (en considérant seulement les plus-values). A long terme, ils peuvent donc utiliser comme approximation le PIB à long terme car ils supposent que la part des profits dans la valeur ajoutée est constante à long terme. Notons que nous pourrions contester cette hypothèse puisque les évolutions récentes témoignent d’une modification de la répartition des revenus ; concernant la part des salaires dans la valeur ajoutée, la tendance est à la baisse. A court terme, l’approximation pourrait être les variations du PIB car les profits augmentent en bonne conjoncture. A propos de l’immobilier, les loyers peuvent jouer le rôle de dividendes. Cette distinction entre court et long terme pourrait nous permettre d’isoler les parties « valeur fondamentale » et « bulle » dans le prix de l’actif. Le bénéfice conservé correspondrait à la valeur fondamentale tandis que le bénéfice distribué concernerait la bulle spéculative.
Les bulles irrationnelles
La formation des bulles passe évidemment par les représentations que les agents se font.
Selon Keynes, à cause du caractère imprévisible des agents, il est impossible de raisonner dans un cadre d’anticipations rationnelles. Les prix des actions sur les marchés boursiers, les taux d’intérêt sur les marchés obligataires, les cours de change (sauf maintien de la banque centrale)… reflètent non la valeur fondamentale mais ce que les spéculateurs croient être l’opinion des autres spéculateurs à propos de l’avenir (concours de beauté). « Loin d’être un ensemble d’individus séparés et indépendants, le marché ressemble plus à une communauté fortement interconnectée, voire même à une foule » (Orléan, 2001). Ce genre de propos fait apparaître la notion de mimétisme, mécanisme fondamental du comportement humain qui tient un rôle central dans tout phénomène de contagion. Shiller (2000) décrit un mécanisme dans lequel les investisseurs achètent des actifs à cours croissant à cause de la confiance qu’ils ont en un marché porteur. Ce mécanisme est amplifié par les autres qui copient ce que font les premiers. Ce processus amplificateur conforte l’idée que les marchés financiers sont un lieu de « dynamique collective » où les anticipations sont transformées par les actions des autres. Notons que ce type de comportement peut trouver sa source suite à un effet d’annonce. Le 5 décembre 1996, Alan Greenspan, alors président de la Fed utilise l’expression « exubérance irrationnelle » pour décrire le comportement des agents sur les marchés boursiers. En conséquence, les indices boursiers réagissent très violemment, à l’instar du Nikkei et du Dow Jones qui enregistrent des baisses respectives de 3,2% et 2,3%.
Ce repli vient du fait que les agents anticipent une politique monétaire restrictive avec la simple prononciation de ce terme fortement évocateur. Au contraire, un autre terme, dont la paternité revient également à Greenspan et qui peut convaincre l’opinion publique d’une reprise est celui d’ « ère nouvelle », terme souvent employé et accompagné de chiffres plus ou moins robustes dans le but de faire effet.
Nous voyons donc en quoi l’intégration de facteurs autres que la maximisation en fonction de la seule aversion au risque est importante dans les phénomènes de bulles spéculatives. C’est dans un tel esprit de rejet de certaines hypothèses de la théorie traditionnelle que se situe un nouveau cadre théorique, celui de la « Finance comportementale » qui tente de tirer des conclusions à partir d’expériences faites en laboratoire et contredit les principes de rationalité généralement admis. Concernant notre sujet, la volatilité et l’écart aux fondamentaux seraient le résultat de déviances des comportements par rapport aux règles qui garantissent une formation efficiente des prix d’actifs (Pollin, 2004). L’analyse se situe à deux niveaux, le premier étant une remise en cause de la « théorie de l’utilité espérée » avec un éclairage sur certaines propriétés du comportement des agents et le second étant simplement une contestation de la rationalité des individus.
Revenons donc sur un des principaux outils de la théorie de la décision qu’est celui de l’utilité espérée comme mesure des préférences individuelles. La prise de décision en cas de risque peut être décrite comme un choix entre perspectives, éventualités ou « loteries ». Une loterie (xi, pi) rapporte un revenu xi avec la probabilité pi et zéro avec la probabilité 1-pi.
L’application de la théorie de l’utilité espérée en situation de risque repose sur des principes parmi lesquels un principe fondamental ; celui de l’aversion au risque. L’individu en situation d’incertitude est en effet adversaire du risque et cette aversion est représentée par une fonction d’utilité (U) de Von Neumann et Morgenstern, avec U’>0 et U »<0, soit une fonction croissante et concave. D’après Tversky et Kahneman (1979), la formulation des préférences par Von Neumann et Morgenstern ne rend pas compte de certaines observations sur les choix en incertitude. La contestation repose sur une représentation en trois points. (Notons toutefois qu’ici, la fonction de préférences ne s’interprète pas comme une irrationalité). D’une part, les agents ont une perception déformée des probabilités objectives. Ils surestiment les faibles probabilités et sont plus sensibles aux différences de probabilités lorsque leur niveau est plus élevé. D’autre part, les agents sont sensibles à la variation relative de leur situation plutôt qu’à leur niveau absolu, l’utilité devrait donc être définie sur le montant des gains et des pertes plutôt que sur la richesse finale. Enfin, la forme de la fonction définie sur les pertes est différente de celle définie sur les gains. Concernant les pertes, un individu préfère une perte élevée mais incertaine à une perte certaine. L’utilité serait donc concave dans le domaine des gains et convexe dans celui des pertes.
Ce premier apport tient compte des comportements face à une situation immédiate.
Cependant, lorsque les agents anticipent les événements à venir, c’est la rationalité qui est remise en cause. L’hypothèse forte en économie est celle de la rationalité des agents. Dès lors, selon Kindleberger, (1994), « la psychose collective ou l’hystérie se définissent comme les déviations occasionnelles d’un comportement rationnel ». Cependant, les travaux de psychologie expérimentale montrent qu’un certain nombre de facteurs biaisent la rationalité des agents. Les résultats de telles expériences amènent à penser que les agents font des prévisions avec une confiance excessive et sous-estiment leurs marges d’erreur. De plus, ils n’utilisent généralement pas la totalité des informations disponibles pour former leurs anticipations et se laissent influencer par des observations récentes, des faits marquants, des expériences antérieures, des stéréotypes. Un exemple, dans le contexte qui est le notre, est celui de l’observation des comportements antérieurs des Banques centrales. Un autre effet est celui du contexte dans lequel les agents anticipent leurs choix ; ils n’ont pas le même comportement selon qu’ils raisonnent en terme de gain ou de perte.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I REVUE DE LA LITTERATURE
I PDR ET ALEA MORAL
I.1 DE LA NECESSAIRE GESTION
I.2 AUX MODALITES D’INTERVENTION
II PRIX D’ACTIFS ET BULLES
II.1 DE L’ANALYSE DU LIEN LIQUIDITE – PRIX D’ACTIFS
II.2 AUX THEORIES DES BULLES SPECULATIVES
PARTIE II LE MODELE DE SELECTIVITE DU RENFLOUEMENT ET SON PROLONGEMENT
III UN MODELE DE DISCRIMINATION : LA SELECTIVITE DU RENFLOUEMENT
IV RENFLOUEMENT ET LIQUIDITE DE SORTIE DE CRISE : UNE NOUVELLE CONTRAINTE OPERATOIRE
IV.1 SOUS-LIQUIDITE ET PRIX DES ACTIFS
IV.2 SURLIQUIDITE ET PRIX D’ACTIFS
IV.3 CONFRONTATION DU MODELE AUX EVENEMENTS RECENTS
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet