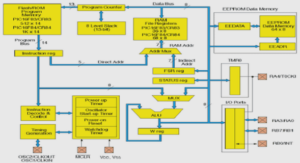Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Considérations concernant la parole de l’enfant
Dans cette première partie, il s’agira de définir la parole de l’enfant (1), d’établir sa construction par le prisme du soin (2), d’évaluer sa fiabilité (3) et d’étudier les limites de cette parole (4).
Enfant et Parole, définitions.
L’enfant est défini par le Larousse comme le garçon ou la fille, avant son entrée dans l’adolescence. Comme une personne naïve au caractère enfantin. Il s’agit de la fille ou du fils de quelqu’un, d’un descendant. Deux notions sont particulièrement intéressantes : la naïveté et la notion de « descendant de ». La naïveté fait appel à l’inexpérience, la crédulité, à la simplicité. Il est possible de la concevoir comme une notion disqualifiant la parole de l’enfant qui n’a pas vécu assez d’expériences pour acquérir un socle de connaissance suffisant à la décision, qui croit ce qu’on lui dit et serait donc incapable d’avoir un avis propre basé sur une connaissance de son sujet. La descendance, « être le fils ou la fille de » renvoie à une forme d’appartenance. La préposition « de » sert justement en français à introduire un complément d’appartenance dans une phrase. L’enfant appartiendrait donc à ses parents. Sur le plan étymologique, Infans signifie « qui ne parle pas ». Ce terme désignait initialement le nourrisson. Dans « la parole de l’enfant, de l’enfance muette à l’enfance déniée », D. Calin revient sur l’étymologie : s’il cela est vrai que le bébé ne parle pas, l’enfant développe, quant à lui, rapidement un langage. L’étymologie ne renvoie donc pas à une incapacité de parler mais à la non reconnaissance sociale de cette parole. On relève que dans beaucoup de familles françaises, la tradition interdisait aux enfants de parler à table. Dans la société, on commence à faire une place particulière aux enfants à partir du XVIème siècle, cela se traduit notamment par une différenciation au niveau vestimentaire.
L’enfant se décrit comme celui qui n’est pas encore adolescent ou comme le fils ou la fille de tout âge, par relation au père et à la mère. Le descendant, la personne proche ou la chose produite par une autre. Le terme Infans se construit à partir d’un préfixe privatif attaché au terme for/fari qui signifie parler. L’enfant est celui qui est incapable de bien parler. Déjà, on retrouve la notion d’incapacité. Enfin, Filius, le fils, renvoie une nouvelle fois à la notion de filiation. D’un point de vue étymologique on retrouve donc les mêmes notions phares que dans celle de la définition française de l’enfant : l’enfant est incapable de parler et son existence est intrinsèquement liée à sa filiation. Jean-Louis Le Run, pédopsychiatre, définit la parole de l’enfant ainsi : « la parole exprime la pensée par l’intermédiaire du langage ». Elle n’a de valeur qu’en raison de son contenu. Il ne suffit pas de faire des sons avec sa bouche. Il y a la parole qui compte (le serment) et les beaux discours (les flatteries). Le psychanalyste, Lacan, distingue la parole vide de la parole pleine. La parole vide étant le langage uniquement objectivé en termes de communication ou le discours de la folie dans lequel le sujet est parlé plus qu’il ne parle. Il confronte cette parole à la parole pleine qui serait, quant à elle, une parole riche de sens et de symbolique. Il est possible de dissocier la parole distribuée par le vecteur du langage comme affirmation de soi, comme volonté consciente de prendre position, et la parole qui émane du corps, qui transparait au-delà des intentions du locuteur, le langage du corps, l’infra-verbal. Laquelle aurait plus de valeur ? Laquelle faudrait-il prendre en compte ? Laquelle vaudrait consentement ? « Qui ne dit mot consent » est un dicton souvent utilisé en société et sert d’ailleurs à justifier des actes que l’on n’aurait pas commis si la personne avait pu clairement exprimé sa volonté. C’est une manière de verbaliser l’absence de réponse verbale, le silence comme une autorisation par défaut. Or, malgré la popularité de ce dicton, il n’a jamais été question en droit civil d’associer silence et consentement. Alors que faut-il retenir ? Les impressions que nous laissent le langage du corps ou les mots choisis par le locuteur ? Il est possible de dire oui de la bouche et non de tout son corps. Il s’agit donc de choisir entre l’envie, le désir de la personne et sa volonté, ses capacités décisionnelles. Le droit choisit la volonté exprimée qu’importe ce que le corps montre tant qu’aucune pression n’est de nature à vicier le consentement. Ainsi, le patient se rendant chez le dentiste pour se faire retirer une dent peut transpirer d’angoisse, trembler de peur et affirmer au dentiste son accord pour procéder au soin parce qu’il sait au-delà de sa peur que c’est ce qui est bon pour lui. Le droit reconnaît à la personne humaine, sa capacité à faire des choix et sa volonté au-delà de ce qui peut la motiver, la travailler. On pourrait alors déterminer que le juriste s’attache à la parole dans ce qu’elle a d’objectif, la volonté de la personne tandis que le thérapeute, le soignant s’attachera plus à la parole en ce qu’elle a de symbolique, d’interprétable, en ce qu’elle témoigne des ressentis et du vécu de l’interlocuteur.
Alors comment entendre, écouter, prendre en compte ou en considération la parole de l’enfant, de celui qui est incapable de parler et qui ne peut être pensé que dans la cadre de sa filiation ? Selon le dictionnaire Larousse, entendre c’est : percevoir par l’ouïe, écouter volontairement, prêter attention, comprendre, saisir le sens… Ecouter, c’est déjà aller plus loin. Il s’agit de prêter attention à ce que quelqu’un dit pour l’entendre et le comprendre. C’est tenir compte de ce que dit quelqu’un. Enfin, la considération est rattachée au fait de peser quelque chose, de l’apprécier, le prendre en compte, le respecter et l’avoir en estime. A travers ces notions graduées, on peut comprendre que ce qui est l’objet de notre attention peut passer du bruit parasite que l’on capte sans y faire attention à quelque chose d’une grande valeur nécessitant une attention particulière.
La parole de l’enfant est ici étudiée dans le cadre des services et établissement médico-sociaux accueillant des enfants au titre de la souffrance psychique ou de la déficience quelle qu’elle soit. L’action médico-sociale est définie par l’article L 116-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle tend « à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur l’évaluation continue des besoins et attentes des usagers ». On peut d’ores et déjà noter les notions d’autonomie, de protection et de citoyenneté. Les établissements et services médico-sociaux sont chargés de favoriser l’exercice de l’autonomie et de la citoyenneté des usagers qu’ils accueillent. L’autonomie est une notion complexe qui trouve bien des définitions. On peut considérer depuis les deux lois de 2002 relatives pour l’une au sanitaire pour l’autre au médico-social que l’autonomie réside dans le fait de pouvoir permettre à l’usager de faire des choix éclairés le concernant après l’avoir informé de manière adaptée. C’est aussi permettre à l’usager de faire tout ce qu’il peut faire de lui-même, lui-même. L’autonomie est souvent pensée en opposition à la dépendance. Par ailleurs, le citoyen est celui qui dispose de droits civils et politiques et qui peut les exprimer sans craindre l’oppression. Dans notre situation, on peut déjà entrevoir que les choix de César ne sont pas pris en compte, reste à savoir si on peut considérer qu’il s’agit de choix éclairés. De même, César peut-il exprimer son opinion sans craindre de répercutions : risque-t-il de perdre l’affection de sa maman ? De ne plus faire partie de cette fratrie unie par le TSA ? Pourrait-il décevoir les soignants auxquels il est attaché s’il se rallie à sa maman ?
Construction de la parole de l’enfant, prisme du soin.
Dans le cadre des accompagnements médico-sociaux et des soins psychiques, le petit enfant a longtemps besoin d’un porte-parole puisqu’il n’a pas encore développé de langage bien qu’il communique. Le comportement et la parole de l’enfant font donc d’emblée l’objet d’une interprétation. Dès le commencement de sa vie, les besoins et souhaits de l’enfant vont s’exprimer par le biais de son comportement et de ses expressions qui seront eux même interprétés et traduits en mots par l’intermédiaire de ses parents puis des professionnels de la petite enfance. Pour pouvoir traduire ces comportements et expressions, il est nécessaire de connaître l’enfant, de l’avoir observé. « La mère de l’enfant et ceux qui s’en occupent vont transformer des éléments incompréhensibles en éléments pensables et introjectables »1. L’enfant est pensé et mis en mots par d’autres avant le processus de subjectivisation. Cela lui sert d’appui dans un premier temps pour pouvoir se faire comprendre. Dans un second temps, cela finit aussi par l’étouffer. Il se dégage de ce socle par le « non ». Le langage apparaît lors du processus de subjectivisation : lorsque l’enfant comprend que sa mère et lui forment deux êtres distincts. Le langage apparaît comme un tiers séparateur entre la mère et l’enfant, avant son apparition « la mère [de l’enfant] est l’interlocuteur privilégié et l’interprète permanent »2. Nombreux sont les retards de langage liés à des difficultés de séparation : « trop de collage = pas de langage » (F. Noël, orthophoniste en CAMSP). L’enfant ne parle que parce qu’il en a besoin, que cela à une utilité. Si il est en fusion avec sa mère dans son quotidien et que celle-ci anticipe avec brio tous ses besoins celui-ci n’aura pas de raison de développer le langage. On observe aussi chez les enfants présentant des difficultés de séparation et un retard de langage que la parole peut-être perçue comme menaçante au sein de la famille ou encore l’enfant peut percevoir la crainte de sa mère à l’idée qu’il ne soit plus dépendant d’elle et s’autonomise. Effectivement, l’apparition du langage a aussi un retentissement majeur dans la relation de l’enfant à l’autre : il peut dès lors exprimer son malaise, ses émotions, son mal-être. Il n’a plus besoin de son interprète et peut même s’exprimer en contrariété avec celui-ci. Par ailleurs, l’enfant est un être sociable, entre l’âge de 3 et 5 ans il va normalement abandonner la violence au profit du langage pour régler les conflits avec autrui. La parole apparait donc comme quelque chose dont l’enfant peut se saisir pour s’individuer et s’opposer à ses parents en faisant ses propres choix. Le processus d’individuation, initialement conceptualisé par Jung, est le processus par lequel l’individu se dissocie, se différencie des autres membres de son espèce afin d’être une personne à part entière. A contrario, est-il possible de penser que l’enfant qui n’est pas en capacité de s’individuer et de s’opposer à ses parents n’a pas encore terminé la phase de développement nécessaire pour cela ? Serait-il alors violent d’attendre de lui qu’il agisse ainsi alors qu’il n’en est pas là ? Peut-on demander à un enfant de courir s’il ne sait pas marcher ? Si César avait maintenu la position exprimée devant le pédopsychiatre de manière ferme et continue cela n’aurait-il pas eu l’impact le plus important que l’on puisse imaginer pour empêcher son entrée au SESSAD ? Le fait qu’il ne l’ait pas fait, est-il significatif d’un développement psychique insuffisant ? Si César n’est pas totalement individué, sa parole est-elle fiable ? Doit-elle être prise en considération ? Il serait possible de raisonner comme cela si l’individuation était un concept manichéen. Si tous les êtres humains passent par ce processus, l’aboutissement de celui-ci couvre un large spectre. Etre individué ne signifie pas qu’une frontière infranchissable se dresse entre l’individu et les pressions extérieures : ce serait nier la notion d’emprise, au encore de loyauté, de conflit d’intérêt, d’amitié fusionnelle… D’un point de vue systémique, un individu est forcément lié à d’autres individus qui vont influencer son analyse, être l’objet d’enjeux. On pourrait penser que le chemin parcouru par César lorsqu’il exprime ne pas être autiste puis lorsqu’il se positionne contre une entrée au SESSAD devant sa maman témoigne de son processus d’individuation qu’il ne faudrait pas nier sous prétexte qu’il s’est avéré trop risqué ou menaçant pour lui de maintenir un positionnement frontal. Dans le cadre des abus sexuels, Ferenczi note que « la peur de l’enfant semble le pousser à se soumettre automatiquement à la volonté de son agresseur, à deviner le moindre de ses désirs, à obéir en s’oubliant complétement et à s’identifier totalement à l’agresseur. »3
La fiabilité de la parole de l’enfant
L’affaire Outreau est le symbole des questionnements autour de la parole de l’enfant : fiabilité, crédibilité, authenticité, impact, rôle de l’adulte… La parole de l’enfant est une question qui est très souvent abordée sous l’angle de la fiabilité.
La parole de l’enfant pose la question de la fiabilité de celle-ci. J-Y Hayez, psychiatre et docteur en psychologie, détermine que la parole de l’enfant est fiable si elle restitue fidèlement sa connaissance exacte de la réalité extérieure ou de la réalité de soi en tant qu’objet de connaissance. La parole de l’enfant est fiable si je lui demande ce qu’il voit par la fenêtre, qu’il répond « un camion de pompiers » et qu’un camion de pompier est effectivement garé dans la rue. Il faut dissocier la fiabilité de l’authenticité. L’authenticité désigne la capacité de l’enfant à restituer son monde interne tel qu’il se le représente. Le Dr Hayez considère que des ilots de fiabilité apparaissent dès les 2 ans de l’enfant et qu’à 4 ans, la fiabilité est solidement installée. Le problème posé par la prise en compte de la parole de l’enfant n’est donc pas la fiabilité mais la suggestion. Effectivement, les enfants auraient tendance à se faire à l’idée que ce qu’on leur dit est vrai. Les autres peuvent exercer des pressions en tout genre sur l’enfant et ce n’est pas facile pour lui d’y résister. J-Y Hayez pointe d’ailleurs qu’il est particulièrement difficile pour l’enfant de résister à la suggestion lorsque celle-ci est puissante, répétitive, assortie de menaces ou chantage et qu’elle émane d’un personnage très important comme l’est la mère de l’enfant. Encore une fois, on ne peut reprocher à César de ne pas avoir pu s’affirmer vis-à-vis de sa mère et que celle-ci ait pu le convaincre longtemps du fait qu’il était autiste. Dans « la fiabilité de la parole de l’enfant », J-Y Hayez note que la qualité du discours de l’enfant s’appauvrit lorsqu’on lui fait répéter plusieurs fois les choses sans que rien ne se passe. L’enfant semble se décourager lui-même et sa mémoire s’effriter. L’enfant s’attend, lorsqu’il se mobilise pour « cracher le morceau », prenant ainsi des risques vis-à-vis par exemple de sa famille, à être aidé vite et bien. Selon le Dr Hayez tout l’enjeu est là : Il faut savoir saisir la perche tendue. A défaut, l’enfant peut être traversé par différentes inquiétudes : pourquoi les adultes censés le protéger passent autant de temps à tergiverser ? A-t-il déplu à l’adulte à qui il s’est confié ? Ces inquiétudes risquent de faire naître angoisses et culpabilité au point de pousser l’enfant à changer de version ou se rétracter. On comprend à travers l’analyse du docteur Hayez que l’absence de réponse face aux révélations couteuses d’un enfant constitue une forme de violence pour celui-ci. On peut imaginer que César se soit questionné à plusieurs reprises notamment après que le CRA ait fait tomber son diagnostic. César savait comme nous que nous attentions cette expertise pour déclencher des changements, il attendait ces changements. Néanmoins, nous n’avons eu aucune réaction après cela et la communauté soignante et médico-sociale a laissé sa mère poursuivre ses démarches. On peut dès lors imaginer que César puisse avoir perdu confiance en cette communauté pour l’avenir. Exactement comme sa maman qui ne fait pas ou plus confiance au système et qui décide de le contourner, César pourrait se retrancher, rallier cette famille seule contre tous.
Les limites de la parole de l’enfant
La première limite à l’émergence de la parole de l’enfant est probablement celle ayant motivée la rédaction de ce mémoire : à quoi bon créer les circonstances pour que la parole émerge si nous n’avons pas la capacité d’intervenir et de protéger l’enfant ?
Dans le cadre judiciaire, l’enfant a depuis 2008 le droit d’être entendu. Une des juridictions devant laquelle il est le plus amené à le faire est le juge aux affaires familiales. Effectivement, c’est ce juge qui sera compétent pour trancher les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale. L’enfant peut alors être entendu dans des circonstances variées : litige relatif au choix de la résidence en cas de séparation parentale, relatif à l’éducation religieuse si les titulaires de l’autorité parentale ne sont pas d’accord… Laurent Gebler, juge aux affaires familiales témoigne : permettre à un enfant de donner son point de vue n’est en aucun cas la même chose que l’obliger à le faire, à choisir. On comprend bien concernant la parole de l’enfant que si il est question de la soutenir, de l’aider à s’exprimer et à la faire entendre, il n’est pas question de donner à l’enfant la responsabilité bien trop lourde de choisir et de porter ce choix.
Effectivement, C. Thompson, psychologue, dans le livre « la violence de l’amour » explique que permettre à l’enfant d’être décisionnaire c’est aussi le placer dans une position adultomorphe qu’il n’est pas capable de tenir et qui le met en difficulté. Demander à l’enfant de faire des choix, de prendre des décisions qui ne lui appartiennent pas c’est exercer sur lui une pression démesurée et le mettre en échec. Ainsi, elle prend l’exemple des couples séparés qui attendent la bénédiction de leurs enfants pour s’autoriser à rencontrer de nouveaux compagnons. Elle relève aussi la situation des familles recomposées et du « tourisme familial » en citant ces adolescents libres de choisir leur résidence au gré des positionnements éducatifs de leurs parents : alors qu’ils n’attendent finalement aucun revirement éducatif mais simplement l’obligation de rester.
Par ailleurs, si le professionnel de l’enfance a notamment pour rôle de permettre à la parole de l’enfant de surgir en créant les conditions pour cela il ne doit pas pour autant idéaliser cette parole, la sacraliser au risque de dépasser les attentes de son émissaire. Ainsi, la « position du thérapeute est de ne rien attendre pour obtenir quelque chose et de ne pas chercher à extirper une parole tout en offrant les conditions de son surgissement »4
D. Calin, professeur de philosophie, dans « de l’enfance muette à l’enfance déniée » offre une critique nuancée de la prise en compte de la parole de l’enfant dans la société contemporaine. Son développement est le suivant : la pensée freudienne incite a priori à prendre au sérieux tout ce que vivent et disent les jeunes enfants. Effectivement, celle-ci enracine les difficultés psychiques rencontrées par les adultes dans leur petite enfance. Grâce à l’influence de la pensée psychanalytique, une plus grande attention a été portée au développement de la personnalité et des affects par les parents, la société et les professionnels. Plus tard, Françoise Dolto notamment dans le livre « la cause des enfants » révolutionnera la manière de concevoir et de porter attention à l’enfant tout comme E. Bick viendra révolutionner l’observation du nourrisson. D. Calin va aussi s’intéresser à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qu’il va caractériser d’irréaliste et utopiste. Il prendra comme exemple la liberté d’expression donnée aux enfants au même titre qu’aux adultes. Pour autant, il est difficile d’imaginer un enfant de 13 ans se pensant pacifiste se rendre chez un tatoueur sans ses parents pour demander d’inscrire Peace & Love en grosses lettres sur sa poitrine sous couvert de la liberté d’expression. Ce que cherche à démontrer D. Calin c’est que quelques soient les extrêmes : d’une part une société passée dans laquelle on ne pense pas l’enfant et où on ne l’écoute pas et d’autre part une société actuelle dans laquelle l’enfant est indissocié de l’adulte ; l’enfance est niée. Que l’on réduise l’enfant au silence et qu’on discrédite sa parole ou qu’on le mette sur le même plan que l’adulte : on nie le concept d’enfance. Pour D. Calin, l’enfance est le moment où l’on devient humain, avant ça notre humanité nous serait d’emblée donnée sous la forme d’un potentiel.
Il est par ailleurs dangereux de vouloir confondre la parole de l’enfant et celle de l’adulte. C’est ce qui transparait notamment dans « Confusion de langue entre les adultes et l’enfant » de Sandor Ferenczi. Selon lui, les séductions incestueuses résultent d’un amour entre un enfant et un adulte. Tandis que l’enfant est animé par des fantasmes qu’il qualifie de ludiques, le jeu de celui-ci peut se teinter d’érotisme mais reste toujours au niveau de la tendresse. L’adulte incestueux peut confondre les jeux des enfants avec les désirs d’une personne ayant atteint la maturité sexuelle. De même, la réaction de l’enfant victime d’abus peut différer de celle qui semblerait logique à des adultes. Ferenczi note que « la personnalité encore faiblement développée réagit au brusque déplaisir (ex : douleur provoquée par une pénétration), non pas par la défense, mais par l’identification anxieuse et l’introjection de celui qui la menace ou l’agresse »5. Il est donc important de ne pas retirer à l’enfance son caractère inachevé, en construction, au risque de la malmener ou de la maltraiter.
Il est donc primordial de dissocier deux mouvements : celui qui tend à mieux comprendre l’enfant, à s’en rapprocher pour lui permettre de se développer harmonieusement et celui qui tend à le positionner en petit adulte responsable et décisionnaire.
Le cadre légal de la parole de l’enfant
La question de la parole de l’enfant en droit peut se traiter sous l’angle du régime applicable à la minorité. Néanmoins, avant de définir ce régime, il convient de s’intéresser à la minorité en elle-même et donc à la question de l’âge et de ses conséquences en droit (1). A partir de là il sera possible de brosser le régime juridique de la minorité, entre incapacité (2), autonomie (3), représentation (4) et assistance (5).
La minorité : la question de l’âge.
A l’époque de la Grèce Antique, le mineur voyait sa capacité s’étendre en deux fois : un seuil était posé à l’âge de 7 ans à partir duquel il semble que l’enfant soit en capacité de discerner le bien du mal. A partir de 7 ans, âge de raison, l’enfant était considéré comme Infantia jusqu’à ses 14 ans où il atteignait la Puerita, c’est-à-dire la puberté. En droit romain, l’enfant était la propriété de son père, il n’existait pas en tant que sujet de droit. Le père avait droit de vie et de mort sur sa progéniture. Plus tard, en France, en droit coutumier médiéval, la majorité est fixée
à 25 ans. L’enfant n’est pas important, c’est un petit adulte. Le régime juridique de l’enfant semble dépendre de l’importance de la natalité et de l’espérance de vie. Longtemps, l’enfant n’avait que deux rôles : perpétuer la lignée familiale (rôle de transmission) et aider la famille dans le travail quotidien (corvée) mais aussi à l’extérieur de la structure familiale (salaire venant suppléer celui du père). L’enfant est placé sous la puissance paternelle. Le véritable droit des mineurs est un droit assez moderne, la coparentalité est apparue tardivement (2002) de même que les lois sur les châtiments corporels toujours objet de débats à ce jour. L’enfant tel qu’il est conceptualisé de nos jours a commencé à l’être à partir de 1841 et de la première loi restreignant le travail des enfants. De 1792 à 1974, la majorité sera fixée en France à 21 ans avant d’être abaissée à 18 ans.
En France, la minorité est fixée par l’article 388 du Code Civil. Celui-ci prévoit que « le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». L’âge en droit français est un indicateur de vulnérabilité : par exemple certains crimes ou délits sont aggravés par la circonstance d’avoir été réalisés sur un mineur ou sur une personne âgée. Il existe une volonté de protéger les personnes vulnérables et tout particulièrement les enfants: Déclaration Internationale des Droits de l’Enfant actant de nombreux droits à garantir aux enfants, Ordonnance de 1945 organisant la réponse pénale faite aux mineurs et mettant en place « l’excuse de minorité ». Les mineurs sont particulièrement protégés et la loi est plus sévère lorsqu’on leur porte atteinte. La protection du mineur est assurée de deux manières en droit. D’une part en droit civil sur le plan de la préservation de ses intérêts, par l’incapacité du mineur et ses pendants : l’autorité parentale et l’administration légale. D’autre part, en droit pénal, elle est assurée par l’excuse de minorité. La protection au sens juridique a été définie par G. Cornu comme une « précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu’elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l’assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité ».
L’âge en droit est souvent pensé de manière chronologique, à savoir le temps écoulé depuis la naissance. Il se calcule heure par heure comme l’a énoncé la Cour de Cassation dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 septembre 1985. Celle-ci a déterminé qu’un mineur devenait majeur au sens de la responsabilité pénale 18 ans, heure pour heure, après sa naissance. L’âge en droit et particulièrement en droit pénal a un impact primordial. Cette manière de le définir est complètement arbitraire et pragmatique. Elle ne tient pas compte du degré de maturité et de discernement pour déterminer la responsabilité. Néanmoins, un des piliers de la démocratie et de la paix sociale est la sécurité juridique. Il est nécessaire à la vie en société que nous soyons tous concernés par les mêmes règles dont nous avons connaissance et qu’il soit possible d’anticiper leur application, savoir qui sera responsable de quoi. En France, le mineur est traité de la même manière quel que soit son âge sur le plan de la capacité : celle-ci se met en place à la majorité fixée à 18 ans. En droit pénal par contre, le régime applicable au mineur évolue grâce à des seuils d’âge. Ces seuils d’âge intègrent l’idée que l’enfant se développe de manière progressive pour devenir adulte au fur et à mesure que son intelligence et ses facultés se développent. Pour autant, les seuils d’âge sont eux aussi arbitraires : deux enfants de 13 ans ne présentent pas forcément les mêmes capacités de discernement. Il aurait été possible de laisser à chaque fois la possibilité au juge d’apprécier in concreto l’âge de l’enfant avant de se prononcer sur le volet de la responsabilité pénale. Cela aurait mieux répondu au besoin de protection du mineur. Mais on se heurte une nouvelle fois à la sécurité juridique qui demande de la précision et de la stabilité. L’ordonnance de 1945 a donc posé des seuils en droit pénal. Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent se voir appliquer que des mesures éducatives, à partir de 10 ans des sanctions éducatives sont possibles, à partir de 13 ans, le juge peut donner une peine mais celle-ci bénéficie automatiquement d’une réduction. Enfin, entre 16 et 18 ans le juge peut prononcer une peine classique, la réduction de peine étant facultative et laissée à son appréciation. Au-delà de ces seuils, il semble important de rappeler que l’ordonnance de 1945, en son préambule notamment, a fixé des principes fondamentaux : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains », la protection et l’éducation avant la répression…
On comprend donc que sur le plan de la responsabilité pénale, le mineur est particulièrement protégé. Il n’est donc pas considéré comme responsable de ses actes, il n’a pas à en répondre tout du moins pas avant un certain âge. Néanmoins, si on considère que le mineur n’est pas responsable de ses actes, c’est que l’on pense qu’il n’a pas encore acquis le discernement nécessaire pour faire des choix éclairés, pour dissocier le bien du mal. Dans ces circonstances, peut-on pour autant conférer au mineur des droits et la possibilité de les exercer ?
Le mineur frappé d’incapacité
La question de l’acquisition des droits et de leur exercice pose celle de la personnalité juridique. Effectivement, la personnalité juridique revêt l’ensemble des droits reconnus aux personnes. Elle s’acquière à la naissance, si l’enfant né vivant et viable. Dès lors, il devient titulaire de l’ensemble des droits reconnus aux personnes en France. Il convient ensuite de dissocier le fait d’être titulaire de droits et le fait de pouvoir les exercer. L’exercice de ses droits est relatif à la capacité de la personne. Si celle-ci est capable, elle peut exercer pleinement l’ensemble de ses droits. La capacité se définit par l’aptitude à devenir titulaire de droits ou d’obligations et à les exercer. Elle constitue le principe, et l’incapacité, l’exception. L’incapacité peut être de jouissance et/ou d’exercice. L’incapacité de jouissance empêche son auteur d’être titulaire d’un droit, d’acquérir un droit (ex : le médecin ne peut recevoir de libéralités de la part du patient qu’il a accompagné en fin de vie). Quand une personne est privée de l’exercice d’un droit elle peut en rester titulaire, elle ne peut juste plus le mettre en œuvre elle-même. C’est alors qu’entre en jeu le système de représentation. Le mineur, en raison de son âge, peut acquérir des droits mais ne serait pas apte à les exercer lui-même. Ce sont ses parents, par le biais de l’autorité parentale et de l’administration légale, qui exercent ses droits à sa place par le système de la représentation. L’incapacité peut être générale ou spéciale, lorsqu’elle est de jouissance elle ne peut être que spéciale sans quoi elle retirerait la personnalité juridique ce qui ne peut être le cas que dans la mort. L’enfant mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercice de ses droits, l’article 1146 du Code Civil énonce : « sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés. ». Les droits du mineur sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale et ses administrateurs légaux.
Pour autant, le mineur n’est pas totalement incapable. La loi et l’usage lui reconnaissent certains droits. Par exemple, il est toujours communément admis que bien qu’il soit incapable de contracter le mineur puisse se rendre dans une boutique et acheter un cadeau de fête des mères (contrat de vente).
Vers une autonomie progressive du mineur
Depuis quelques décennies, les droits autonomes du mineur ne cessent de croître. Le mineur n’échappe pas à la logique d’autonomisation des personnes vulnérables. L’autonomie est une notion difficile à définir, les lois de 2002 et 2007 permettent d’en cerner les contours. L’autonomie serait le fait de faire par soi-même tout ce que l’on est capable de faire, ce serait alors le contraire de la dépendance. C’est aussi avoir accès aux informations qui nous permettent de donner un consentement libre et éclairé. C’est l’auto-détermination, le fait de pouvoir, en toute connaissance de cause, faire des choix pour soi et choisir les chemins de la vie que l’on souhaite emprunter.
A la différence des personnes âgées, des adultes en situation de handicap ou des majeurs placés sous protection juridique il ne s’agit pas de préserver, maintenir ou développer une autonomie mais plutôt de prendre en considération le mineur et le préparer à une autonomie future. Le mineur n’est pas empêché par une altération de ses capacités, c’est le législateur qui le place dans un régime d’incapacité jusqu’à sa majorité (18 ans) ou son émancipation (16 ans). L’incapacité des majeurs ne peut reposer que sur la reconnaissance médicale et judiciaire d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté. L’incapacité du mineur repose non pas sur ses facultés mais uniquement sur son état, à savoir sa minorité.
Le mineur profite du mouvement d’autonomisation des personnes vulnérables. Sa parole et son avis sont de plus en plus recueillis. Les textes favorisant l’écoute et la prise en compte
20
de la parole de l’enfant sont de plus en plus présents. Dès lors, à tout âge, le mineur peut reconnaître son enfant et devenir titulaire de l’autorité parentale. Il s’agit d’un élément non négligeable et à la signification importante : le mineur peut exercer l’autorité parentale sur quelqu’un d’autre alors qu’il est lui-même incapable et dépendant de l’autorité de ses propres parents. Il peut être entendu par un juge en procédure civile. Il peut témoigner, être entendu, jugé et condamné au pénal. Il peut saisir le défenseur des droits. Le mineur peut à tout âge accoucher sous X et obtenir une méthode contraceptive même d’urgence. Le mineur peut consulter seul que ce soit dans le cadre d’un avortement ou de tout type de consultation (art 1111-5 CSP). Enfin, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant lui reconnait un ensemble de droits et libertés fondamentales tels que la liberté d’expression, la liberté de culte…
A 13 ans, le mineur peut refuser ou accepter son adoption simple ou plénière. Il peut accepter ou refuser un changement de nom ou de prénom. Il peut consentir à l’acquisition de la nationalité française (pour les enfants nés en France de parents étrangers). Il peut s’opposer au prélèvement post mortem de ses organes. L’âge de 13 ans peut être considéré comme l’âge de la capacité à donner son consentement concernant des actes éminemment personnels.
A 15 ans, le mineur acquiert la majorité sexuelle. La doctrine détermine qu’en droit, les 15 ans semblent être le seuil du discernement.
A 16 ans, le mineur peut choisir son médecin traitant. Il peut aussi rédiger son testament. Il peut surtout obtenir son émancipation. Les textes de loi et la pratique permettent donc de penser que le mineur de 16 ans dispose d’une certaine autonomie. A partir de 16 ans, un mineur peut sortir de la tutelle de ses parents et de l’autorité parentale : il peut obtenir son émancipation. Il lui faudra alors le soutien de l’un de ses parents pour pouvoir saisir le juge. Néanmoins, en ouvrant cette possibilité, le législateur sous-entend qu’un mineur de 16 ans peut être en capacité d’exercer les droits d’un majeur.
Il est pourtant assez intéressant de noter un autre âge qui apparaît en droit : les 28 ans. Si le mineur atteint la majorité au plus tard à 18 ans, le droit de la procédure pénale lui laisse jusqu’à ses 28 ans pour porter plainte concernant certains crimes qui auraient été commis à son encontre (exemple : viol). De même, les établissements médico-sociaux et sanitaires doivent conserver les dossiers des patients mineurs jusqu’à leurs 28 ans minimum. Le législateur semble admettre ici que si le mineur peut devenir capable de contracter, d’ester en justice à 18 ans, il lui faut encore parfois de nombreuses années pour affronter les ombres de son passé. Cet allongement des délais de prescription et d’archivage n’est pas tant dus à la gravité des crimes concernés ou à une nécessité médicale qu’au fait que, bien que nous ne l’expliquions pas encore totalement, le mineur semble profiter pleinement de sa majorité une dizaine d’année avant de commencer à être rattrapé par les méandres de son passé.
Sur le plan particulier de la santé, les soins et traitements relèvent en principe de l’autorité parentale. Cela fait partie des attributs de l’autorité parentale qui appartiennent aux parents de l’enfant pour « le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité » (Art. 371-1 CC). Il appartient donc aux titulaires de l’autorité parentale de consentir aux soins dispensés auprès de leur enfant mineur. Cependant, le consentement du mineur doit lui aussi être recherché et ce quelle que soit la nature de l’acte réalisé. Le code de la santé publique, dans son article 1111-2 alinéa 5 prévoit que les mineurs reçoivent eux-mêmes les informations qui les concernent et participent aux décisions de manière adaptée à leur degré de maturité. Le code de la santé publique va encore plus loin pour déroger à l’autorité parentale. Dans certains cas, le médecin est dispensé d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale : lorsque le traitement s’impose pour sauvegarder la santé du mineur ou si celui-ci s’oppose expressément à la consultation des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Dans ce dernier cas, le médecin doit tout faire pour obtenir du mineur l’autorisation de prévenir ses représentants légaux. Si celui-ci maintient son opposition il doit alors être accompagné de la personne majeure de son choix.
Il apparait donc que le mineur est de plus en plus amené à pouvoir décider pour lui seul. Pour autant, parallèlement, les droits des titulaires de l’autorité parentale et des administrateurs légaux, s’ils sont critiqués, ne semblent pas en déclin.
Le mineur toujours représenté par les titulaires de l’autorité parentale
Le XXIème siècle semble être celui de la participation directe et de la remise en cause des régimes de représentation. Effectivement, parallèlement à la croissance des droits visant l’autonomie du mineur, on a observé la réforme de 2007 concernant les majeurs protégés qui ont vu leurs libertés fondamentales réaffirmées. Le progrès technique valorise aussi cette autonomisation. Effectivement, nombre de majeurs protégés placés sous protection du fait leur impossibilité physique à exprimer leur volonté voient le champ des possibles s’ouvrir grâce aux progrès de la science et des nouvelles technologies (récemment, Elon Musk a annoncé travailler sur une puce implantable dans le cerveau et capable de retranscrire la pensée). Le soin a lui aussi été touché par cette dynamique via la démocratie sanitaire. Le patient devient acteur direct de son parcours de soin, il veut en maîtriser les tenants et aboutissants. La politique est aussi touchée par ces mouvements d’autonomisation voire d’individuation. Effectivement, l’année 2018-2019 a été marquée en France par le mouvement des « gilets jaunes » dont l’une des principales revendications était le référendum d’initiative populaire. A l’heure du tout numérique et de l’instantané, la démocratie représentative semble avoir du souci à se faire.
Enfin, au XXIème siècle émerge une nouvelle forme de militantisme et de nouvelles revendications. L’expertise professionnelle rencontre l’expert de soi-même, du quotidien, de son enfant. C’est à l’expert professionnel de s’adapter, de conduire et guider l’usager ou le patient. D’ailleurs, on assiste à un développement massif de l’éducation thérapeutique pour les maladies chroniques. Quel que soit le sujet (racisme, sexisme, discriminations diverses…), dans les milieux militants les mêmes discours reviennent : le mieux placé pour prendre la parole sur un sujet est celui qui le vit et il n’existe pas de grands principes manichéens, seule la volonté individuelle doit être respectée. La représentation inspire la méfiance, elle est désignée dans notre société comme un facteur de domination, de paternalisme et de suprématie. Elle est perçue comme permettant de museler les personnes concernées en donnant la parole à des privilégiés capables de penser et de parler pour elles.
Néanmoins, si l’autonomie est un concept très fort du XXIème siècle, il semble déjà connaître quelques écueils : la solitude, la vulnérabilité, la responsabilité… J-J. Lemouland, Professeur de droit, écrira « les bonnes intentions n’ont jamais suffi à régir la vie en société ni à protéger ceux qui doivent l’être »6. Effectivement, un peu plus de dix ans après les lois Kouchner, 2002-2 et 2007, les juristes commencent à pointer l’envers de l’autonomie. Si elle doit être affirmée chaque fois que cela est possible, cela doit toujours se faire dans l’intérêt de la personne vulnérable. L’idée du législateur n’est pas de la mettre plus en difficulté, il incite famille et professionnels à se montrer attentifs, à agir dans l’intérêt de la personne vulnérable, avec celle-ci chaque fois qu’elle le peut. Mais si l’autonomie pousse à juger responsable ne serait-ce que sur le plan moral une personne vulnérable, s’agit-il toujours d’un progrès ou d’un retour en arrière ? Doit-on faire peser sur les épaules de personnes fragiles ou démunies des choix lourds ? N’est-il pas bon parfois de se laisser porter par les conseils professionnels du médecin lorsque l’on souffre trop ? Ou doit-on coûte que coûte faire valoir notre autonomie ?
Lemouland Jean-Jacques. L’assistance du mineur : une voie possible entre l’autonomie et la représentation. RTDCiv. : Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 1997.
Pour ce qui est du mineur, le régime de représentation a évolué. De la puissance paternelle unilatérale nous sommes passés à une notion plus moderne d’autorité parentale. L’article 371-1 du Code Civil prévoit ainsi que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. ». On observe là de grandes évolutions : de droits sur l’enfant, l’autorité parentale devient un ensemble de devoirs et d’obligations envers l’enfant. L’intérêt de l’enfant est par ailleurs une notion floue, sans définition, au caractère discrétionnaire.
Le législateur va plus loin dans le second alinéa : « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». A ce stade, toutes les difficultés semblent levées. Les parents de l’enfant le protègent jusqu’à sa majorité et l’associent, au fur et à mesure qu’il mature, aux décisions qui le concernent. Ainsi, théoriquement, les parents de César aurait dû le consulter et prendre avec lui la décision qui le concerne. Néanmoins, on touche ici à toute la fragilité des lois déclaratives, bienveillantes mais dépourvues de sanction. La société évolue moins vite que le législateur. C’est maintenant qu’il est important de se remémorer l’origine du mot « enfant » et tout ce qu’il porte. L’enfant, outre son incapacité à parler, est la propriété de ses parents. G. Raoul Cormeil, lors de ses conférences en droit des successions, rappelait régulièrement qu’il y a deux choses cruciales pour notre société : la filiation et le patrimoine. Le législateur peut bannir la fessée, demander aux parents d’associer l’enfant aux décisions qu’ils prennent pour lui, il ne sera jamais dans l’intimité des foyers et ne retirera pas aux parents l’idée que leur enfant leur appartient. D’autant à cette période, où certains semblent penser qu’il existe un droit à avoir un enfant. L’immixtion de l’Etat dans l’éducation que les parents prodiguent à leur enfant est en soi une question éthique. Aux Etats-Unis, par exemple, une liberté bien plus grande est laissée aux parents concernant les choix éducatifs.
Néanmoins, entre autonomie et représentation, au-delà des bonnes intentions, il est possible d’entrevoir un autre régime juridique : celui de l’assistance.
De la représentation à l’assistance ?
Dans l’article « l’assistance du mineur : une voie possible entre l’autonomie et la représentation », J-J Lemouland rappelle que l’incapacité a pour but la protection et que les parents sont en principe les mieux placés et les plus sensibles à cette question. Il semble nécessaire de se poser une question : l’intérêt de l’enfant est-il mieux préservé par l’autonomie ou par l’incapacité ?
Le Professeur Lemouland souligne le caractère « batard » du régime du mineur. Incapable mais doté de droits importants, il ne peut être partie dans une affaire de justice mais a pourtant le droit d’être entendu par un juge. Le régime de la minorité est à paramètres variables : le code civil pose des règles, le code de la santé publique de multiples exceptions. Alors que des seuils d’âge existent en droit pénal, il n’en est rien en droit civil… Le régime applicable aux mineurs semble dès lors très chaotique, à géométrie variable. Mais n’est-ce pas ce que fait le droit lorsqu’il est face à des sujets sensibles qui demandent d’être évalués au cas par cas, qui demandent des régimes complexes ? Le législateur ne traite-t-il pas finalement la parole de l’enfant avec minutie ? En s’adaptant à chaque situation ? Il reste tout de même difficile d’allier autonomie et représentation. Il serait possible d’envisager des seuils d’âge, comme en droit pénal et de faire passer progressivement le mineur d’un régime de représentation à un régime d’assistance avant d’entrer dans l’autonomie. En comparaison avec les majeurs protégés qui voient leur protection graduée vis-à-vis de leurs capacités, il serait possible d’imaginer qu’à partir d’un certain âge, le mineur lambda ait acquis suffisamment de discernement pour passer de la représentation à l’assistance notamment concernant les actes éminemment personnels comme ceux relatifs à sa santé.
Dans un régime de représentation, la personne représentée est titulaire de ses droits mais ceux-ci sont exercés par son représentant qui fait écran. Dans un régime d’assistance, l’assisté est titulaire de ses droits, il peut en exercer certains seuls, d’autres lui sont interdits et enfin il réalise une grande part d’entre eux avec les conseils de son assistant et sa co-signature. Cela formaliserait un régime déjà suggéré par le fait d’associer le mineur aux décisions le concernant au regard de son degré de maturité.
Il existe une différence notable entre suggérer aux parents d’associer leur enfant aux décisions le concernant et exiger que les documents soient co-signés par les deux parties. En l’occurrence, dans notre cas, l’assistance aurait pu permettre à César d’exprimer son opposition et personne hormis le juge n’aurait pu permettre son entrée au SESSAD sans son consentement matérialisé par l’apposition de sa signature sur le document individuel de prise en charge. Par ailleurs, il s’agirait d’un message fort envoyé aux titulaires de l’autorité parentale : votre enfant est un adulte en devenir, son avis compte et à partir d’un certain âge vous serez contraints de le prendre en compte. Alors qu’adviendrait-il des enfants qui auraient franchi le seuil d’âge sans pour autant savoir quel est leur intérêt et qui pourraient être amenés à se porter préjudice ?
Comme pour les majeurs protégés, les situations de désaccord entre le curateur et le majeur sont tranchées par le juge des tutelles. Le parent titulaire de l’autorité parentale pourrait toujours refuser de signer, de donner son consentement pour le mineur.
Nous avons traité les aspects théoriques de la prise en compte de la parole de l’enfant dans le cadre du soin, il est maintenant temps de s’intéresser au traitement clinique de celle-ci et à notre situation.
Le traitement clinique de la parole du mineur
« L’enfant dépend des adultes qui l’entourent, qui sont ses portes parole mais qui parfois substituent leurs propres demandes aux siennes ou les étouffent. »7 Dans la situation de César, il parait pertinent sur le plan clinique de faire émerger la parole de l’enfant, sa demande, et de permettre aux parents de ce dernier de l’entendre et de la prendre en considération.
Dans un premier temps, il sera question de déterminer comment procéder, en théorie, pour permettre la rencontre entre la parole de l’enfant et les titulaires de l’autorité parentale (A) puis nous nous pencherons sur le cas spécifique des familles dites « pathologiques » (B).
La rencontre entre la parole de l’enfant et les titulaires de l’autorité parentale
Dans la situation de César, il convient de s’interroger sur notre rôle et nos missions afin de pouvoir nous appuyer sur celles-ci et ne pas s’aventurer sur le domaine d’un autre. En tant que professionnels de soins, notre action thérapeutique pour aider César dans le contexte précédemment défini va consister à faire émerger la parole de l’enfant et provoquer la rencontre avec les titulaires de l’autorité parentale. Il sera donc question de traiter l’émergence de la parole de l’enfant et l’alliance thérapeutique (1), la fonction phorique (2) et les limites de ce positionnement (3).
Emergence de la parole de l’enfant et alliance thérapeutique
En consultation avec un pédopsychiatre (ou tout autre professionnel de santé), l’enfant vient avec ses portes paroles/portes demandes parce qu’il présente des symptômes qui inquiètent/gênent ces derniers. Le praticien se pose alors la question de « qui souffre ? », « qui parle ? » « qui demande quoi ? » « qui doit-on écouter, soigner, soulager ? ».
Peut-être un peu tout le monde si l’on tient compte de l’approche systémique. Déjà, on peut noter l’absence récurrente du père de César qui est pourtant lui aussi censé être le porte-parole de son fils.
En tout cas, J-L Le Run souligne l’importance de pouvoir rencontrer l’enfant seul dès la première consultation si celui-ci l’accepte. La position du thérapeute serait alors de « ne rien attendre pour obtenir quelque chose et de ne pas chercher à extirper une parole tout en offrant les conditions de son surgissement. »8 Le rôle des professionnels de l’enfance est notamment de permettre à la parole de surgir, de créer les conditions pour cela. Ils accompagnent l’enfant dans sa communication, servent de traducteurs, l’éduquent à la parole pour qu’il puisse s’en saisir. Ils permettent à l’enfant de passer du trouble à la mise en mots.
Néanmoins, on observe que dans un groupe, chacun occupe une place et que si l’un des membres du groupe modifie son comportement ou ses attentes vis-à-vis du groupe cela impacte les autres membres de ce groupe. Ainsi, il n’est pas rare de constater qu’il est contre-productif d’accompagner un enfant si son environnement reste le même. Prenons le cas des enfants maltraités par exemple, il est possible d’accompagner l’enfant dans un travail de réassurance, d’estime de soi, de travailler sur sa sécurité interne mais tout cela sera systématiquement mis en échec par son environnement non protecteur qui mettra à mal le travail effectué voire le psychisme de l’enfant. Effectivement, il peut être confus pour un enfant violent de travailler sur l’expression verbale en cas de conflit si celui-ci est systématiquement confronté à la violence insensée de ses parents.
De la même manière, il est possible que l’enfant se sente mal ou en conflit de loyauté si son environnement n’évolue pas avec lui. Ainsi par exemple, il est possible d’observer que travailler sur l’hygiène corporelle, physique et alimentaire en internat avec un jeune qui ne peut reproduire la même chose au domicile le mettra en porte à faux, créera un sentiment de malaise vis-à-vis de sa famille qui pourra d’ailleurs lui renvoyer sa différence. Il est donc primordial de prendre en compte l’environnement de l’enfant et d’aider celui-ci à se mouvoir en même temps que le travail thérapeutique auprès de l’enfant opère. Cela repose notamment sur l’alliance thérapeutique.
|
Table des matières
Introduction
I/ Considérations concernant la parole de l’enfant
1. Enfant et Parole, définitions
2. Construction de la parole de l’enfant, prisme du soin
3. La fiabilité de la parole de l’enfant
4. Les limites de la parole de l’enfant
II/ Le cadre légal de la parole de l’enfant
1. La minorité : la question de l’âge.
2 .Le mineur frappé d’incapacité
3. Vers une autonomie progressive du mineur
4. Le mineur toujours représenté par les titulaires de l’autorité parentale
5. De la représentation à l’assistance ?
III/ Le traitement clinique de la parole du mineur
A. La rencontre entre la parole de l’enfant et les titulaires de l’autorité parentale
1. Emergence de la parole de l’enfant et alliance thérapeutique
2. La fonction phorique
3. Les limites de ce positionnement
B. Approche clinique des familles pathologiques
1. Analyse de la pathologie familiale
2. La place de l’enfant dans la dynamique familiale
3. Propositions thérapeutiques dans le cadre d’une pathologie du lien
IV/ La réponse pratique à apporter en l’absence de réponse thérapeutique
1. Les moyens pour un enfant de faire valoir ses droits lorsque les titulaires de l’autorité parentale agissent contre son intérêt
2. La dénonciation de la famille
Conclusion
Télécharger le rapport complet