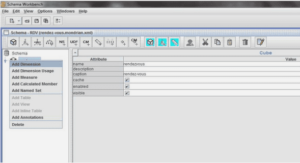Pendant les deux dernières décennies, l‟utilisation des convertisseurs statiques dans les dispositifs d‟électronique de puissance est devenue très courante, ils constituent un moyen de conversion d‟énergie très performant. Néanmoins, ils engendrent des perturbations électromagnétiques importantes aussi bien en mode conduit qu‟en mode rayonné principalement de par les variations de tension et de courant (dV/dt et dI/dt) pendant les commutations des interrupteurs à semi-conducteur. Plusieurs laboratoires se sont intéressés à la mesure des perturbations électromagnétiques dans le but de les quantifier et de déterminer avec précision leurs origines, notamment par la mesure du champ électromagnétique proche. Celle-ci permet de localiser les principales sources rayonnantes, d‟identifier les chemins les plus favorables à la circulation des perturbations ainsi que le couplage entre les composants.
Description et réalisation du banc expérimental
Contexte général
Tout appareil électronique ou électrique engendre naturellement des signaux parasites ou perturbations. Les mesures de ces perturbations sont réalisées soit pour vérifier la conformité aux normes de l‟équipement, soit pour analyser le comportement d‟un appareil ou d‟une installation sur un site et en assurer la compatibilité électromagnétique. Pour caractériser complètement le niveau d‟émission d‟un dispositif électrique ou électronique, il faut mesurer les perturbations émises par rayonnement et celles émises par conduction. Si les laboratoires industriels sont essentiellement concernés par les mesures de type normatif, les laboratoires universitaires quant à eux s‟intéressent à la mesure des perturbations avec pour objectif le développement de nouvelles méthodes d‟essais moins coûteux, plus rapides et réalisables lors de la phase de conception d‟un dispositif. [BAUDRY 05], [BEREAU-06], [HAELVOET-96], [HERNANDO-07], [DE DARAN-03], [LORANGE-01]. De par leur nature, les perturbations produites par un dispositif électrique ou électronique sont de deux types :
– Perturbations conduites, caractérisées par les tensions perturbatrices induites aux différents accès ou par les courants conduits sur les câbles d‟entrée/sortie.
– Perturbations rayonnées, caractérisées par le champ électromagnétique produit à une distance définie de l‟appareil, dans des conditions de reproductibilité satisfaisante.
Dans notre étude, nous nous intéressons uniquement aux perturbations rayonnées par des systèmes d‟électronique de puissance. Pour évaluer le champ électromagnétique émis par un dispositif, nous distinguons deux types de test :
o En champ lointain : Les tests se font en chambre anéchoïque ou en site libre à 10 mètres du dispositif en général, avec un système d‟antenne calibrée et un analyseur de spectre large bande ou un récepteur de mesure possédant les modes de détection normalisés. L‟espace doit être suffisant autour de l‟appareil sous test pour pouvoir positionner les antennes conformément aux indications des normes d‟essai. Les fréquences couvertes vont de 30 MHz jusqu‟à 1 GHz. Cet essai est une référence dans le domaine normatif, et il nous permet de comparer la mesure obtenue directement avec les normes CEM.
o En champ proche : c‟est une technique de mesure qui s‟est beaucoup développée pendant ces dernières années, elle permet d‟établir des cartographies représentant le champ magnétique sur la surface du dispositif testé. Ces cartographies nous permettent d‟identifier les composants perturbateurs, les chemins privilégiés du courant ainsi que les couplages entre les composants, ce qui incite fortement à utiliser cette technique de diagnostic au cours de toutes les étapes de conception d‟un produit.
Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux essais en champ proche. Notre objectif principal est de définir des modèles équivalents des sources perturbatrices qui peuvent nous aider à prédire le rayonnement en champ proche, et par la suite d‟intégrer ces résultats durant la phase de conception d‟un système électronique pour optimiser son rayonnement électromagnétique.
Présentation du banc de mesure initial
Le banc de mesure
Il s‟agit d‟un banc de mesure en champ proche réalisé en plexiglas équipé d‟une table de dimension (40 cm×40 cm) recouverte d‟un plan de cuivre d‟une épaisseur de 2 millimètres. Le déplacement selon l‟axe x est assuré par une transmission par vis sans fin, le déplacement selon l‟axe x est quant à lui possible grâce à un entraînement par courroie. L‟axe Z est manuel, ce qui permet d‟ajuster rapidement la hauteur d‟acquisition en fonction de l‟encombrement des composants du dispositif sous test et du niveau d‟émission recherché maximum de l‟équipement sous test. Ces déplacements sont réalisés par deux moteurs pas-àpas, pilotés par une carte de commande PCI 7342, de la société National Instruments. Pour éviter une éventuelle attribution au bruit ambiant qui entoure le banc, la carte de commande a été installée dans une boite métallique. Le banc de mesure permet d‟obtenir une cartographie 2D du champ magnétique dans le plan (Oxy) parallèle au plan de cuivre après avoir fixé la hauteur de la sonde de mesure manuellement.
Les sondes utilisées sont des sondes blindées de type boucle circulaire de champ magnétique, elles font partie d‟un kit de sondes champ proche de la société « The Electro Mechanics Compagny ».
Protocole de la mesure
Pour une question de répétabilité d‟essai, nous avons suivi le protocole de mesure suivant : nous positionnons l‟équipement sous test sur la table du banc et nous l‟alimentons sous les conditions de fonctionnement normal. Nous commençons par faire une analyse spectrale sur une bande de fréquence : 9 kHz-150 kHz, 150 kHz- 30 MHz ou 30 MHz-300 MHz (conformément aux bandes de fréquences normatives) en fixant la sonde de mesure en un point au dessus de l‟équipement sous test. Nous relevons alors les fréquences de mesure, qui correspondent aux fréquences où l‟amplitude du champ est la plus élevée.
Finalement, la superposition de la cartographie 2D avec une photographie de l‟équipement sous test permet de localiser avec précision les composants perturbateurs ainsi que leur niveau de rayonnement magnétique. C‟est principalement cette méthode qui a été utilisée et qui nous a permis d‟identifier les sources rayonnantes dans le convertisseur statique et le variateur de vitesse .
Le logiciel LabView
LabView
LabVIEW est dédié à la programmation conçue pour le pilotage d’instruments électroniques. Son principe de programmation est basé sur l’assemblage graphique de modules logiciels appelés « Instruments Virtuels » (« VI »). Le rôle d’un VI est d’acquérir des données issues par exemple de fichiers, du clavier ou encore de cartes électroniques d’Entrée/Sorties, de les analyser, et de les présenter au travers d’interfaces hommes machines graphiques (encore appelées « face avant » par analogie avec la face avant permettant de piloter un appareil électronique). Dans LabVIEW, ce qu’on appelle la « face avant » est donc l’interface utilisateur permettant d’exploiter, de piloter, le programme.
Le principe des programmes
Nous avons élaboré trois programmes séparément :
o Pilotage manuel : c‟est un programme qui nous permet de positionner la sonde au point de départ de la mesure, la sonde se déplace avec la souris suivant les directions désirées.
o Acquisition des données : c‟est un programme qui permet de balayer une surface à une hauteur fixe, il permet aussi la sauvegarde instantanée des données issues du balayage du système en essai.
o Gestion des données : à la fin de l‟acquisition, le tableau de mesure contenant les valeurs du champ magnétique est représenté sous forme d‟une cartographie 2D qui met en évidence le module de chaque composante du champ magnétique.
La superposition de la cartographie de la composante verticale Hz avec une vue de l‟équipement sous test (EST) permet une identification rapide et facile des composants perturbateurs ainsi qu‟une première idée sur l‟interaction entre les composants perturbateurs. Complétée par la superposition des composantes longitudinales Hx, Hy et de l‟équipement sous test, elle permet d‟établir le modèle équivalent à la source.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : DESCRIPTION ET REALISATION DU BANC EXPERIMENTAL
I. INTRODUCTION
I.1. CONTEXTE GENERAL
I.2. CHAMP PROCHE
II. PRESENTATION DU INITIAL BANC DE MESURE
II.1. LE BANC DE MESURE
II.2. PROTOCOLE DE LA MESURE
II.3. LE LOGICIEL LABVIEW
II.3.1. LabView
II.3.2. Le principe des programmes
II.4. LES LIMITES DU INITIAL BANC DE MESURE
III. LA REALISATION DU NOUVEAU BANC DE MESURE
III.1. CAHIER DES CHARGES DE LA PARTIE MECANIQUE
III.2. REALISATION MECANIQUE
III.3. AUTOMATISATION
III.3.1. Principe de fonctionnement des codeurs
III.3.2. Acquisition
III.3.3. Performances mécaniques
III.3.4. L’environnement électromagnétique expérimental
II.4. SONDES DE MESURE
III.5. TRAITEMENT DES DONNEES
III.5.1. Principe
III.5.2. Position du problème
III.5.3. Détermination de la fonction de transfert de la sonde
III.5.4. Le filtrage de Wiener
III.5.5. Résultats et conclusions
III.5.6. Utilisation du post traitement dans le cas du convertisseur
IV. BILAN ET CONCLUSION
CHAPITRE II : APPLICATION ACADEMIQUE
I. EVALUATION DES SOURCES EN CHAMP PROCHE DANS UN DISPOSITIF SIMPLE
I.1. INTRODUCTION
I.2.OBJECTIF DU CHAPITRE
I.3. METHODOLOGIE DE L‟ETUDE
I.4. PRESENTATION DE LA MAQUETTE DU HACHEUR SOUS TEST
I.5. MESURES EN CHAMP PROCHE
I.5.1. Identification des fréquences de rayonnement et de leurs origines électriques
I.5.2. Etude du rayonnement à la fréquence de découpage
I.5.3. Mesure en haute fréquence
I.6. MODELISATION PAR UNE SOURCE EQUIVALENTE
I.6.1. Introduction
I.6.2. Modélisation en fréquence
I.6.2.1. Modèle en basse fréquence
I.6.2.2. Modèle en haute fréquence
I.7. AUTRES MODELES EXISTANTS
I.7.1 Méthode basée sur les algorithmes génétiques
I.7.2. Méthode PEEC
I.8. CONCLUSION
CHAPITRE III : APPLICATION INDUSTRIELLE
I. INTRODUCTION
II. DESCRIPTION DU VARIATEUR DE VITESSE
III. METHODOLOGIE D’ESSAI
IV. ANALYSE DES DIFFERENTES SOURCES PERTURBATRICES
IV.1. ETUDE DES PERTURBATIONS GENEREES PAR L‟ALIMENTATION A DECOUPAGE
IV.1.1. Description du dispositif
IV.1.2. Analyse en champ proche
IV.1.3. Analyse des grandeurs électriques dans la maille de commutation
IV.1.4. Modélisation du transformateur
IV.1.5. Modélisation complète du Flyback
IV.1.6. Conclusion et limites du modèle
IV.2. ETUDE DU MODULE DE PUISSANCE
IV.2.1. Présentation du module de puissance
IV.2.2. Mesure en champ proche
IV.2.3. Mesure et analyse du courant à l’entrée et à la sortie de l’onduleur
IV.2.4. Modélisation de l’onduleur en mode différentiel
IV.2.5. Conclusion
IV. CONCLUSION
CONCLUSION GENERALE