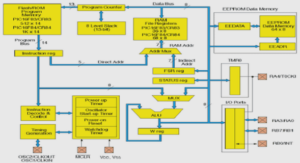Historique
C’est Matthew Lipman, professeur de philosophie et de logique à l’Université de Columbia qui à la fin des années 60, met pour la première fois en place un programme visant à faire « bien penser » les enfants. Il se rend compte lors des cours qu’il dispense à l’Université, que les étudiants, qui sont pourtant d’âge assez mûr, ont des difficultés de raisonnement liées au fait que le cerveau soit déjà solidement programmé. Il se dit alors que la logique et la réflexion sur le monde qui nous entoure devraient être enseignées plus tôt dans la scolarité des enfants afin de former des citoyens autonomes et éclairés. Enseigner ces facultés dès le plus jeune âge se légitime de plus car cette réflexion s’acquiert dans un long processus d’apprentissage. Matthew Lipman publie alors plusieurs romans philosophiques destinés à présenter aux enfants des situations logiques. Pour cela, il s’inspire des théories de Bruner1 et Dewey2 en pensant que tout objet d’enseignement est accessible à l’enfant grâce à une contextualisation appropriée des savoirs, c’est-à-dire que l’expérience modélise les savoirs. Ainsi, des inducteurs adaptés à l’âge des enfants sont vecteurs de pensée, même chez les plus jeunes. Pour ce faire, Matthew Lipman édite des guides d’accompagnement déclinés selon les tranches d’âge des enfants ou des adolescents. Ces guides proposent aux enfants, des textes romancés qui présentent les grands thèmes de la philosophie traditionnelle (tels la sagesse, la morale, la liberté, etc.) accompagnés des idées directrices que soulèvent les différents textes ainsi que d’exercices spécifiques à la réflexion. Ces guides permettent alors aux enseignants de mener cette pratique de discussion à visée philosophique en classe. Lipman déroule les séances de philosophie en classe en trois étapes : la lecture collective du texte, un recueil de questions de la part des enfants qui portent sur ce même texte et enfin une discussion qui découle du questionnement recueilli précédemment. La discussion se décline ensuite en quatre étapes : 1) la production d’une hypothèse pour répondre à la question du débat (préalablement choisie à la suite du recueil de questionnement), 2) la production collective d’une argumentation pour soutenir cette hypothèse, 3) la recherche collective d’objections aux arguments produits et de contreexemples, 4) la synthèse de ces éléments (arguments et contre-arguments) afin de corriger, nuancer, abandonner ou soutenir l’hypothèse initiale. Ce sont ces habiletés de pensée (argumenter, définir, donner un exemple, donner un contre-exemple, contextualiser, comparer, distinguer, etc.) qui sont travaillées lors de ces discussion et qui permettront ensuite aux enfants de cultiver leur réflexion et leur raisonnement face au monde qui les entoure. Toutefois, même si les enfants entrent facilement dans ce dispositif, les enseignants ont eux, sûrement par manque de formation et de connaissances logiques et philosophiques, plus de difficultés à pratiquer cette méthode en classe. Par ailleurs, le contenu de ces guides est aujourd’hui assez critiqué. Effectivement, la qualité des textes soi-disant littéraires qui sont censés activer l’expérience du réel chez les enfants est jugée assez mauvaise (récits trop linéaires, peu ludiques et peu stimulants). En France, c’est Michel Tozzi1 dans les années 70 qui s’empare principalement de la pédagogie visant à enseigner la philosophie aux enfants. Pour cela, il s’inspire des travaux de Lipman, tout en élaborant une didactique du débat à mener en classe. Il met en œuvre diverses activités liées à la pratique de la philosophie : cafés philosophiques, ateliers de lecture philosophique, ateliers d’écriture philosophique et des universités populaires. Au fur et à mesure des années, il travaille en collaboration avec Alain Delsol2 puis avec Sylvain Connac 3 . Leur dispositif s’articule en une double visée : une visée démocratique (par le respect des règles de la discussion, le respect d’autrui et l’attribution de rôles aux élèves durant la discussion) et une visée philosophique. Pour cette dernière, l’enseignant doit de par son animation veiller à trois exigences intellectuelles : au questionnement des élèves et du groupe, à une conceptualisation qui cherche à définir une notion ou un thème et à une argumentation qui valide de façon rationnelle le point de vue de chacun. Tout comme pour Lipman, ce courant a pour objectif d’apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, à élaborer une pensée rationnelle et à la confronter au sein d’un groupe. Toutefois, contrairement à Matthew Lipman, Michel Tozzi ne propose pas nécessairement de texte littéraire pour induire et faciliter la discussion. Bien que cela soit possible, dans sa méthode, les élèves peuvent aussi choisir un thème ou une question à aborder. Le dispositif de cette méthode nécessite selon lui un cadre fixe pour permettre au mieux la dimension démocratique de la discussion. Le respect du tour de parole et du silence lorsque qu’un élève émet une idée est notamment indispensable au bon fonctionnement de celle-ci. De plus, les élèves sont disposés en cercle, car l’engagement corporel est nécessaire dans cet exercice. On trouve dans ce cercle les différents coanimateurs que sont l’enseignant, le président de séance, le reformulateur et le synthétiseur ainsi que les autres parleurs. En retrait, hors du cercle, se trouvent les observateurs. Le temps de la discussion est précis et connu à l’avance par les élèves (et est établie selon l’âge des élèves). Ce cadrage, ces fonctions et ces repères sont essentiels selon Michel Tozzi pour sécuriser et libérer la parole des élèves. Enfin, le microphone est selon lui un outil qui permet la facilité d’attention, d’écoute et de compréhension. Chez Lipman, l’enseignant, a pour rôle d’induire des idées directrices pour faciliter la réflexion des enfants, mais qu’en est-il du dispositif de Michel Tozzi ? Dans le laboratoire de pensée de Tozzi, Connac et Delsol, la discussion repose sur une coanimation professeur-élèves. Tout d’abord grâce aux différentes fonctions attribuées (ce qui enrôle et responsabilise les élèves) mais aussi parce que l’enseignant a un rôle essentiel : en plus de veiller au bon déroulement de la séance, il relance la discussion, place le groupe en recherche, reformule en cas de besoin et synthétise certaines idées. De plus, il encourage et valorise les propos des élèves qu’il considère comme des « interlocuteurs valables1 ». Toutefois, pour ne pas influencer les élèves et libérer au mieux leur parole, jamais il ne donne son point de vue. En comparaison au courant de Lipman donc, nous pouvons constater que le dispositif français se veut plus démocratique et engage davantage les élèves. Au-delà de leur implication dans la discussion à visée philosophie, les enfants ont en effet une fonction définie, ce qui les place dans une réelle posture de libre-penseur valable et légitime.
Le courant de littérature avec les enfants
La littérature de jeunesse donne lieu à des débats interprétatifs, et tout comme pour la méthode Freinet ou pour Delsol, Connac et Tozzi, ces débats reposent sur une « triade problématisation – conceptualisation – argumentation ». En effet, « la littérature de jeunesse donne lieu à un débat herméneutique ». Pour représenter cette thèse, Jean-François Goubet fait référence à Edwige Chirouter, professeure de philosophie, maître de conférence en sciences de l’éducation au sein de l’université de Nantes ; et auteure d’Aborder la philosophie en classe à partir d’albums de jeunesse, Hachette éducation, 2011. Pour pratiquer le débat interprétatif en classe, Edwige Chirouter prescrit une pratique régulière. Selon elle, constituer un réseau littéraire permet d’apporter une culture commune à toute la classe et permet un réel support de débat. En effet, nombreux sont les thèmes abordés dans les albums jeunesse (l’amitié, l’amour, la mort, l’art, etc.). Selon elle, les séances de débat doivent être bien préparées, tout d’abord, l’auteure constitue une bibliographie ciblée qui s’articule en plusieurs thèmes :
⁃ l’amitié/l’amour/la différence/l’égalité entre les êtres
⁃ grandir/vieillir/mourir
⁃ l’art/le beau
⁃ l’ignorance, la connaissance
⁃ le travail/l’argent.
Ces cinq progressions correspondent à cinq séquences qui chacune se déroule sur un mois. Chaque séquence comporte quatre séances qui durent trente minutes à une heure quinze (selon le cycle des élèves) et permet de détailler un thème plus précis. Pour chacune d’elles, l’auteure propose un ouvrage qui sera lu en amont par toute la classe afin d’étayer le débat philosophique, d’élargir les points de vue et de montrer la problématique sous ses différent aspects ainsi que de mettre le problème à bonne distance afin de prendre assez de recul pour commencer à réfléchir. Elle complète cette bibliographie avec d’autres livres qui peuvent être mis à disposition dans la classe et que les élèves peuvent consulter librement. Après ces lectures, le débat peut être engagé. Pour cela, l’ouvrage d’E. Chirouter donne quelques notions et quelques pistes de réflexion permettant de recentrer le débat. L’enseignant a pour rôle de guider les élèves, de soulever quelques questions qui pourraient être plus détaillées et donner des pistes de réflexion. Afin de garder une trace de ces échanges, l’auteure conseille de créer une affiche qui relève les points principaux de la discussion. Elle propose également, pendant la dernière séance, d’exposer des dessins dans la classe qui traitent du thème abordé, ce qui permettrait de rendre compte du travail fait par les élèves. Mais pourquoi et comment, précisément, la littérature de jeunesse est-elle au service de la philosophie ? Selon Edwige Chirouter, « Le texte littéraire est un support privilégié pour apprendre à philosopher. En effet, l’enfant, dans les balbutiements de sa pensée réflexive, ne sait, ne peut sortir de sa subjectivité. De plus, son expérience du monde est forcément limitée. C’est pourquoi il faut lui donner des outils pour affiner son raisonnement et l’émanciper de son seul point de vue. La littérature permet indéniablement cette décentration. Car la fiction littéraire, loin de trahir et de déformer la réalité, la révèle dans ce qu’elle a de plus profond. »1 En outre, le texte permet une bonne distanciation vis-à-vis des thèmes travaillés. Il permet de passer de l’affect individuel à un concept universel. Plus précisément, « La littérature pense comme la philosophie, mais sous la forme plus spécifique du récit. L’écrivain fait volontairement le choix de la métaphore pour penser et dire. »2. Ainsi, « La fiction littéraire (« métaphore vive »3 ), parce qu’elle représente la possibilité démultipliée d’expériences exemplaires et signifiantes sur la ou les vérité(s) du monde, nous permet de penser la condition humaine dans toute sa complexité. ». La littérature fonctionne donc par analogie avec la réalité, et c’est grâce à sa dimension fictionnelle qu’elle nous donne le moyen de comprendre le réel. La fiction littéraire n’est donc pas seulement de l’ordre de l’imaginaire, mais elle dispose aussi d’une fonction référentielle qui dévoile des dimensions insoupçonnées de la réalité. ». Le réseau littéraire permet ainsi la problématisation de la discussion, sa compréhension sert à conceptualiser les idées qu’il dégage et sa fonction référentielle permet une large réflexion lors du débat. Pour aller plus loin, la littérature se présente comme une expérience de la pensée philosophique. La littérature de jeunesse peut alors être considérée comme littérature à part entière, puisqu’au-delà de sa fonction « plaisir », elle sert aussi de levier pour penser et philosopher. Pour E. Chirouter, « Le texte littéraire dit « de jeunesse », comme celui de la littérature en général, peut être défini comme un texte, qui, contrairement à l’écrit purement fonctionnel, comprend différents degrés de lecture. C’est un texte qui peut et doit bousculer le sujet et susciter des discussions sur ses significations. ». Bruno Bettelheim affirme que « Aujourd’hui, comme jadis, la tâche la plus importante et aussi la plus difficile de l’éducation est d’aider l’enfant à donner un sens à sa vie. (…) Pour qu’une histoire accroche vraiment l’attention de l’enfant, il faut qu’elle le divertisse et qu’elle éveille sa curiosité. Mais pour enrichir sa vie, il faut en outre qu’elle stimule son imagination ; qu’elle l’aide à développer son intelligence et à voir clair dans ses émotions ; qu’elle soit accordée à ses angoisses et à ses aspirations ; qu’elle lui fasse prendre conscience de ses difficultés, tout en lui suggérant des solutions aux problèmes qui le troublent. », la littérature a donc un rôle dans le développement affectif et intellectuel de l’enfant et comporte une dimension initiatique non négligeable. De plus, comme le rappelle l’auteur, la littérature de jeunesse a sa place dans les programmes depuis 2002. Les débats interprétatifs sont donc essentiels afin de vérifier et garantir la compréhension des œuvres étudiées. Néanmoins, Jean-François Goubet pondère cette pratique philosophique exclusivement à partir de la littérature. En effet, malgré son grand intérêt, la littérature « ne joue aucun rôle dans une déduction des sciences de la nature. L’expérience de pensée en physique ne fonctionne pas dans le royaume du bien et du mal humain mais dans celui des états de fait explicables objectivement ». Il faudrait alors sans doute combiner un débat s’appuyant sur des fictions littéraires tout en intégrant des textes scientifiques. Le réseau ne serait alors plus seulement littéraire, mais n’en serait pas moins riche. Par ailleurs, l’auteur ajoute que pour qu’un texte littéraire puisse être un tremplin à l’exercice de la philosophie, il faut qu’il soit de temps à autre « fantasque », afin d’avoir une alternative à la réalité humaine. De surcroît, certains genres littéraires se prêtent davantage à la réflexion philosophique, et pour Jean-François Goubet, c’est précisément le mythe qui peut permettre une réelle réflexion sur la condition humaine par sa dimension allégorique.
L’acquisition
D’après Agnès Florin, dans son ouvrage intitulé Le développement du langage, le langage porte une motivation innée pour l’enfant car il se rend compte inconsciemment mais très tôt, que cela lui offre un fantastique outil d’apprentissage et de communication. Selon elle, « l’apprentissage de la langue maternelle, pourtant très complexe, prend seulement deux ou trois ans pour que l’enfant arrive à se faire comprendre verbalement, plus deux ou trois ans encore pour posséder les bases de la langue, à la fois du point de vue du lexique (le vocabulaire), de la syntaxe (les règles d’organisation des énoncés), et des principales fonctions du discours (ce que le langage peut exprimer). » L’acquisition de la base de la langue est donc un processus assez rapide et naturel. En effet, l’enfant met environ deux ou trois ans pour se faire comprendre et encore deux ou trois ans pour acquérir les bases (lexique, syntaxe et fonctions du discours) de sa langue maternelle, aussi complexe soit-elle. On l’observe d’ailleurs dans les classes d’école maternelle, les élèves à cet âge, savent se faire comprendre par un adulte, par un pair ou par un groupe. Dans son ouvrage, Agnès Florin explore les principales théories du développement du langage et de son acquisition, idées qui ont beaucoup évolué au cours du XXème siècle. On retrouve tout d’abord le behaviorisme qui envisage la progression du langage grâce à l’action et à l’entourage de l’enfant. L’approche interactionniste se base sur les études de Lev Vygotski1 , c’est-à-dire que l’interaction est un moteur au développement du langage et que l’efficacité de ce processus est du à la zone proximale de développement qui est apporté par un tiers. L’approche pragmatique est elle fondée sur la fonction de communication du langage : « tout acte de langage nécessite une sélection des mots et de leur organisation ; il aura des conséquences, prévisibles ou non, telles que convaincre, rassurer, informer, etc. ». Mais depuis les années 80, certains chercheurs défendent l’idée d’un langage autonome, d’un module indépendant du reste de la vie mentale, ce sont les théories modularistes. Selon eux, beaucoup d’activités seraient automatisées chez l’expert alors qu’elles seraient contrôlées chez le novice. Pour d’autres encore, les connexionnistes, « le traitement du langage n’est qu’un aspect du fonctionnement mental général. Il correspond à un processeur spécialisé parmi d’autres qui constituent un réseau de connexions nombreuses fonctionnant en parallèle. »3 . Ce courant semble aller dans le sens des recherches actuelles en neurosciences qui révèlent le langage comme étant une connexion neuronale entre différentes zones du cerveau. Pour revenir à l’enseignement de la philosophie et en tout cas à l’exercice de la discussion argumentée chez les enfants, il semble que l’adulte ait un rôle phare, celui d’apporter un étayage, ou une zone proximale de développement (si on parle de Vygotski) pour rendre efficace l’apprentissage du langage lors de cette activité. Comme l’envisage Michel Tozzi, l’enseignant doit relancer la discussion et parfois reformuler pour faire avancer le débat. Cet étayage en plus de faire progresser la réflexion des élèves, ne ferait-il pas aussi progresser leur langage ? A quel âge les enfants sont-ils capables de traduire alors une pensée plus complexe ou une réflexion ? Comment les élèves sont-ils capables d’argumenter ?
Les interactions entre pairs
Les adultes, et en premier lieu les parents, sont les partenaires privilégiés des enfants dans leurs apprentissages langagiers. Mais ils ne sont pas les seuls, et les enfants peuvent apprendre aussi beaucoup sans eux, grâce aux interactions avec leurs pairs. Bien-sûr, pour pouvoir communiquer, il faut disposer de certains moyens. Dès l’âge de trois ans, avec le développement des verbalisations, peuvent apparaître de véritables conversations entre enfants qui se connaissent bien. Vers l’âge de trois ou quatre ans, les enfants commencent à tenir compte des caractéristiques de leur interlocuteur : comme les adultes, ils ralentissent leur débit de parole, élèvent le ton et exagèrent l’intonation lorsqu’ils s’adressent à un bébé. Plusieurs études ont montré qu’ils modifient également la nature et la complexité de leur discours selon qu’ils s’adressent à un enfant plus jeune, à celui qui voit le jeu dont on parle ou à celui qui ne le voit pas. Les interactions entre pairs ayant des compétences et des styles communicatifs différents peuvent inciter les enfants à expérimenter des stratégies variées pour se faire comprendre et obtenir des autres qu’ils se fassent comprendre. L’intérêt de ces échanges pour la construction de nouvelles habiletés cognitives individuelles a été démontré depuis longtemps dans des activités de résolution de problèmes, dans l’acquisition de connaissances dans le cadre scolaire (confronter des points de vue différents pour arriver à expliquer un phénomène physique comme la pluie par exemple), et aussi dans le développement des compétences de communication. Le débat semble possible et légitime en classe de grande section de maternelle. Même si tous les enfants ne sont pas encore en capacité de mener de front tous les aspects argumentatifs, ceux-là sont en construction ; il paraît alors justifié de construire ces compétences avec l’exercice du débat lui-même. C’est-à-dire que l’enfant peut apprendre l’argumentation par l’entrainement. Une question demeure : à quel point la discussion à visée philosophique peut-elle développer les compétences langagières chez les jeunes enfants ?
Le protocole
Afin d’observer le mieux possible l’évolution des compétences orales des élèves grâce aux discussions à visée philosophique, j’ai décidé de mener une séance avec ce groupe de grandes sections de maternelle par semaine. Cette fréquence engage ainsi une véritable ritualisation de cet exercice et par conséquent des résultats plus fiables et plus significatifs. Avec l’accord des familles d’élèves, j’ai pu enregistré vocalement (avec la fonction enregistreur d’un smartphone) chaque discussion en classe afin de les retranscrire à l’écrit par la suite. Ces retranscriptions permettent ainsi une réelle observation du déroulement et du contenu de ces discussions. Pour analyser au mieux la progression du langage oral des élèves je m’intéresserai dans un premier temps à l’évolution de l’ensemble du groupe d’élève. C’est-à-dire, à son taux de participation au fur et à mesure des discussions (en comparaison de celui de l’enseignante qui les guide), mais également aux interactions entre pairs (objections, approbations entre les élèves). Dans un second temps, il s’agira d’observer les conduites argumentatives de certains élèves, ainsi que leur taux de parole au sein de la discussion. Concernant les conduites argumentatives, elles concernent donc la justification et la négociation1. Pour rappel, on inclut dans la justification, les énoncés de causalité, de finalité et exemplification et les arguments qui dépassent l’exemple personnel (en se référant à des valeurs sociales reconnues ou des faits attestés) ; c’est l’argument basique. La négociation en revanche, c’est l’argumentation en tenant compte de son ou ses interlocuteur(s), il s’agit donc de convaincre ou de prendre en compte des contre-arguments. On associera donc les occurrences. Le taux de parole et la complexité des phrases énoncées par les élèves vont ainsi se rattacher à la compétence « oser entrer en communication », ou si l’on préfère à ce que l’on nomme « compétence psychologique » (lié à l’affect et la confiance en soi), alors que les habiletés de pensée vont elles, davantage se rattacher à la compétence « échanger et réfléchir avec les autres » et ainsi se référer à la compétence dite « discursive » (c’est la connaissance des modèles langagiers, savoir quel genre de message produire et quelles règles respecter selon qu’il faut raconter, expliquer, décrire ou argumenter). Une fois l’analyse assez globale de l’évolution des compétences orales du groupe de moyennes sections réalisée, je vais m’intéresser à quelques cas individuels. Comme nous avons pu le voir précédemment, chaque cas est particulier, et c’est tout-à-fait naturel, surtout à cet âge-là. Toutefois, il y a certaines similitudes entre plusieurs élèves. Comme nous avons pu le constater dans le tableau précédent, Eden et Jade par exemple, sont deux profils d’élèves assez similaires, tout comme Kharys, Wassila et Kenji. J’ai donc choisi de sélectionner plusieurs élèves afin de constituer un panel assez important et assez significatif pour avoir des résultats sur l’évolution des compétences orales, plus fiables et plus pertinents. Pour ce faire, j’ai choisi cinq élèves : Olivia (qui malgré de solides bases dans tous les domaines, ose très peu participer à l’oral), Kenji (un élève qui maitrise bien la compréhension mais qui peut être assez peu intéressé par les travaux de groupes), Younes (un élève qui parle très facilement mais n’a pas acquis encore une syntaxe très complexe et un vocabulaire très varié), Amélia (qui est considérée comme une « très bonne » élève, mais qui a des difficultés à coopérer et qui est assez réservée) ainsi que Eden (un élève qui n’a de difficultés dans aucun domaine ou compétence). Il s’agira donc, à travers ce tableau, d’observer l’évolution et la progression des compétences orales de chaque cas étudié afin de valider ou non notre hypothèse de départ : la discussion à visée philosophie développe les compétences langagières orales chez les jeunes enfants. Cependant, un dispositif fixe, cadrant et rassurant doit être mis en œuvre pour faciliter la réflexion des élèves. Quel est-il ?
|
Table des matières
Introduction
I. Cadrage théorique
1. La philosophie chez les jeunes enfants
– Historique
– Pédagogie
– Etat des lieux
2. Le développement du langage
– L’acquisition
– Les conduites argumentatives
– Les interactions entre pairs
II. Cadrage méthodologique
1. Public
2. Protocole
3. Dispositif et pédagogie
III. Analyse des résultats
1. Analyse collective
2. Analyse de cas individuels
Conclusion
Bibliographie, vidéographie et sitographie
ANNEXES
Télécharger le rapport complet