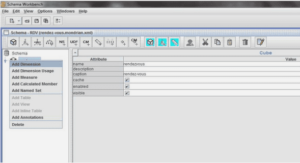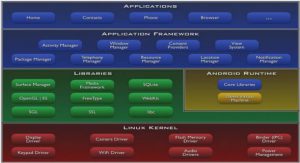Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les sources de la construction du corpus juridique de la gouvernance du développement durable
Les alertes sur les méfaits d’un certain modèle de développement économique et humain
Grâce à une revue de la littérature, nous avons pu retracer la généalogie des publications sur le développement durable qui remonte jusqu’à la fin du 18ème siècle. Elle révèle une large production de différentes communautés : communauté scientifique, organisations politiques, organisations publiques internationales, intergouvernementales, nationales, organisations privées, société civile. Cette large production témoigne de l’intérêt de plus en plus important porté au développement durable. L’essentiel des publications tiennent lieu d’alertes qui portent particulièrement l’accent sur des aspects tels que la capacité de la biosphère à faire face aux développements économique et humain, l’impact des activités humaines, économiques et industrielles sur la nature, l’état de l’environnement et du climat mondial, les crises socio-économiques et écologiques, etc. La généalogie des publications révèle la place pivot accordée aux changements climatiques en raison de leur gravité particulière et des risques d’irréversibilité qu’ils présentent. D’ailleurs, ces deux aspects sont d’autant exacerbés par les phénomènes climatiques dits extrêmes qui marquent l’opinion publique internationale par leur ampleur, leur fréquence d’avènement et leurs coûts humain et financier, comme nous pouvons l’observer dans le tableau 1.
Tableau 1 : Les évènements climatiques / météorologiques majeurs dits extrêmes (liste non exhaustive)
Les changements climatiques soulèvent un certain nombre de débats dont certains portent davantage l’accent sur leur nature, leur portée, leur ampleur et leur coût, les incertitudes liées à leur quantification et leur impact, la fréquence des évènements dits extrêmes, les stratégies d’atténuation et d’adaptation. Les experts, la communauté scientifique et l’opinion publique internationale s’accordent plus ou moins sur un certain nombre de points tels que la fréquence des évènements climatiques dits extrêmes de plus en plus nombreux et dévastateurs sur les plans humains et financiers, la diversité des manifestations des changements climatiques, le rôle de l’homme et de ses activités de plus en plus mis en avant par les recherches scientifiques (Giec, 2014, 2019).
Nous abordons, dans ce qui suit, les publications et les alertes dont font l’objet les problématiques liées au développement durable. Malgré leur nature hétéroclite, nous portons l’accent sur les publications scientifiques et les alertes relatives aux changements climatiques. Pour ce faire, nous avons constitué un corpus de documents composés de travaux scientifiques, de rapports d’experts, de rapports institutionnels internationaux, européens et nationaux français. Ce corpus vient compléter la revue de la littérature afin de nous permettre d’avoir un regard distancié. Cette démarche mixte a permis de retracer la généalogie des publications et des alertes depuis la fin du 18ème siècle. Par ailleurs, elle s’est avérée un véritable outil de veille scientifique qui nous sert de base à l’analyse des autres sources de construction du corpus – juridique de la gouvernance du développement durable.
La généalogie des publications scientifiques et des alertes
Les alertes s’inscrivent dans une longue dynamique critique des modèles de développement économique et humain qui remonte dès la fin du 18ème siècle. Diverses traces ayant d’abord porté sur l’état de l’environnement et plus tard sur le développement durable tel que connu aujourd’hui peuvent être retrouvées dans divers textes issus de diverses disciplines. En deux temps forts, nous présentons, de manière synthétique, dans les tableaux 2 et 3, la généalogie des publications et des alertes :
Un premier temps fort allant de la fin du 18ème siècle jusqu’au milieu des années 1980 où on observe une dualité Homme/environnement qui pose les prémices du développement durable (tableau 2) ;
Un deuxième temps fort allant du rapport du Brundtland à nos jours qui prolonge le débat sur cette dualité tout en portant particulièrement l’accent sur la construction, toujours en cours, du concept de développement durable et sur ses diverses acceptions contemporaines (tableau 3).
Les deux tableaux dressent une généalogie des publications qui met en évidence une combinaison hétérogène d’alertes en faveur du développement durable. Deux principaux axes se profilent : un axe qui porte l’accent sur les modèles (de société) tout en essayant de les conceptualiser ; un autre axe qui porte l’accent sur les changements climatiques et qui propose une veille scientifique sur le réchauffement climatique et ses impacts. Entre les deux axes et à l’intérieur de chacun d’eux, des débats émergent, se nourrissent et nourrissent les tensions entre théorisations et observations pratiques. Un consensus sur l’urgence de la situation relative notamment aux changements climatiques semble, toutefois, être trouvé. Ce consensus justifie la nécessité de faire un focus sur les publications scientifiques portant sur les changements climatiques comme sources d’alertes.
Les publications scientifiques et les alertes portant sur les changements climatiques
La problématisation de l’effet de serre joue un rôle pivot dans les travaux sur le réchauffement climatique. Cette notion est employée pour la première fois par Gustaf Ekholm en 1901. Néanmoins, il faut remonter au 19ème siècle avec les travaux de Jacques Fourrier pour retrouver les prémices de la problématisation de l’effet de serre. Par la description du phénomène naturel de rétention des radiations solaires par l’atmosphère, Fourrier formule les premières hypothèses de l’effet de serre, néanmoins expérimenté et quantifié par Svante Arrhenius qu’à la fin du 19ème siècle. Les travaux de ce dernier aboutissent à l’élaboration du lien entre la quantité de gaz à effet de serre et la hausse de la température. En effet, d’après Arrhénius, « si l’on rejette dans l’atmosphère de grandes quantités de carbone (à cause des activités industrielles fonctionnant par la combustion du charbon), l’air va se charger en CO2 et retenir plus de chaleur ». Et, « un doublement de la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère entraine une hausse moyenne de la température de 4 degrés »12. En raison des croyances sur les capacités d’autorégulation de la nature, ces résultats furent minimisés jusqu’aux années 1940 où Gilbert Plass confirme définitivement le lien entre réchauffement climatique et gaz à effet de serre. Ses travaux fondent les premières définitions (Grinevald, 19903 ; Grinevald et Urdelli, 20004) du réchauffement climatique et sert de base référentielle à la communauté scientifique. Ils s’ensuivent de nombreuses recherches portant, entre autres, sur les émissions de gaz à effet de serre, la concentration de CO2 dans l’atmosphère et sa mesure, la capacité d’absorption de la nature, les conséquences sur la nature et sur l’homme.
La pléthore de publications scientifiques et de rapports d’experts sur le rapport réchauffement climatique et effet de serre (Rapport Sawyer, 1972) constituent un outil de veille scientifique sur les preuves du réchauffement climatique. Les publications et les alertes font l’objet d’un intérêt politique grandissant qui aboutit à la création, en 1988, du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) pour étudier le réchauffement climatique et ses impacts.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et ses alertes sur le réchauffement climatique
Regroupant des centaines de membres (scientifiques, climatologues, géologues, océanographes, biologistes, économistes, sociologues, ingénieurs et spécialistes de divers domaines), le Giec publie périodiquement des rapports depuis 1990. Entre 1990 et 2014, il a produit cinq rapports : 1990, 1995, 2001, 2007, 2014. A travers ces rapports, le Giec analyse le réchauffement climatique, ses causes, son impact sur l’écosystème et la société, fait des prévisions sur l’évolution du climat. Ces conclusions servent de base scientifique aux engagements juridiques internationaux relatifs au développement durable, à l’élaboration de stratégies d’atténuation et d’adaptation au réchauffement climatique par les pouvoirs publics et les entreprises. Le tableau n°4 synthétise les rapports du Giec de 1990 à 2014.
|
Table des matières
INTRODUCTION
Première partie : Le corpus de la gouvernance du développement durable.
Sources de construction, contenus et réceptions
Chapitre 1 : Le corpus juridique de la gouvernance du développement durable. Sources de construction et contenus
I. Les sources de la construction du corpus juridique de la gouvernance du développement durable
1. Les alertes sur les méfaits d’un certain modèle de développement économique et humain
1.1. La généalogie des publications scientifiques et des alertes
1.1.1. Les publications scientifiques et les alertes portant sur les changements climatiques
1.1.1.1.Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et ses alertes sur le réchauffement climatique
1.1.1.2. Les alertes citoyennes
2. Les crises socio-économiques et écologiques
3. L’élargissement des parties prenantes
3.1. Les institutions du système de Nations Unies
3.2. Les parties prenantes institutionnelles internationales concurrentes
3.2.1. Le Groupe des puissants (G7) comme parties prenantes
3.2.2. Le G20 comme parties prenantes
3.3. La catégorisation des Parties prenantes pour une responsabilité commune mais différenciée
3.4. Les rencontres internationales sur le climat et le développement comme parties prenantes
3.4.1. Focus sur les conférences des Parties
4. Des concepts émergents et des courants philosophiques en confrontation
II. Les effets de quatre sources sur le corpus juridique de la gouvernance du développement durable
1. Des engagements juridiques internationaux
2. Une catégorisation des engagements juridiques
3. L’instrumentation juridique des politiques environnementales
3.1. Une gouvernance volontaire et des accords négociés dans les pays industriels développés
3.2. Une gouvernance multilatérale et décentralisée dans les pays en développement
Chapitre 2. La réception du développement durable dans l’Union européenne et en France
I. La réception des engagements juridiques dans l’Union européenne
II. La réception des engagements juridiques en France
1. La stratégie nationale de développement durable de 2003-2008
2. La charte de l’environnement, 2005
3. Les lois Grenelle de l’environnement 1 (2007) et 2 (2010)
4. Les engagements portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
5. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
Deuxième Partie : La politique publique d’exemplarité. Une mise en perspective de la post bureaucratie et du management public
Chapitre 3. La politique publique d’exemplarité des organisations publiques en matière de développement durable
I. La politique publique d’exemplarité. Une dynamique internationale et européenne
1. Des réflexions internationales et un corpus qui portent l’accent sur les achats publics
1.1. Le Groupe de Travail de Marrakech (GTM) sur les Achats Publics Durables (APD)
1.2. Les recommandations de l’ONU-Environnement, de l’OCDE, de l’OIT, de l’OMC sur la constitution d’un cadre décennal de programmation sur la consommation et la production durables
2. La réception des réflexions au sein de l’Union européenne
3. La réception de la politique publique d’exemplarité en France
3.1. Des réflexions qui portent sur les achats publics
3.2. La construction du corpus juridique
3.3. Les achats publics durables
3.3.1. Le Plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)
3.3.2. Les achats publics durables
II. La réception de la politique publique d’exemplarité dans les administrations publiques françaises
1. L’émergence autour des achats publics
2. La réception de l’exemplarité à travers la démarche « Administration exemplaire »
2.1. Le plan administration exemplaire 2008-2014
2.1.1. Les indicateurs de réussite
2.1.2. Les fiches actions
2.2. Le Plan ministériel administration exemplaire 2015-2020
Chapitre 4. La mise en oeuvre opérationnelle de la démarche Administration exemplaire.
Le Plan administration exemplaire
I. Les outils incitatifs financiers et non financiers
1. Le pilotage du Plan administration exemplaire
1.1. Le Comité de pilotage Etat Exemplaire
1.2. Les fiches actions
1.3. Le fond Etat exemplaire
1.3.1. Le dispositif bonus-malus
1.3.2. Les indicateurs de réussite
II. L’analyse des outils incitatifs financiers et non financiers du Plan administration exemplaire (PAE) et du Plan ministériel administration exemplaire (PMAE)
1. Des indicateurs de réussite et/ou de performance et la montée en puissance des objectifs
2. Une politique par objectifs
3. Des outils autocentrés sur le fonctionnement des administrations publiques, sur la mutualisation et sur la rationalisation des dépenses publiques
Chapitre 5. La politique publique d’exemplarité. Une mise en perspective de la postbureaucratie et du management public
I. Une mise en perspective de la bureaucratie
1. La bureaucratie. Des tentatives de conceptualisation
2. Les courants critiques de la bureaucratie
3. De la bureaucratie à la post-bureaucratie
II. Les courants post-bureaucratiques
1. La nouvelle gestion publique
1.1. Emergences et fondements
1.2. Définitions et principes
1.3. Les courants post-nouvelle gestion publique
1.3.1. Le management de la qualité
1.3.2. La nouvelle gouvernance publique traitée par les chercheurs en sciences administratives ou en sciences de l’organisation
III. Les courants post-nouvelle gestion publique, post-bureaucratiques émergents
1. Les communs organisationnels. Une mise en perspective de la post-bureaucratie et de la post-NGP
2. Les communs informationnels. Une mise en perspective de la post-bureaucratie et de la post-NGP
3. La « smart governance », la « smart city », les « smart grids », les « smart meters » : Une mise en perspective de la post-bureaucratie et de la post-NGP
4. Une discussion de la gouvernance du développement durable. Une approche post-bureaucratique ?
5. L’exemplarité comme une mise en perspective du management public
5.1. La démarche administration exemplaire : dans la perspective de renouveau du (des) management(s) public(s) ?
5.1.1. Le management public. Un objet en mouvance à saisir ?
5.1.2. La refonte du Plan administration exemplaire (PAE). Une mise en perspective du management public ?
Troisième Partie: Posture épistémologique, méthodologie, résultats : analyse et mise à l’épreuve
Chapitre 6. Positionnement épistémologique
I. L’épistémologique
1. Une tentative de définition(s)
1.1. L’épistémologie : Une analyse synthétique – longétitudinale de son émergence, son développement et ses questionnements
1.2. L’Epistémologie des sciences de gestion
2. Une réflexion – nécessaire sur notre posture épistémologique en science de gestion
II. Notre posture épistémologique
1. Notre démarche de recherche
2. Nos hypothèses épistémologiques en management
3. Notre attitude épistémologique
3.1. La démarche de recherche
3.2. La question de recherche en sciences de gestion
3.2.1. Comprendre et contextualiser notre recherche en organisation
Chapitre 7 : La méthodologie de recherche
I. L’approche du terrain
1. Une recherche exploratoire hybride par un raisonnement inductif
2. Une analyse qualitative
3. L’analyse de contenu
4. La méthode de l’idéaltype
II. La collecte des données
1. L’analyse de contenus
1.1. La collecte et préparation des données
1.1.1. La collecte des données
1.1.2. La préparation des données
1.2. Le codage
1.2.1. L’unité d’analyse
1.2.2. La catégorisation de l’unité d’analyse
1.3. Extraction des thématiques
1.4. L’extraction de verbatims sur l’exemplarité
1.5. L’analyse des données
2. Méthode de l’idéaltype
2.1. Le ciblage du terrain et des porteurs
2.2. Le mode de recueil de données, choix d’unité d’analyse
2.3. La structuration de l’idéaltype. Identification du registre des phénomènes/Logique d’agrégation des éléments
2.4. La spécification de l’idéaltype. Amplification des caractéristiques par rapport à la logique ou caricature
Chapitre 8 : Analyse de données, résultats et mise à l’épreuve
I. Analyse de contenu de l’exemplarité en matière de développement durable.
Présentation et analyse des résultats
1. Une brève revue de la littérature de l’exemplarité
1.1. L’exemplarité dans le langage courant, en philosophie générale et en management
1.2. Les lectures contextuelles de l’exemplarité comme préalable à la coopération et à l’engagement
2. Le contenu de l’exemplarité
2.1. Les univers de sens et les corpus mobilisés
2.2. Les résultats de l’analyse des corpus théoriques, conceptuels et représentatifs (discursifs, juridiques et opérationnels) de l’exemplarité des organisations publiques
2.3. Résultats et analyse
2.3.1. 1er résultat et analyse : L’exemplarité. Un cadre global, décliné à différentes échelles.
2.3.2. 2ème résultat : L’exemplarité, un cadre global flou
2.3.3. 3ème résultat et analyse : quatre typologies d’exemplarité
2.3.4. 4ème résultat et analyse : L’exemplarité comme une mise en perspective de ses propres rhétoriques
3. Analyse de contenu de l’exemplarité des organisations publiques en matière de développement durable. L’administration exemplaire
II. Les résultats de l’analyse des idéaux-types d’organisation publique
1. L’idéaltype bureaucratique
1.1. La structure organisationnelle de la démarche administration exemplaire
1.1.1. Un pilotage centralisé
1.1.2. Le pilotage articulé autour des achats publics
1.1.3. Une bureaucratie en réseau à travers le pilotage élargi de la démarche administration exemplaire
1.2. Les dispositifs de coordination des activités de la démarche administration exemplaire
1.3. Un exemple d’organisation au niveau des ministères
1.4. La communication interne
1.5. Les figures de leadership émergents avec l’administration exemplaire
1.6. La structure du pouvoir et les modes de participation
1.7. Les recrutements et les profils recherchés
2. Idéaltype de type firme capitaliste
2.1. Une politique par objectifs et la montée en puissance des indicateurs de réussite ou de performance
2.2. Des outils autocentrés sur le fonctionnement des administrations publiques, la mutualisation et la rationalisation des dépenses publiques
2.2.1. La gestion des parcs immobiliers et mobiliers
2.2.2. La gestion du parc automobile de l’État et des opérateurs
2.2.3. La valorisation et le recyclage des déchets inertes du bâtiment et travaux publics
3. Les idéaux-types émergents post-bureaucratiques. Une mise en perspective de la post-bureaucratie par les communs organisationnels
III. Mise à l’épreuve de nos propositions de travail
1. Le Plan administration exemplaire : une double tendance à la bureaucratisation et la nouvelle gestion publique
2. Une mise en perspective – critique de la double tendance à la bureaucratisation et à la nouvelle gestion publique à travers la refonte du Plan administration exemplaire
2.1. Les scénarii d’évolution du PAE vers le PMAE pour mettre en perspectives de la double tendance à la débureaucratisation et à l’affaiblissement de la nouvelle gestion publique
3. Plan ministériel administration exemplaire (PMAE). Une remise en cause de la double tendance à la bureaucratisation et à la nouvelle gestion publique ?
IV. Les implications de nos résultats sur la transformation des organisations publiques
1. La transformation de l’organisation publique
2. La démarche administration exemplaire : un renouveau du management public ?
Télécharger le rapport complet