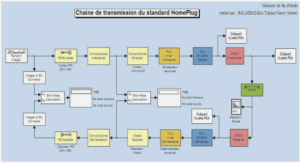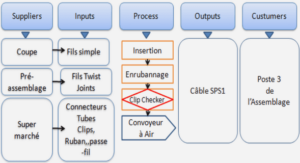Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Le carcéralisme, ou la « culture » incorporée de l’enfermement
L’institution totalitaire, les « corps disciplinés »
L’univers carcéral est, par essence, structuré selon des procédés coercitifs, dont l’évidence, selon Michel FOUCAULT, « se fonde avant tout sur son rôle, supposé ou exigé, d’appareil à transformer les individus. Comment la prison ne serait-elle pas immédiatement acceptée puisqu’elle ne fait, en enfermant, en redressant, en rendant docile, que reproduire, quitte à les accentuer un peu, tous les mécanismes qu’on trouve dans le corps social ? »70. Cette coercition passe essentiellement par la disciplinarisation des corps, elle-même structurée selon plusieurs procédés, tels que le morcellement du temps, l’application d’un règlement strict et sécuritaire, le travail ou les activités contrôlés et organisés de telle sorte qu’aucune marge de manœuvre n’est laissée au détenu. Le panoptique, imaginé et créé par Jeremy BENTHAM71, reflète parfaitement, selon FOUCAULT, ce processus de disciplinarisation des corps. Ce modèle architectural circulaire, qui instaure « à la fois surveillance et observation, sûreté et savoir, individualisation et totalisation, isolement et transparence [et dont l’effet majeur est d’] induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir »72, a « trouvé dans la prison son lieu privilégié de réalisation » 73 comme forme concrète d’exercice du pouvoir. Ce modèle architectural caractérise, aujourd’hui encore, 25 des établissements pénitentiaires français. Dans les prisons plus récemment construites, même si la géométrie architecturale est différente, l’esprit du panoptique résiste, par le biais de nouvelles technologies permettant le maintien de la surveillance permanente des détenus (portiques automatisés, système de vidéosurveillance…). Pour aller plus loin, la rationalisation de la servitude ou les dispositions, souvent coercitives, prises par les institutions pénitentiaires pour structurer les prérogatives individuelles (nettoyage des latrines au prétexte d’hygiène, traitements administrés de force au prétexte de la sauvegarde de la vie, réglementations coercitives au prétexte de sécurité) conduisent à l’adoption du fonctionnement propre, selon Ervin GOFFMAN, aux institutions totalitaires, en ce sens qu’elles enveloppent et règlent minutieusement la vie des reclus, et ont pour caractéristiques d’user de techniques de mortification des individus. Cette mortification se déroule selon un processus, parfois non intentionnel, que l’auteur définit comme « le début de certains changements radicaux dans la carrière morale du nouveau venu, carrière marquée par une modification progressive des certitudes qu’il nourrit à son propre sujet et au sujet d’autres personnes qui importent à ses yeux »74. Ce processus mortifère est marqué par des procédés communs à toutes les institutions totalitaires : l’isolement, les cérémonies d’admission, le dépouillement des biens, la dégradation de l’image de soi (perte du sentiment de sécurité personnelle, humiliation, coercition…), la contamination physique (violation de l’intimité de l’individu, mise à disposition du public de son dossier d’antécédents sociaux, fouilles à nu…), la contamination morale (mélange des groupes d’âges, des groupes culturels…). Ces procédés de mortification se basent en premier lieu sur le règlement intérieur, présent dans toute institution totalitaire, puisque, comme le souligne Didier FASSIN, « Les enjeux d’ordre est de sécurité sont consubstantiels à l’univers carcéral »75, ce dès lors que l’on contraint quelqu’un dans son existence tout entière et qu’on l’enferme contre son gré. Ervin GOFFMAN caractérise le règlement intérieur comme un « ensemble de prescriptions et d’interdictions pour une grande part explicitement formulées qui fixent les principales exigences auxquelles le reclus devra plier sa conduite »76. Ce règlement fixe en premier lieu les modalités qui régissent l’admission et « coupent le nouvel arrivant à ses attaches antérieures [et] apparaissent comme un moyen utilisé par l’institution pour le préparer à entamer une vie nouvelle, pliée aux exigences du règlement intérieur »77. En prison, tout manquement au règlement entraîne la délivrance d’une sanction, dispensée par le prétoire78, qui constitue une punition au sein de la punition (suppression de parloirs, encellulement individuel…).
Face à ces procédés de mortification, Ervin GOFFMAN distingue, chez les reclus, deux stratégies d’adaptation : les adaptations primaires et les adaptations secondaires. Les adaptations primaires regroupent l’ensemble des comportements visant, pour le détenu, à adopter le comportement qui est, selon lui, attendu de sa part. Face aux procédés de mortification subis, le reclus « peut avoir recours à divers modes personnels d’adaptations selon le développement de sa carrière morale »79. Ces différentes tactiques, parfois adoptées alternativement, sont :
Le repli sur soi, par lequel le reclus se refuse à toute participation personnelle aux évènements interférents ;
L’intransigeance, dans laquelle le reclus « lance un défi volontaire à l’institution en refusant de collaborer avec le personnel »80 ;
L’installation, dans laquelle les bribes d’une « vie normale » intra-muros viennent remplacer la totalité du monde extérieur, aboutissant à la construction d’« une existence stable et relativement satisfaite »81 ;
La conversion, où le reclus « semble (…) adopter l’opinion de l’administration ou du personnel et s’efforce de jouer le rôle du parfait reclus »82 ;
Enfin, le mélange des styles, soit une adaptation opportuniste, alternant les différentes tactiques en fonction du contexte.
GOFFMAN décrit par ailleurs le système d’adaptations secondaires. Ces dernières tendent à préserver une partie de soi de l’emprise de l’institution. GOFFMAN les décrit comme des « pratiques qui, sans provoquer directement le personnel, permettent au reclus d’obtenir des satisfactions interdites, ou bien des satisfactions autorisées par des moyens défendus […] Le reclus y voit la preuve importante qu’il est encore son propre maître et qu’il dispose d’un certain pouvoir sur son milieu »83. Ce système d’adaptations implique un code illicite, une forme de contrôle social visant, pour le détenu, à se prémunir de la délation et, de facto, de la moindre menace sur le fonctionnement de ce système. L’adoption d’un « code d’honneur » entre détenus, la construction de petits espaces de liberté, tels que le bricolage maison qui autorise les détenus à se créer une petite « cuisine » en sont des exemples. L’usage du « yo-yo »84, qui permet d’effacer symboliquement, voire même physiquement, les murs de la cellule en permettant des échanges de cigarettes ou autres produits entre détenus, en est un autre. Mais ces échanges par « yo-yo », a priori banals car relevant d’accommodations matérielles de la détention, traduisent un système d’interactions qui, là encore, participe du contrôle et de la hiérarchisation des rapports sociaux. Ces adaptations secondaires vont induire, sur le long terme, une incorporation des codes et de la culture carcérale et, parallèlement, du fonctionnement de l’institution pénitentiaire, dont les conséquences pour le détenu résideront en une modification profonde de son comportement.
Le carcéralisme ou l’incorporation d’une « sous- culture » de la prison
La mise en perspective de l’institution totalisante85 qu’est la prison et de ses procédés de mortification avec le rapport au temps nous renvoient au concept, initialement développé par Donald CLEMMER en 1940 sous le terme de prisonization, et repris en 1990 par Guy LEMIRE, sous le terme de prisonniérisation. Il est défini comme un processus d’assimilation progressive des valeurs de l’univers carcéral et qui se manifeste au travers des modes de vie imposés par cet univers : vivre en promiscuité, sous la permanence du regard d’autrui, même dans ses actes les plus intimes (tel que celui de faire ses besoins), ne plus ouvrir la porte, ni allumer ou éteindre la lumière, ne prendre aucune initiative. Sur ce sujet, Ervin GOFFMAN postule que « nous avons affaire à un processus plus limité que celui de l’acculturation ou de l’assimilation. Si certains changements culturels se produisent néanmoins, c’est plutôt par la suppression de la possibilité d’actualiser certains comportements, et l’ignorance totale des modifications récemment intervenues dans le milieu extérieur. Ainsi, si le séjour du reclus se prolonge, il peut se produire ce que l’on a appelé une « déculturation » (…) au sens d’une « désadaptation » qui rend l’intéressé temporairement incapable de faire face à certaines situations de la vie quotidienne, s’il doit à nouveau les affronter. »86
Anne-Marie MARCHETTI reprend elle aussi ce concept sous le terme de carcéralisme, qu’elle définit comme « le processus par lequel le détenu s’intègre à la prison en assimilant, à différents degrés, des normes, des coutumes et une culture générale propre à son nouveau milieu »87. Cette intériorisation des habitudes propres au monde carcéral est un processus progressif, étroitement corrélé à la durée de détention. Deux facteurs entrent en jeu dans le processus de carcéralisme : la durée de l’incarcération d’une part, le quantum de peine restant à accomplir d’autre part.
La phase initiale de ce processus correspond aux six premiers mois de la détention, période durant laquelle le détenu va être, selon Guy LEMIRE, tiraillé entre les valeurs des uns et des autres. C’est également la période où, à la suite du procès, le détenu accuse le verdict et l’entérinement de la peine qu’il doit accomplir.
La phase centrale, dite d’adaptation, correspond à une prise de distance, à la fois spatiale et temporelle, avec l’extérieur, période durant laquelle le détenu fait en quelque sorte « partie des murs ». Plus la période centrale est longue, plus le phénomène de carcéralisme s’accentue.
Anne-Marie MARCHETTI, dans son étude sur les longues peines, a distingué trois attitudes adoptées indépendamment par les détenus durant cette phase centrale :
Le détenu intégré au monde pénitentiaire, qui se caractérise par la perte d’intérêt pour le monde libre au profit de la détention, la négation des aspects positifs de la vie en-dehors de la détention : personne ne l’attend à l’extérieur, il n’a pas de travail, pas d’argent…
Le détenu dit végétatif, qui perd également tout intérêt pour le monde extérieur, coupe parfois volontairement les liens avec ce dernier, mais maintient néanmoins une réelle insatisfaction, voire une aversion, pour le monde pénitentiaire.
Le détenu actif ou hyperactif, qui tente coûte que coûte de garder un pied extra-muros. Cette de la résistance à l’institution, le besoin d’ouverture sur le monde libre, la capacité à susciter des rencontres, à élaborer des projets, l’aptitude à maintenir des relations sur le long terme et à courir le risque d’une séparation (cas de ceux qui se battent pour la révision de leur procès, par exemple), une capacité à entretenir le réseau extérieur (envois de courriers), voire de le développer (demander à bénéficier des visites d’un bénévole de l’ANPV, par exemple). Ces détenus sont souvent les premiers à demander à bénéficier d’un travail ou d’une formation.
Enfin, la phase terminale correspond aux six mois précédant la sortie. Le phénomène de carcéralisme tend à baisser au cours de cette période, la perspective de sortir semblant inverser le processus de croissance antérieurement présent dans la phase centrale.
Il est à noter que ce phénomène de carcéralisme se retrouve chez l’ensemble des personnes détenues pour de longues peines en établissement pour peine, les récidivistes vivant les mêmes phases que les primo-détenus bien que l’univers carcéral soit, pour eux, déjà connu.
Plus que l’intérioriser, le détenu, sur le long terme, finit par incorporer la culture carcérale car, comme le souligne Tony FERRI89, « Cette action d’enfermer est rendue visible sur le corps de l’être enfermé qui peut porter, de-ci de-là, les stigmates de la période de l’enfermement et qui peut révéler, par son marquage, son attitude et sa gestuelle, les conditions de sa captivité et l’obligation qui lui a été faite de s’adapter, pour survivre, aux nouvelles contraintes corporelles.
Il est des conditions et des lieux de vie figurés par les espaces de l’enfermement qui ne peuvent que laisser des traces corporelles et psychiques ».
Ces traces corporelles passent, indépendamment ou conjointement, comme le souligne Simone BUFFARD90, par le désinvestissement du corps (bien que certains, par le culturisme, tentent d’y résister), le vieillissement précoce, les troubles de la sexualité, l’altération des aptitudes psychomotrices faute de pouvoir se mouvoir librement, les troubles mnésiques, la dégradation de la vue – due au champ visuel limité – et de l’odorat. Car l’expérience carcérale est aussi une expérience sensorielle, où s’articulent une ambiance sonore alternante et spécifique des sons propres à la prison (portes qui se ferment, trousseaux de clés, cris des codétenus), l’obscurité, des lieux aseptisés et d’autres infects, les odeurs inexistantes ou écœurantes, la fadeur des plats servis, la perte de tout ce qui constitue, pour Jack GOODY, « nos fenêtres sur le monde »91 et qui interagissent avec nos sensations, émotions, mentalités.
Ainsi, à la libération, l’incorporation de ces habitudes propres à la vie en détention, la carence de stimuli physiques et sensoriels « vont s’ajouter aux handicaps de l’ancien détenu et rendre encore plus difficile son insertion dans le monde libre »92.
La déconstruction et la reconstruction identitaire
Le concept d’identité
L’identité est un concept polysémique. Dans son sens premier, l’identité est définie comme le caractère de deux ou plusieurs êtres identiques93. L’identité se construirait ici par l’identification à l’autre, le fait d’être même, et ne peut donc s’entendre que dans le sentiment d’appartenance à un groupe donné et la place qui nous est donnée dans ce groupe. Il s’agit ici, dans la théorie wébérienne, de la forme identitaire communautaire, en opposition à la forme identitaire sociétaire, dans laquelle l’individu se construit non seulement par rapport au groupe, mais aussi par rapport à lui-même. Cette deuxième forme implique une multiplicité d’appartenances groupales qui peuvent changer au cours de l’existence. À ce sujet, Vincent de GAULEJAC renvoie que « C’est justement parce qu’il y a des contradictions entre le communautaire et le sociétaire, le généalogique et le personnel, le passé et le présent, entre des héritages pleins et d’autres vides, des histoires lourdes et d’autres plus légères, que l’individu est amené à faire des choix qui le sollicitent à devenir un sujet »94
L’identité communautaire, elle, renvoie de facto à la notion d’identité plurielle. Le groupe, comme le souligne Vincent DESCOMBES95, se construit sur un classement des genres : « on ne peut pas compter les pommes avec les poires, il faut les compter comme des fruits »96. Ainsi, un même individu peut appartenir à plusieurs groupes, l’appartenance se définissant selon deux critères principaux :
L’appartenance à une même classe, au sens logique où les individus possèdent les mêmes attributs (une passion ou des idées identiques par exemple) ;
L’appartenance à une même communauté, au sens sociologique, où le lien social se crée par le seul fait d’appartenir au groupe (par exemple, être de la même famille ou du même pays).
Dans la sociologie interactionniste de GOFFMAN, l’individu construit son identité sur la base, non seulement du rôle que le groupe lui assigne, mais aussi de son degré d’appropriation de ce rôle. Dans Stigmates, GOFFMAN abandonne le concept de soi (self) au profit de la notion d’identité, qui tend à désigner « une étiquette sociale que les autres appliquent à l’individu en fonction de son rôle ou de sa position sociale, étiquette que cet individu peut changer en identité s’il la reprend à son compte, mais dont il doit aussi négocier le contenu dans une interaction avec les autres »97. Ce processus d’étiquetage social nous renvoie nécessairement au concept bourdieusien d’héritage culturel, qu’il nomme habitus et par lequel les individus apprennent et intériorisent, tout au long de leur socialisation (par le biais des médias, de leurs pairs, de leur famille, de l’école), des conceptions stéréotypées de leur personnalité et de leurs compétences. L’étiquetage social est si prégnant que les individus sont marqués par des pressions à s’y conformer, à l’intérioriser, et finit par contraindre la production de comportements conformes. Ces dispositifs sociaux que sont l’étiquetage ou l’habitus participent du processus de construction sociale, et donc de la construction identitaire de l’individu.
Partant de ce postulat, nous pourrions rapidement conclure que si le rôle que la société assigne à l’individu change, et qu’il incorpore ce nouveau rôle comme étant le sien, son identité change. Cette idée peut sembler triviale, or l’objecter soulève un paradoxe certain ; car il y a une opposition indéniable entre demeurer soi-même (et donc conserver son identité) et changer, c’est-à-dire devenir autre. Cependant, comme le souligne Vincent DESCOMBES, changer ne relève pas nécessairement d’un processus de déconstruction identitaire, mais peut, a contrario, participer du renforcement de cette identité.
Le croisement de ces diverses théories nous amène à penser l’identité sous le prisme des différentes composantes identitaires de l’individu, dont l’origine peut être innée (généalogique) ou acquise (par l’héritage culturel, la trajectoire personnelle), intrapersonnelle (représentation du soi), et interpersonnelle (étiquetage social, sentiment d’appartenance). L’identité s’inscrit également dans une mouvance temporelle, au gré de l’articulation de ces diverses composantes entre elles, mais également au gré du degré de conviction et d’intériorisation de l’individu pour ces diverses composantes.
Dans quelle dimension peut-on alors parler de déconstruction identitaire ? Nous pourrions définir ce processus comme la prégnance d’un stigmate qui vient se substituer à toutes les autres composantes de l’identité (généalogique, sociale, physique, personnelle). Rapporté au détenu, comme le souligne Philippe COMBESSIE, « La prégnance du stigmate “comportement haïssable” attaché à chaque justiciable incarcéré occulte toutes les autres propriétés des êtres humains qu’une décision de justice prive un jour de liberté. Leurs qualités de voisin, de collègue, de père, de sportif, d’artiste, etc., en un mot, leurs qualités humaines, disparaissent, et ne reste plus que l’image détestable, voire abominable, du comportement qu’on leur reproche. Comment envisager pouvoir réintégrer ensuite la société dans de telles conditions ? » 98
En détention, les substantifs les plus couramment utilisés renvoient à l’infraction commise ou à la longueur de la peine ; avec le numéro d’écrou, ils sont ce qui qualifie le détenu. Nous l’avons vu supra, ils participent également du sentiment d’appartenance liant les détenus entre eux. Comme le souligne Ervin GOFFMAN, le condamné, retiré de son environnement habituel, brutalement déclassé par la suppression de ses biens matériels et sa projection dans un univers impropre et vétuste, voit sa personnalité diluée dans la communauté des reclus. Cette dilution de la personnalité s’amorce souvent dès le procès, durant lequel « le criminel, désigné comme l’ennemi de tous, que tous ont intérêt à poursuivre, tombe hors du pacte, se disqualifie comme citoyen, […] il apparaît comme le scélérat, le monstre, le malade et bientôt l’anormal. »99
Par la suite, comme le souligne Philippe COMBESSIE, « Cette impression de perdre son temps, de ne rien faire d’intéressant, de ne rien apprendre, de réaliser un travail sous-qualifié, de ne cultiver ni son corps ni son esprit, de passer des journées stériles occupées à des gestes insignifiants [nourrit] le sentiment d’une existence sans valeur. »100 Ce processus de réification de l’individu implique donc la nécessaire déconstruction de son identité initiale (celle d’avant la peine) au profit d’une nouvelle, propre à la détention.
De la déviance comme justification de la peine
Comme développé dans la section précédente, la construction identitaire d’un individu passe par les représentations sociales dont il fait l’objet. Dans le champ de la pénalité, ces représentations sociales sont d’autant plus marquées qu’elles renvoient systématiquement les individus concernés à leur violation du pacte social légal ou, pour le dire autrement, leur déviance par rapport aux normes législatives socialement intégrées. Si Ervin GOFFMAN a développé la notion de stigmate, Howard BECKER, dans son ouvrage Outsiders, a montré comment la société construit ses représentations de la norme et, par extension, de la déviance. Selon BECKER, l’analyse de la déviance ne peut se réduire à l’état, à la nature ou aux attributs de la personne dite déviante ; la déviance n’est pas simplement la violation de normes sociales, mais elle est un processus qui oblige à considérer, outre le « déviant » lui-même, l’ensemble des individus qui le définissent — ou qui l‘étiquettent — comme tel. Plus précisément, « Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des déviants »101. Didier FASSIN reprend cette théorie en stipulant qu’« il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu’il est un crime, mais il est crime parce que nous le réprouvons »102 et que, par extension, « on n’est pas condamné parce qu’on est coupable, mais on est coupable parce qu’on est condamné. »103
BECKER démontre également qu’il existe une relativité dans la qualification d’un acte déviant, en fonction des « catégories respectives de celui qui le commet et de celui qui s’estime lésé par cet acte »104. Ainsi, il existe une différence de traitement de la déviance entre les classes populaires et les classes privilégiées, ce parfois pour une même infraction, ce que Didier FASSIN dénonce comme une inégale distribution des peines là où l’essence même de la justice est, de facto, d’être juste et impartiale : « En mettant ainsi l’individu seul face à son acte, la société s’exonère elle-même de sa responsabilité dans la production et la construction sociale des illégalismes. »105 Les normes sociales sont créées par des groupes sociaux spécifiques, à des moments spécifiques. Ainsi, « Le même comportement peut constituer une transgression des normes s’il est commis à un moment précis ou par une personne déterminée, mais non à un autre moment ou par une autre personne »106. L’exemple le plus parlant réside dans les situations de guerre, durant lesquelles l’assassinat d’autrui est non seulement excusé, mais encouragé. Pour Didier FASSIN, le système punitif actuel est l’héritier d’« une moralisation de la peine d’inspiration chrétienne. »107 Ces normes, découlant de la morale chrétienne, souvent manichéennes, se confrontent régulièrement à l’évolution de la société. L’homosexualité, autrefois lourdement réprimée, voit aujourd’hui les propos qui la discriminent condamnés. Ainsi, les normes sont souvent sources de conflits ou de désaccords car elles relèvent de processus de type politique au sein de la société ; les récents antagonismes concernant le « mariage pour tous » en sont une démonstration significative. Sur un autre versant, les affaires de mœurs autrefois lourdement sanctionnées peuvent aujourd’hui, sous le regard de la psychiatrie, invoquer des circonstances atténuantes telle qu’une pathologie, et conduire à un traitement différencié du crime via, par exemple, une hospitalisation.
Au-delà du processus de construction des normes, Howard BECKER développe le concept de « carrière » du déviant, processus par lequel les comportements déviants s’inscrivent et s’approprient dans la durée, pour aboutir à construire l’identité du sujet déviant. Pour cet auteur, la déviance correspond à l’adoption d’un genre de vie, qui organise l’identité du sujet sur la base d’un comportement déviant, qui a été socialement et progressivement appris.
Si ce concept de carrière peut s’entendre au regard des déterminants sociaux de l’individu qui peuvent, par l’étiquetage social, l’entraîner dans une forme de quadrature du cercle, il convient de garder la mesure qu’un milieu criminogène n’implique pas nécessairement que tous ceux qui y vivent deviendront des criminels. Les déterminismes sociaux ne doivent pas non plus chercher à justifier le crime, mais leur prise en considération permet d’en comprendre le mécanisme. Car ils sont ce qui conforte le corps social dans ses représentations ; ils sont ce qui fait que les sujets les plus souvent incarcérés sont ceux pour lesquels les représentations sociales à leur égard sont les plus prégnantes, en lien souvent avec leur culture, leur ethnie, ne serait-ce que par l’incapacité de ces individus, du fait de leur capital culturel, à utiliser un langage ou à se procurer un avocat qui leur permette la meilleure défense possible, ce qui influencera l’issue de leur procès. Ainsi, les déterminismes découlent des représentations sur le milieu qui étayent et accroissent les suspicions. Car la déviance ne se construit pas uniquement par rapport à la norme, mais aussi par rapport aux présupposés déviants.
De même, la réinsertion ne peut être pensée en prenant uniquement en compte le taux de récidive à la sortie et en occultant ce qui s’est passé pour la personne avant son enfermement. Pour tenir compte des conséquences de l’enfermement sur la récidive, il faudrait s’assurer que l’accompagnement à la socialisation des primo-arrivants en détention a bien été mis en œuvre en amont de leur incarcération.
De surcroît, il existe une hiérarchie des actes réprimés (meurtre / viol / fraude fiscale), qui reflète les conventions socialement définies et dont découle la pénalité ; comme le souligne Gaetano FILANGIERI, « La proportion entre la peine et la qualité du délit est déterminée par l’influence qu’a sur l’ordre social le pacte qu’on viole. » 108. Dans le même ordre de pensée, NIETZSCHE, dans son second essai de La généalogie de la morale109, met en perspective l’équivalence entre le dommage et la douleur, qu’il traduit comme l’équivalence de la faute et de la dette, soit le dédommagement, la rétribution destinés à compenser un crime. Ainsi, comme le souligne Didier FASSIN, punition et souffrance sont indissociées : « C’est parce qu’on estime que l’expiation de l’acte rend nécessaire un certain quantum de souffrance que punir ne peut que signifier faire souffrir. »110 La peine serait donc uniquement destinée, dans le corps social, à faire souffrir à hauteur du crime commis. Ce à quoi DURKHEIM ajoute qu’« on nous dit que nous ne faisons pas souffrir le coupable pour le faire souffrir ; il n’en reste pas moins vrai que nous trouvons juste qu’il souffre »111. Face à cette notion de justice dans l’expiation, comment, alors, l’intégration d’un détenu, sa peine passée, peut-être être appréhendée par le corps social ? Car si un détenu est formellement reconnu comme « lavé » de ses crimes une fois sa peine intégralement éprouvée, les représentations de la déviance, elles, tendent à persister dans le champ de l’informel.
Ce second chapitre nous a permis de saisir les effets de l’incarcération sur de très longues peines. La torsion du temps et de l’espace, entre dilution et exiguïté, le système d’interactions propre au système pénitentiaire, son fonctionnement coercitif et liberticide, l’accumulation des pertes de stimuli physiques et sensoriels… autrement dit, les effets du carcéralisme ne peuvent être sans conséquence sur la construction sociale et identitaire du détenu, ni sur son processus de réintégration à la suite de sa réclusion. Bien qu’il convienne de garder à l’esprit le poids des facteurs favorisant ou amplifiant ce phénomène de carcéralisme, ce dernier ne peut être occulté dans la manière dont l’ancien détenu va pouvoir œuvrer à sa réinsertion.
PRÉPARER ET VIVRE L’APRÈS : L’INTRICATION DES PARADOXES
Insertion, intégration, assimilation, inclusion : éclairages sémantiques
Lorsque l’on interroge le devenir des personnes anciennement détenues, il convient en préambule de préciser les notions d’insertion, d’assimilation, d’intégration et d’inclusion qui, bien que souvent confondues, renvoient à des réalités et des attendus bien distincts.
Au sens premier du terme, l’« insertion » désigne la simple addition d’un élément à un tout, plus précisément l’introduction ou l’intercalage dans une série, sans que l’élément introduit ni la série ne soient modifiés. Dans une approche sociologique, la notion d’insertion renvoie au champ de l’action politique et sociale, en termes de leviers, d’actions, visant à combler une intégration défaillante. Cette notion est apparue dans les années 70, avec ceux que Robert CASTEL appelait « les naufragés de la crise »112, c’est-à-dire les individus pour lesquels la problématique sociale émanait de l’absence de ressources due à la privation d’emploi. De cette notion sont nées les différentes actions et politiques de lutte contre les exclusions. Longtemps assimilée à la notion d’intégration, l’insertion en diffère néanmoins sur plusieurs points. Premièrement, par son domaine de compétences ; l’insertion étant avant tout en lien avec l’action sociale, alors que le concept d’intégration est, lui, issu de la sociologie. Mais la distinction renvoie surtout aux réalités différentes que ces deux termes recouvrent, même s’ils restent contigus.
L’insertion s’attache avant tout à définir le processus qui va conduire un individu à trouver sa place au sein d’un groupe social, processus avant tout axé sur la capacité de cet individu à mettre en œuvre, à l’aide des moyens qui lui sont octroyés, des actions visant à ce qu’il s’insère à un groupe donné. Aussi l’insertion peut-elle s’appliquer à divers sous-systèmes en fonction du domaine dans lequel elle s’inscrit : insertion professionnelle, sociale, scolaire… À noter que ce processus est réversible puisqu’aucune des deux parties (individu et groupe social) ne trouve intrinsèquement modifiée et peut revenir à son état antérieur ; on parle alors de désinsertion.
Les concepts d’intégration et d’assimilation sont souvent, à tort, confondus. Dans le processus d’assimilation, phase ultime de l’acculturation, l’autre devient même. Au sens étymologique, le terme prend ses racines dans le verbe « assimilare » qui signifie « rendre semblable ». Assimiler revient donc à modifier l’identité du nouveau venu dans un groupe pour le rendre semblable aux éléments antérieurs du groupe. Dans la sociologie des rapports interculturels, l’assimilation désigne le fait qu’« un individu ou un groupe intègre la totalité des traits culturels (langue, croyances, mœurs) de la culture dominante en abandonnant ses caractéristiques antérieures. Ce processus connaît, en fait, de multiples degrés, depuis la totale assimilation (intermariage, intégration culturelle…) jusqu’aux diverses formes de différenciation et de résistance à cette assimilation. »113. Robert PARK, au sujet de l’assimilation, indique qu’elle ne passe pas nécessairement par l’abandon des particularités de chaque groupe d’individus pour aboutir à une homogénéité culturelle de l’ensemble de la population, mais, à l’inverse, par leur reconnaissance et par la capacité de chacun à participer activement à la vie sociale. Ainsi, selon cet auteur, l’assimilation correspond à « un processus d’interpénétration et de fusion dans lesquels les personnes et les groupes acquièrent les souvenirs, les sentiments, les attitudes de l’autre et en partageant leur expérience, leur histoire, s’intègrent dans une vie culturelle commune »114.
Si l’assimilation fait souvent écho au principe régalien français de l’égalité, sous lequel on tend parfois à la confusion entre égalité et identité, rapportée aux personnes anciennement détenues, elle pourrait correspondre à l’idée de la réhabilitation parfaite, au sens où la société l’entend, par laquelle la personne rompt totalement avec son passé et renie le contexte qui l’a amenée en prison. Le processus d’assimilation, parvenu à son terme, est irréversible, puisque l’élément assimilé se voit profondément et intrinsèquement modifié par son nouveau groupe d’appartenance, devenu autre.
De même donc qu’il existe des nuances dans la manière d’accepter l’autre au sein d’un groupe, il en existe dans les antonymes des termes que nous venons de décrire ci-avant. Ainsi, le couple assimilation/rejet pose les bornes du tout ou rien : alors que l’assimilation réussie est une fusion, son échec rejette l’autre dans une extériorité absolue, qui peut alors prendre la forme de l’exclusion. La marginalisation, quant à elle, antonyme de l’insertion, est plus insidieuse puisqu’elle met l’autre en marge du groupe, sans toutefois l’exclure.
Assimilation et insertion ont pour point commun que l’élément rapporté, qu’il soit radicalement modifié ou non, ne vient pas transformer fondamentalement le groupe d’appartenance. Ni l’insertion, ni l’assimilation, ne transigent, à des degrés divers néanmoins, avec les identités de chacun et leurs différences.
L’intégration, si on la considère sous son sens littéral, se tient à mi-chemin de ces deux écueils, car non seulement elle fait place à la différence, mais elle sait aussi se laisser transformer par elle. Intégrer est avant tout une démarche mentale d’acceptation de l’autre dans sa différence en prenant le risque – ou en se donnant la chance – d’être modifié par lui. C’est postuler qu’il a sa place à part entière dans la communauté, qui serait amputée s’il ne l’occupait pas. Le sens étymologique du mot « intégration » vient du latin integrare, qui signifie « rendre entier », « construire une totalité ». Dans la sociologie durkheimienne, le concept d’intégration désigne « le processus par lequel un groupe social, quelles que soient ses dimensions, s’approprie l’individu pour assurer la cohésion du groupe. Même s’il s’agit d’une relation entre le groupe et l’individu, l’intégration définit une caractéristique du premier et non pas du second. »115. Autrement dit, « un groupe, ou une société, est intégré(e) quand ses membres se sentent liés les uns aux autres par des valeurs, des objectifs communs, le sentiment de participer à un même ensemble sans cesse renforcé par des interactions régulières »116. L’intégration sociale est donc une propriété collective et l’insertion, dans ce contexte, se réfère à la participation au niveau individuel à un système social intégré. Ainsi, l’intégration modifie à la fois l’élément intégré et l’ensemble intégrant. Le Haut Conseil à l’Intégration a résumé ainsi ce principe : « L’intégration consiste à susciter la participation active à la société tout entière de l’ensemble des femmes et des hommes appelés à vivre durablement sur notre sol en acceptant sans arrière- pensée que subsistent des spécificités notamment culturelles, mais en mettant l’accent sur les ressemblances et les convergences dans l’égalité des droits et des devoirs, afin « à parler juste, intégrer est plus qu’insérer ou inclure : c’est bien faire place à l’autre (ce que disent insérer et inclure), mais, ce faisant, c’est se modifier et retrouver, avec l’autre, la complétude qui aurait fait défaut sans lui. »118
Par conséquent, l’intégration des individus à une société qui poserait le problème de leur socialisation ou de leur identité poserait également le problème de l’identité même de cette société. Partant de ce principe, l’incapacité d’une société à intégrer indique sa difficulté à affirmer sa propre identité. L’intégration n’est donc pas seulement une médiane entre insertion et assimilation, en incluant l’arrivant sans le transformer radicalement, mais elle va bien au-delà en considérant toute société comme une entité qui perdure en se modifiant par la diversité de ses apports successifs et de ses redéfinitions en découlant.
A contrario de l’intégration se trouve la ségrégation, ou l’exclusion interne, qui consiste, certes, à faire place aux éléments différents, mais à leur assigner dès lors un espace à part, tels que les ghettos, asiles, établissements spécialisés… où chacun demeure ce qu’il est, inchangé par la présence de l’autre ou des autres.
Si la notion d’intégration relève du champ sociologique, l’inclusion, « action d’inclure quelque chose dans un tout ainsi que le résultat de cette action », renvoie au champ de la psychosociologie et lui est généralement préférée dans les domaines de l’éducation et du handicap. La notion d’inclusion sociale a été développée par le sociologue allemand Niklas LUHMANN119 pour caractériser les rapports entre les individus et les systèmes sociaux. D’aucuns lui prêtent aujourd’hui une efficience plus aboutie que l’intégration dans la mesure où ce concept interroge la norme (ce que ne fait pas l’intégration) en posant le postulat que la société doit supprimer les notions de norme et de rapprochement de la norme. Cette notion couvre de fait notre champ d’étude puisqu’elle se réfère plus particulièrement aux individus appartenant au groupe des exclus internes, telles que peuvent être considérées les personnes incarcérées.
Ainsi, tout au long de cette recherche, et afin d’être au plus proche de la réalité des différentes dimensions étudiées, nous faisons le choix d’employer opportunément les termes d’« insertion » lorsqu’il sera question du champ de l’insertion sociale et professionnelle, d’« intégration » lorsque sera étudiée la nature des rapports aux différents groupes sociaux, et d’ « inclusion » dès lors que sera interrogé le rapport à la norme. Nous optons également pour un usage parcimonieux et opportun du préfixe « ré » dont l’usage est courant pour parler d’insertion et d’intégration, puisqu’il postule que l’individu concerné n’était, dans sa situation antérieure, pas socialement intégré. Or, l’intégration peut être effective pour l’individu au sein même du système carcéral, de même qu’elle pouvait l’être par sa condition antérieure à la détention.
Les paradoxes de la sortie
Si l’insertion des anciens détenus constitue, après la mise en sécurité, la seconde mission de l’administration pénitentiaire, cette double mission porte en elle un premier paradoxe en ceci que le fonctionnement coercitif propre à l’institution totalitaire annihile la capacité de projection de l’individu. Car, comme le soulève Anne-Marie MARCHETTI, citant un assistant socio-éducatif du Centre National d’Observation (CNO) de Fresnes, « Il faut maintenir un certain dynamisme sans mettre en jeu l’institution qui garde. Si le gars se projette trop dans l’avenir, il ne supportera pas le présent, sera déprimé, agressif. En fait, il faut […] qu’on permette une insertion pénitentiaire : c’est le principe de réalité et c’est quelque part très contradictoire avec la réinsertion »120. Ainsi, dans la mesure où « un détenu qui s’autogère (relativement) est un détenu qui se libère »121, donc potentiellement dangereux, l’institution pénitentiaire l’exhorte à se gérer le moins possible en lui faisant endurer de nombreuses pertes : celles de l’autonomie, du contrôle, de sa capacité de choix, des liens, des stimuli, des comportements du quotidien. Tout ceci entre en complète contradiction avec la responsabilisation. Comment, alors, exiger de lui qu’il soit en capacité de construire son projet de sortie, capacité qui mobilise toutes les composantes de ce qu’il a perdu en détention ? Un second paradoxe renvoie au terme même d’insertion. Le détenu doit, officiellement, se réinsérer. L’usage du préfixe « ré » présuppose deux dilemmes. Le premier est que le détenu était socialement inséré, voire intégré, avant son incarcération. C’est bien entendu le cas pour certains, qui étaient parfois totalement intégrés au corps social ; cependant, la garantie de recouvrer ce statut et cette situation n’est pas toujours effective, ce d’autant moins pour les détenus de longue peine pour lesquels les liens sociaux se sont parfois dissous sur le temps d’incarcération. Pour d’autres, cette intégration était bien ressentie comme effective, mais au sein d’un groupe social qui lui, est étiqueté comme déviant aux yeux du corps social. L’individu peut pourtant s’estimer avoir été intégré à ce groupe avant son incarcération, y avoir entretenu des liens forts, allant jusqu’à se substituer, parfois, à ceux de sa famille. Dans ce cas, on exige de lui, à sa libération, une double sortie : celle de la prison et celle de son ancien milieu. Le second dilemme est que l’univers carcéral représenterait à lui seul un lieu de désinsertion ou de non-insertion, un lieu détaché du corps social puisque, comme le souligne le président de la Cour de Cassation en mars 2000, le paradoxe du système carcéral réside en ceci qu’il a pour objet de « réinsérer une personne en la retirant de la société »122. Ajouté au phénomène de carcéralisme, le détenu se retrouve dans la nécessité de devoir mobiliser des compétences non entretenues, voire perdues, pour rengager un processus d’intégration.
Enfin, un troisième paradoxe concerne l’évolution du concept d’insertion post-carcérale. L’OIP, dans son rapport de 2011123, affirme qu’avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, la notion de prévention de la récidive s’est substituée à celles d’insertion et de réinsertion : « La Cour des comptes souligne en ce sens que “le législateur a voulu transformer la réinsertion sociale des personnes sous main de justice en une mission plus générale », mettant ainsi « la réinsertion au service de la prévention de la récidive” »124. Le défaut de récidive porte un nom : la « sortie positive ». Ainsi, la sortie devient positive à partir du moment où elle garantit la mise en sécurité de la société au regard de l’ancien détenu. Comment ce dernier peut-il alors composer avec l’injonction de sortir « positivement » non pour lui-même, pour sa reconstruction et son intégration au corps social, mais pour la garantie qu’il ne sera plus dangereux pour ce corps social ?
Ces divers paradoxes ne sont pas étrangers à la personne détenue qui appréhende sa sortie prochaine, et le conduisent souvent, à l’approche de sa libération, à une dissension entre espoir, défiance et inquiétude.
L’approche de la sortie : entre idéalisation et appréhension
Accomplir sa peine induit nécessairement, chez le détenu, l’attente de la sortie. Cette sortie est à la fois idéalisée, fantasmée, mais aussi anxiogène. Pour les très longues peines, les mois qui précèdent la sortie correspondent à un phénomène de recrudescence de transgressions pouvant conduire à un allongement de la peine, voire de suicides. GOFFMAN, dans Asiles, exprime très bien cette ambiguïté : « En dépit […] de leur habitude de compter minutieusement les jours qui les séparent de la sortie, les libérables se montrent très souvent anxieux à la pensée du départ et vont même parfois […] se rengager pour différer l’échéance. Cette anxiété du reclus s’exprime souvent par une question qu’il se pose à lui-même ou qu’il pose à ses amis : “Suis-je capable de me tirer d’affaire dehors ?” »125. Les mois qui précèdent la sortie correspondent également au moment où le détenu doit se soumettre aux entretiens et expertises psychiatriques qui reviennent sur son crime, jusque-là objet de non-dits. Si ce travail sur soi et le crime est nécessaire, le fait qu’il s’exécute généralement au moment où il est demandé au détenu de se projeter dans un avenir optimiste peut être, in fine, subversif.
Brigitte HOLZKNECHT, dans son article « imaginaires d’insertion », évoque par ailleurs la place de l’imaginaire dans le processus de préparation à la sortie : « En prison, tout devient possible. Ce qui était impensable auparavant devient imaginable aujourd’hui. Il s’agit de marquer l’avant de l’après-incarcération, de justifier le temps en prison, que cela “ait pu servir à quelque chose”. Interpeller l’homme détenu dans ses perspectives d’Homme libre, c’est alors ouvrir une large porte sur son imaginaire. Qu’importe le réalisme du projet, l’individu incarcéré devient un être désirant… »126. Cependant, l’auteure souligne que les détenus, par leur éloignement spatial et temporel avec la société, se représentent cette dernière souvent de manière très simplifiée, et n’en perçoivent que très rarement les nuances, les dégradés, les modulations.
Ainsi, la réintroduction de l’individu détenu dans la société va impliquer pour lui de se confronter à une réalité dont il n’a pas anticipé toutes les dimensions. À cet éloignement spatial et temporel s’ajoute en effet une complexification de la société qui participe de ce phénomène. Car même si le détenu a continué de percevoir cette évolution sociétale durant son temps d’incarcération, il a pu également percevoir à quel point il allait être en difficulté pour l’appréhender.
La sortie, ou la divergence des réalités
Comme le souligne Brigitte HOLZKNECHT, « La sortie de prison, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle se réalise, peut entraîner un véritable choc pour le sortant qui se retrouve complètement anéanti et submergé par la réalité. Les capacités qu’il avait à se projeter dans l’avenir n’ouvrent pas la porte de l’agir. »127. Car force est de constater, selon l’auteure, que l’adaptation sociale de l’individu passe par sa connaissance de la réalité sociale, pour pouvoir ainsi l’appréhender et se l’approprier. Lorsque l’individu sort d’une longue peine d’incarcération, son imaginaire, qui englobe l’ensemble de ses représentations de la société, coïncide très peu avec le réel, voire entraîne une vision irrationnelle à son sujet. Il en résulte un sentiment d’impossible inclusion ; la société, devenue anxiogène, est alors désignée comme responsable de ses difficultés à s’y intégrer.
L’imaginaire d’insertion se confronte souvent, en premier lieu, à la difficulté de trouver un logement. Cette difficulté est prégnante, notamment en raison de la temporalité incertaine, qui permet rarement d’être synchrone avec la date de sortie. De plus, si le logement est souvent fantasmé durant la détention comme la recouvrance de l’autonomie et de la restauration de l’intimité, ce passage est souvent difficilement vécu, notamment par les détenus sortant de longue peine. Brigitte HOLZKNECHT en donne un aperçu des plus parlants en citant une femme ayant purgé une peine de 10 ans : « Je n’arrivais pas à ouvrir les portes de l’appartement… J’attendais qu’une surveillante vienne ouvrir !!! J’avais l’impression de ne pas avoir le droit… C’était pareil quand le téléphone sonnait… J’ai mis du temps à réaliser que c’était bien à moi de décrocher… »128. À cette difficulté s’ajoute, pour le détenu, le fait de devoir, parfois du jour au lendemain, réapprendre à se « débrouiller » seul : repérer les nouveaux dispositifs de l’aide sociale, en réaliser les demandes inhérentes (CMU, RSA…), remplir des formulaires, se déplacer, généralement en transports en commun, dans une ville qui lui est souvent inconnue. Il est à soulever que le choc sus-cité provoqué par la sortie est encore plus important dans les situations dites de sortie sèche, où le détenu est littéralement projeté hors les murs dans une ville inconnue, sans perspective d’emploi et avec un très faible pécule et, souvent, une unique nuit réservée auprès des services d’hébergement d’urgence.
Concernant les longues peines, Brigitte HOLZKNETCH souligne que les établissements pour peines, dont le régime est plus souple qu’en maison d’arrêt et se situe généralement dans une « perspective de maturation progressive du processus de resocialisation, permettent une meilleure inscription des détenus dans le temps, par le suivi et l’accompagnement qui y sont proposés. »129. Si l’on peut considérer que cette souplesse de fonctionnement les expose à une plus grande violence et les conduit à adopter des comportements excessifs de protection, il s’avère que chez ces détenus, l’inadaptation à la réalité se situe essentiellement dans la perte de repères sensoriels et spatio-temporels qui sont à se réapproprier. L’incidence des années d’enfermement, entraîne, en outre, une immaturité psycho-affective qui pousse souvent les individus à se réinscrire dans la situation qu’ils ont antérieurement connue et, parfois, à se réapproprier les mêmes traits de personnalité responsables de leur passage à l’acte criminel initial (relations passionnelles impulsives, assujettissement à l’autre…). Se pose, alors, la question du rôle de la prison et du sens de la peine, sa capacité à faire évoluer le détenu, non seulement vers un projet de réinscription sociale, mais aussi de développement personnel. Il s’agit bien, ici, de la confrontation du caractère normatif du châtiment aux études qui démontrent son inefficacité.
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION
1ERE PARTIE : ELEMENTS DE CADRAGE ET REFERENCES
CHAPITRE 1 : LA PRISON : CADRE CONTEXTUEL ET CONCEPTUEL CADRE SOCIO–HISTORIQUE DE LA PRISON CONSIDERATIONS CONTEMPORAINES SUR L’ENFERMEMENT
CHAPITRE 2 : DEL’ENFERMEMENT AU CARCERALISME
LES EFFETS D’ACCULTURATION EN PRISON
LE CARCERALISME, OU LA « CULTURE » INCORPOREE DE L’ENFERMEMENT
LA DECONSTRUCTION ET LA RECONSTRUCTION IDENTITAIRE
CHAPITRE 3 : PREPARER ET VIVRE L’APRES : L’INTRICATION DES PARADOXES
INSERTION, INTEGRATION, ASSIMILATION, INCLUSION : ECLAIRAGES SEMANTIQUES LES PARADOXES DE LA SORTIE
LA PEINE ATERMOYEE
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
2EME PARTIE : ANALYSE
CHAPITRE 1 : NOTRE SUJET D’ETUDE
PROBLEMATIQUE
METHODOLOGIE
CHAPITRE 2 : L’ANALYSE DES RECITS
LE VECU CARCERAL : UNE EXPERIENCE POLYMORPHE ET DIFFERENCIEE QUI INFLUENCE LE RAPPORT A SOI ET A LA SOCIETE
LA PREPARATION A LA SORTIE : DE L’IDEAL AU PRINCIPE DE REALITE
SE DEPARTIR DES MURS : UNE READAPTATION PROGRESSIVE
DE L’ANALYSE AUX PRECONISATIONS
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
CONCLUSIONS DE CETTE RECHERCHE
TABLE DES SIGLES
GLOSSAIRE
BIBLIOGRAPHIE – SITOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet