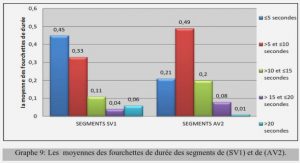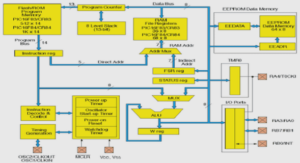Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Le bidonville : espace maudit du monde urbain
Si les bidonvilles existent, c’est avant tout parce qu’ils fournissent des logements bon marché et demandent peu d’investissements publics. Effectivement, puisqu’ils reposent en grande majorité sur une occupation des sols illégale, les municipalités ne sont pas dans l’obligation directe de mettre à la disposition de ces quartiers informels les infrastructures et services publics dont peut profiter le reste de la ville.
D’ailleurs, très souvent, ces lieux n’apparaissent pas sur les cartes des métropoles. Pour le sociologue Adelmalek Sayad1, le bidonville est « une ville qui n’existe pas ». Volontairement ou par omission, les gouvernements cherchent bien souvent à dissimuler ces populations aux statuts incertains et aux conditions de vie inacceptables, reflet d’un dysfonctionnement d’un système économique et social obsolète.
Dès son origine, le bidonville est donc inéluctablement placé en marge de la ville au sens légal du terme. En effet l’installation sur les terrains, qu’elle s’opère progressivement ou subitement, par affinité, de jour ou de nuit, est illégale.
Cette clandestinité nait tout d’abord de la nature même de ces territoires que les bidonvillois s’approprient. En effet, il s’agit en grande majorité de terrains classés « inconstructibles » ou « inutilisables » de part leur caractère dangereux. Soumis à des risques d’inondation élevés, à des glissements de terrains ou encore hautement pollués, ce sont des bouts de territoire qui n’intéressent ni l’Etat ni les investisseurs privés et qui sont donc laissés à l’abandon. Cependant, officiellement, ces sols appartiennent bien à quelqu’un : à l’Etat ou au secteur privé, l’installation des bidonvilles en ces lieux constitue donc une atteinte au droit de propriété de ses propriétaires puisqu’ils restent malgré tout possiblement sujet à la spéculation immobilière.
Habiter un bidonville revient donc à habiter dans un entredeux, à s’approprier un résidu de territoire en étant sous la menace permanente de l’expulsion. Ces habitants ne possèdent pas officiellement d’adresse et ne sont donc pas publiquement reconnus aux yeux de tous. Illégaux, ils ne peuvent pas exister au regard de la loi au même titre que les autres citadins. D’ailleurs, le vocabulaire employé par les autorités pour qualifier ces zones d’habitat informel reflète parfaitement le caractère temporaire et indésirable qui est imposé à leur existence. On entend alors parler de «camps» ou de «campements illicites», termes qui mettent en exergue la dimension non pérenne qu’on leur assigne d’office.
Dans son ouvrage « Roms et riverains, une politique municipale de la race », Eric Fassin parle de technique d’ « auto-expulsion2 ». Celle-ci consiste à rendre la vie d’une population migrante la plus difficile possible afin qu’elle parte d’elle-même.
Mise en place en 1994 par les conservateurs américains pour combattre l’installation de migrants latino-américains sur le territoire, cette mesure proposait de fermer l’accès aux hôpitaux et aux écoles publiques aux immigrés en situation irrégulière. Il s’agit bien ici d’une attitude répressive déployée face à la pauvreté, d’un refus inconditionnel de voir s’installer des quartiers d’habitat informel dans une urbanité existante réglée sur un modèle unique.
Les bidonvilles sont donc l’expression urbanistique visible de la pauvreté et de l’inégalité sociale. Cette forme d’urbanité constitue une faille dans la représentation dominante du monde, elle représente la part maudite de l’urbain, celle de l’échec de la ville capitaliste néolibérale à accueillir, à subvenir aux besoins et à respecter un des droits fondamentaux de tous, le droit au respect de la dignité humaine. Ainsi, on choisit ou non de le montrer, d’en parler, de le faire entrer dans le règne du visible : il n’a pas de nature propre, autonome, car ses habitants n’ont toujours pas la possibilité de faire entendre leur voix.
Le bidonville dans les années 1950 – 1970 : symbole de révolution contre l’aliènation de la culture et de l’architecture comme produits du monde moderne capitaliste
La naissance des premières pratiques anti-autoritaires
Comme nous avons pu le constater, il existe donc une relation profonde entre la ville et les inégalités sociales. Pour les fustigateurs de l’architecture moderne, la ville produite par le système capitaliste est une ville pensée sur le mode du réseau, des flux et de la dématérialisation qui déshumanise ses habitants.
C’est dans ce contexte que, dès le début du XXème siècle, le bidonville apparaît comme l’expression urbaine de la paupérisation d’une société soumise à des contraintes techniques, industrielles et économiques de plus en plus fortes.
Quelle place est laissée à l’humain ? Aux libertés individuelles et à la spontanéité ? Comment se défaire d’un système destructeur pour ces individus ?
Le bidonville dans les années 1950 – 1970 : symbole de révolution contre l’aliènation de la culture et de l’architecture comme produits du monde moderne capitaliste dans le bidonville une alternative à la ville capitaliste aliénante. Et si cet habitat informel n’était plus seulement la conséquence désastreuse des inégalités sociales de la ville mais au contraire, l’embryon d’une ville nouvelle ?
Les architectes et sociologues de cette nouvelle pensée critique veulent imaginer la ville du futur, plus juste et plus libre. Ils se placent en opposition à l’architecture moderne comme modèle universel et écho d’une organisation capitaliste dominante. Ils refusent la ville produite en série par un urbanisme autoritaire et pensée pour des populations modestes au quotidien dicté par le système. Ils se révoltent contre ces métropoles qui amenuisent et qui contrôlent l’expérience personnelle et la liberté de chacun. Ces villes qu’ils réprouvent, ce sont celles pensées sur des logiques de standardisation, de simplification et de planification rationalistes.
Nous tenterons ici de montrer en quoi les pratiques de l’architecture critique du XXème siècle constituent une réponse originale, notamment par la mise en place d’un processus qui, contrairement à la majorité des courants critiques observés jusqu’alors, prend comme point de départ la pratique, individuelle ou collective, et non plus la théorie de celle-ci. C’est d’ailleurs cette nouvelle méthode qui justifie que les premières théorisations sur l’urbanisme critique où les principes de réappropriation1 n’apparaissent que plus tardivement à la fin des années 1960.
Ce mouvement, qui rejette d’un même geste la spécialisation et la théorisation au profit de la réappropriation des savoirs par
1: Cf : Michel DE CERTEAU – L’invention du quotidien, t. 1. arts de faire – Paris, Gallimard, 1990. Henri LEFEBVRE – Le droit à la ville – Paris, Economica, 2009
Le bidonville dans les années 1950 – 1970 : symbole de révolution contre l’aliènation de la culture et de l’architecture comme produits du monde moderne capitaliste
2 : Le CORBUSIER – Charte d’Athènes – Paris, Editions de Minuit, 1941
Se réapproprier l’habitat
C’est dans la période d’après-guerre avec l’apparition des premiers « grands ensembles » que vont se dessiner les prémisses de cette vague d’insatisfaction vis-à-vis d’un mode d’habiter unique pour la majorité de la population modeste. En effet, la production de ces « machines à habiter » constitue, pour la majorité d’entre elles, une application peu inspirée des principes énoncés par Le Corbusier dans la Charte d’Athènes de 19412. Renforcement du zonage urbain (séparation des espaces d’habitation et de travail, des voies de circulation entre elles), définition des besoins en espace, lumière et air, recours aux matériaux et aux modes de constructions industriels. Tous ces paramètres, calculés et optimisés pour être ensuite appliqués à un modèle unique et invariable, amènent à considérer l’être humain comme une machine, un automate et donc à renier le caractère unique des modes d’habiter de chacun. Effectivement, si au départ on retrouve dans la Charte d’Athènes une certaine dimension utopiste, ou du moins sociale, les grands ensembles eux l’évincent complétement au profit d’une architecture ayant pour objectif principal le rendement tous à travers l’action, confirme bien qu’il s’agit d’un mode de penser et de produire particulier, qui refuse de s’ancrer dans un courant purement théorique et donc fortement spécialisé au détriment de pratiques individuelles plus spontanées.
Cependant, si les premières insatisfactions se font ressentir dès le début du siècle, on peine à proposer de réelles solutions aux problèmes posés par ces architectures dysfonctionnelles.
La Team X, chargée dès 1953 de préparer le prochain CIAM de 1956, est composée de jeunes architectes déjà sceptiques quant à l’attitude à adopter en cette période d’après-guerre.
Ils effectuent alors des recherches dans des lieux d’habitat collectif (cité-jardin et bidonvilles) dans l’espoir de trouver des solutions capables d’encourager les résidents à créer des relations humaines au sein des grands ensembles, conscients que les habitants ont également des besoins sociaux et culturels spécifiques. Au fil de ces réunions se dessine alors la volonté d’une architecture plus humaine mais qui finalement restera au stade de l’étude et ne constituera pas une prise de position ensuite affirmée sur le terrain.
Il faut attendre la fin des années 1950 pour voir émerger les premières approches vraiment révolutionnaires. En 1958, Friedensreich Hundertwasser rédige le « Manifeste de la moisissure contre le rationalisme en architecture »3 dans lequel il dit :
Il faut préférer les logements matériellement inhabitables des quartiers miséreux, les taudis, aux logements moralement inhabitables de l’architecture fonctionnelle et utile. Dans les quartiers miséreux seul le corps des hommes peut périr, mais dans l’architecture prétendument conçue pour l’homme, c’est son âme qui périt. C’est pourquoi il faut améliorer le principe qui régit les taudis, c’est-à-dire l’architecture à développement sauvage et incontrôlé́, et la prendre pour base à la place de l’architecture fonctionnelle » 4
3: Friedensreich HUNDERTWASSER – Manifeste de la moisissure contre le rationalisme en architecture – discours tenu en 1958 par Hundertwasser dans l’abbaye de Seckau.Texte en annexe.
4 : Ibid (paragraphe inclus dans le manifeste seulement après la lecture à Seckau.)
Le bidonville dans les années 1950 – 1970 : symbole de révolution contre l’aliènation de la culture et de l’architecture comme produits du monde moderne capitaliste et plus loin :
« Il est temps que les gens se révoltent eux-mêmes contre leur installation dans des constructions semblables aux cages à poules et à lapins qui ne correspondent en rien à leur nature. » 5
Dès 1958 donc, est amorcée cette idée que l’avenir de la ville doit passer par un renouveau des méthodes à la fois de construire mais aussi de penser.
Pour Hundertwasser, cette révolution passe par le principe d’autoconstruction, par l’adaptation et l’amélioration d’un modèle qui existe déjà dans les quartiers d’habitat informel.
Modèle qui, contrairement à celui de l’architecture moderne, permet à l’homme de s’épanouir moralement. Cette liberté d’expression individuelle, dont les êtres humains sont privés une fois enfermés dans l’architecture des grands ensembles, permet à l’homme de développer sa vraie nature, celle de l’être humain bâtisseur capable de construire sa maison grâce à sa créativité et à des choix qui lui sont propres.
Il oppose alors, au-delà de l’architecture, deux conditions humaines bien distinctes. La première, celle de l’homme aliéné produit de l’architecture moderne et la seconde, celle de l’homme du bidonville, pleinement maître de son existence capable de construire un monde unique, en constante évolution. Pour Hundertwasser, l’architecture des grands ensembles constitue un « acte criminel » qui prive l’être humain de son autonomie tandis qu’il pose l’architecture spontanée des quartiers d’habitat informel comme une condition indispensable de l’existence qui nous permettrait de nous rapprocher de la « vraie vie ».
Bien que ce manifeste, par son ton radical, visait très certainement plus à faire réagir qu’à vraiment initier un mouvement urbain et architectural, il marque le point de départ de cette nouvelle pensée anti-autoritaire qui sera ensuite revendiquée et développée dans la décennie qui suit par de nombreux architectes, sociologues et autres théoriciens.
D’ailleurs, dans les années qui suivront, on assistera au-delà de la simple remise en question de l’architecture moderne, à la remise en cause de la fonction architecturale toute entière.
C’est dans la continuité de cette critique que sera présentée, en 1964 au MoMA, l’exposition Architecture Without Architects de Bernard Rudosky 6.
Il y présente des exemples d’architectures vernaculaires issues du monde entier censées représenter le génie commun, l’inventivité d’autodidactes et de bâtisseurs non-architectes capables de trouver des solutions là où l’architecture moderne a échoué. (cf figures ci-dessus et ci-contre)
(d) Houseboat – Shanghai Soochow Creek
(e) Tente en peau de chèvres – Ajdir plateau in the middle atlas
Il oppose les manières de faire des intellectuels et spécialistes qu’il place en-dehors du processus de construction et donc incapables de comprendre et de répondre complétement au attentes de ceux qui l’habitent, à celles intrinsèques, plus spontanées, nées de savoir-faire communs et prenant en compte les expériences de toute une communauté 7. Il met en exergue la beauté des créations qui ne sont pas le fruit d’architectes savants, l’ingéniosité des constructions faites de matériaux de récupération et nous invite à nous réapproprier notre espace habité.
Nous pouvons donc avancer qu’il existe, dans ces manières de faire et de penser la ville, des principes et potentialités dignes d’être reconnus. En effet, ces créations spontanées, représentations urbaines d’une liberté individuelle reconquise, nous permettent de nous questionner sur les modes de fabrication de la ville contemporaine.
Il faut cependant prendre conscience du paradoxe qui domine cette relation conflictuelle entre la ville et le bidonville.
Effectivement, à la fois hors du capitalisme, de ses modes de construction et de sociabilité, de ses matériaux et de sa ville, il ne peut se concevoir qu’en son sein. Ses habitants, déplacés, exploités, aliénés, sont eux-mêmes des produits de la modernité industrielle. Les baraques construites avec des matériaux de récupération (morceaux de bois, de tôles, plastiques et tissus) ne sont imaginables que dans une société qui produit ces matières premières en masse.
|
Table des matières
Introduction
Le bidonville en représentation.
Entrée en matière, contexte général
Le bidonville, espace maudit du monde urbain
Le bidonville dans les années 1950 – 1970 : symbole de révolution contre l’aliénation de la culture et de l’architecture comme produits du monde moderne capitaliste
Le tournant des années 1980 : intégrer pour mieux régner ?
Learning from Buenos Aires
Histoire urbaine de Buenos Aires ,
naissance des premières inégalités
Villa 31 et 31bis, le bidonville le plus cher d’Argentine
D’informel à formel, ou de formel à informel ?
Asentamientos irregulares
Perspectives
Conclusion
Table des matières
Médiagraphie
Annexes
Télécharger le rapport complet