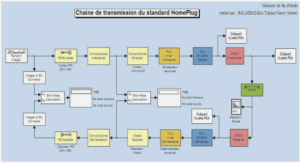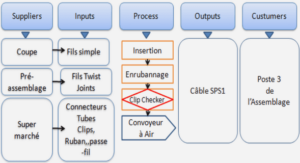Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Bourdieu et l’approche structurelle
Il faudra ensuite attendre les années 1980 pour que le capital social subisse un véritable aggiornamento marqué par une division de son approche analytique. En France, Pierre Bourdieu (1980a) développe la première approche en définissant le capital social comme : « la somme des ressources, actuelles ou virtuelles, qui reviennent à un individu ou à un groupe du fait qu’il possède un réseau durable de relations, de connaissances et de reconnaissances mutuelles plus ou moins institutionnalisées ».
Le capital social est censé représenter ainsi « la valeur des obligations sociales ou du contact créé par un réseau » au bénéfice que les individus peuvent en tirer pour eux-mêmes. « Le volume du capital social que possède un agent particulier dépend de l’étendue du réseau des liaisons qu’il peut effectivement mobiliser et du volume du capital (économique, culturel ou symbolique) possédée en propre par chacun de ceux auxquels il est lié » (Bourdieu, 1986).
Le capital social et les autres formes de capitaux
Dans son analyse des relations de domination, le capital social contribue à la reproduction des positions de pouvoir, ce qui permet de penser en termes de dynamique d’inégalité de pouvoir des acteurs et de conflits d’intérêts. Il considère ainsi le capital social comme complément contextuel du capital humain. Capital social, capital économique et capital culturel et capital humain sont présentés comme indissolublement liés dans une analyse de la société qui accorde la prépondérance, au-delà de l’habitus, aux notions de reproduction sociale et d’intérêts de classe. Le capital social n’est jamais envisagé autrement qu’à travers les relations qu’il entretient, d’une manière indissociable, avec le capital économique et le capital culturel. Il souligne que « les détenteurs d’un fort volume de capital social comme les patrons, les membres des professions libérales et les professeurs d’université s’opposent globalement aux plus démunis de capital économique et de capital culturel, comme les ouvriers sans qualification » (Bourdieu, 1994).
Capital social et reproduction sociale
Au-delà de cette analyse, on retrouve également chez Bourdieu la volonté de lier les propriétés des individus et de la société dans laquelle ils agissent. « La notion de capital social s’est imposée comme le seul moyen de désigner le principe d’effets sociaux qui, bien que saisis clairement au niveau des agents singuliers […], ne se laissent pas réduire à l’ensemble des propriétés individuelles possédées par un agent déterminé ; ces effets, où la sociologie spontanée reconnaît volontiers l’action des relations, sont particulièrement visibles dans tous les cas où différents individus obtiennent un rendement très inégal d’un capital (économique ou culturel) à peu près équivalent, selon le degré auquel ils peuvent mobiliser par procuration le capital d’un groupe […], plus ou moins constitué comme tel et plus ou moins pourvu de capital » (Bourdieu, 1980a).
Dans La Distinction (1979), il note que rien ne classe plus une personne que ses habitus. Ceux-ci expriment la position qu’occupe une personne dans l’espace social. Bourdieu remarque à ce sujet : « L’espace des positions sociales se retraduit dans un espace de prises de position par l’intermédiaire de l’espace des dispositions ou des habitus (…). À chaque classe de positions correspond une classe d’habitus produits par les conditionnements sociaux associés à la condition correspondante et, par l’intermédiaire de ces habitus et de leurs capacités génératives, un ensemble systématique de biens et de propriétés, unis entre eux par une affinité de style » (Bourdieu, 1994).
La reproduction des positions sociales s’effectue, à travers l’héritage et la transmission des différents types de capital économique, culturel et social, au sein d’une même lignée familiale. Bourdieu se réfère ainsi aux notions de reproduction et de transmission pour développer une théorie de la société : les manières d’être (habitus) que les personnes expriment dans les différents champs sociaux sont initialement apprises dans un milieu social particulier, où les individus sont nés et ont grandi, avant d’être jouées dans les différents champs de la scène sociale. La notion de capital surgit ainsi, dans sa théorie, à la jonction des interrelations dialectiques entre, d’une part, les conditions objectives et les habitus et, d’autre part, entre les habitus et les champs en tant qu’espace d’alliance et de confrontation des pratiques des différents agents sociaux (Bibeau, 2005).
Coleman et la théorie du choix rationnel
La seconde approche analytique est développée outre-Atlantique vers la fin des années 1980. Il convient de rappeler que la sociologie avait été imprégnée par les théories du choix rationnel, lesquelles remplaçaient, au niveau de la pensée et des méthodes, les théories sociales plus classiques de Talcott Parsons, Robert K. Merton et Paul Lazarsfeld (Bibeau, 2005). En effet, les champs de la sociologie américaine connaissaient jusqu’alors un partage sans faille. Parsons (1991) avait intégré dans son modèle le sociologisme fonctionnaliste d’Émile Durkheim, la pensée interprétative de Max Weber et le descriptivisme, sous forme statistique, de Pareto. Pour sa part, Merton (1949) avait synthétisé les travaux des mêmes maîtres européens dans une modélisation théorique à portée moyenne (middle-range theories1). Enfin, Lazarsfeld (1970) avait mis le néo-positivisme à la mode dans les sciences sociales américaines, en jetant les bases de ce que l’on appelle aujourd’hui la macrosociologie. Il avait ainsi lancé la mode des vastes enquêtes statistiques. Les trois maîtres de la sociologie américaine avaient bien évidemment exclu la pensée marxiste jugée « déplacée » dans le contexte américain. Bourdieu écrivait d’ailleurs à ce propos non sans ironie : « Le discours sociologique des années 50 et 60 réussissait le tour de force consistant à parler du monde social comme si on n’en parlait pas (…) Il suffit de lire les revues américaines des années 50 : la moitié des articles étaient consacrés à l’anomie, aux variations empiriques ou pseudo-théoriques sur les concepts fondamentaux de Durkheim, etc. C’était une sorte de radotage scolaire et vide sur le monde social, avec très peu de matériel empirique. (…) Heureusement, il y avait des exceptions, comme l’École de Chicago, qui parlait des slums, de la Street Corner Society, qui décrivait des bandes, ou des milieux homosexuels, bref, des milieux et des gens réels. Mais, dans le petit triangle Parsons-Lazarsfeld-Merton, on ne voyait rien » (Bourdieu, 1987).
Putnam et la culture civique
Plus récemment, à la fin des années 1990, Robert D. Putnam, professeur à Harvard, a donné un nouvel élan au capital social en définissant le concept comme les réseaux qui connectent entre eux les membres d’une société et les normes de réciprocité et de confiance qui en découlent. En référence aux travaux de Coleman, sa thèse suggère toutefois que le capital social peut présenter des externalités positives mais également négatives. Il convient donc d’identifier, de mesurer et de favoriser le développement des formes de capital social bénéfiques à l’individu et à la société en général. Cette approche du capital social provoquera de très nombreuses réactions parmi les chercheurs en sciences sociales et le nombre des publications consacrées au capital social connaîtra dès lors une véritable explosion (Bevort et al., 2006). En se positionnant dans une perspective culturelle, Putnam se distingue de l’approche du choix rationnel développée préalablement par Coleman.
Making Democracy Work et la culture civique
Initialement, Putnam est un politologue dont les travaux se fondent sur la recherche des facteurs déterminant les performances démocratiques des sociétés. A cet égard, il considère la culture civique des sociétés comme le facteur explicatif fondamental. Elle se caractérise par une société dans laquelle les citoyens sont disposés à la confiance, à la solidarité et manifestent un intérêt pour les affaires publiques. Pour l’auteur, la vie associative fait émerger les normes de réciprocité qui permettent aux sociétés de bien fonctionner. Les associations constituent l’essentiel de ce qu’il appelle les réseaux. La vie associative est au cœur d’un processus qui génère à la fois civisme, coopération et efficacité des institutions.
Dans Making Democracy Work (1994), Putnam présente les résultats d’une investigation approfondie, engagée dans les années 1970, sur les performances institutionnelles des 20 régions administratives italiennes. Il remarque que les gouvernements régionaux du nord de l’Italie affichent des bilans bien plus positifs que ceux du sud de la péninsule. Les régions situées au nord connaissent des gouvernements locaux stables, fiables et efficaces, pour la plus grande satisfaction de leurs administrés. Il explique cette différence par le niveau d’engagement civique des populations. Au nord, les populations participent à la vie associative, notamment dans les chorales, les cercles littéraires et les clubs de football. Ils portent un fort intérêt pour les affaires publiques, illustré par la lecture des journaux et la participation électorale. Au contraire, dans les régions du sud, la sociabilité est très faible et la corruption et le clientélisme ont infesté la vie politique.
L’histoire montre que les origines de ces configurations sont déjà anciennes : au XIVème siècle, les régions du nord étaient dotées de nombreux réseaux (guildes de marchands, fraternités, coopératives et associations de voisins), qui n’existaient pas dans les régions du sud. Pour Putnam, la présence d’une communauté civique est aux fondements de l’explication. La qualité de la démocratie, sous l’angle de l’efficacité des institutions, et le niveau de développement économique sont le produit de dynamiques vertueuses impulsées dès le Moyen-Age. Il souligne : « If the civic community associations proliferate, memberships overlap, and participation spills into multiple arenas of community life » (Putnam et al., 1994).
Making Democracy Work pose ainsi les fondements de la théorie du capital social, laquelle établit une corrélation entre l’engagement civique et les performances sociales, institutionnelles et économiques. Pour Putnam, une société forte se reconnaît à la quantité de son capital social défini alors comme « those features of social organization, such as trust, norms and networks that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions » (Putnam et al., 1994).
La société civile issue de la confiance
La thèse de Putnam est ainsi organisée autour de l’idée qu’il existe des liens directs entre capital social et vie démocratique. Les sociétés à faible capital social (le sud de l’Italie) seraient moins en mesure que les sociétés à fort capital social (le nord de l’Italie) de générer les vertus civiles associées à la vie démocratique. Il explique que, dans les régions situées au sud, des familles aristocratiques ambitieuses auraient contrôlé et exploité les populations locales. Des groupes mafieux, tels que la Camorra ou la Mafia, auraient infesté l’économie et la vie politique de la région, créant un déficit démocratique majeur qui aurait empêché le développement d’une société civile dans le Mezzogiorno. Au contraire, dans le nord, une véritable société civile se serait historiquement mise en place, avec des communes autonomes, des associations de citoyens qui ont contrôlé le pouvoir des familles aristocratiques et ont permis de faire apparaître un gouvernement vraiment démocratique. Les sociétés civiles fortes ne se retrouvent, selon Putnam, que dans les pays, régions et localités où les citoyens ont confiance les uns dans les autres. Il s’agit de sociétés dans lesquelles les individus ne trompent pas les étrangers. Les pots-de-vin sont inexistants. Le bénévolat est encouragé comme une forme de participation citoyenne.
Putnam place ainsi la confiance entre les citoyens au cœur de sa définition du capital social. Pour lui, les relations entre les individus, les réseaux familiaux, les associations locales et les institutions politiques de proximité sont liés dans un vaste ensemble qui remplit une fonction de relais vers l’État. Pour Putnam, il existe d’autant plus de société civile dans une localité, une région ou un pays que les citoyens ont davantage à cœur de faire fonctionner leurs communautés de base, qu’il s’agisse de villages ou de quartiers urbains et qu’ils s’efforcent de le faire ensemble, sans attendre que l’État ne vienne solutionner leurs problèmes. La source du capital social se trouve dans les dispositions d’esprit et les attitudes qui engendrent et soutiennent les habitudes sociales, interpersonnelles et politiques des citoyens et qui les poussent à prendre en main le fonctionnement de leurs communautés.
Bowling Alone et le capital social
Dans Bowling Alone (2001), Putnam reprend la même analyse et l’applique aux États-Unis. Le constat est sans appel. Les pratiques associationnistes ont tendance à disparaître. La société civile s’affaiblit dans son ensemble. Le capital social des citoyens s’est appauvri. Il démontre qu’au cours des trois dernières décennies, il y a eu un changement fondamental dans l’engagement politique et civique. La participation électorale, la confiance politique et l’activisme politique au niveau local ont diminué. Dans les associations, l’adhésion et la participation ont chuté très rapidement. Par ailleurs, les liens sociaux informels se sont transformés. La sociabilité des américains, tellement appréciée, s’effrite peu à peu. Enfin, les niveaux de confiance sont en chute libre. Pour Putnam, cela ne fait aucun doute : l’affaissement du capital social correspond au prix qu’a dû payer la société américaine pour faire accéder une large classe moyenne à la prospérité et créer une plus grande tolérance à l’égard des personnes et des groupes porteurs d’une différence. Putnam a avancé d’autres raisons, plus contextuelles, pour expliquer le déclin de l’engagement social chez les Américains : ceux-ci passeraient trop de temps au travail et regarderaient trop la télévision.
Fukuyama, la confiance et les valeurs
Francis Fukuyama (1995, 2000) a repris la définition proposée par Putnam mais en la rapprochant davantage de l’approche de Coleman. Dans Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995) et The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order (2000), il analyse le processus du retour des valeurs morales, de la reconstruction d’un nouvel ordre social fondé sur la solidarité. Il entrevoit la réorganisation du monde du travail et le développement d’une société civile prospère ancrée dans la pratique des vertus sociales chez les citoyens.
Fukuyama pose la notion de capital social au centre de son analyse de la reconstruction, à l’âge postindustriel, de la société américaine. Il identifie le capital social à la coopération, à la confiance et à la solidarité au sein des communautés comme autant de valeurs qui servent de ciment à la construction d’une société libre, pluraliste et tolérante. Il écrit à ce propos : « It is to get around the problem of cultural relativism that this book concentrates not on cultural norms writ large, but on a certain subset of norms that constitute social capital. Social capital can be defined simply as a set of informal values or norms shared among members of a group that permits cooperation among them. If members of the group come to expect that others will behave reliably and honestly, then they will come to trust one another. Trust is like a lubricant that makes the running of any group or organization more efficient » (Fukuyama, 2000).
La confiance repose sur des valeurs partagées
Pour Fukuyama, le capital social se confond avec les valeurs partagées d’une communauté. Comme le capital physique et le capital humain, le capital social produit de la richesse et de la valeur à l’économie d’une nation. Il formule une hypothèse : la capacité d’une nation à développer les institutions qui la rendent puissante et performante dépend de l’aptitude à la confiance de sa population, aptitude qui trouve son origine dans les valeurs inhérentes à la culture : « L’une des leçons majeures que l’on puisse tirer de l’étude de la vie économique c’est que la prospérité d’une nation et sa compétitivité sont conditionnées par une seule et unique caractéristique culturelle omniprésente : le niveau de confiance propre à la société » (1995).
Le monde se divise ainsi entre les pays dont le niveau de confiance est élevé et des pays dont le niveau de confiance est bas. L’Allemagne, le Japon et jusqu’à très récemment les États-Unis sont des pays particulièrement bien dotés en confiance. Les individus forment une véritable communauté culturelle. Au contraire, l’Italie, la France, ou certaines minorités ethniques aux États-Unis souffrent d’un déficit de confiance. Plus précisément, leur culture ne leur permettrait pas de développer la confiance. Ainsi, si les acteurs ne parviennent pas à partager de communauté culturelle, ils se privent d’opportunités économiques. Cela signale un déficit de capital social, lequel dépend « des normes et des valeurs partagées par les communautés, mais aussi de la disposition des individus à subordonner leurs intérêts à ceux de groupes plus larges. De ces valeurs partagées naît la confiance » (1995).
Le capital social émerge de la confiance
Fukuyama (1995) définit la confiance comme « l’attente qui naît, au sein d’une communauté, d’un comportement régulier, honnête et coopératif, fondé sur des normes communément partagées ». Elle permet de s’associer avec d’autres, et de « travailler ensemble à des fins communes au sein des groupes et organisations qui forment la société civile ». Elle est aux fondements d’une « sociabilité spontanée » qui permet le développement des relations sociales, et par conséquent la création de capital social. Pour Fukuyama (1995), le capital social se définit comme :
« Un actif qui naît de la prédominance de la confiance dans une société ou certaines parties de celle-ci. Il peut s’incarner dans la famille, le groupe social le plus petit et le plus fondamental, aussi bien que dans le plus grand de tous, la nation, comme dans tous les autres corps intermédiaires. Le capital social diffère des autres formes de capital en ce qu’il est habituellement créé et transmis par des mécanismes culturels comme la religion, la tradition ou les habitudes historiques ».
L’apport des sociologues des réseaux au capital social
Dans la lignée de Bourdieu, Granovetter (1985) estime que le cadre néo-classique décrit une conception sous socialisée de l’homme qui voit l’individu comme un être atomisé, anonyme, et privé de toute influence sociale à travers ses relations. En d’autres termes, ce cadre ignore le rôle des interactions sociales, en dehors du marché, dans la détermination individuelle et collective de comportements qui conditionnent les évolutions économiques et sociales.
Au contraire, pour Granovetter, les actions économiques sont encastrées dans les relations sociales. Cette notion d’encastrement signifie que « […] l’action est toujours socialement située et ne peut pas être expliquée en faisant seulement référence aux motifs individuels, et [deuxièmement] que les institutions sociales ne jaillissent pas automatiquement en prenant une forme incontournable, mais sont « construites socialement » (Granovetter, 1990).
C’est dans ce courant que l’étude des réseaux sociaux va donner lieu à une conceptualisation du capital social. Pour Granovetter, il existe deux types de réseau selon la nature du lien qui unit les individus : les liens faibles et les liens forts. Il distingue ainsi les relations profondes et soutenues que l’on a par exemple avec des amis proches – des liens forts – et les relations plus distendues que l’on a avec des connaissances – les liens faibles.
La force d’un lien est ici définie comme « une combinaison (probablement linéaire) de la quantité de temps, de l’intensité émotionnelle, de l’intimité (la confiance mutuelle) et des services réciproques qui caractérisent ce lien » (Granovetter, 1973). Les liens faibles permettent d’agir comme des ponts entre divers réseaux de liens forts, ce qui permet de diversifier et d’accroître les sources d’information. Ces sources d’information seraient inaccessibles en leur absence dans la mesure où la plupart des réseaux, articulés autour de liens forts, tendent à être constitués de personnes aux caractéristiques proches.
La distinction entre ces deux types de lien est fondamentale dans la compréhension de la mise en forme de la notion d’encastrement et par la suite dans l’élaboration du concept de capital social par Nan Lin (1995) et Ronald Burt (1995). Cette distinction permet en effet de faire ressortir au moins deux sortes d’encastrement : l’encastrement relationnel et l’encastrement structurel. Le premier type d’encastrement indique que selon le type de liens que partagent les individus, leurs actions vont être différentes. Le deuxième type d’encastrement indique que les réseaux de liens forts sont en relation et s’influencent les uns avec les autres grâce aux réseaux de liens faibles.
Le réseau de relations
L’étude des réseaux sociaux va permettre l’analyse, en tant que structure, des interdépendances, des régularités et des contraintes des relations. Dans cette structure, les choix de l’acteur sont non seulement possibles, mais se traduisent par la mise en œuvre de stratégies de construction de son réseau de relation (Mercklé, 2004). Le réseau de relation est souvent représenté au niveau de l’individu comme l’ensemble des ressources auxquelles il a accès ou qu’il peut mobiliser. Dans la mesure où le réseau de relation est selon Lin (1995), une structure où les positions sont hiérarchisées selon les ressources détenues par les individus, plus il y aura de niveaux au sein de la structure, plus celle-ci sera grande et plus les opportunités seront importantes. Les liens faibles jouent ici un rôle de pont, permettant aux acteurs d’accéder à des ressources détenues par des individus qui occupent des positions à un autre niveau de la structure, notamment des positions plus élevées.
L’approche de Lin se situe dans la perspective des actions instrumentales, c’est-à-dire engagée dans un objectif. Les ressources sociales sont ainsi un moyen de parvenir à cet objectif, c’est-à-dire d’acquérir des positions ou de se rapprocher d’acteurs occupant des positions plus élevées. Il y a donc ici deux idées : celles de position et aussi celle d’une action, consistant à rechercher un point d’accès aux ressources. Il y a également une troisième idée, celle d’échange : « L’un des présupposés de l’usage des ressources sociales est l’obligation de réciprocité ou de compensation » (Lin, 2002).
Pour Lin, les « ressources sociales constituent l’élément central du capital social ». Mais le capital social résulte de l’« investissement d’un individu dans ses relations avec d’autres » (1995). Entre ressources et relations, Lin définira un capital social à deux niveaux : individuel et collectif (Ponthieux, 2004).
Le capital social et les trous structurels
L’approche de Burt (1995) se distingue de celle proposée par Lin. Pour lui, le capital social relève à la fois des ressources relationnelles détenues par les acteurs et de la structure des relations dans le réseau. Il développe ainsi la notion de « trou structurel » pour représenter une position caractérisée par l’absence de relations entre acteurs équivalents. Ces trous représentent pour les individus des occasions de se poser en intermédiaire et de bénéficier de cette position. Le capital social se comprend alors par le fait de profiter d’informations que les autres n’ont pas, de contrôler leurs actions sans que les siennes soient contrôlées, que les autres doivent passer par lui. Ainsi, si le réseau est grand et peu dense, avoir du capital social est très important pour tirer profits de son capital financier et humain.
Les deux types d’avantages liés au capital social dépendent de l’importance des trous structuraux dans le réseau d’un individu. Burt (1995) utilise ce terme pour désigner la séparation entre deux contacts non-redondants. Les contacts non-redondants sont connectés par un trou structural. Des contacts sont redondants s’ils se connaissent directement ou si, indirectement, ils sont en situation d’équivalence structurale ; c’est-à-dire s’ils connaissent les mêmes personnes. La non-redondance des contacts assure des bénéfices en termes d’information et de contrôle.
Les bénéfices informationnels dépendent de la nature du réseau relationnel. Un individu sera plus ou moins bien informé des meilleures opportunités d’investissement. De manière générale, la qualité du réseau se mesure à l’aune des bénéfices informationnels qu’il procure : savoir, et savoir vite, fait toute la différence. Cette qualité dépend de la sélectivité des contacts (connaître la bonne personne) mais aussi de leur nombre. Au-delà de l’information, le taux de retour sur investissement dépend également de la capacité d’un individu à s’assurer de la réalisation de ces opportunités.
Capital social et cohésion sociale
Le capital social trouve également une place spécifique dans le débat désormais classique qui oppose penseurs libéraux et communautariens. De tous temps, les philosophes n’ont eu cesse de s’interroger sur la nature du meilleur contrat politique. La pensée libérale considère qu’il n’existe aucune volonté essentielle des individus de vivre ensemble. Ceux-ci développeraient le sens du bien commun parce qu’ils y ont rationnellement intérêt. A l’opposé, les philosophes de la tradition républicaine classique, croyant davantage en la capacité de transformation de l’être humain, préfèrent imposer une éducation des citoyens aux vertus civiques. Celles-ci sont censées orienter les individus dans leur recherche du sens de l’appartenance à une société, à son histoire et à sa culture.
Le contexte de la crise économique des années 1980 et la percée des thèses néo-libérales ont indirectement influencé les termes du débat. En incitant à un désengagement de l’État de certains aspects de la vie sociale et en provoquant un vaste mouvement de régionalisation et de décentralisation des pouvoirs vers les autorités locales, les politiques néolibérales des années 1980 ont parallèlement encouragé le développement de la société civile afin de favoriser une implication et une responsabilisation de chacun dans la vie politique, économique et sociale tout en essayant de maintenir le sens de la solidarité et des liens entre citoyens. Peter Hall (2004), dans son étude sur le capital social en Grande Bretagne, rappelle que les politiques gouvernementales n’ont eu de cesse de favoriser le développement de l’engagement citoyen et du bénévolat : «Since the beginning of the twentieth century, British governments have made substantial efforts to cultivate the voluntary sector, notably by using it to deliver social services to a degree that seems stricking in cross-national terms. »
Le rôle attribué à la société civile a trouvé un écho favorable dans la pensée communautarienne. En effet, on trouve chez les philosophes communautariens l’idée que l’individu est une personne qui construit son identité dans l’interaction avec ses semblables et la reconnaissance des autres membres de la collectivité. Toute identité se définit ainsi dans un contexte socio-culturel mais également par le soutien réciproque et interactif avec le groupe, la communauté ou la société (Taylor, 1998). Dans cette même lignée, Walzer (1980) soutient que les intérêts et les décisions d’un individu dépendent de ses attaches sociales, notamment à sa communauté de vie, étant donné qu’il se constitue comme personne dans et par rapport à un milieu social concret et historique. L’identité émerge ainsi d’un contexte socio-historique mais aussi de l’expérience vécue en société. Les organisations locales constituent les lieux où se forgent la notion de responsabilité mutuelle et le sens civique. Ainsi, pour les communautariens, la vie associative constitue le ferment de cette forme de participation créant un sens du bien commun et donnant une réalité au lien politique et citoyen.
Mais la société civile comme lieu d’apprentissage de l’identité et de la citoyenneté trouve également sa place dans le discours des tenants du capital social. En effet, les réseaux, les normes et la confiance facilitent l’action collective et permettent la collaboration et la réciprocité ainsi que les bases de l’interaction entre les individus. Le Tiers secteur devient 53
ainsi le terrain propice au développement de l’identité. La participation à la vie associative développe parmi les individus le sens des intérêts et des enjeux communs, le sens de la réciprocité et du vivre ensemble. Les relations de proximité constituent une meilleure prise en compte des individus. La confiance et la connectivité sont les dimensions qui illustrent la multiplication des relations sociales utiles à l’apparition d’un sens d’intérêt collectif et d’appartenance. Le sens du vivre ensemble dépend de la densité des relations sociales tissées au sein du milieu de vie. Et la participation à des réseaux à l’échelle de la parenté, du voisinage, des milieux de travail et de loisir et des affiliations culturelles, religieuses, politiques deviennent des indicateurs d’insertion sociale positifs (Helly, 1999).
La grille d’analyse que nous offre le capital social sur le thème de la cohésion sociale présente l’intérêt spécifique d’établir un pont entre libéraux et communautaristes sur un sujet sur lequel ils sont traditionnellement opposés. Les deux courants s’accordent de fait sur l’importance du rôle du capital social dans les conditions nécessaires au renforcement de la cohésion sociale. En d’autres termes, le capital social identifie et apporte un fondement théorique au champ de la société civile en proposant une grille d’analyse des relations non marchandes. Toutefois, comme Kath (2004) le souligne, en s’attachant aux facteurs sociaux tels que les normes, la confiance et la réciprocité, le capital social remet en question la pertinence du modèle libéral centré sur la seule perspective économique pour expliquer le développement des pays les plus pauvres.
D’une manière générale, le capital social contribue au débat sur le type de société dans lequel nous souhaitons vivre mais il incite également à approfondir la réflexion sur la nature de la relation que l’individu doit entretenir avec la société.
Capital social et performance économique
Les travaux autour de la notion de capital social ont également ambitionné d’apporter un cadre analytique permettant d’étudier les relations diverses entre phénomènes économiques et sociaux. Impulsés par les contributions de Coleman et Putnam, ces travaux appréhendent l’impact des mécanismes sociaux sur l’activité économique. Bien que la notion de capital social en France soit largement associée à la sociologie de Bourdieu, ses racines puisent également dans les travaux d’économistes. Il s’agit pour l’essentiel d’économistes qui se rattachent à l’école néo-libérale ou plus simplement au libre marché, tels Becker, Putnam ou Stiglitz.
Gary Becker fut notamment distingué, par le Prix Nobel d’économie en 1992, pour ses recherches sur l’application de la théorie économique à toutes sortes de comportements humains, y compris ceux qui n’étaient pas considérés jusque-là comme relevant du champ économique. Dans son discours de récipiendaire, il déclarait : « Mes travaux ont recours à l’approche économique pour analyser des questions sociales qui vont au-delà de celles généralement traitées par les économistes ». Pour Becker, les individus optimisent à la marge leurs choix économiques, mais aussi leurs choix sociaux, en maximisant leur bien-être.
La notion de capital social peut se rattacher à sa théorie de la « conduite altruiste ». Becker (1974; 1988) dirige en effet ses recherches sur l’utilité de liens non égoïstes au sein d’une famille, et entre groupes d’individus n’appartenant pas à la même famille. Des gains universels qui s’attachent à cette conduite altruiste, il tire une théorie du « cercle vertueux », qui conduirait selon lui les individus à multiplier les liens non-égoïstes entre eux, au-delà de leur appartenance à telle ou telle classe de la société pour maximiser leur bien-être. Au-delà de cette vision d’une conduite vertueuse spontanée, Becker développe une réflexion sur le rôle des institutions publiques, qui se substitueraient à des comportements individuels, et créeraient un « altruisme artificiel ». La redistribution des richesses par le biais de l’impôt et des subventions est une forme de cet altruisme volontairement et artificiellement créé par l’État ou les collectivités.
Par ailleurs, les recherches initiales de Putnam sur le fonctionnement des institutions en Italie en 1993, puis sur les États-Unis, ont mis en évidence un lien entre la société civile d’une part, et la performance économique et politique d’autre part :
» Les stocks de capital social comme la confiance, les normes et les réseaux tendent à s’auto-renforcer et à être cumulatifs. Les cercles vertueux ont pour effet des niveaux d’équilibre sociaux avec de hauts niveaux de coopération, de confiance, d’engagements de réciprocité civique et de bien-être collectif…L’absence de fiabilité, le manque de confiance, l’exploitation, l’isolement, le désordre et la stagnation se nourrissent les uns des autres dans les miasmes étouffants des cercles vicieux » (Fine, 2000).
Le risque de cercle vicieux, de dérive, attaché à la notion de capital social que décrit Putnam a été étudié par certains économistes. L’utilisation du capital social à des fins perverses est en particulier l’objet de recherches sur la corruption (Rubio, 1997). D’autres chercheurs ont plutôt mobilisé le concept de capital social pour éclairer leur vision de l’économie globale (Fukuyama, 1995, 2000). Ce dernier met en particulier l’accent sur l’importance des valeurs non rationnelles comme la solidarité, la culture et la tradition dans la réussite future des sociétés modernes.
Le capital social en mesures
La mesure du capital social n’est pas un exercice aisé. Comme pour sa partie théorique, la recherche empirique est en perpétuel avancement. Toute approche consiste à trouver un outil qui permet de mesurer un concept, lequel est par nature multidimensionnel. En toute logique, la construction d’un tel instrument de mesure doit corroborer les éléments retenus pour la définition du capital social.
Les premiers essais de construction d’outils de mesure ont été abondamment critiqués. Certes, les études empiriques choisissaient des variables et des indicateurs en fonction des dimensions retenues par le chercheur mais également et peut-être surtout selon la disponibilité de données fiables. Stone (2002) indique que bon nombre de recherches menées sur le capital social se sont révélées inopérantes car les données utilisées provenaient d’études antérieures conduites à d’autres fins que celle de l’analyse du capital social. Conséquemment, elles étaient impropres à la construction d’un outil capable de mesurer le concept.
De la même façon, Paxton (1999) note que les études empiriques, en utilisant des indicateurs inadaptés, n’ont pu établir de lien évident entre la théorie et la mesure du capital social. Elles ne parviendraient pas à mesurer le capital social en tant que tel mais se limiteraient à en mesurer ses effets. Par exemple, le fait de voter devrait être considéré comme un produit du capital social alors que les études considèrent généralement la participation électorale comme une composante du capital social.
D’autres limites dans les techniques de mesure ont pu être identifiées. La plupart des études n’abordent qu’un traitement quantitatif du capital social, en négligeant ses aspects qualitatifs, alors que les deux approches sont nécessaires pour révéler son impact (Nombo, 2008). Elles mesurent souvent le capital social en agrégeant des réponses individuelles alors que le concept est présenté comme un bien collectif.
Parallèlement, les recherches ne distinguent généralement pas les différentes formes (bonding, bridging, linking) du capital social identifiées dans sa conceptualisation (Stone et al., 2002). Enfin, la prédominance d’une analyse de l’influence micro-individuelle dans laquelle le capital social est pensé au travers des caractéristiques personnelles des individus ignore l’impact des forces macrosociales sur le concept (Patulny, 2004).
De fait, dans le débat conceptuel, la question de la mesure du capital social a surgi tardivement alors qu’il aurait sans doute était préférable de la traiter de manière concomitante. Il s’agit pourtant d’un point incontournable pour qui veut démontrer l’existence du capital social et a fortiori en comparer le niveau entre différents pays. En tout état de cause, la question se pose aujourd’hui en deux parties : que faut-il mesurer et comment y parvenir?
A partir des problèmes identifiés, l’OCDE (Healy and Côté, 2001) recommande une certaine prudence : « The difficulties involved in measuring social capital need to be recognised. Sources, functions and outcomes may be confused in the desire to measure. Much of what is relevant to social capital is tacit and relational, defying easy measurement or codification. Individual attitudes (eg. trust) or behaviour (eg. joining organisations or voting) provide proxy measures of social capital, but these measures should not be confused with the underlying concept. Attempts to capture key dimensions of how people interact and relate to each other are hampered by the lack of suitable data sources. This in turn reflects the absence of a sufficiently comprehensive range of questions in survey questionnaires, and the fact that surveys are not designed to assess social capital per se. Hence, sources of data on social capital at the international level are difficult to obtain. »
Un certain nombre d’organisations nationales et internationales ont entrepris des initiatives de recherche sur le capital social. Leur positionnement par rapport aux grands modèles conceptuels qui dominent actuellement le champ de recherche sur le capital social n’est pas toujours explicite. Mais il est possible de distinguer quelques approches principales, leurs implications sur l’opérationnalisation du concept et le choix des instruments de mesure.
Les échelles retenues pour analyser le capital social diffèrent amplement dans les études déjà réalisées. Certaines portent sur le niveau de capital social d’une petite collectivité (Kreuter et al., 1999), d’autres comparent des provinces, des régions ou des États d’un même pays (Putnam, 2001), d’autres, enfin, utilisent les pays comme unités d’analyse comparative (Putnam, 2002). En outre, les recherches sur le capital social mettent un fort accent sur l’analyse comparée.
Les mesures nationales
Dans Bowling Alone (2001), Putnam utilise une mesure qui consiste en un indice composite qui résulte de la moyenne de 14 indicateurs combinant des réponses individuelles et données agrégées, groupées en cinq dimensions :
– la vie organisationnelle de la communauté compte la proportion de personnes ayant participé, l’année précédente, au comité d’une organisation locale, celle des personnes qui ont été membres du bureau d’un club, association ou organisation, et le nombre d’organisations civiques ou sociales pour 1000 habitants, le nombre moyen de réunions dans un club l’année passée, et le nombre moyen d’adhésions à un groupe, club, association ;
– l’engagement dans les affaires publiques est mesuré par la participation aux élections (1988 et 1992), et le nombre moyen de réunions publiques locales auxquelles les personnes ont assisté ;
– l’engagement bénévole communautaire est mesuré par le nombre d’organisations sans but lucratif pour 1000 habitants, le nombre moyen d’heures consacrées à un projet communautaire l’année passée, et le nombre moyen d’interventions bénévoles l’année passée ;
– la sociabilité informelle combine la proportion de personnes déclarant « avoir passé beaucoup de temps avec des amis l’année passée », et le nombre moyen de réceptions organisées à la maison l’année passée ;
– la confiance sociale est mesurée par les proportions de personnes déclarant que «l’on peut faire confiance à la plupart des gens », et que « la plupart des gens sont honnêtes».
Dans chacun des États américains, les indicateurs ont ainsi permis de mettre en évidence une érosion du capital social sur les 30 dernières années.
En 1999, the Saguaro Seminar, à l’initiative de Putnam, a consacré un atelier à la mesure du capital social. Il a lancé une large enquête intitulée « Social Capital Community Benchmark Survey (SCCBS) ». Cette enquête, réalisée entre 2000 et 2002 dans 41 communautés à travers les États -Unis, était fondée sur la mesure de cinq dimensions :
– la confiance
– les réseaux informels
– les réseaux formels
– l’engagement politique
– l’égalité d’engagement civique à travers le pays
Parallèlement, en Grande Bretagne, Hall (2004) menait une recherche similaire en se fondant sur cinq dimensions mesurables :
– l’adhésion aux associations
– le volontariat
– les actions de générosité (charitable endeavours)
– la sociabilité informelle
– la confiance sociale
Cette recherche n’a pas révélé de baisse significative du niveau de capital social en Grande Bretagne depuis la Seconde guerre mondiale.
Au Royaume-Uni, l’Office of National Statistics (ONS) s’est étroitement inspiré de la définition de l’OCDE afin de mettre de l’avant une approche macro du capital social qui s’appuie sur sa valeur d’intégration sociale. Aussi, le capital social y est-il vu comme un résultat en soi, un bénéfice collectif résultant de divers aspects de la vie des personnes notamment leurs activités associatives.
Cinq dimensions principales du capital social sont identifiées :
– la participation et l’engagement social;
– le contrôle et la maîtrise de soi;
– les perceptions relatives au milieu de vie;
– les interactions sociales, les réseaux sociaux et le soutien social; et
– la confiance, la réciprocité et la cohésion sociale.
Les interrelations entre ces dimensions ne sont pas conceptualisées à partir d’un cadre unique de sorte qu’au plan de la mesure, l’approche préconisée est plutôt pragmatique. Elle consiste en un inventaire systématique des données provenant de plusieurs enquêtes reliées à l’une ou l’autre de ces dimensions et compilées au sein d’une matrice servant d’outil de référence.
|
Table des matières
Remerciements
Résumé
Résumé en anglais
Liste des tableaux
Liste des figures
Liste des annexes
Introduction
Première partie Revue de littérature
1 Le capital social
1.1 Les définitions du capital social
1.1.1 Bourdieu et l’approche structurelle
1.1.2 Coleman et la théorie du choix rationnel
1.1.3 Putnam et la culture civique
1.1.4 Fukuyama, la confiance et les valeurs
1.1.5 L’apport des sociologues des réseaux au capital social
1.1.6 Analyse critique des définitions
1.2 Les contributions du capital social
1.2.1 Capital social et démocratie
1.2.2 Capital social et cohésion sociale
1.2.3 Capital social et performance économique
1.3 Le capital social en mesures
1.3.1 Les mesures nationales
1.3.2 Les mesures internationales
1.3.3 Les mesures des études thématiques
1.4 Les critiques du capital social
1.4.1 Critiques conceptuelles
1.4.2 Critiques sur la nature capitalistique
2 La philanthropie
2.1 Du don rituel à la philanthropie moderne ?
2.2 Charité et philanthropie : traditions religieuses et gréco-romaine
2.2.1 La Tsédaka dans le judaïsme
2.2.2 La charité chrétienne
2.2.3 La charité dans l’islam
2.2.4 La tradition gréco-romaine
2.3 Une approche structurelle et institutionnelle de la philanthropie
2.3.1 Première période : sécularisation progressive de la charité au 17ème siècle
2.3.2 Deuxième période : Philanthropie et capitalisme financier au 18ème siècle
2.3.3 Troisième période : L’esprit philanthropique face à l’Etat au 19ème siècle
2.3.4 La quatrième période : La philanthropie scientifique au 20ème siècle
2.3.5 Cinquième période : philanthropie de masse et mondialisation au 21ème siècle
3 L’identité – Une approche interactionniste
3.1 L’interactionniste symbolique
3.2 Formation des identités
3.3 Lien social et réciprocité
3.4 Identité et territoires
3.5 Capital social, connectivité et identité
3.6 Identité et lien social
3.7 Individu désarticulé ou réticulé
4 La société civile
4.1 Le Tiers secteur, une perspective nord-américaine
4.1.1 Les courants théoriques du Tiers secteur
4.1.2 Les typologies du Tiers secteur
4.1.3 Définition du JHCNSP
4.1.4 L’expansion du Tiers secteur
4.1.5 La critique du Tiers secteur
4.2 L’économie sociale, une perspective européenne
4.2.1 Les définitions de l’économie sociale
4.2.2 Les composantes de l’économie sociale
4.2.3 Analyse critique de l’économie sociale
Deuxième partie Philanthropie, capital social et identité : analyse empirique
5 Le cadre théorique
5.1 Les caractéristiques du capital social
5.1.1 Les formes
5.1.2 Les sources
5.1.3 Les effets
5.2 Les approches traditionnelles
5.2.1 L’approche micro
5.2.2 L’approche méso
5.2.3 L’approche macro
5.3 Les dimensions classiques du capital social
5.3.1 Les réseaux
5.3.2 Les normes
5.3.3 La confiance
5.4 Repenser le modèle théorique du capital social
5.4.1 L’analyse réticulaire
5.4.2 L’analyse fonctionnaliste
5.4.3 Un filtre institutionnel
5.5 Méthodologie
5.5.1 Problématique et hypothèses
5.5.2 Conceptualisation : Définitions et dimensions
5.5.3 Construire un instrument de mesure du capital
5.5.4 Les avantages d’une approche intégrée et stratégique
5.5.5 Démarche méthodologique
5.5.6 Le choix du terrain
5.5.7 Partir de données brutes
6 Résultats et discussion
6.1 La philanthropie à l’aune du capital social
6.1.1 Sélection de données issues du JHCNSP
6.1.2 Traitement des données
6.1.3 Présentation des résultats
6.1.4 Premiers enseignements
6.2 La philanthropie comme mode de représentation des identités
6.2.1 Philanthropie, identité et capital social : une approche culturelle
6.2.2 Sélection et traitement des données du WVS
6.2.3 Présentation des résultats et premiers enseignements
6.3 Discussion
6.3.1 La Nouvelle sociologie économique
6.3.2 La sociologie relationnelle
6.3.3 L’analyse réticulaire de l’encastrement de l’économie
6.3.4 Sociabilité, réseaux, liens et capital social
6.3.5 L’analyse culturelle du marché
6.3.6 Le capital social dans l’économie sociale
6.3.7 Le capital social en entreprise
6.3.8 Le capital social comme facteur organisationnel
6.3.9 Le capital social comme générateur de sens
Conclusion
Résumé
Résumé en anglais
Télécharger le rapport complet