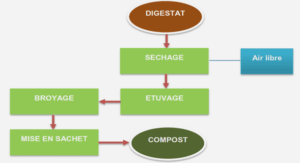Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Marchés de masse et consommation
La posture presque inverse se trouve par exemple chez Stuart Ewen39. À l’instar des deux précédents auteurs, Ewen porte son regard sur l’action des entreprises dans l’instauration des marchés de masse mais pour en faire une critique impitoyable. L’ouvrage accuse les entreprises industrielles d’avoir fait grossir artificiellement la sphère de la consommation pour écouler la production issue de capacités productives devenues colossales. À la fin des années 1920, 2/3 du revenu national passait ainsi par le circuit de distribution de détail pour des biens qui un siècle plus tôt étaient produits dans la sphère domestique40.
Un seul agent de changement est, chez Ewen, responsable de cette situation : la publicité. Mais la publicité ne se montre pas seulement d’une formidable efficacité pour vendre les produits, elle transporte aussi une idéologie corrosive qui défait les anciens liens familiaux, dissout les solidarités traditionnelles et les identités façonnées par l’appartenance à une classe sociale. Pourtant ce pouvoir de la publicité n’est pas démontré : que la publicité fasse réellement ce qu’elle prétend faire n’est jamais questionné mais au contraire considéré comme une évidence. Pour cette raison, d’ailleurs, ceux qui sont devenus malgré eux des consommateurs et dont Ewen prend la défense sont singulièrement absents du livre : la puissance d’effet de la publicité permet d’analyser la transformation exercée sur ceux que la publicité vise, sans enquête sur les pratiques effectives. Ces lourdes limites mises de côté, il reste que Ewen met en évidence, de façon très convaincante, l’invention d’une sorte de grammaire publicitaire de la production du désir, fondée sur l’activation du mécanisme de l’imitation41. Le discours publicitaire est, en effet, articulé de telle sorte qu’il met les produits en situation et déjà « en circulation ».
l’inverse d’une univocité de la cause, Susan Strasser, dont le livre est sorti un an avant celui de Richard Tedlow, retrace la construction du marché de masse aux États-Unis entre 1880 et 1920 en conservant toujours en ligne de mire ses implications concrètes pour les consommateurs, dont l’identité de consommateur, écrit-elle d’ailleurs, apparaît en même
temps qu’apparaissent les nouveaux produits (et donc leurs usages) constitutif de ce « marché de masse »42. Strasser étudie l’activité de « marketing » aux États-Unis entre 1880 et 1920, au sens anglo-saxon du terme marketing, c’est-à-dire un sens qui n’est pas restreint aux seules pratiques de management des ventes des entreprises, ainsi qu’on l’entend en français, mais qui couvre, au contraire, un large spectre d’activités marchandes. Ainsi Strasser retrace la transformation de l’ensemble des activités d’intervention marchande et de mise en forme du marché, du lancement des produits aux pratiques d’approvisionnement des ménagères.
Le dispositif de la marque ou l’horizon de la mainmise sur la relation marchande
La première image (ill. 1.1.) nous ramène à une période bien éloignée de sa date de parution (1947), quelque part entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Elle figure, en effet, un comptoir d’épicerie devant lequel se trouve une femme vêtue d’une robe à manches gigots, exagérément penchée au-dessus du comptoir pour mieux examiner, l’aide de son face-à-main, le tas de haricots secs que l’épicier dans son tablier blanc, de l’autre côté du comptoir, dresse sur l’un des plateaux de la balance. « Grand-Mère s’inquiétait de la qualité », dit le slogan, « les ménagères, aujourd’hui, n’ont qu’à demander Cookquik ». L’image se clôt, en bas à droite, par la photographie de deux paquets de pois cassés et de haricots Cookquik dans leurs emballages de cellophane. La publicité, par ces effets de raccourcis qui la caractérisent, pousse à l’extrême le contraste entre l’achat à l’ancienne, représenté par le dessin, et l’achat moderne, signifié par le slogan. « Il suffit de demander Cookquik » : l’achat moderne se fait par la marque et cela fait, à proprement parler, table rase de l’ensemble de l’agencement, aussi bien matériel que social qui caractérisait l’achat-vente traditionnel.
Définition de la marque comme dispositif
L’épicier, le comptoir, la balance, les produits en vrac, dans des casiers, des barils et sur les étagères derrière le vendeur, l’incertitude sur la qualité des produits et, enfin, l’attitude de confiance et de méfiance de l’acheteur vis-à-vis de l’épicier (et inversement, car les épiciers faisaient crédit à leur client) — chacun de ces éléments étant sinon le corollaire exact de l’autre, du moins, très fortement imbriqué à ce qui fait l’ensemble — ; c’est de tout cet ensemble que le dispositif de la marque entend se débarrasser. « Dispositif de la marque » car pour comprendre l’effet de la marque sur les marchés, il convient de considérer non la marque « en soi » comme émetteur sémiologique49, ou comme qualité substantielle50, mais comme objet relationnel entre un signe, un ensemble de significations, et des publics.
La marque moderne scelle à la fois la présence du fabricant sur le lieu même de la vente et une assurance sur la qualité des produits. Deux définitions du mot sceau sont, en effet, mises en jeu dans la marque moderne : la signature, d’une part, par le nom de marque, qui atteste de l’existence et de la continuité d’un fabricant particulier ; le cachet, d’autre part, qui ferme un contenant et assure son intégrité. De fait, dans le cas des produits alimentaires, le dispositif de la marque est difficilement séparable de l’emballage physique, du packaging, du contenant qui permet de délimiter l’espace sur lequel le fabricant conserve le contrôle alors même qu’il se situe en-dehors de la fabrique. Ainsi grâce au nom de marque, qui assure une continuité dans le temps et auquel il est possible d’attacher des qualités propres, et à l’emballage qui permet d’inscrire ce nom et de délimiter le produit auquel la garantie de la marque s’applique, le fabricant peut court-circuiter l’épicier.
Le produit emballé déporte, en effet, la fixation, la stabilisation et la garantie de la qualité vers l’amont, c’est-à-dire vers l’appareil industriel. Il déporte également vers l’aval le discours du vente, tenu au plus près du consommateur, grâce, notamment, à la publicité insérée dans les journaux. Et de même que l’emballage assure l’intégrité du produit, il assure aussi l’intégrité du discours sur la marque (argumentaires inscrits sur le produit) – au point d’ailleurs qu’on peut parler du discours de la marque (et non plus sur la marque). Celle-ci gagne une sorte d’autonomie. Grâce au dispositif de la marque, le client, lorsqu’il pénètre dans la boutique, dispose déjà d’une connaissance des marques et des qualités des produits sur lesquels elles sont apposées et il peut nommer, demander, exiger même, le produit qu’il souhaite. La connaissance des produits dont jouit le consommateur ne dépend ainsi plus, en principe, de ce que l’épicier veut bien lui en dire. Cela a été mis en évidence par Susan Strasser et Franck Cochoy51.
Bien que l’on retrouve dans la marque moderne, des caractéristiques que l’on peut décrire en reprenant le mot « sceau », il importe de distinguer le dispositif de la marque tel qu’il apparaît à la fin du XIXe siècle des formes anciennes de marquage des objets (sceau, poinçon, brandon…)52. Il me semble que la marque moderne constitue une innovation assez radicale vis-à-vis de ces formes anciennes de marquage. Dans ces dernières, la marque vaut uniquement comme authentification de l’identité de l’acteur marchand à l’origine du bien. Le sceau, le poinçon, le timbre et autres signatures des biens, comme l’estampille vétérinaire de certains produits alimentaires aujourd’hui, sont des marques destinées à l’administration ou au corps des pairs mais en aucun cas au public des acheteurs. À l’inverse, le dispositif de la marque moderne est un puissant outil de mise en visibilité de l’offreur auprès du public des acheteurs.
Le dispositif de la marque moderne est inséparable de sa propagation, de la possibilité d’être objet de publicité53. Il rend possible la constitution d’un nouveau lien, non plus celui du rapport de signature qui relie le propriétaire et l’objet possédé, le producteur et ses produits, mais celui de la relation de clientèle qui attache le vendeur, le produit et le client. C’est pourquoi j’ai dit plus haut que la marque est un dispositif relationnel entre un signe distinctif (la marque au plan matériel), un ensemble de significations (notamment toutes celles que les marketeurs et les publicitaires s’efforcent de mettre derrière ce signe : image, valeurs, mission, etc.) et des publics.
Le magasin sans vendeur : l’expérience de l’achat
Or la seconde image d’une scène de vente (ill. 1.3.) apporte un cinglant démenti à la vision du commerce « avec marque » exprimée dans les précédentes (ill. 1.1., ill. 1.2.). De Cookquik à Duraglas, le supermarché est devenu réalité. Les deux personnages sont, comme dans la précédente image, un homme et une femme mais ils se trouvent cette fois du même « côté » du marché. Leur relation n’est plus marchande mais conjugale. Ils font leurs courses ensemble. L’homme pousse ce qui est apparemment un « porte-paniers » (voir chapitre 2) et la femme lui tend une bouteille de sirop pour pancake. Mais de cette seconde image, le vendeur qui se trouvait dans la première image a disparu, formellement, du moins. Ne reste qu’un grand étalage de produits emballés, marqués, publicisés, et le client, circulant librement parmi les produits. Scène idéale pour que triomphe la marque : le vendeur ne fait plus obstruction entre le client et la marque, finies les déviations de la substitution. Le client est libre d’effectuer lui-même la sélection et… de se conformer aux arguments de la marque, sans contre-argument du vendeur !
On l’a dit : par rapport à l’engagement direct avec le produit qui prévalait dans l’épicerie traditionnelle, l’industrialisation des modes de production et la main managériale posée sur les marchés a introduit une saisie des qualités des produits par les inscriptions portées sur l’emballage. Le client ne devrait choisir qu’en fonction des marques qu’il connaît ou après avoir lu les étiquettes. Pourtant, la publicité Duraglas met en scène d’autres critères de choix que la marque. « Un regard… et c’est vendu ! » est le slogan de la publicité qui promeut auprès des commerçants, les produits vendus dans des récipients en verre de marque Duraglas, dont le propre slogan (la signature) est « vend par le regard ». L’emballage en verre qui laisse voir (et magnifie ?) le contenu est présenté comme un motif de choix, un facteur de déclenchement de l’achat.
Corporation et gestion scientifique de la distribution
En ce qui concerne le commerce alimentaire, les plus connues des chaînes sont A&P, Kroger et Safeway107. En 1925, A&P possédait 14 000 magasins, 15 700 en 1930 ; Kroger disposait de 2 599 magasins en 1925 et en avait le double 5 ans plus tard (5 165). Safeway, enfin, possédait 330 magasins en 1925 et plus de 8 fois plus en 1930 (2 765)108. Au total, les 5 plus grandes chaînes de magasins d’alimentation représentaient environ 5% des ventes de produits alimentaires au détail en 1920, 11% en 1925 et 27% en 1930109. La modernisation organisationnelle de ce mode de distribution résidait bien sûr dans la centralisation et dans l’intégration verticale, deux traits constitutifs de l’entreprise multi-divisionnelle dont le potentiel d’efficacité gestionnaire n’est plus à démontrer110. Les chaînes profitaient d’économies d’échelle en matière de coût d’approvisionnement, de publicité, de coût d’équipement des magasins quand celui-ci fut standardisé, de prix avantageux en matière d’assurance et même de fiscalité car certaines taxes ne s’appliquaient qu’à l’organisation centrale, c’est-à-dire aux quartiers généraux, et non magasin par magasin.
Les chaînes intégraient les fonctions des anciens grossistes, des fonctions qui, outre, l’achat auprès de fabricants, le stockage et la logistique, comprenaient souvent une part de mise au détail des produits et, ce faisant, de « marquage » (nom du grossiste, du détaillant ou marque fantaisie)111. La « mise au détail » est, en effet, et comme leur nom l’indique, la fonction traditionnelle des détaillants. Cette mise au détail implique une intervention directe sur le produit, que le système des produits emballés et marqués a précisément fait disparaître. Beaucoup de chaînes avaient démarré avec le commerce du thé et du café, achetant en gros, traitant ces produits (torréfaction, mélanges…) et les conditionnant à leur marque112. La pratique des « marques privées » (private labels) ou « marques propres » y était ainsi très répandue, représentant une part importante des produits offerts à la vente ; et l’entreprise A&P, en particulier, était une fervente opposante du système des marques nationales — toutefois vendues dans ses magasins — qui venaient interférer dans la relation construite entre l’enseigne et le client113.
L’intégration verticale par les chaînes pouvait aller jusqu’au stade de la production. La fabrication de boulangerie était très courante, au point, d’ailleurs, qu’elle faisait partie de la raison sociale de la Kroger : « The Kroger Grocery and Baking, Co. »114. A&P, ne serait-ce que par l’effet de sa taille, était certainement l’entreprise qui avait le plus développé cette intégration de la fabrication des produits. À partir de 1920, celle-ci entreprit la production
grande échelle de produits alimentaires115. A&P possédait ainsi des usines de production de chocolat, de céréales, de gélatine, des conserveries, etc., mettant en œuvre l’un ou l’autre des pans de l’alternative « make or buy » selon le type de structuration du marché considéré116. La stratégie industrielle de A&P était notamment conçue comme un moyen de pression sur les fabricants de produits de marque117.
En aval, à présent, au niveau de la boutique, la période d’essor des chaînes (1910-1930) correspond à une rénovation de la conception de la vente dans les magasins d’épicerie. Un point commun important à l’ensemble des types de chaînes depuis la fin du XIXe siècle était de proposer des prix plus bas que ceux proposés ailleurs. L’affichage des prix en boutique allait de pair avec ces prix moins chers, et marquait d’ailleurs la modernité des chaînes sur les épiciers traditionnels118. Mais aux alentours de 1910, dans les chaînes d’épicerie, l’accent mis sur les prix fut décuplé et les magasins transformés, passant à un modèle de vente à bon marché.
Avant cela, les magasins succursalistes dans le domaine de l’épicerie, de la droguerie, du tabac, de la chaussures, du vêtement, ou encore des « variétés », se différenciaient des magasins indépendants non seulement par des prix plus bas et clairement affichés mais aussi par le caractère plaisant et hédoniste — si ce terme n’est pas trop anachronique — de l’expérience d’achat proposée aux clients. En 1900, la plupart des chaînes proposaient ainsi une expérience de shopping particulière. Il est assez facile de s’imaginer quelle qualité » et quelle nouveauté d’expérience pouvait proposer un magasin de « variétés » à 5 et 10 cents, qui procurait en abondance et à très bas prix aux couches sociales modestes des biens jusque là considérés comme luxueux (porcelaine, couverts, napperons, ustensiles de cuisine, objets décoratifs, parfum, lingerie, quincaillerie, confiserie, entre bien d’autres).
Le cash and carry
Aux alentours de 1910, et cette transformation demanderait à être étudiée et éclaircie, les chaînes de magasins d’épicerie supprimèrent la pratique des primes et se réorientèrent vers la vente à bon marché. C’est, encore une fois, A&P qui fournit l’illustration détaillée de ce mouvement dont il fut bien davantage le suiveur que l’initiateur. Les magasins à bon marché A&P réalisaient une économie drastique en matière d’équipement : la présentation des magasins était standardisée au maximum et A&P avait réussi à faire tenir le coût total d’installation d’un nouveau magasin, aménagement et stock de départ compris, dans une enveloppe globale minimale. Le magasin n’était plus tenu que par deux employés, quand il en fallait au moins 6 et souvent bien davantage dans le modèle précédent de magasin. Les primes et autres systèmes de promotions analogues avaient disparu. Mais toute promotion n’avait pas disparu : que les chaînes mettent l’accent sur les prix bas à partir de 1910 ne signifie pas l’absence « d’animation commerciale ». Tout au contraire, les chaînes se mirent à faire un usage encore plus intensif de la publicité dans les journaux, et surtout elles firent la promotion chaque semaine des « leaders » (des articles mis en avant à prix très bas) et toutes sortes de « prix spéciaux »127.
Mais le plus important changement dans le mode de commercialisation des produits de la part des chaînes était la suppression de tous les services de prise de commande par téléphone, de livraison et de paiement à crédit. Désormais, la plupart des chaînes de magasins d’épicerie fonctionnaient sur le principe du « cash and carry », un « payez et emportez » qui rompait avec la pratique en vigueur de la vente à crédit et de la livraison au domicile du client, qu’il fût venu en personne sélectionner ses achats ou qu’il eut délégué cette sélection à l’épicier en lui passant commande par téléphone, ce qui était une pratique courante, et le demeura longtemps128. La pratique du « cash & carry » était à ce point notable qu’elle suffît à elle seule à nommer une enseigne : l’État d’Arizona comptait ainsi 24 magasins « Pay’n Takit »129.
Le client de 1920 pouvait quitter le magasin en emportant avec lui beaucoup plus de marchandises qu’il ne pouvait le faire en 1900, moins en termes de capacité de transport (cela fait l’objet du prochain chapitre) qu’en termes de largeur de choix offert. Les chaînes alimentaires vendaient alors tout type de produit d’épicerie : biscuits et crackers, pain, céréales, confiserie, préparations alimentaires, condiments, thé et café, conserves, huiles et graisses, savon… En dépit de l’augmentation du nombre de produits vendus, le taux de rotation des stocks demeurait plus que jamais le facteur essentiel de rentabilité — et la question des arbitrages entre la largeur du choix dans chaque catégorie et la concentration sur les produits les plus vendus constituait une « entrée » inévitable des écrits gestionnaires130, comme elle l’avait été quelques décennies auparavant pour les grands magasins131 et comme elle le serait aussi pour les supermarchés132.
Mais entre les années 1920 et les années 1940, un autre problème, beaucoup plus visible, absorba les managers des chaînes intégrées. Contre ces chaînes, les épiciers indépendants menèrent, en effet, un intense lobbying, qui conduisit à de multiples réglementations anti-chaînes (taxation selon le nombre de magasins détenus), ne gênant véritablement économiquement les chaînes qu’à partir d’une décision de la Cour Suprême en 1931 qui assura la légalité des taxes basées sur le nombre de magasins détenus par une compagnie133. Entre 1931 et 1939, 27 États sur 48 instituèrent de telles taxes134 et le mouvement anti-chaînes conduit également au vote du Robinson-Patman Act qui visait les pratiques discriminatoires des chaînes en matière de prix135.
Ce contexte réglementaire défavorable aux chaînes prit sa part dans l’émergence du supermarché, qui grâce à une très large surface de vente permit de relocaliser les économies d’échelle au niveau du magasin et non plus à celui du siège central de l’entreprise, et ainsi de se passer des points de vente multiples sur lesquels était assises les taxes « anti-magasins à succursales multiples »136.
L’ouverture du magasin King Kullen en 1930
Michael Cullen est l’homme qui lança la première des deux bombes citées plus haut sur le monde de la distribution en 1932. En 1930, celui-ci se trouvait dans l’Illinois où il dirigeait une branche de la chaîne de magasins Kroger. Il y écrivit une lettre demeurée célèbre au président de la compagnie. Il y exposait, avec une mégalomanie peu commune et des accents prophétiques, ce qu’était la situation actuelle pour les chaînes, très menacée par le sentiment et les mesures réglementaires anti-chaînes, et les opportunités qui se présentaient elle, brillantes à condition qu’un changement radical de stratégie fut opéré. Cette lettre de plusieurs pages contenait un plan chiffré détaillé et portait une proposition d’association pour ouvrir cinq magasins, les « Cullen Stores », des magasins d’une « taille monstrueuse », dans des bâtiments à la location peu coûteuse, dotés d’un grand parking, organisés principalement en libre-service, achetant directement en gros sans l’aide d’un grossiste, et vendant environ un quart des articles à prix coûtant, un quart des articles à 5 % de marge, un troisième quart à 15 % et le dernier quart à 20 % de marge. Les coûts étaient réduits au maximum, la marge dégagée très limitée mais elle devait être couplée à un taux de rotation élevé pour un chiffre d’affaires qui paraissait exorbitant pour l’époque (10 000 dollars par semaine pour l’épicerie et 2 500 pour la boucherie).
Le public enfoncera les portes pour entrer. Ce sera l’émeute ! Je devrai appeler la police et contingenter le nombre de personnes autorisées à entrer en même temps dans le magasin. Je conduirai le public hors des terres d’esclavage des magasins à prix élevés et je le ferai entrer dans la maison des bas prix, en terre promise.
… Je serai l’homme providentiel de l’épicerie. Le public ne voudra pas, et ne pourra pas en croire ses yeux. Tous les jours de la semaine deviendront des samedis ; les jours de pluie seront des jours ensoleillés, et ensuite, quand la grande foule du peuple Américain viendra acheter tous ces produits à bas prix et ceux à 5 % de marge, je les environnerai de produits
15, 20 et même, dans certains cas, à 25 % de marge ! En d’autres termes, je peux me permettre de vendre une boîte de lait à prix coûtant si je vends une boîte de petits pois sur laquelle je fais 2 cents de marge, et ainsi de suite sur toute l’épicerie.
Un rayon fruit et légumes de ce type serait une mine d’or. Rien que ce seul rayon pourrait dégager un bénéfice net de 7 % grâce au formidable taux de rotation qu’on obtiendrait en vendant l’intégralité du rayon chaque jour, au lieu de jeter la moitié des bénéfices à la poubelle comme cela se fait dans 25 % des succursales de chaîne du pays »
Zimmerman, 1955, Revolution in distribuition, pp. 33-34 extrait de la lettre qu’aurait adressée M. Cullen au président de la Kroger
On le lit, c’est une transsubstantiation de l’épicerie que souhaitait Michael Cullen, qui ne craignait apparemment pas de passer pour un illuminé : le marchand en Abraham, le consommateur en homme libre, la pluie en beau temps, les jours creux en jours d’affluence, les fruits et légumes en mine d’or, Cullen lui-même en faiseur de miracles. Mais ce qui est le plus étonnant peut-être dans cet extrait, et c’est une figure qui se répète tout au long de la fameuse lettre, c’est le basculement soudain d’une envolée visionnaire exaltée à un stratagème commercial posément énoncé, de la terre promise à la boîte de petits pois, au point que les deux sont parfois parfaitement entremêlés, comme dans le dernier paragraphe de cette citation. Le texte conduit une foule vers un lieu d’approvisionnement à bas prix et semble se prendre à son propre jeu de délivrance du joug de l’épicier accapareur, quand, tout à coup, c’est comme un piège qui se referme, la foule attirée par les prix coûtants et les faibles marges se retrouve entourée de produits à marges bien plus élevées. La tactique de captation149 est justifiée par l’arithmétique : puisque je vends cela à prix coûtant, je me paie sur cet autre article. Au fond, il n’y a là rien que de très classique : le commerçant à l’ancienne mode, un peu profiteur, un peu arnaqueur, tout ce fond péjoratif du mot « épicier », ne s’était pas perdu dans le prophète150.
De cette missive, la chute est également fameuse. « Quel est votre verdict ? » demandait Cullen ; « non » répondit le président de la Kroger. Porté par ses convictions, Michael Cullen avait néanmoins commencé à mettre à l’épreuve ses idées dès 1928, et si ses premiers essais furent infructueux151, le magasin qu’il ouvrit en 1930, ayant trouvé à s’associer avec un grossiste, allait figurer dans les annales du commerce. À l’été 1930, il ouvrit dans un ancien garage à Long Island, un magasin, certes de proportions bien plus modestes que celles qu’il s’était pris à rêver dans la lettre adressée à Kroger, à l’enseigne de « King Kullen, le plus grand casseur de prix au monde ». Aidé d’une publicité non orthodoxe, dans laquelle Cullen écrivait de longs paragraphes pour se présenter et présenter son système économique, son magasin reçut bientôt un grand succès et il en ouvrit un deuxième puis un troisième, bien plus grands que le premier. Ces premiers magasins utilisaient des boîtes et des casiers vides en guise de meubles, et vantaient bruyamment les faibles coûts d’équipement et le libre-service qui leur permettaient d’offrir leur bas prix de vente152. Michael Cullen ajoutait aussi à ses magasins, dès qu’il le pouvait, des emplacements qu’il louait à d’autres commerçants (concessions) et qui constituaient une source de revenus importante pour le magasin. « Le système de King Kullen était simple, écrit Zimmerman. Il vendait l’épicerie avec la marge la plus faible possible parce qu’il faisait plus de chiffre d’affaires sous un seul toit qu’il ne pouvait en être fait dans cent magasins de quartier. En outre, une part de ses bénéfices provenait du taux de rotation et une autre part de ces nombreuses concessions153. »
En 1932, Cullen dirigeait déjà 8 magasins, ce nombre avait été porté à 15 lorsqu’il mourut brutalement en avril 1936, à l’âge de 52 ans. L’année suivante, en 1937, lors du premier congrès du nouvellement crée Institut du Supermarché, William H. Albers, qui était le président de la Kroger lorsque M. Cullen lui adressa la fameuse lettre, rendit hommage au génie commercial de ce dernier. Albers reconnaissait aussi, à demi-mot, son incrédulité de l’époque, son manque de « vision » — les fondateurs de Big Bear l’avaient également sollicité et il avait également décliné la proposition154. Depuis, cependant, il s’était rattrapé : Albers avait quitté la Kroger et fondé en 1933 sa propre chaîne de supermarchés dans l’Ohio155.
La création du magasin Big Bear en 1932
Après avoir, comme Michael Cullen, essuyé un refus de la part de William Albers, probablement au début de l’année 1932, Roy O. Dawson avait trouvé à s’associer avec Robert M. Otis, qui était, comme lui, un commerçant expérimenté. Ensemble, ils avaient convaincu un grossiste de se joindre à leur entreprise : créer un vaste magasin à prix cassés, qu’ils nommèrent « Big Bear ». Ils louèrent une usine automobile abandonnée à Elizabeth dans le New Jersey, ainsi qu’un terrain de l’autre côté de la route pour en faire un parking. Ils transformèrent le rez-de-chaussée de l’usine, d’une surface d’environ 4 500 m2 en un immense magasin, comprenant au centre de l’espace, la section alimentaire, et tout autour, 11 autres sections (marchand de couleurs, accessoires automobile, radios, ustensiles de cuisine et appareils ménagers, drugstore, un comptoir de rafraîchissements et un restaurant pour déjeuner). Concernant la section alimentaire, le mobilier était de piètre apparence, des étagères et des tables en pin mal dégrossi, conférait l’ensemble l’aspect d’un bazar temporaire, d’un arrangement pas fait pour durer. Big Bear ouvrit en décembre 1932, à grands renforts de publicité dans la presse locale, présentant l’enseigne comme un « écraseur de prix » et annonçant des dizaines de produits des prix réduits. Son ouverture fut un succès relayé par la presse sur l’ensemble du territoire. Le magasin reçut la visite de milliers de clients et son chiffre d’affaires hebdomadaire dépassa régulièrement les 80 000 dollars156. Il représentait l’équivalent en chiffre d’affaires de 100 des magasins A&P qui se trouvaient aux alentours ! Le premier magasin King Kullen de taille beaucoup plus modeste en représentait 10157. Ces nouveaux magasins firent rapidement des émules et l’on vit se répandre dans les États de l’Est et du Middle West, de multiples magasins « monstres », sous les enseignes de grands et de petits ours (imitations du Big Bear original), tigre géant, grande baleine et même un « roi Arthur », ouverts dans des usines et des entrepôts abandonnés, avec des installations sommaires et la promesse de prix « massacrés »158. L’un des ressorts de ces magasins était l’atmosphère de cirque » qu’ils organisaient, grâce à de nombreuses animations commerciales : jeux et tirages au sort, et dans le cas de Big Bear, un véritable ours dressé qui passait entre les rayons muni d’un panier à provision.
Cependant, dans le New Jersey, Big Bear fut confronté à une vive contestation de la part des autres commerçants. Chaînes et indépendants s’allièrent pour faire pression sur les parlementaires et faire voter des lois interdisant la vente à prix coûtant ou à perte, sur les grossistes pour qu’ils ne livrent pas les supermarchés et sur la presse pour empêcher la parution des publicités Big Bear (si bien que le magasin fit imprimer des prospectus qu’il distribua directement dans les foyer). À mesure que ce type de magasin se répandait, les critiques progressaient, elles aussi159.
Pourtant, beaucoup parmi les commentateurs de la vie du commerce de détail demeuraient sceptiques sur le bien-fondé du principe même du supermarché, et annonçaient que ce type de magasin, fils de la crise, était destiné à s’éteindre avec elle. Quand la prospérité économique reviendrait, alors, les ménagères renoueraient avec soulagement avec les épiceries traditionnelles, avec la bonhomie et avec l’attention que seul leur épicier pouvait leur prêter, avec la commodité des services offerts. Elles n’auraient plus de raison de faire l’effort d’un déplacement important, de supporter l’inconfort d’un environnement désagréable, chaotique et impersonnel pour faire leurs courses. Pourtant, vers 1934, certaines chaînes commençant à douter de la fiabilité de ce pronostic, se mirent à fermer plusieurs de leurs boutiques pour en ouvrir de plus grandes, les remplacer par… quoi ? sinon ce qu’il fallait bien appeler des supermarchés160.
|
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Qu’est-ce qui fait vendre ?
La problématique de la mise en marché
La fabrication de la place de marché
Les masses manquantes de la vente en masse
La transformation de l’achat-vente
La question de l’achalandage
Positionnement
Matériau empirique
PREMIÈRE PARTIE
Introduction de la première partie
CHAPITRE UN DU COMPTOIR AU LIBRE-SERVICE: LA DISTRIBUTION DU VENDEUR DANS LES DISPOSITIFS
Introduction
I. Le marketing et le merchandising : action à distance et action sensible sur les marchés
I. 1. La construction des marchés de masse
I. 2. La reconfiguration de l’achat-vente par les techniques marketing
II. Du libre-service au supermarché : l’agencement du lieu de vente
II. 1. 1. Modernisation du commerce et distribution de masse en 1930 : les chaînes
II. 2. Les contributeurs visibles ou les « héros » du supermarché
II. 3. Une typologie des supermarchés vers 1936
Conclusion
CHAPITRE DEUX «THE GREATEST SALESMAN EVER PUT IN A MARKET»: GENÈSE DU CHARIOT DE SUPERMARCHÉ
Introduction : Le chaînon manquant
I. Préambule : le suspens du chariot
II. L’invention des porte-paniers (années 1930)
II. 1. Le premier chariot de l’histoire de Goldman (1936-1937)
II. 2. Lointains précurseurs et prédécesseurs immédiats : les sources d’inspiration avouées et inavouées de Goldman (1919-1937)
II. 3. La prolifération des porte-paniers et la convergence des formes (1937-1946).155
III. L’invention du chariot moderne (1947)
III. 1. Du porte-paniers au chariot : l’étonnante discrétion discursive de Goldman/Wilson
III. 2. L’inspiration et la pesanteur : les chariots emboîtables de Orla E. Watson (1946-1947)
III. 3. Le succès de l’idée du chariot « téléscopable » et les difficultés de Telescope Carts, Inc. (1947-1949)
III. 4. La course du chariot : Telescope Carts contre Folding Carrier
III. 5. De reprise en reprise, l’élaboration collective d’un chariot modèle et la lutte pour la création d’un droit de propriété
Conclusion
DEUXIÈME PARTIE
Introduction de la deuxième partie
CHAPITRE 3 L’ACCROCHAGE DU PRIX: UNE ETHNOGRAPHIE VISUELLE
Introduction
I. Le display des prix
I. 1. La matérialité composite du prix
I. 2. L’annonce des prix : le système des correspondances spatiales
I. 3. Conclusion sur la façon dont le prix se présente
II. Le conditionnement du prix : la gamme des Curly
II. 1. Le raisonnement de la dépense : gagner à acheter plus
II. 2. Le reconditionnement du produit
II. 3. Conclusion sur le conditionnement du prix
III. Calculer, qualculer : l’étendue des calculs proposés
III. 1. Un prix associé et dissocié : le stop-rayon « Waaoh »
III. 2. Les marges arrières : l’espace de la coopération commerciale
III. 3. L’écriture des prix comme invitation au calcul
III. 4. Peut-on additionner des bons d’achat et des gratuits ? Constituer l’espace de calcul qui permet de lire un prix
III. 5. Conclusion : le client comme « faiseur de prix »
Conclusion
CHAPITRE 4 DONNER LE CHOIX: LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS À MDD
Introduction
I. Le développement des MDD dans la grande distribution française
I. 1. Les MDD génériques
I. 2. Les MDD thématiques
I. 3. Où le hard-discount permet de préciser la notion d’achalandage
II. Approfondir le choix : le développement d’une MDD « me-too »
II. 1. Du bon et du mauvais marketing
II. 2. Accrocher les produits à d’autres produits
II. 3. Pré-produire : l’élaboration d’un projet de produit
II. 4. Reproduire : le développement du produit
II. 5. Juger de la qualité de la reproduction : les procédures d’engagement du goût 352
II. 6. Finaliser le développement : produire et reproduire encore
II. 7. Conclusion : fabriquer un marché pour le produit imitatif
Conclusion
TROISIÈME PARTIE
Introduction de la troisième partie
CHAPITRE 5 RELEVER LE MARCHÉ: TECHNIQUES DES ÉTUDES
Introduction
I. Le focus group, outil en propre de la market research
I. 1. De la « focussed interview » au « focus group », la reprise et le développement d’une technique d’interrogation
I. 2. De la market research au marketing académique
II. Catégoriser les marchés : les panels
II. 1. Regarder le panel, voir le marché
II. 2. L’étude des « performances commerciales »
II. 3. Représenter le marché dans le panel
Conclusion
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet