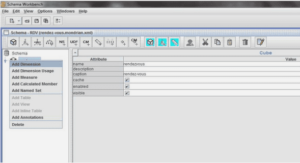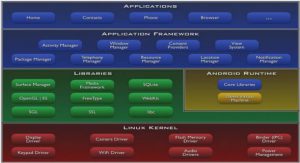Le web, en plus d’être un fascinant outil de communication, est aussi un véritable terrain pour le multimédia. Et depuis quelques années, nous sommes entrés dans l’ère du son, de l’image et de la vidéo.
Plus personne ne sait que le web est aujourd’hui un véritable média, au même titre que la radio et la télévision utilisant la diffusion hertzienne, et même plus. Et avec l’avancé technologique: hauts débits et meilleures bandes passantes, une association entre la radiodiffusion et l’Internet s’impose. D’où la naissance de la webradio, une technologie utilisant la technique du streaming, qui permet à une station de radio de diffuser sur l’Internet.
Dans le cadre d’une perspective d’exploitation de la technologie du streaming et de la radio sur l’Internet, ce présent mémoire intitulé : « LA WEBRADIO » aura pour objet de présenter l’étude de cette technologie de communication et son application. Ce travail s’adresse à ce qui compte installer une webradio dans le domaine de la radio diffusion.
LA TRANSMISSION SUR INTERNET
L’Internet
Définitions
L’Internet (INTERconnected NETwork) est un ensemble de réseaux de différents types sur toute la planète coopérant par différents protocoles qui sont des règles et des formats permettant l’échange des données entre les utilisateurs. Un réseau informatique se définit comme un ensemble d’ordinateurs connectés entre eux par différents liens de communication.
Historique
Les travaux du DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), premier centre de recherche américain sur les réseaux à transfert de paquets, débutèrent au milieu des années 70 et avaient pour but de développer un réseau à commutation de paquets pour relier ses centres de recherches, dans le but de partager des équipements informatiques et échanger des données et du courrier. Il ne fallait donc pas qu’il comporte de points névralgiques dont la destruction aurait entraîné l’arrêt complet du réseau. C’est ainsi, que dès le départ le réseau ARPANET fut conçu sans noeud particulier le dirigeant, et de telle sorte que si une voie de communication venait à être détruite, alors le réseau est capable d’acheminer les informations par un autre chemin.
C’est vers 1980 qu’est apparu le réseau Internet, tel qu’on le connaît maintenant, lorsque l’ARPA commença à faire évoluer les ordinateurs de ses réseaux de recherche vers les nouveaux protocoles TCP/IP et qu’elle se mit à subventionner l’université de Berkeley pour qu’elle intègre TCP/IP à son système d’exploitation Unix. Ainsi le quasi totalité des départements d’informatique des universités américaines commencèrent à se doter de réseaux locaux qui en quelques années seront interconnectés entre eux sous l’impulsion de la NSF (National Science Foundation). Même si dès son origine l’Internet comprenait des sociétés privées, celles-ci étaient plus ou moins liées à la recherche et au développement, alors qu’à l’heure actuelle les activités commerciales s’y sont considérablement multipliées, et ceci surtout depuis l’arrivée du web en 1993.
Aujourd’hui, il faut distinguer deux catégories de réseaux Internet. La première fait référence à l’Internet (ou Internet 1) et la seconde qui fait référence à la nouvelle génération Internet NG ou I2 (Internet 2) ou IP-NG (IP New Generation). Internet 2 est un concept qui a été lancé dans les années 95 et qui permet des réseaux dans lesquels une qualité de service peut être demandée. L’introduction de la nouvelle génération provient en premier lieu d’une augmentation très importante des débits pour arriver à prendre en compte des applications multimédias. En second lieu, lorsque cela est possible, c’est le passage d’IPv4 à IPv6 qui permet à la base de gérer une qualité de service.
Concepts
Le principe fondamental de l’Internet a été de créer un mode de transmission par paquet remplaçant les modes en continu utilisés jusque-là pour la transmission de données. Chaque fichier transmit sur Internet est segmenté en paquets de données autonomes pouvant être transmis indépendamment les uns des autres. Pour que cela fonctionne, chaque paquet de données doit contenir des informations de pilotage telles que l’adresse de l’ordinateur émetteur et l’adresse de l’ordinateur récepteur.
Formé d’un groupe d’ordinateurs dispersés sur la terre, l’Internet représente le réseau IP (Internet Protocol) le plus vaste à ce jour. Les machines reliées à l’Internet communiquent grâce au protocole IP et chacune est identifiée par une ou plusieurs adresse IP uniques aux quelles correspondent une dénomination littérale. En terme simple, il s’agit ni plus ni moins d’un groupe d’innombrables machines qui échangent des données de façon normalisée.
Le protocole principal de communication permettant de transmettre des données sur Internet est le protocole TCP/IP qui est une pile de protocole. Le protocole de premier niveau, IP (Internet Protocol) s’occupe du routage des informations entre l’expéditeur et le destinataire : il accomplit sa tâche en divisant les informations en paquets (de 1500 octets) et leur adjoint une adresse de provenance et de destination (exactement comme une enveloppe envoyée par la poste).
TCP (Transport Control Protocol) s’appuie sur IP pour gérer le transfert des données entre l’expéditeur et le destinataire. TCP fournit également les mécanismes permettant d’établir les connections, de vérifier l’arrivée dans le bon ordre des données, de gérer des données perdues, les erreurs et de récupérer des données concernées. Précisons que TCP n’est pas le seul protocole utilisant IP : TCP/IP comprend également UDP (Unigram Data Protocol). Il s’agit d’un protocole sans connexion et sans garantie utilisé pour des transmissions de faible importance (comme la vidéo ou l’audio sur Internet).
Adresses IP et classes de réseaux
Le futur IPv6
Selon la norme IPv4, une adresse est codée sur 32 bits (soient 4 octets). Du fait de la répartition en réseaux de classe A, B et C, le nombre d’adresses possibles est largement inférieur au nombre théorique, et il existe aujourd’hui un risque de pénurie d’adresse IP. La norme IPv6 consiste à utiliser 128 bits pour coder les adresses (soient 16 octets). Cette norme a été adoptée en 1995 après quatre années de discussions dans différentes assemblées et différents groupes de travail. La compatibilité avec la norme IPv4 a été préservée afin de permettre une phase de transition suffisante pour le passage de IPv4 vers IPv6. A noter que les versions récentes de Linux prennent déjà en compte la norme IPv6.
Classes de réseaux
Pour que l’acheminement des données fonctionne sur l’Internet, chaque ordinateur doit posséder une adresse IP unique. Selon la norme en vigueur actuellement (IPv4), une adresse IP est codé sur 32 bits répartis en quatre octets : par exemple 192.168.12.10 (la valeur d’un octet variant de 0 à 255). L’ensemble des adresses IP est divisé en régions, à l’intérieur desquelles coexistent plusieurs classes de réseaux. Internet considère que les adresses IP à l’intérieur d’une classe de réseau font partie du même réseau : Internet n’attend qu’un point d’entrée, ce que nous appelons une passerelle, pour pouvoir router des paquets aux hôtes de ce réseau.
L’espace adresse IP est réparti entre des régions de réseaux de classe A, B et C :
– les réseaux de classe A, en nombre très limité, possèdent une adresse dont le premier nombre est compris entre 1 et 126. Seul ce premier nombre est fixe. Un réseau de classe A peut posséder 16 777 214 hôtes.
– les réseaux de classe B, possèdent une adresse dont le premier nombre est compris entre 128 et 191. Les deux premiers nombres sont fixes. Il peut ainsi exister 16 382 réseaux de classe B possédant chacun jusqu’à 65 534 hôtes.
– les réseaux de classe C, possèdent une adresse dont le premier nombre est compris entre 192 et 223. Les trois premiers nombres sont fixes. Il peut ainsi exister plus de 2 millions de réseaux de classe C possédant chacun un maximum de 254 hôtes.
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I : LA TRANSMISSION SUR INTERNET
I.1. L’Internet
I.1.1. Définitions
I.1.2. Historique
I.1.3. Concepts
I.1.4. Adresses IP et classes de réseaux
I.1.4.1. Le futur IPv6
I.1.4.2. Classes de réseaux
I.1.4.3. Masque de réseau et routage
I.1.4.4. Adresses IP particulières
I.1.4.5. Le concept des ports
I.1.5. Noms logiques et DNS
I.1.5.1. Adresses IP et noms logiques d’ordinateurs
I.1.5.2. DNS – Domain Name Service
I.1.5.2.1. Organisation et structure
I.1.5.2.2. Fonctionnement du DNS
I.2. La transmission sur l’Internet
I.2.1. L’unicast
I.2.1.1. Principes
I.2.1.2. Les adresses unicast
I.2.1.3. Le routage IP
I.2.2. Le multicast
I.2.2.1. Principes
I.2.2.2. Les adresses multicast
I.2.2.3. Le protocole IGMP
I.2.2.4. Le routage multicast
I.2.3. Le broadcast
CHAPITRE II : LE STREAMING AUDIO
II.1. L’audio
II.1.1. La nature du son
II.1.1.1. L’origine du signal sonore
II.1.1.2. Les propriétés physiques du son
II.1.1.2.1. La fréquence
II.1.1.2.2. La célérité
II.1.1.2.3. L’amplitude
II.1.1.2.4. La longueur d’onde
II.1.1.3. Les sons complexes
II.1.2. De l’analogique au numérique
II.1.2.1. La fréquence d’échantillonnage
II.1.2.2. La quantification
II.1.3. La compression audio
II.1.3.1. La compression non destructive
II.1.3.2. La compression destructive
II.1.3.3. Les différents codecs
II.1.3.3.1. La famille MPEG
II.1.3.3.2. Windows Media Audio
II.1.3.3.3. RealAudio
II.1.3.4. Les différents formats audio
II.1.4. La transmission audio sur l’internet
II.2. Le Streaming
II.2.1. Définitions
II.2.2. Principes
II.2.3. Les différents types de streaming
II.2.3.1. Le streaming unicast
II.2.3.2. Le streaming multicast
II.2.3.3. Le streaming live
II.2.4. Les solutions en streaming
II.2.4.1. RealAudio
II.2.4.2. Windows Media technologies
II.2.4.3. QuickTime
II.2.4.4. Les autres technologies
II.2.5. Les points forts et les points faibles
II.3. La Webradio
II.3.1. Généralité
II.3.2. Principes
II.3.3. Les facteurs clés du développement du webradio
II.3.3.1. Digitalisation de données, voix et images
II.3.3.2. Standards technologiques gratuitement téléchargeables
II.3.3.3. Possibilité de programmation interactive
II.3.3.4. Rejet des frontières du monde
II.3.4. Les contraintes techniques
CHAPITRE III : LES PROTOCOLES UTILISES PAR LA WEBRADIO
III.1. Le modèle de référence OSI
III.2. L’architecture TCP/IP
III.2.1. La couche application
III.2.2. La couche transport hôte à hôte
III.2.3. La couche Internet
III.2.4. La couche d’accès au réseau
III.3. Le protocole IP
III.3.1. Le datagramme IP
III.3.2. La fragmentation IP
III.3.3. Le protocole IP Multicasting
III.4. Les protocoles de la couche Transport
III.4.1. Le protocole TCP
III.4.2. Le protocole UDP
III.4.3. Comparaison des protocoles TCP et UDP
III.5. Les protocoles de la couches hautes
III.5.1. Le protocole RTP
III.5.1.1. Objet du protocole RTP
III.5.1.2. Caractéristiques
III.5.1.3. Fonctions
III.5.1.4. En-tête
III.5.2. Le protocole RTCP
III.5.2.1. Objet du protocole
III.5.2.2. Fonctions
III.5.2.3. Formats des paquets
III.5.2.3.1. Les paquets RTCP SR
III.5.2.3.2. Les paquets RTCP RR
III.5.2.3.3. Les paquets RTCP SDES
III.5.3. Le protocole RTSP
III.5.3.1. Généralités sur le protocole RTSP
III.5.3.2. Principe du RTSP
III.5.3.3. HTTP ou RTSP
III.5.3.4. Syntaxe de l’URL
III.5.3.5. Les méthodes RTSP
III.5.3.6. Dialogue RTSP
CONCLUSION