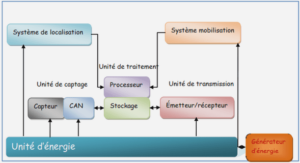Tripoli : présence de l’armée syrienne et rapports avec la communauté alaouite
Si la situation s’est relativement stabilisée à Beyrouth, les autres régions n’en avaient pas fini de se quereller. C’est le cas en particulier « à Tripoli où, depuis le début d’octobre [1982], de sanglants combats opposaient les milices alaouites, soutenues par les Syriens, aux mouvements populaires sunnites ». Après l’expulsion du chef de l’Organisation de Libération de la Palestine, Yasser Arafat, en 1982, la grande ville septentrionale était « sous la domination des intégristes sunnites de Saïd Chabane et des Frères musulmans syriens hostiles au régime laïc des alaouites de Damas. Au début des années 1980, le Président Syrien décide de reprendre du poil de la bête dans des espaces stratégiques, Tripoli en fait partie. Une communauté alaouite y est implantée depuis plusieurs décennies, une bonne façon de ronger de l’intérieur les méandres du système politique en place. Avec la vigueur et la détermination des milices pro-syriennes, les appétences damascènes parviennent à exterminer le noyau dur régnant, appuyées par son artillerie lourde prêtée pour l’occasion. Le 15 octobre 1985, Tripoli tombe sous le joug du pouvoir syrien et sa « reddition restaure la crédibilité d’une pax syriana au Liban » (Alem et Burrat, 1991).
Vingt années durant, les troupes étrangères feront la pluie et le beau temps sur la cité jusqu’à son retrait officiel le 26 avril 2005, laissant la place au gouvernement fraîchement élu de Najib Mikati, l’homme politique tripolitain le plus influent sur la scène levantine. A la suite de la résolution 1559 votée par l’ONU, 4 000 hommes ont été renvoyés à la frontière et les bureaux de renseignements syriens fermés afin de rétablir « l’intégrité territoriale, la pleine souveraineté et l’indépendance politique du Liban ».En effet, en 1976 une force arabe de dissuasion est créée par la Ligue arabe pour apporter une solution au conflit interne. Quoique multinationale, ces troupes sont commandées par Damas qui doit assurer une « présence symbolique ». Mais 40 000 soldats syriens ne passent pas inaperçus et la force allégorique des hommes armés renvoie surtout aux populations soumises une icône représentant l’occupation.
Au niveau local, le district du Nord a recouvré ses droits, aux dépens de la communauté nusayrî protégée par les occupants. De nombreux témoins de cette période m’ont redit leur soulagement lorsque l’armée a fini par décamper, seulement six ans avant qu’un nouvel afflux de syriens réinvestisse le territoire, non pas pour l’occuper militairement mais humainement. Marqués par la présence étrangère sur leur sol pendant une trentaine d’années, nombre de Libanais ont cru revivre une seconde colonisation à partir de 2011, à la différence que la majorité des migrants étaient de leur côté, c’est-à-dire sunnites car recherchés et condamnés par le régime dictatorial en place. D’après une enseignante qui a tenu à rester anonyme, Tripoli a particulièrement souffert de l’oppression des généraux qui ont « humilié la ville », voire même « pillé ». Dans les rues, en guise de protestation, les habitants envoyaient aux militaires des « houla » (marque d’humiliation en arabe) et s’ils étaient bien acceptés dans les premiers mois de leur opération, les visées impérialistes du régime de Hafez al Assad ont vite trouvé une riposte acharnée dans certaines parties de la cité, comme à Bab el Tebbane.
Construction d’un territoire et scission en deux quartiers autonomes
Une entité administrative commune
Jusqu’au milieu des années 1970, le quartier à majorité sunnite de Bab el Tebbane ainsi que celui alaouite de Jabal Mohsen ne formaient qu’une seule entité administrative gérée par la partie basse. Officiellement, cette unification n’a pas changé, comme le montre un rapport datant de 2010 qui précise que les résidents de Jabal Mohsen ont encore inscrit sur leur carte d’identité ‘Bab el Tebbane’ comme lieu de naissance.
A l’origine, l’espace est un « important centre commercial situé aux abords de Tripoli, habité à la fois par de grands commerçants et de petits ouvriers », d’après le témoignage de l’ancien maire, Rachid Jamali, cité dans le compte-rendu de Crisis Group. J’en ai moi-même eu la confirmation en interrogeant la famille de ma prof d’arabe à Paris, originaire de Bab el Tebbane mais qui a fini par quitter le quartier pour emménager dans les secteurs plus sécurisées et fuir les affrontements réguliers entre les deux communautés depuis la guerre civile. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer « la porte dorée », surnommée ainsi pour la richesse de son marché, comme un quartier prospère où des notables s’étaient établis. Les ménages les plus aisés ont commencé à fuir avec la montée de courants politiques très impliqués dans les problèmes structurels que vivait alors le pays, à savoir la crise des Palestiniens, la présence de l’armée syrienne, le conflit avec Israël et bien d’autres encore. La petite confrérie de chrétiens maronites implantée à l’Est a également migré vers la corniche après les guerres de 197238 et de 1975, fuyant à Zghorta ou s’enracinant durablement dans le quartier d’Al Mina, départs qui ont repoussé les limites de la ville vers la mer.
De son côté, la communauté nusayrî a toujours eu un pied sur ce territoire sans pour autant y avoir une place. Attroupée à la périphérie de Tebbane, le coeur économique de Tripoli, la minorité alaouite, dénigrée et discriminée « y trouva une source d’emplois, souvent dévalorisants, au service d’une majorité sunnite qui voyait en elle une population de seconde classe ». En raison de leur confession marginale – les alaouites ne représentent que 3% de la population libanaise – « l’accès à la fonction publique ou à des carrières politiques leur était impossible, voire impensable ». Cette relégation a été particulièrement mal vécu par les personnes concernées, et l’arrivée de troupes syriennes sur le sol libanais a été pour eux comme une lueur d’espoir, un tremplin pour enfin faire valoir leur existence.
Les avant-goûts d’une séparation géographique
Qu’elles aient commencé dès 1976 ou se soient périodiquement répétées au cours des quatre dernières décennies, les animosités entre jabaliens et tebbaniens prouvent une chose : la cohabitation entre les différentes sectes au Liban n’est pas chose aisée. Certes le climat tendu dans la région n’encourage pas au dialogue et à des résolutions de paix imminentes, mais qu’un conflit en interne aussi meurtrier continue de courir au sein d’une grande commune comme Tripoli, amène à en trouver l’origine et la responsabilité portée par quelqu’un. Je ne m’attarderai pas à entrer dans le jeu des malversations politiques qui pourraient expliquer les travers de cette haine stagnante, mais j’énumèrerai certains évènements qui auraient pu mettre la puce à l’oreille aux dirigeants à propos des trublions des quartiers pauvres de l’agglomération, et ainsi faire avorter dans l’oeuf leurs velléités bagarreuses. Mais sans doute étaient-ils conscients de la portée de leur silence, qu’ils ont volontairement gardé.
Pourtant rattachés à la même entité administrative, les deux communautés ont toujours nourri en leur chair des antagonismes inexplicables tant elles sont coulent dans leurs veines. La présence d’une minorité alaouite a permis aux sunnites de raffermir leur supériorité face à moins forts qu’eux. Contrairement aux chrétiens, qui forment un groupe avec qui des alliances stratégiques peuvent être scellées, les alaouites, trop affiliés aux chiites du Hezbollah, représentent au contraire une menace. Les musulmans sunnites n’ont jamais accepté l’accession au pouvoir du parti Baas en Syrie, d’abord entre 1963 et 1966, puis de nouveau à partir de 1970, dont le chef de file était le Président Hafez al Assad. Les nusayrîs en Syrie, largement minoritaires (ils constituent environ 11% de la population totale), prennent alors la tête du pays et exercent un pouvoir autoritaire, marqué par une répression systématique à l’encontre des réfractaires, dont des techniques de torture qui resteront une ‘référence’ en la matière. A Tripoli, les dizaines de milliers de sujets inféodés à Damas portent en eux l’étiquette de terreur et d’autoritarisme pratiqués 30km un peu plus au Nord. Déjà avantagés numériquement et politiquement, les sunnites profitent de cette prépotence pour en faire une minorité singulièrement rejetée et maintenue la tête sous l’eau.
Lorsque la guerre civile éclate, tout le Liban est divisé et au bord de l’implosion. La Ligue arabe envoie 30 000 soldats pour tenter de faire revenir la paix sur le territoire. La localité tripolitaine est alors envahie par des myriades de militaires syriens et la communauté lésée est prise sous l’aile de ses bienfaiteurs et alliés, ce qui envenime encore davantage les rancoeurs et les disparités entre les deux factions. Pour se venger, la secte dominante ne les embauche plus, brûle leurs magasins situés dans le souk et isole toujours plus les alaouites contraints à l’entre-soi.
Si des affrontements ont déjà donné le ton des relations de voisinage dès le milieu des années 70, il sera fréquemment remis à l’ordre du jour en fonction des conflits à l’échelle nationale, voire internationale. Outre les débordements datant de la guerre civile, dont je développerai les causes plus finement dans le prochain point, la présence militaire syrienne à Tripoli jusqu’en 2005 n’a pas fini de creuser le fossé au niveau de la rue de Syrie : « check-points omniprésents, collaboration forcée avec les services de renseignement, répression de toute tentative d’insubordination, la majorité sunnite estime avoir subi des mesures de sécurité particulièrement sévères (les habitants du quartier et les responsables de Tripoli assurent que des centaines de personnes furent emprisonnées et torturées par les services de sécurité syro-libanais après la fin de la guerre). La minorité allawite, par contraste, bénéficia d’un traitement plus enviable. Damas veilla à ce que le PDA fut désarmé, comme l’ensemble des milices libanaises (à l’exception du Hizbollah). Mais à Tripoli, la proximité réelle ou supposée des allawites avec les agents de sécurité syriens leur conférait un ascendant sur leurs concitoyens ».
Alors que l’année 2005 aurait dû marquer un tournant dans les rapports entre les deux communautés ennemies avec le retrait des troupes étrangères, un nouvel acte vient obscurcir les éventuelles réconciliations envisagées. Le 14 février, l’homme d’affaires et homme politique libanais, Rafic Hariri est assassiné dans sa voiture après qu’une camionnette chargée de 1 800kg d’explosifs est venue s’encastrer dans son véhicule blindé. L’attentat-suicide, encore en instruction dix ans après les faits, n’a jamais été éclairci par la justice internationale mais de lourds soupçons planent sur le Parti de Dieu ainsi que son parent syrien. La communauté sunnite est ébranlée par cette attaque démesurée, qui a fait dans le même temps une vingtaine de morts et plus de cent blessés, et est touchée en plein coeur par la disparition d’une figure fédératrice. Les séquelles de trente années d’occupation se dilatent et, béantes, elles ouvrent la porte à une série de vendettas à travers le pays.
Puis c’est en 2007-2008 que l’Est tripolitain redevient « une zone d’affrontement par procuration », moins coûteuse que si elle se déroulait à Beyrouth et plus facilement gérable. En échange d’une centaine de dollars, les jeunes déscolarisés et désoeuvrés trouvent en ces épisodes une façon de s’occuper et de passer le temps, « que peuvent-ils espérer de mieux qu’un conflit armé qui leur donne l’occasion d’apprendre le maniement des armes et de gagner un peu d’argent ? » se demande le responsable du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) lors d’un entretien accordé à Crisis Group en juillet 2010. En mai 2008, environ 70 personnes sont tuées dans le pays en raison d’une crise entre le gouvernement et le Hezbollah. A Tripoli, les hommes sont réarmés le temps de quelques rafales et une poignée de victimes. Après quoi, un répit de trois ans est accordé aux habitants voisins avant une nouvelle bouffée de gaz toxiques à compter de la guerre civile syrienne.
Bab el Tebbane : un bastion rebelle mené par Khalil Akawi
Au cours des années 1970-80, une Résistance populaire émerge dans ce qui deviendra les quartiers turbulents « contaminés par le politique » (Seurat, 2012). De plus en plus de jeunes se coalisent autour de ce noyau dur nationaliste pour « défendre militairement l’honneur (karâma) de Tripoli et sa mémoire contre l’armée syrienne ». Une migration des « mauvais garçons (shabâb ; ahdâth, za’rân, qabadaye) » s’opère, désertant la rive Ouest de la rivière Abu Ali – notamment les souks situés proches de la Citadelle et la grande mosquée – vers des quartiers plus éloignés géographiquement mais qui forment le « coeur battant de la cité », tels que Suwaiqa, Dahr el Maghr, Qobbé et Bab el Tebbane, faisant face frontalement aux patriotes alaouites, l’une des cibles privilégiées de leurs revendications.
Ici, se constitue une rébellion virulente contre les envahisseurs, qu’ils soient Syriens ou Israéliens, et à la suite de l’invasion de 1982 par le Sud, la Résistance populaire et deux autres groupes d’activistes s’unissent pour créer le Mouvement d’unification islamique (Harakat al tawhîd al islâmi), plus connu sous le nom de Tawhîd.
Lors d’un entretien avec le fils du leader, Arabi Akawi me décrivait son père comme un « 100% tripolitain », qui avait des relations très proches avec le Fatah – ou Mouvement de Libération de la Palestine – commandé par Yasser Arafat. D’après lui, même après qu’il ait fondé son parti, Khalil Akawi n’a jamais participé aux massacres et a au contraire joué un rôle de modérateur entre les communistes très vindicatifs et la politique officielle. Près de trente ans après sa mort en 1986, il est toujours aussi vénéré dans le quartier et présenté comme un héros intègre, « désintéressé et pauvre » puisque jusqu’à la fin il a tenu à poursuivre son travail dans un four à pain.40 Avant qu’il ne se décide à fonder la Résistance populaire il partait avec son frère dans le coeur de ville dépouiller les riches pour le redistribuer aux pauvres.
L’aura de ce Robin des Bois tripolitain fait de lui un mythe vivant, la référence du quartier qui permet de croire en leur cause. Profondément antiétatique, Abou Arabi (littéralement, le père d’Arabi) ne souhaitait pas se soumettre aux ordres du pouvoir central qu’il considérait comme « créé par l’Occident qui a voulu imposer à l’Islam son propre modèle de modernisation politique ; dominé par une confession non musulmane ; établi à Beyrouth ; refusé en tant qu’Etat dans l’absolu, au même titre que les autres qui divisent l’Oumma des croyants ; relève de la quadrature du cercle ». (Seurat, 2012)
Islamiste dans le titre (et non pas au sens salafiste, qui est apparu bien plus tard), il n’en était pas moins un pacifiste qui réclamait ‘le changement avant de parler d’explosion’ dans ses slogans lors des manifestations organisées dans cette localité. Cet ancien marxiste a trouvé dans l’Islam la réponse à sa quête intérieure mais, quoique affilié aux sunnites, il se disait « chiite de coeur » et pour l’ « Islam des déshérités ». En fin de compte, son combat n’avait rien de religieux mais l’oppression syrienne et les relents israéliens dans le Sud du pays ont exacerbé des sentiments d’iniquité et de relégation pour un peuple déjà mis au ban de la société.
Peu à peu est survenue une autre figure charismatique de Mouvement d’unification islamique, il s’agit du Cheikh Sa’id Sha’bân qui refusait de voir en lui un parti, laissant l’entièreté de la place à la religion, « le mouvement c’est l’Islam ».42 Le sociologue Michel Seurat qui avait choisi Tripoli comme terrain d’étude et connaissait parfaitement la question analyse que « le Tawhîd apparait bien là comme un ‘mouvement’, non plus au sens d’une organisation ayant sa structure propre, mais plutôt d’un courant sans aucune cohésion interne ». En effet, deux après sa création, le courant islamique était dirigé par sept émirs qui se partageaient sept fiefs répartis dans toute la ville. Cheikh Saïd Sha’ân s’était attitré le statut d’ « émir suprême ». Voyant ses idéaux humanistes et réconciliateurs se perdre dans des aspirations de « purification de la cité ». Khalil Akawi déclare à la fin de l’année 1983 que « le mouvement d’unification n’est pas uni » puis le quitte définitivement un an plus tard alors que les différents fiefs (‘asabiyyat) se liguent les uns contre les autres au sein même du Tawhîd et que 28 militants communistes sont assassinés dans leur domicile à Al Mina « sur l’allégation que le sang des athées est ‘licite’ au regard de la Loi islamique. »
L’éradication aussi expéditive des partis politiques par l’organisation est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, le leader indétrônable de la résistance tripolitaine se retire de la scène publique. Deux ans après, le 9 février 1986, c’est à son tour d’être la victime des dissensions confessionnelles et politiques. Il avait 31 ans. Pour nombre de tebbaniens, la perte d’Abou Arabi est semblable à un « tremblement de terre »dans le quartier sunnite. Et d’autres rajoutent encore qu’ « il y a deux choses que les habitants ne peuvent pas oublier : le massacre et l’assassinat de Khalil ». En effet, quelques mois après la mort de son chef spirituel, le quartier de Bab el Tebbane a été le champ de bataille d’une boucherie d’une particulière horreur. L’hécatombe a causé la mort à des centaines de civils (entre 300 et 800 personnes, il n’existe pas de chiffres officiels), exécutés en deux jours. Cet évènement a fini de creuser le fossé symbolisé par la rue de Syrie, la ligne de front entre les communautés alaouite et sunnite.
Depuis, la « génération des orphelins », comme elle est nommée, attend patiemment l’heure des représailles qui est un plat qui peut se manger très froid. « Chaque foyer a connu au moins un ou deux martyrs et nous vivons encore dans un esprit de revanche depuis le bain de sang de 1986. Il y a beaucoup de rancune ici et les gens n’ont pas encore vidé leurs coeurs. Nous attendons n’importe quelle occasion pour nous venger », témoignait un militant à International Crisis Group en 2007. Quatre ans plus tard l’entretien, soit 25 ans après le carnage, cet homme et tous ceux qui couvaient en eux le désir de mettre fin à leur deuil, ont brisé l’omerta, sorti les armes et pour laver leur conscience ont cru bon de lessiver « la colline d’en face », comme Khalil Akawi appelait Jabal Mohsen.
Définition de rounds
Dans son acception courante au Liban, le terme de rounds fait référence aux périodes de plusieurs jours où les heurts reprennent entre les milices islamistes du quartier de Bab el Tebbane et les combattants alaouites. Il arrive parfois que l’armée libanaise s’interpose et prenne part aux combats dans l’espoir de rétablir l’ordre dans cette zone de non-droits qui n’appartient qu’aux factions prônant le djihad pour les uns, la défense de leur communauté et leur allié voisin pour les autres.
Depuis que la guerre civile en Syrie a éclaté en mars 2011, 21 fois les armes ont claironné à l’Est, ne laissant dormir que les plus habitués à ces tapages sonores. Scrupuleusement, les tripolitains calculent dans leur tête à combien d’échauffourées ils en sont, espérant secrètement que cette fois sera la dernière mais n’osant même plus y croire.
Depuis qu’un plan de sécurité a été décidé par le gouvernement en avril 2014, plus aucun round n’a été enregistré, si ce n’est un duel en octobre 2014 d’une violence et gravité rares, opposant les forces libanaises aux rebelles islamistes. Après trois jours d’affrontements, 16 personnes, dont 11 soldats ont péri. Lors de cette ultime bataille (un an après aucun nouvel acte n’a été signalé), l’armée a repris le contrôle du fief salafiste, après une décennie de blocus.La brutalité des combats et du matériel déployé (l’artillerie a été sortie pour venir à bout des insurgés) a fait fuir la majeure partie des habitants du quartier, pourtant familiarisés avec ces pratiques.
Situation en février 2014
A l’aube de mon arrivée au Liban, la situation est à l’image des Libanais et de leur résignation, des attentats ont lieu périodiquement mais cela n’altère en rien le quotidien de ceux qui ne sont pas directement impliqués ou victimes. Par-ci par-là des bombes explosent, comme cette double attaque suicide qui a causé la mort de trois personnes au moins à la mi-février. La banlieue Sud de Beyrouth, fief du Hezbollah chiite, était alors visée, mais dans les jours suivants (ou précédents) ce seront d’autres quartiers ennemis qui feront les frais d’une vendetta sans fin. La loi du talion, inventée précisément dans cette région du monde – le royaume de Babylone – en 1730 avant notre ère, n’a rien perdu de son aura d’antan et continue de mettre en pratique l’ « oeil pour oeil, dent pour dent » qui vire facilement à une prise en charge personnelle de la justice par les intéressés eux-mêmes, préférant s’arranger à l’amiable plutôt que passer par un juge au pouvoir discrétionnaire. Si le Parti de Dieu a été frappé début 2014, c’est que lui-même avait frappé plus tôt, qu’il frappera son ennemi plus tard, qu’en retour l’ennemi frappera et que sans fin ils se frapperont.
Le contexte en préambule de mon séjour se résume à une succession d’assassinats ou d’attentats à Tripoli, Beyrouth, Tyr et Saïda. Mais si la guerre n’a pas encore franchi la frontière, c’est parce que le Liban est parvenu à maîtriser ses élans bellicistes afin de préserver sa population d’une énième contagion sanguinaire. Les territoires limitrophes, quant à eux, sont régulièrement touchés par des roquettes lancées depuis les positions syriennes, la petite ville d’Ersal en tête, qui subit les va et vient de milices rebelles traquées par le régime baathiste.
Concernant le lieu sur lequel porte mon étude, une relative accalmie a duré « le temps de se réapprovisionner en armes et munitions », ironisent des habitants du quartier de Bab el Tebbane, « soit trois semaines environ ». Le 20 février, au lendemain de la double explosion à Beyrouth, un responsable du Parti démocratique arabe, principale milice alaouite de Tripoli, est assassiné en pleine rue, alors qu’il conduisait sa voiture. Une vengeance qui arrive six mois après que son fils a été inculpé dans l’attentat contre deux mosquées sunnites, tuant 29 personnes et en blessant plus de 500. Lui-même représailles d’un autre évènement, l’attentat venait en réponse à un précédent commis à l’encontre du fief du Hezbollah huit jours plus tôt et faisant une vingtaine de victimes également. Et effectivement, trois semaines plus tard, jour pour jour, une nouvelle personne est abattue dans le centre-ville de Tripoli, début d’un 21ème round entre les factions fratricides, qui laissera à terre 24 martyrs en une dizaine de jours d’affrontements.
La mise en place d’un plan de sécurité début avril, venu recoudre les stigmates de ce round de trop, aura permis de rassurer les riverains sous tension depuis 2011 et de les laisser réapprendre à « dormir la nuit », comme témoigne Mahmoud Koja, dont l’appartement donne sur la rue de Syrie. Bien que personne dans le quartier, l’agglomération ou le pays ne croit réellement à l’efficacité durable de cette intervention musclée de l’armée libanaise dans le secteur mis en quarantaine, lui s’exclame : « C’est magique : d’un instant à l’autre, les affrontements se sont arrêtés. […] On n’est plus à la merci de tirs pour un oui ou pour un non. C’est un luxe qu’on n’avait pas connu depuis deux ans, peut-être trois ! ». Et toujours cette même question qui revient dans l’esprit de toutes les parties prenantes, indirecte plus que directe, de ces combats : pourquoi seulement maintenant ?
METHODOLOGIE
La nécessité de l’auto-ethnographie
Avant toute tentative de rédaction, je n’envisageais pas de relater mon expérience proche-orientale autrement que par l’auto-ethnographie. D’abord pratiquée par les ethnographes, cet usage s’est étendu à la géographie et se définit, selon Louis Dupont comme une « méthode favorisant l’inclusion de l’expérience personnelle du chercheur comme « étudiant » (d’une culture), c’est-à-dire comme scientifique, et comme « étudié », c’est-à-dire comme une personne ayant eu à divers degrés une expérience de l’intérieur ».Ayant vécu des moments intenses et parfois difficiles, je me voyais mal faire fi de ma posture et de mon ressenti pour garder une objectivité qui, de toute évidence, n’aurait pu être sincère. Ce sont les épreuves endurées pendant mes quatre mois de terrain, ainsi que le quotidien dans une ville en conflit qui ont mûri ma réflexion et l’ont rendu possible.
L’auteur continue sa démonstration en précisant que « l’auto-ethnographie n’est pas une biographie personnelle, bien qu’elle puisse s’appuyer sur des notes bibliographiques et des anecdotes personnelles. L’idée n’est pas non plus, comme certains le craignent, de s’enfoncer dans la régression psychanalytique ou la narration romanesque. » C’est un écueil dans lequel je me suis moi-même engouffrée et que dans certains cas j’ai volontairement conservé dans le rendu final, notamment avec les « regards biaisés ». Je m’explique. Sur le terrain, l’écriture a été un remède, un exutoire nécessaire pour vider le trop plein de saletés que j’entassais dans mon esprit. Afin d’en réchapper, je me devais de m’échapper, et l’écriture m’a ouvert la voie vers cette issue de secours. Les quelques textes que j’ai griffonnés sur mon ordinateur ont donc eu ce rôle « psychanalytique » qui m’a été vital. Par la suite, à mon retour en France, j’ai pendant plusieurs mois repoussé le commencement de mon travail de composition. Non seulement l’année universitaire que j’entamais allait me mener dans un tout autre univers (je débutais alors un cursus en Criminologie) – il est effectivement laborieux de mener de front deux projets distincts – mais il m’a surtout été particulièrement douloureux de me replonger dans des souvenirs mal refermés. Mes premières et longues tentatives de rédaction ont ainsi fait office d’auto-psychothérapie et, avec un pincement amer, je plaisantais en présentant mon mémoire comme mes mémoires. Je suis donc à moitié d’accord avec L. Dupont car, si l’on veut pousser la méthode d’auto-ethnographie encore plus loin, tout le cheminement intérieur du chercheur devrait transparaître dans son travail et il ne devrait pas avoir honte de se mettre à nu – comme j’ai la désagréable impression de le faire – car il n’est jamais facile de s’avouer faible et brisée par quelques mois de vagabondage oriental. Il me semble que mon vécu personnel est indissociable de mon terrain, qu’il a orienté mes recherches et lectures postérieures, qu’il a inconsciemment sélectionné les informations retenues, enfin, qu’il est intrinsèque à mon travail global. Je ne saurai parler du conflit au Nord-Liban sans me référer à ce que j’y ai vécu et je refuse de me présenter comme une spécialiste de la question, puisque mon point de vue est trop partial (et partiel) pour prétendre le considérer comme une vérité scientifique, sinon universelle. Je souhaiterais donc que ce rapport soit lu comme un regard possible sur Tripoli et accepté dans toute sa subjectivité, sa spontanéité et sa relativité.
Une position préalable difficile à trouver
Jeune femme occidentale, blonde aux yeux bleus, avec appareil photo et tatouage au pied cherche terrain de recherche en zone de conflit.
La première difficulté dans l’approche de ce terrain a été celle de l’apparence physique. A Tripoli, et plus particulièrement dans le quartier sunnite de Bab el Tebbane, la tradition du voile est de mise pour les femmes et rares sont celles qui se paradent dans la rue le chef découvert. La question s’est donc posée de savoir si je devais me couvrir ou non, autrement dit si je choisissais d’être en immersion ou bien de rester à ma place en tant que spectatrice d’une situation. Toutes les personnes à qui j’ai demandé leur avis m’ont dissuadé de le faire pour une seule raison à leurs yeux : « Tu n’es pas libanaise, tu n’es pas musulmane, tu es française, alors reste qui tu es ». J’ai trouvé cette phrase suffisamment convaincante pour me résoudre à l’idée qu’en aucune manière, même si j’avais voulu le faire, je ne serai jamais comme eux. Les limites de l’immersion du chercheur s’arrêtent avec le bon sens et la seule volonté ne suffit pas à nous rendre ce que nous ne serons pas. C’est donc en tant que « moi » que j’ai décidé de faire ce travail, avec mes différences, mes préjugés et mon impossible assimilation.
|
Table des matières
REMERCIEMENTS
TABLE DES MATIERES
Premier regard biaisé : Posture de départ
Première partie : CADRE CONCEPTUEL
Section 1 – Le communautarisme
1. Distinction communauté et communautaire
2. Sunnisme VS chiisme
3. Le Liban, un Etat multicommunautaire
4. La notion de société civile
Section 2 – La géographie des conflits
1. Reconnaître et appréhender un conflit
2. Les géographies en support
Seconde partie : CONTEXTUALISATION
1. La guerre civile en Syrie : diviser pour mieux régner
2. Rappels historiques au Liban
3. Construction d’un territoire et scission en deux quartiers autonomes
Troisième partie : METHODOLOGIE
1. La nécessité de l’auto-ethnographie
2. Une position préalable difficile à trouver
3. Une approche informelle du terrain
4. Evolution du sujet : du rêve à la réalité
5. Tentative de comparaison avec le conflit nord-irlandais
Quatrième partie : PRESENTATION DES ASSOCIATIONS TRIPOLITAINES
1. Ruwwad al tanmeya – Lebanon
2. Utopia
3. Offre Joie
4. Fondation Safadi
5. Médecins Sans Frontières
Cinquième partie : TRIPOLI, LES TRIPOLITAINS ET LES AUTRES
1. Etrange sentiment de bien-être à Tripoli
2. Une ville rassurante, mais pour qui ? Portraits de eux, de nous
Second regard biaisé : Un mois au Liban
Sixième partie : ETUDE DE CAS : BAB EL TEBBANE ET JABAL MOHSEN, DEUX QUARTIERS DANS ET HORS DE TRIPOLI
1. Pauvreté et mise à l’écart par le reste de la ville
2. Terrain de recherche : accéder aux lieux, une aventure difficile et dangereuse
3. Adaptation forcée de l’espace : les remparts contre la guerre
4. Premières impressions d’un conflit
5. Jouer sur la ligne de front
Troisième regard biaisé : « La musique souvent me prend comme une mer »
6. Jabal Mohsen : un îlot sur la défensive
7. Bab el Tebbane et Jabal Mohsen : entre intégration et rejet de la ville
Septième partie : LA SURVIE DES QUARTIERS OPEREE PAR LA SOCIETE CIVILE
1. Quelles priorités face au tandem pauvreté/conflit ?
2. Quelles conclusions tirer de ces initiatives ?
Quatrième et dernier regard biaisé sur un des 38 conflits armés qui se déroulent actuellement dans le monde : Posture de retour
BIBLIOGRAPHIE
TABLES DES ILLUSTRATIONS
TABLE DES MATIERES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet