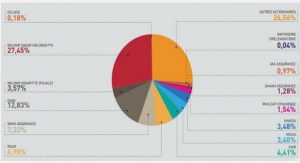La préhistoire
L’anti-européanisme prendra corps dès l’arrivée sur le sol américain des premiers colons, du moins chez ceux qui avaient quitté l’Europe pour des motifs d’ordre religieux. Cet anti-européanisme aura en effet partie liée à une forme de messianisme apocalyptique dont la tradition en anglais de la Bible hébraïque donnera, en quelque sorte, le coup d’envoi. La tradition des textes sacrés, qui avait été l’une des premières initiatives de la Réforme protestante pour la diffusion des écritures saintes, allait en effet connaître des retombées inattendues. Les métaphores guerrières de l’Ancien Testament, une fois traduites en Anglais, prendront le pas sur le message de paix des Évangiles et l’Apocalypse hébraïque connaîtra ainsi un remarquable succès. Plus encore, l’Apocalypse de saint Jean qui, dans les chapitres 20 et 21 du dernier livre de l’Évangile, annonce le retour du Christ sur terre pour affronter l’Antéchrist flanqué de « Satan et de tous les rois de la terre avec leurs armées rassemblées », nourrira la passion des puritains angloaméricains : pendant mille ans, le règne du Christ devait s’établir sur terre avec, à ses côtés, les martyrs de la foi ressuscités ; au terme de ce règne millénaire, le jugement dernier devait mener les justes au ciel et les damnés en enfer. Le succès de ces idées millénaristes et ce littéralisme sont attestés par l’abondante littérature publiée entre le XVIe et le XVIIe siècle en Angleterre. Le mathématicien John Napier (inventeur des logarithmes) fut l’un des premiers à consacrer un ouvrage à l’Apocalypse. Newton lui-même, qui fut un fervent lecteur de l’Apocalypse, se convainquit que le Pape était l’Antéchrist. La rupture progressive des puritains avec l’Église anglicane et la montée progressive de leur haine pour l’Angleterre s’opéreront en raison de leur désir d’« étendre le royaume du Christ et [de] répandre l’Évangile dans les contrées du monde les plus lointaines », en particulier en Amérique où « seuls quelques hommes sauvages et brutaux y rodaient ça et là, à la manière des bêtes sauvages qu’on y trouve »11. Apparaît là le double mythe de la nature sauvage, de ces contrées lointaines qui ne sont pas sans évoquer le désert des Hébreux avant que ceux-ci n’atteignent la terre promise, et celui de la doctrine de la prédestination faisant d’eux un peuple d’élus et de leurs futurs ennemis une incarnation du mal. La rupture fut consommée dès 1620 avec l’embarquement sur le Mayflower de puritains tournant le dos à une Europe endeuillée par les conflits entre catholiques et protestants et les persécutions religieuses : le pacte, rédigé par les Pères pèlerins avant même le débarquement, était une pure et simple déclaration d’indépendance et la manifestation de la volonté de créer une société de justice et d’égalité, anticipation du règne millénariste du Christ sur terre. Le « modèle » incarné par les Pères pèlerins ne sera jamais prédominant mais leurs refus de la richesse et du pouvoir, leur refus du luxe, et la recherche d’un idéal inaccessible et d’une récompense spirituelle s’inscriront à tout jamais dans la mémoire collective américaine. Outre cette empreinte spirituelle et le souvenir de la lutte pour la liberté religieuse contre l’Église anglicane, contre le catholicisme et son Église corrompue, ce qui a marqué de manière indélébile la conscience collective américaine dès sa formation, et sans jamais se démentir, c’est le mépris pour une Europe féodale, avec ses rois, ses empereurs, ses Papes belliqueux, toujours prompts à utiliser la religion à des fins guerrières, ne cherchant jamais à œuvrer pour la paix, la liberté et le bonheur des hommes. De là naîtront la certitude, enracinée au plus profond de la culture des Américains, d’être le peuple élu et le sentiment de supériorité vis-à-vis des autres peuples, notamment des Européens, et a contrario la conviction que, en vertu de la doctrine de la prédestination – qui se propagera tout au long de l’histoire des États-Unis –, leurs ennemis doivent être considérés comme l’incarnation du mal. Les années 1730 verront se renforcer la conviction des Américains d’être un peuple différent du peuple européen, « un peuple qui a un pacte avec Dieu », et se propager une nouvelle vague de millénarisme prophétique : le « Grand Réveil ». Sans se réduire au millénarisme apocalyptique du siècle précédent, celui-ci ne brillera pas par sa soumission au rationalisme, arcbouté qu’il sera sur une critique de la philosophie des Lumières européennes, tout en parvenant à enrôler des hommes des « Lumières » américaines tel Benjamin Franklin. Les sermons des prédicateurs, qui parcouraient la NouvelleAngleterre, ne seront pas étrangers au climat de guerre sainte, pendant la guerre francoindienne entre 1756 et 1763 (qui, en Europe, prendra le nom de « guerre de Sept Ans), contre les Français papistes. Cette guerre provoquera en outre chez les Américains une hostilité à l’égard des Anglais, qui avaient pourtant combattu aux côtés des colons américains contre les Français. Dans le même temps, les immigrés scoto-irlandais alimentèrent un sentiment de haine à l’égard de l’Angleterre qui, après les avoir transplantés d’Écosse en Irlande, les avait contraints à l’exil en Amérique en fermant les marchés anglais aux produits irlandais. La rhétorique apocalyptique contre les Anglais atteindra, dans les années qui suivirent, son acmé dans les discours ecclésiastiques, en particulier après le Québec Act qui protégeait le catholicisme au Canada français. En réaction à tous ces camouflets, « les colons se mobilisèrent le long de frontières géographiques, créant le Congrès International, des comités illégaux, des gouvernements provinciaux et une armée – ces étapes aboutissant à l’indépendance nationale en moins de deux ans […] L’extension géographique de la définition de la Communauté de Dieu provoqua un changement important au milieu des années 1770. Avant cela, le pacte manichéen et le discours sur la Providence, qui décrivait les vertus et les obligations du peuple de Dieu, étaient largement ancrés dans le vocabulaire provincial de la Nouvelle Angleterre. Désormais ce symbolisme touchait toute la nation […] La représentation de la Grande Bretagne comme l’Antéchrist devint de plus en plus fréquente dans les colonies. »14 En 1776, le pamphlet Common Sense, publié par Thomas Paine, condensera les termes de la colère des Américains contre le roi d’Angleterre, traité de « brute royale ». Mais ce pamphlet vaut surtout pour sa présentation de la particularité américaine par rapport à « un vieux monde effondré (offrant l’hospitalité à l’antéchrist papiste), une Angleterre égyptienne (esclave d’un pharaon endurci par un caractère funèbre) et une nouvelle Canaan à qui le salut de l’humanité avait été confiée par les desseins du ciel ». Paine affirmera que « le temps est venu de la séparation. La distance que le Tout-Puissant avait mise entre l’Angleterre et l’Amérique était précisément une preuve fournie par la nature que la suprématie de l’une sur l’autre n’avait jamais été dans les desseins de Dieu […] La Réforme fut précédée par la découverte de l’Amérique comme si le Tout-Puissant avait eu la bienveillante intention de créer un refuge pour les futurs persécutés à qui leur patrie n’offrait plus ni amitié ni salut. [Les opprimés ont fui l’Europe] pour venir ici et échapper […] à la cruauté d’un monstre. »15 John Adams, l’un des chefs de file de la Révolution américaine, qui deviendra le deuxième Président des États-Unis, aura lui aussi recours à un discours millénariste : il prédit que la libération de la nation « s’accomplirait de la même façon qu’elle s’était déroulée pour les fils d’Israël, en passant par toutes les ténèbres, avec du sang et des trahisons » et que « ce serait le jour des épreuves d’Israël. » Le texte de la Déclaration d’Indépendance, ratifiée le 4 juillet 1776, sera imprégnée d’une version laïcisée de cette rhétorique millénariste : « Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés par le Créateur de droits inaliénables ; parmi ces droits figurent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » L’idée que tous les hommes « sont créés égaux » ne peut être comprise que dans le sens apocalyptique de l’égalité des justes et des martyrs ressuscités pour le règne du Christ sur la terre pour mille ans. Sans cette interprétation, la Déclaration serait incompréhensible puisqu’il va de soi que, dans l’esprit de ses rédacteurs, il n’était pas question de promettre l’égalité sociale. L’affirmation que la « poursuite du bonheur » devait compter parmi les droits inaliénables provient en droite ligne de la « philosophie » millénariste, seul le règne du Christ sur terre pouvant garantir un tel droit. La Déclaration d’Indépendance aboutira à une guerre civile au cours de laquelle les patriotes infligeront de durs traitements aux loyalistes, les torries : expropriation des biens, flagellations, pendaisons. Les patriotes se considéraient comme le nouveau peuple élu, celui des défenseurs de « la vérité contre l’erreur et le mensonge, de la justice contre l’injustice […] le parti […] du père miséricordieux de l’univers contre le prince des ténèbres destructeur de la race humaine ». La guerre entre Anglais et Américains sera l’occasion pour les ennemis européens des premiers de prendre le parti des seconds : la France et l’Espagne déclarèrent la guerre à l’Angleterre ; la Russie, la Suède et le Danemark manifestèrent leur neutralité – la Vieille Europe corrompue contre l’Angleterre totalement corrompue. Il faut évidemment se garder de réduire la Révolution américaine (voir infra) à cette interprétation apocalyptique mais il ne faut pas non plus en minimiser l’importance : les premières versions du sceau des États-Unis, présentées par Franklin et Jefferson figuraient Moïse guidant le peuple élu. Le symbole de l’aigle qui fut finalement adopté aurait, selon certains, l’Apocalypse pour origine. L’aigle est en effet le symbole dont on trouve trace dans un texte du prophète Ézéchiel : « Au centre je discernai quelque chose qui ressemblait à quatre animaux dont voici l’aspect : ils avaient une forme humaine (Ez 1:5). Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes (Ez 1:6). Quant à la forme de leurs faces, ils avaient une face d’homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite, et tous les quatre avaient une face de taureau à de gauche, et tous les quatre avaient une face d’aigle (Ez 1:10). » Dès les lendemains de l’indépendance, en 1783, un nouvel État, la « cité sur la colline », devait être édifié avec le souci constant de se démarquer du « modèle » européen. Le rejet de l’Europe par les politiques se fondait notamment sur celui de la confusion entretenue dans les pays du Vieux Continent entre le sacré et le profane. Aussi, en dépit des références permanentes aux Évangiles pour fonder la condamnation de l’Europe et asseoir l’idée que les États-Unis était une nouvelle Jérusalem, la laïcisation de la société américaine fut-elle précoce et plus aboutie qu’en Europe. Nous y reviendrons ultérieurement mais notons que le poids de la religiosité aux États-Unis ne sera jamais, bien au contraire et contrairement à la légende, un frein à la laïcisation. Cette vision particulière du rôle que les Américains seraient appelés à jouer dans le monde, cette croyance en un destin exceptionnel, s’inscrit donc dans la tradition biblique ainsi que dans la tradition réformée. Le calvinisme et sa doctrine de la prédestination ouvriront la voie au mythe du peuple élu et à l’idée d’une nation dans laquelle chaque réussite est le signe de l’élection divine, une doctrine qui ne va pas sans une vérification permanente de la preuve de l’élection et du développement d’une mentalité conquérante, aussi bien dans le domaine de la réussite personnelle que dans le domaine politique. Le terme de « destinée manifeste » n’apparaîtra sous la plume de John O’Sullivan qu’en 1845 mais la réalité que recouvre cette expression – conceptualisation du destin exceptionnel de la nation américaine en un instrument géopolitique – existe depuis les origines. Cette notion de destinée manifeste va peu à peu s’imposer comme le fondement idéologique du rapport qu’entretiendra l’Amérique avec le reste du monde. L’idée de frontière (au sens de front pionnier) en découlera et avec elle le besoin existentiel de la nation américaine de repousser sans cesse les limites naturelles, psychologiques ou politiques – l’impossibilité d’assigner des limites aux États-Unis. La frontière sera donc repoussée jusqu’à ce que les limites naturelles du territoire soient atteintes. Quand, au XIXe siècle, les États-Unis décideront de promouvoir les vertus du libre marché comme manifestation des valeurs démocratiques, il deviendra nécessaire d’en assurer la promotion au-delà des frontières géographiques du pays et de bâtir un nouvel ordre mondial. En outre, le « droit au bonheur » imposé par la déclaration d’indépendance ne pouvant être l’apanage des citoyens américains devra donc s’étendre à l’ensemble du monde des hommes. Cette vocation universaliste légitimera encore plus l’interventionnisme. L’expansionnisme américain avait vu le jour.
Les habits neufs de l’impérialisme américain
« Ce que nous essayons de faire, c’est que les États-Unis soient encore les leaders pendant les cinquante ans à venir » : ce message sans ambiguïté de Benjamin Rhodes, conseiller adjoint à la sécurité nationale jusqu’au terme du second mandat d’Obama, fera voler en éclats les espoirs de ceux qui avait cru bon d’accorder crédit aux promesses de ce dernier lors de sa première campagne pour l’accession à la Présidence. Obama lui-même, lors de son deuxième mandat, n’hésitera pas à proclamer à maintes reprises que le XXIe siècle serait, à l’instar du précédent, le siècle des États-Unis. En fait, les signes de l’adhésion d’Obama à la politique impériale, dans la continuité de celle de son prédécesseur, furent brandis par l’hôte de la Maison Blanche au lendemain de son élection. Opposé à la guerre en Irak avant son entrée au Sénat, Obama fera voter l’octroi de 360 milliards de dollars de crédits pour intensifier les combats. La résistance irakienne sera finalement écrasée mais il aura fallu pour cela cinq ans de combats et l’intervention de 250 000 hommes sur le territoire irakien. En Afghanistan, pays sur lequel Obama entendait concentrer les efforts de guerre, tous les moyens technologiques seront utilisés pour venir à bout de la guérilla afghane : missiles Hellfire sur les villages suspects à la frontière nord-est du pays ; drones qui, pendant le premier mandat d’Obama, auront un « rendement » dix fois supérieur à celui obtenu sous la présidence de Bush. Aujourd’hui, bien qu’un retrait quasiment total des troupes eût été prévu d’ici la fin janvier 2017, quelque 10 000 soldats américains sont encore déployés sur le sol afghan. Pour que cette « guerre nécessaire » (par opposition à la « guerre choisie » contre l’Irak) ne connaisse pas une issue fatale, c’est-à-dire une véritable défaite des États-Unis, ces derniers ont signé avec Kaboul un traité qui prévoit la présence en Afghanistan de bases, de forces aériennes et de conseillers américains jusqu’en 2024. La guerre contre le terrorisme, elle, se poursuit et obéit à la même logique depuis son déclenchement : les techniques d’interrogatoire de l’époque Bush sont toujours à l’œuvre ; Guantanamo n’est toujours pas fermé ; l’action présidentielle est, plus que jamais, recouverte du voile du secret. Pour ce qui est du conflit avec l’Iran, l’accord du 14 juillet 2015 se limite au dossier nucléaire et ne concerne nullement les autres contentieux qui séparent Téhéran de Washington. Une normalisation des rapports entre les deux pays n’est pas à portée de main et cet accord sur le nucléaire peut difficilement être vu comme l’élément précurseur d’une relance des relations bilatérales. Washington a d’ailleurs envisagé de nouvelles sanctions visant Téhéran et plus particulièrement son programme balistique, à la suite de deux essais qui, selon les États-Unis, violent les obligations internationales de l’Iran. Les accusations américaines contre Téhéran sont nombreuses. Elles visent donc les essais balistiques mais aussi le soutien iranien à des organisations classées par Washington comme groupes terroristes, ou plus généralement les activités de déstabilisation au Proche-Orient (soutien apporté au régime syrien et à la guérilla houthiste au Yémen). L’ardeur mise par Washington pour conclure un traité sur le nucléaire iranien, qui ne faisait peser aucune menace sur les États-Unis, s’explique avant tout par la présence dans la région d’un important arsenal nucléaire israélien dont la mise au point d’une bombe iranienne aurait brisé le monopole. Le risque d’embrasement du monde arabe qu’une intervention militaire d’Israël représentait et l’impossibilité pour les États-Unis de déclencher une guerre préventive en Iran convainquirent Washington de tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord. Toutefois, le véritable objectif d’Obama était d’étrangler le régime iranien par un blocus économique et une cyberguerre, donc d’enclencher une dynamique de l’escalade. L’accord sur le nucléaire iranien, avec l’arrivée de Trump à la Maison Blanche et l’adoption par ce dernier d’une position alignée sur celle d’Israël, est aujourd’hui menacé, mais le carcan américain conçu par Obama reste en place. Pour ce qui est de la situation en Syrie, les États-Unis se voient reprocher leur manque de leadership face à l’intensification et à l’internationalisation de la guerre et leur incapacité d’empêcher leur allié turc de bombarder les Kurdes syriens et d’enrayer le rouleau compresseur russe. Les critiques les plus dures contre Washington viennent de Paris qui n’a jamais accepté que Obama renonce en 2013 et à la dernière minute, à frapper le régime du président Bachar el-Assad. L’administration américaine fit valoir que la chute d’Assad n’est pas une priorité et que la coalition militaire de 65 pays qu’elle pilote a déjà à son actif des milliers de raids contre le groupe État islamique. Il est vrai que Washington est dans une position inconfortable : il est l’allié d’Ankara au sein de l’Otan et de la coalition anti-djihadistes, mais il soutient aussi les unités de protection du peuple kurde, les milices du Parti de l’union démocratique qui se battent contre l’État islamique ; les États-Unis sont aussi, au grand dam de l’Europe, les partenaires de la Russie pour trouver une solution diplomatique et politique. Le sénateur républicain John McCain crut déceler dans le positionnement de l’administration Obama une concession inacceptable à une « diplomatie russe au service d’une agression militaire que l’administration Obama a favorisée ». Il s’agirait même, selon Michael Ignatieff et Leon Wieseltier dans une tribune de la Brookings Institution d’une « faillite morale de la politique américaine en Syrie ». Mais ces jugements « moralisateurs » ne seront pas de nature à impressionner Obama. Ce dernier savait que le rapport de forces est défavorable au régime d’Assad. En dépit du soutien des alaouites, de la Russie et du Hezbollah et des livraisons d’armes par l’Iran, le pays est pris en tenailles entre les forces de rébellion soutenues par les États du Golfe et les pays occidentaux, Israël et la Turquie – laquelle Turquie sera à terme la puissance dominante dans la région, une arme de plus dans les mains américaines pour soumettre un peu plus l’Iran. Dans les pays du Printemps arabe, les évolutions récentes – la fin des régimes islamistes qui avaient eux-mêmes mis un terme aux régimes policiers – ouvre une période d’incertitude pour les intérêts américains. En Égypte, l’arrivée au pouvoir de Abdel Fattah al-Sissi semblait promettre un partenariat fort avec Washington mais la fronde populaire contre celui qui avait été traité en héros en 2013 pour avoir renversé Mohamed Morsi, le président issu des rangs des Frères musulmans, s’est étendue au point que Sissi semble désormais avoir perdu la plus grande partie de ses soutiens parmi les journalistes, les hommes d’affaires, les classes populaires et même les nationalistes purs et durs. Aussi le pouvoir a-t-il renoué avec les pratiques des régimes autoritaires : la répression s’abat régulièrement sur les forces d’opposition, à l’exception du parti salafiste al-Nour. Les États-Unis soutiennent toutefois le gouvernement égyptien car ils considèrent l’État islamique comme la principale menace et le régime égyptien leur apparaît comme un rempart contre celui-ci, au pire comme un moindre mal, une vision à court terme qui risque de faire le lit des mouvements terroristes. Au Yémen, où se poursuit un conflit opposant la coalition saoudienne aux rebelles houthistes de confession chiite, la tension entre Riyad et Téhéran a conduit Washington à s’engager dans ce qu’il faut bien appeler une nouvelle guerre. John Kerry a même explicitement reconnu l’engagement américain et désigné le responsable : l’Iran, soupçonné de vouloir déstabiliser le pays et qui, lui, accuse l’Arabie Saoudite d’être l’agresseur dans le conflit yéménite. Pour ce qui est du problème palestinien, les États-Unis ont compris qu’il était urgent de ne rien faire. L’affaiblissement de la volonté de résistance de l’Autorité palestinienne désormais au bord de la faillite, le rapprochement du Hamas et du Qatar, l’éloignement des pays arabes qui retirent les uns après les autres leur soutien aux Palestiniens : tout se conjugue pour que les États-Unis se rallient à l’idée que la création d’un État palestinien ne figurera probablement jamais sur un quelconque calendrier. En dépit du caractère extrêmement volatil de la situation dans le monde arabomusulman et des équilibres instables avec lesquels les régimes doivent composer, la place de la puissance impériale américaine au Proche et au Moyen-Orient n’a pas évolué défavorablement, du moins dans le monde arabe où les monarchies pétrolières de la péninsule arabique, soutiens résolus des États-Unis, ont acquis une influence à la mesure de celle que l’Irak, la Syrie ou les pays de Printemps arabe ont perdu. Dans les pays musulmans non arabes, la position américaine est plus inconfortable mais le conflit plus ou moins ouvert entre sunnites et chiites rend illusoire la création d’un quelconque front islamique. En dépit des efforts de Poutine pour être considéré comme un interlocuteur incontournable, la Russie n’a plus guère de cartes à jouer, sur le plan militaire, pour contrarier les desseins américains, y compris dans les régions qui furent autrefois des zones d’influence et doit se contenter de « montrer ses muscles » dans les territoires de l’ex-URSS ou, sur les questions concernant d’autres régions du monde, de manier le compromis au point de risquer de tomber dans la collusion. Obama a même pu s’offrir le luxe d’annoncer, en 2009, l’abandon de la mise en place d’un système de défense antimissile que Bush avait prévu d’installer en Europe de l’Est et d’installer, en 2015, un bouclier anti-missile en Roumanie, bouclier dirigé contre les menaces hors de l’espace euro-atlantique – les deux fois en invoquant la question du nucléaire iranien comme justification de ces décisions : la première fois en arguant du fait que le développement du segment européen de la défense antimissile n’était plus d’actualité, la seconde en affirmant vouloir se protéger des missiles iraniens. Mécontent du détournement par les États-Unis d’un vote favorable de la Russie à une résolution de l’ONU autorisant la création d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Lybie, Poutine a opposé son veto à une résolution semblable concernant la Syrie et Moscou a lui-même procédé à des lancements de missiles contre l’État islamique en Syrie. Ce coup d’éclat de la Russie45 a montré que le système anti-missile américain déployé en Europe de l’est pour contrer la menace iranienne est d’une totale inutilité. Mais, en dehors de ce fait d’armes, Moscou a peu de moyens politiques et financiers pour contrecarrer les visées américaines. La Russie doit se contenter de souffler le chaud et le froid au Conseil de sécurité de l’ONU et se résoudre à servir de base arrière des troupes américaines en Afghanistan. Toutefois, la guerre en Syrie et le contexte syro-irakien ont ramené la Russie de Poutine dans le jeu diplomatique et les États-Unis doivent désormais compter avec Moscou. Pendant que les États-Unis s’enferraient dans d’interminables guerres au ProcheOrient, la Chine allait s’imposer comme puissance économique majeure, plus dynamique que les États-Unis et, surtout, forte de réserves financières dont le crédit public américain deviendrait dépendant. Cette montée en puissance de la Chine, qui est devenu le premier exportateur mondial en 2010 et la première économie manufacturière en 2012, a contraint les États-Unis à opérer de nombreuses réorientations stratégiques pour tenter de limiter les dangers de cette ascension – économique mais également militaire. La stratégie de Washington se développe aujourd’hui sur deux versants. Sur le plan militaire, elle consiste à disposer des installations militaires dans les pays alliés aux États-Unis voisins de la Chine de façon à préserver la supériorité navale américaine dans le Pacifique, y compris dans la mer de Chine orientale. Quoi que l’on pense de la politique chinoise et de la nécessité pour les États-Unis d’endiguer les velléités de la République populaire de Chine, l’attitude américaine est plus que jamais révélatrice de la volonté américaine de jouer maximalement de ses prérogatives impériales : les États-Unis considèrent comme normal de jouer les gendarmes des mers dans le Pacifique à onze mille kilomètres de leurs propres côtes alors qu’une situation symétrique (présence d’une flotte étrangère dans ses eaux territoriales) déclencherait, sans nul doute, une réplique militaire américaine contre les intrus. Sur le plan diplomatique, la stratégie américaine consiste à exercer une pression sur la Chine – capitaliste mais à l’opposé du libéralisme politique – pour qu’elle prenne place dans le système économique mondial et que sa pratique obéisse à un ordre libéralcapitaliste, un double objectif qui permettrait à la Chine de devenir … le second derrière le grand frère américain.
Le face-à-face sino-américain et l’absence de l’Europe
Obama mit à profit son voyage de novembre 2012 en Asie du sud-est, le premier à l’étranger après sa victoire électorale pour un second mandat, pour annoncer la réorientation économique du pivot, réorientation dont l’objectif était de gommer l’image d’une politique, amorcée à la fin de l’année 2010 (deuxième phase du pivot), qui par son approche principalement militaire avait mis les États-Unis sur la voie d’un conflit avec la Chine. En effet, l’échec de la politique de séduction vis-à-vis de la Chine (première étape du pivot) avait conduit l’administration Obama à réallouer l’investissement américain dans les organisations asiatiques au profit d’une stratégie de containment de la Chine, stratégie ayant pris un tour nettement militaire : accroissement de la présence militaire américaine en Asie (nouvelles bases aux Philippines et à Singapour, bases de Marines à l’île de Guam), projet de positionnement à l’horizon 2020 de 60% de la flotte américaine dans le Pacifique. Cette attitude belliciste avait été clairement exprimée par Hillary Clinton dans son discours devant l’ASEAN en 2010 à Hanoï. La réorientation économique du pivot en Asie modérait ainsi cette position – délibérément dure – en mettant l’accent sur le commerce et l’investissement et en plaidant pour la création d’emplois nationaux dans le secteur de l’industrie de transformation grâce à des exportations plus importantes vers « la région à la croissance la plus rapide et la plus dynamique du monde ». Même lors de la visite d’Obama en Birmanie (la première par un Président des États-Unis), les questions concernant le commerce furent au cœur des discussions. Le recentrage annoncé sur les questions commerciales et économiques se traduisit également par le désir de Washington de promouvoir l’Accord de Partenariat transpacifique (TPP68) visant à créer un nouveau groupe de libre-échange Asie-Pacifique excluant la Chine. Cette évolution présumée de la politique des États-Unis à l’égard de la Chine affecte, comme toujours en pareil cas, la rhétorique : les diplomates américains sont désormais invités à éviter le terme de « pivot », à connotation trop militaire, et de lui préférer celui, plus neutre, de « rééquilibrage ». En outre, l’administration Obama va jusqu’à nier que la Chine soit au centre de cette nouvelle stratégie, bien qu’elle lui permette de renforcer ses alliances et ses liens avec les pays périphériques de la Chine, dont l’Inde, le Japon, les Philippines, le Vietnam, l’Indonésie et la Corée du Sud. Il s’agit de ne rien faire et de ne rien dire qui puisse alimenter la colère de la Chine. Mais, en dépit du discours officiel, tout indique que le continent asiatique est devenu le cœur des préoccupations stratégiques américaines et que l’heure n’est pas à une troisième phase du pivot qui viendrait corriger les excès de la seconde. Au-delà des déclarations de neutralité, l’objectif de l’administration Obama est, d’une part, de lancer un message à ses partenaires européens et asiatiques et, d’autre part et de manière plus profonde, de reprendre l’ouvrage interrompu par la gestion de l’héritage de Bush : la redéfinition et la réorganisation du leadership global des États-Unis. Autrement dit, à travers le pivot vers l’Asie, c’est bien la question de la gestion de l’hégémonie qui se trouve posée. Il faut bien comprendre que, depuis plus de vingt ans, les administrations américaines successives parlent du recentrage des intérêts autour de l’Asie-Pacifique. Le pivot des États-Unis vers l’Asie, dans ses diverses phases, n’est peut-être au fond qu’un nouvel emballage rhétorique de vieilles mesures politiques. La position officielle des États-Unis est donc le dialogue avec la Chine mais la réalité est l’endiguement. Il est difficile d’évaluer le degré de dangerosité de la menace militaire que la Chine représente mais les manifestations de fermeté diplomatique de Pékin inquiètent les Américains. Il n’est pas exclu que la position des Chinois soit le reflet de leur inquiétude vis-à-vis des tensions politiques et sociales internes et que la posture de fermeté du pouvoir soit destinée à satisfaire une opinion publique nationaliste, mais le dispositif militaire américain est menaçant pour la Chine. Outre que cela nourrit les peurs américaines, le maintien de ce dispositif renforce le désir des pays alliés (Japon, Corée du Sud, Australie) d’accroître leur autonomie vis-à-vis des États-Unis, désir qui contrarie le souhait de l’administration américaine de les voir partager le fardeau sécuritaire. Les États-Unis doivent donc compter, à la fois, avec leur crainte d’une neutralisation de l’Asie du Sud-Est par la Chine et la nécessité de respecter la marge de manœuvre de leurs alliés. Les institutions militaires américaines anticipent déjà des scénarios de guerre avec la Chine, craignant l’usage par cette dernière de moyens non conventionnels et les effets d’une éventuelle modernisation de l’armée populaire. Le rapport de forces militaire restant extrêmement favorable aux Américains, dans quelle mesure ces scénarios masquent-ils une autre préoccupation de l’administration Obama : la crainte de la remise en cause du statut des États-Unis par la montée en puissance économique de la Chine ?
|
Table des matières
Introduction
L’anti-européanisme américain, de la vassalisation à la relégation de l’Europe
1. Les premiers effluves de la haine anti-européenne
2. La relégation de l’Europe
Les origines de la pensée politique moderne
1. Le génie de l’Occident pré-moderne
2. La naissance du sujet
3. L’émancipation par la raison
4. La naissance de la conscience révolutionnaire
5. Les deux Révolutions
L’Europe et l’Amérique face au nihilisme post-moderne
1. De quelques erreurs concernant le regard contemporain sur la modernité
2. Le libéralisme et l’État
3. Le libéralisme, empire du moindre mal ou meilleur des mondes ?
4. L’Europe au miroir du style national américain
5. Le multiculturalisme
6. Le poids de la religiosité
7. Transcendance ou nihilisme
Conclusion
Annexes
Annexe 1. Le creuset théologico-juridique de l’Occident moderne
Annexe 2. Les États-Unis, laboratoire du suprémacisme racial
Annexe 3. L’Europe des ténèbres
Bibliographie
Télécharger le rapport complet