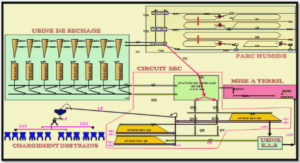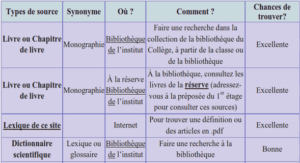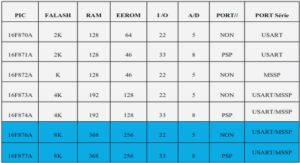Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Le pari de l’indépendance pour reconquérir le lectorat
Pour prendre le temps d’écrire un reportage long et de qualité, il faut justement en avoir, du temps. Et ce n’est souvent pas le cas pour la plupart des médias traditionnels, dont les obligations de réactivité et de rentabilité économique poussent à privilégier l’actualité chaude. Faute de moyens et de temps, les rédactions publient moins de reportages et d’enquêtes au long cours. Ils sont en tout cas beaucoup plus rares que dans les mooks. Pour sortir de cette course à l’information, les mooks font eux le pari de prendre le temps, mais aussi, le pari de l’indépendance, loin des régies publicitaires et des conflits d’intérêts influençant plus ou moins le contenu éditorial. En effet, la majorité des mooks sont détenus pas des actionnaires indépendants, souvent les fondateurs de la revue. XXI est par exemple détenue par ses fondateurs, Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry — à 33% chacun, à 20% par la société Rollin Publications, et le reste par des actionnaires individuels.
Cette indépendance n’a pas été choisie au hasard. C’est, encore une fois, « en réaction » au journalisme traditionnel, et donc, encore une fois, un moyen de se différencier. Marie-Eve Thérenty, chercheuse et professeure à l’Université de Montpellier, rappelle que « dans leurs déclarations d’intention, plusieurs mooks ont affirmé que leur fondation était une réaction à une dégradation généralisée du journalisme liée à la collusion de la presse avec des intérêts financiers et à une exigence d’immédiateté et de réactivité, (…) et contraire, selon eux, aux impératifs d’une information de qualité »(1). Par « intérêts financiers », Marie-Eve Thérenty rappelle ainsi que la majorité des titres de presse sont aujourd’hui détenus par de grands groupes industriels, aux mains de millionnaires dont l’activité principale n’est à la base pas le journalisme. Ces médias sont souvent décriés par la population, accusés d’être à la solde des pouvoirs politique et économique. L’incendie de sept kiosques à journaux lors de l’acte 18 des « gilets jaunes », le 18 mars dernier à Paris, témoigne de cette défiance envers les médias traditionnels. Sonia Zoran, journaliste et productrice suisse, va même plus loin, en affirmant que « les lecteurs se désintéressent d’une presse moribonde à force d’économie et à force de recherches d’annonceurs »(1). Les mooks, par leur volonté de s’opposer à ce journalisme dépendant de multiples intérêts, se dressent donc comme un genre de contre-pouvoir médiatique, car ils font le contraire des autres titres de presse traditionnelle, sur tous les points. Cela passe donc entre autres par l’indépendance éditoriale, mais aussi, par l’absence de publicité.
En effet, s’affranchir de la publicité est un atout considérable des mooks. Aucun ne fait de publicité dans ses pages, hormis de la publicité pour son propre groupe — dans la revue America, la seule publicité est en quatrième de couverture, et invite le lecteur à regarder l’émission La Grande Librairie, présentée et produite par François Busnel, le fondateur de la revue. Dans le fond, l’absence de publicité est aussi un gage d’indépendance, une manière de prouver qu’ils sont affranchis de tout conflits d’intérêts et que l’information est la seule priorité. L’hebdomadaire le 1, qui appartient au même groupe que le récent Zadig et la revue America, 1ère page du manifeste de XXI revendique son indépendance « d’aucun groupe financier » pour « garantir une information fiable, loin de toutes pressions »(2). A supposer, donc, que les autres titres ne seraient pas fiables, car dépendants de la publicité.
Il est vrai que la presse s’est déjà montrée subjective dans ses choix de sujets et dans son traitement de certaines informations. Par exemple, lors de la sortie, en novembre 2014, de plusieurs révélations compromettantes pour Serge Dassault — il aurait eu accès à des procès-verbaux d’audition de son comptable suisse, le journal Le Figaro s’était contenté de quelques lignes sur son site web, et d’une simple brève dans son édition papier, alors que ces dernières révélations avaient abondamment alimenté la Une des médias. « Un choix éditorial pour le moins atypique ! », commente L’Obs, rappelant que Serge Dassault est le propriétaire du Figaro(1). Ce genre de conflits d’intérêts, qui ne sont pas rares dans le paysage médiatique français, ne semblent pas toucher les mooks, car ils s’affirment comme en étant totalement affranchis.
Dans son manifeste pour un autre journalisme, publié à l’occasion de son 21ème numéro, la revue XXI fustigeait d’ailleurs l’aliénation de la presse à la publicité. Dans ces lignes, les fondateurs de XXI, Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria, soulignaient « qu’à viser des « cibles » pour satisfaire aux exigences de la publicité, à accepter de se façonner ainsi, les titres perdent leur âme. Le petit frisson de surprise et d’étonnement, qui fait la valeur d’un titre pour son lecteur, disparaît au profit de rubriques attendues et répétitives. Le public devient objet et non plus sujet »(1). Ce manifeste est particulièrement intéressant, car il aura permis de fixer une certaine identité des mooks, comme souhaitant revenir au coeur de l’actualité par le temps long, et surtout, devenir totalement indépendants dans leur traitement de cette actualité. Mais se lancer dans une totale indépendance représente un certain risque, car les journalistes se privent de certains financements alloués par la publicité. Dans leur manifeste, les fondateurs de XXI commentent ce choix d’absence de publicité : « En prenant ce risque, nous avons adressé un message dont nous ne soupçonnions pas la force : l’adhésion des lecteurs a été immédiate et puissante. L’absence de publicité était pour eux le sceau de notre authenticité »(2).
Mais, surtout, cette information indépendante a un coût, plus élevé que la presse traditionnelle : entre 15 et 20€ le numéro de n’importe quel mook. En y mettant le prix fort, le lecteur a ainsi la sensation de participer au financement de la revue et de ses reportages, et paie aussi l’absence de publicité. Que l’adhésion des lecteurs aient été forte pour la revue XXI n’est donc pas étonnant, surtout qu’elle est le premier mook français. Depuis, de nombreux se sont créés, avec plus ou moins de succès. En témoigne l’arrêt prématuré de Pop Story, une revue bimestrielle de 200 pages, qui n’aura duré que deux numéros en 2016. Par manque de financements, ses créateurs ont dû arrêter sa publication. Mais il existe aussi des exemples de beaux succès, comme la revue America que nous allons maintenant étudier.
Un espace de convergence entre littérature et actualité
Prendre le temps d’élucider le réel, cela veut dire prendre le temps d’écrire, et de bien écrire. Les revues comme les mooks possèdent un style d’écriture bien particulier, relativement unique, dans lequel le journaliste met en scène son récit. Il s’agit de proposer un traitement de l’information plus réfléchi. Patrick Vallélian, rédacteur en chef du mook suisse Sept Info, parlait en interview d’une certaine demande faite aux journalistes d’avoir « un regard différent. Finalement, une brève, un robot peut l’écrire »(1). Le contenu des mooks ne sont pas juste un alignement d’informations, mais plutôt un alignement d’informations romancées, ce qui permet de mieux immerger le lecteur, et de lui faire vivre le récit. La presse, comme la littérature, emmène le lecteur dans un autre lieu, parfois un autre temps, avec l’idée toujours de réalité et de fiabilité. En créant un espace de convergence entre littérature et actualité, les mooks font revivre cette tradition ancienne d’un journalisme qui prend le temps, et, aussi, qui fait du journaliste une figure littéraire importante. Ils n’ont, au fond, rien inventé de nouveau. Au XIXème siècle, les journaux se sont construits au travers de la littérature, et les écrivains deviennent des salariés du journal. C’est le cas par exemple d’Honoré de Balzac qui, après avoir rencontré le patron de presse Émile de Girardin vers 1830, va devenir journaliste pour La Presse. Il y publiera d’abord des critiques littéraires et quelques chroniques, l’idée étant de produire chaque semaine des esquisses de la société sous le nom « La Silhouette ». A cette période, la figure de l’écrivain et du journaliste se confondaient déjà, car la structuration des récits et des articles étaient en fait les mêmes. Il s’agissait de décrire la société telle qu’elle était, sans artifice, et de rendre compte de la vie quotidienne de tout à chacun. Les mooks ont donc renouvelé cette tradition, et c’est ce que nous allons analyser dans cette deuxième partie.
Un journalisme narratif pour plus de profondeur
Les mooks se caractérisent donc par cette littérarisation du journalisme. Cela permet une meilleure immersion dans le récit, lui donnant plus de profondeur. Il s’agit en fait de mettre en avant un certain « storytelling » — en français, la « mise en récit », et une certaine plume libérée, voire décalée. Cela permettrait, selon les mots de François Busnel, d’apporter un certain « supplément d’âme »(1) que le journalisme traditionnel ne parvient pas à transmettre. Ainsi, dans la plupart des articles de mooks, une grande part est laissée au « je » et au « nous », que l’on ne retrouve jamais dans des articles de presse traditionnelle. Le journaliste fait vivre son récit et l’actualité qu’il décrit en se mettant en scène. Il s’agit en fait d’un double-récit : à la fois celui de l’actualité, et celui du journaliste, qui raconte, aussi, son cheminement rédactionnel et sa quête d’informations.
Cela est par exemple visible dans l’article « My president was black » publié dans le premier numéro d’America par le journaliste américain Ta-Nehisi Coates, dans lequel ce dernier dresse un portrait/bilan des deux mandats de Barack Obama. Si c’est avant tout un article retraçant les derniers mois de l’ère Obama, c’est aussi et surtout un récit très personnel, dans lequel le journaliste n’hésite pas à user du « je » pour renforcer ses impressions sur l’action politique d’Obama. Il raconte même un déjeuner qu’il a pris avec ce dernier au printemps 2016, et il écrit : « quand je fis part à Obama de mon opinion selon laquelle la candidature de Trump était une réaction explicite à l’existence même d’un président noir, il me répondit qu’il en était conscient »(2). Ta-Nehisi Coates ne fait preuve d’aucune subjectivité, puisqu’il n’hésite pas à partager son opinion personnelle avec le lecteur. Quelques lignes plus loin, il ajoute même : « J’en vins à voir en Obama un politicien chevronné, un être profondément moral et l’un des plus grands présidents des Etats-Unis. Il était phénoménal »(2). Dans ce papier, le journaliste se montre nostalgique de cette Amérique de Barack Obama, désormais révolue par la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles de 2016.
La parole aux écrivains
Les mooks ne sont pas seulement des viviers de créations de journalistes, mais aussi des espaces d’expression pour de grands écrivains, qui voient dans cette discipline du réel un moyen de se reconvertir et/ou de se diversifier. Dans la revue America, quasiment tous les articles sont signés de la main de grands écrivains américains, comme Stephen King — dans le numéro 5, Pete Fromm — dans le numéro 6, Toni Morrison — dans le numéro 7, ou encore Chimamanda Ngozi Adichie — dans le numéro 8. Mais ces auteurs ne sont jamais choisis au hasard, car ils sont convoqués pour leur « expertise » dans un domaine bien particulier. Stephen King par exemple, a publié dans le numéro 4 d’America un essai inédit sur les armes à feu. C’est un sujet dont on peut dire qu’il lui est familier, puisqu’il s’affirme comme l’auteur de l’horreur et de la folie des hommes. Dans cet essai, il revient notamment sur la publication de son livre Rage en 1977. Ce livre, purement fictionnel, raconte l’histoire d’un lycéen qui tue son professeur et prend sa classe en otage. Stephen King écrit dans son essai pour America que Rage aurait inspiré un lycéen américain du nom de Jeff Cox, qui est arrivé en classe en 1988 armé d’un fusil d’assaut, et a pris sa classe en otage sans faire de victimes. Même chose en février 1996, lorsqu’un autre lycéen américain, Barry Loukaitis, a abattu sa professeure de mathématiques et deux élèves, armé d’un revolver et d’un fusil de chasse, en citant un extrait du livre Rage(1). L’auteur américain confie considérer son propre livre comme « un possible accélérateur » de ces actes violents, d’où le fait que celui-ci ai depuis été retiré de la vente. « On ne laisse pas un jerrycan d’essence à portée d’un enfant animé de tendances pyromanes », écrit-il(1). En racontant tout cela, Stephen King dresse un portrait glaçant de cette Amérique du deuxième amendement, où ses habitants, dès l’adolescence, sont baignés dans la violence. Même s’il est producteur de fiction, Stephen King écrit ici un récit réel et très personnel, qui illustre l’actualité américaine vis-à-vis des armes à feu — le numéro 4 d’America sur la violence en Amérique est sorti quelques semaines avant la fusillade au lycée de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts.
Donner la parole aux écrivains n’est finalement pas si antagonique avec la volonté journalistique d’America. Pour François Busnel, « les écrivains nous entrainent dans un autre monde, le vrai probablement. Leur rôle, Barack Obama l’avait parfaitement saisi. Il s’en fait, dans nos colonnes, le porte-étendard : ‘‘La fiction m’est utile pour me rappeler les vérités sous-jacentes aux sujets dont nous débattons tous les jours. C’est une façon de voir et d’entendre les voix, les multitudes de ce pays’’ »(1). En laissant des auteurs de fictions débattre de l’actualité, il s’agit alors de romancer le réel, de raconter l’actualité avec des mots qui vont toucher le lecteur plus profondément, et résonner en eux plus sensiblement que quelconque autre article. C’est une manière de créer un lien très intime entre le lecteur et l’écrivain. A François Busnel de préciser que « ce qui nous intéresse dans ce magazine, ce n’est pas les intellectuels, ce n’est pas ceux qui ont une opinion politique, mais ces écrivains qui vont nous raconter, nous faire du storytelling sur ce qu’ils voient. Et c’est vous, lecteurs, qui apportez le jugement, politique ou pas, sur ce que vous avez lu. C’est une forme d’engagement très puissante, qui unit le lecteur à l’écrivain »(2). Le lecteur se sent en fait plus proche de l’écrivain que du journaliste et se trouve plus touché par son récit, car il se reconnait plus facilement dans les personnages créés par la fiction, et s’identifie plus fortement à leur quotidien. Donner la parole aux intellectuels, c’est donc leur faire raconter des histoires d’actualité de manière plus concernée et concernante. Gabriel Tallent, écrivain américain, explique par exemple son rôle de romancier au service du monde : « Ma priorité, c’est de raconter des histoires dont le but sera d’influencer les perceptions du monde par les lecteurs »(2). Ces histoires peuvent bien être de la fiction, publiées sous forme de roman, ou de la non-fiction, publiées dans des revues-magazines.
La réapparition de la nouvelle dans l’espace médiatique
En plus d’articles d’opinion ou de récits d’actualité, les mooks ont aussi fait renaitre dans leurs pages un format disparu en France : la nouvelle. C’est, un court récit de fiction qui peut se lire en une seule fois, et qui se prête bien au format du journal et du magazine. Cette tradition de la nouvelle — « short story » en anglais, est très forte dans les pays anglo-saxons, surtout aux Etats-Unis. En France, la tradition était plutôt au feuilleton, avec en précurseur la Vieille Fille d’Honoré de Balzac, qui va susciter en 1836 une explosion des tirages du journal de Girardin, La Presse.
La nouvelle est un exercice littéraire particulier, car elle impose à son auteur de condenser son histoire, tout en gardant un maximum de détails pour crédibiliser son récit. Il s’agit de « souligner certains évènements et d’ignorer le non-pertinent ou le fastidieux, accélérer, ralentir, décrire des personnages clés, mais pas tous, pour se diriger, idéalement, vers un dénouement fort »(1). On pourrait ainsi le rapprocher d’un article de presse, dans lequel le journaliste est dans l’obligation de sélectionner un certain nombre d’informations, sans pour autant délaisser des détails utiles à sa compréhension et à sa vérité.
La nouvelle est en tout cas particulièrement présente aux Etats-Unis. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, plusieurs magazines américains renommés tels que The Atlantic Monthly, le Harper’s Magazine, The Saturday Evening Post, ou encore The New Yorker ont publié des nouvelles dans chaque numéro, rendant populaires des écrivains emblématiques comme Edgar Allan Poe, ou Francis Scott Fitzgerald. C’est après la Seconde Guerre Mondiale que la presse américaine a connu une floraison de nouvelles littéraires. L’une des nouvelles les plus emblématiques de l’époque : The Swimmer, publiée en 1964 par John Cheever dans The New Yorker. Ce titre a également publié Nine Stories, un recueil de nouvelles qui aura révélé J.D Salinger. Même chose pour Stephen King, qui a lui aussi débuté sa carrière en publiant des nouvelles dans la presse américaine, la première étant I Was a Teenage Grave Robber en 1965 dans le magazine Comics Review. Les grands écrivains semblent ainsi avoir un lien tout particulier avec la nouvelle, car elle leur a permis de lancer leurs carrières et d’effectuer leurs premières publications. Cette culture de la nouvelle est donc très forte aux Etats-Unis, encore aujourd’hui. Elle permet de mettre des mots fictifs sur des maux réels, comme a pu le faire James Baldwin en 1965 avec son recueil Going to meet the man, qui aborde une multitude de thèmes sociaux de l’époque comme le racisme, la suprématie blanche, les relations afro-américaines-juives, la justice, la toxicomanie, et la sexualité. C’est donc naturellement que la nouvelle s’est installée dans les colonnes de la revue America, dans ce soucis de parler de l’Amérique réelle et de ses traditions culturelles. Presque tous les numéros ont publié au moins une nouvelle, qui ne sont jamais choisies au hasard, mais toujours dans un soucis de cohérence avec l’actualité et d’exclusivité. Dans son premier numéro, la revue publie par exemple Reconnaissance de dette, une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald tirée du recueil Je me tuerais pour vous, qui sortait par la suite en librairie, quelques mois plus tard(1). Dans son troisième numéro, America publie « la dernière nouvelle de Jim Harrison », intitulée L’Affaire des bouddhas hurleurs. C’est une manière pour la revue de rendre hommage à cet écrivain pionnier de la littérature américaine, décédé un an et demi plus tôt(2). Cela permet aussi, encore une fois, de promouvoir le recueil Dernières nouvelles de Jim Harrison, en librairie quelques semaines plus tard.
Mais America ne publie pas seulement en exclusivité des nouvelles anciennes, mais aussi des nouvelles contemporaines qui ont rencontré un certain succès aux Etats-Unis récemment. C’est le cas de Cat Person, une nouvelle écrite par Kristen Roupenian publiée dans le numéro 6 de la revue — « Ladies First », consacré aux femmes. A l’origine, cette nouvelle a été publiée en novembre 2017 dans The New Yorker. Elle raconte l’histoire d’une rencontre entre un homme et une femme, suivie d’une relation sexuelle non consentie. Elle a, selon les mots d’America, « secoué l’Amérique », car elle est devenue virale sur Internet. Cat Person a par la suite donné lieu à de nombreux débats, notamment sur les sites de rencontres. Cette nouvelle s’insère en tout cas parfaitement dans le thème de ce numéro, qui met en lumière la condition de femme aux Etats-Unis, quelques mois après l’affaire Weinstein et la naissance du mouvement #MeToo(1). Dans ce sens, les nouvelles permettent donc d’illustrer une problématique contemporaine, une actualité forte, et ne sont pas uniquement des histoires sans contexte au préalable. En France, la nouvelle a disparu des journaux traditionnels, mais demeure, grâce aux mooks, un format d’écriture privilégiée, pour raconter le réel par la fiction.
Ainsi, les mooks sont des espaces de convergence entre littérature et journalisme, car ils font appel à des techniques d’écriture propres aux deux genres. En s’appuyant sur la littérature, les mooks usent d’une écriture qui prend son temps et qui se veut poétique et facile à lire. En s’appuyant sur le journalisme par le rubriquage et la construction des récits, les mooks éprouvent le besoin de rester au coeur de l’actualité, avec ce soucis d’informer avant tout. Mais cette information passe aussi par le visuel, l’esthétique soignée étant une caractéristique inhérente aux mooks.
|
Table des matières
1) Une volonté de prendre du recul : le « slow journalism »
a- Prendre le temps pour mieux élucider le réel
b- Le pari de l’indépendance pour reconquérir le lectorat
c- L’exemple d’America : « Comprendre plutôt que juger »
2) Un espace de convergence entre littérature et actualité
a- Un journalisme narratif pour plus de profondeu
b- La parole aux écrivains
b- La réapparition de la nouvelle dans l’espace médiatique
3) Esthétique et forme des mooks : éléments journalistiques ou illustratifs ?
a- Le retour du dessin comme production journalistique
b- Un rapport texte/image pas toujours évident
c- L’esthétique du support qui devient un objet-livre à collectionner
Conclusion
Annexes
Bibliographie
Télécharger le rapport complet