L’exemple parental : l’impact des pratiques littéraciques des parents sur le développement du savoir-lire de l’enfant
Outre le facteur socio-économique, Diatkine (1999 : 15-16) souligne également l’influence des parents et de leurs habitudes de lecture sur le comportement des enfants : « la plupart des enfants dont les parents sont lecteurs et qui ont été familiarisés avec les livres dans leur famille apprennent tôt ou tard à manier la langue écrite facilement ». Ainsi ceci témoigne bien du caractère prédictif de la familiarité avec l’écrit dans le développement du savoir-lire. De fait, afin de développer une certaine appétence à la lecture, il semblerait que les parents doivent eux-mêmes « montrer l’exemple » et témoigner de l’intérêt pour la lecture et ses supports. Certains chercheurs tels que Lahire (1995 :19-20) affirment que « le fait de voir ses parents lire des journaux, des revues ou des livres peut donner à ces actes un aspect “naturel” pour l’enfant », de même que « voir ses parents recourir quotidiennement dans la vie familiale à des écritures de tel ou tel type, peut jouer un rôle important ». Ainsi, il semblerait qu’un enfant ait plus de chance de s’investir dans la lecture si au sein de son entourage, il a l’occasion de côtoyer des adultes lecteurs et surtout lecteurs réguliers. Cette question de l’exemple parental nous amène à nous interroger sur les pratiques littéraciques familiales elles-mêmes. Au carrefour de différentes disciplines comme la sociologie, la psychologie et les sciences de l’éducation, le concept de littératie familiale apparu pour la première fois aux États-Unis dans les années 80 suite aux travaux de Taylor (1983) et a été défini par Dionne (2006 :2) comme étant « l’implication des membres de la famille dans des activités reliées aux littératies ». Cette conception de la littératie implique que « le parent est le premier et probablement le plus important éducateur de l’enfant » (Dionne in Berger et Desrocher, 2011 : 63). En ce sens, certaines études telles que celle effectuée par de Jong et Leseman (2001) ont démontré qu’un investissement fort de la part des parents, comme par exemple la mise en place d’un « environnement riche sur le plan de l’écrit et en expériences langagières » favorise la réussite de l’enfant lorsqu’il entre dans une étape d’apprentissage formel du savoir-lire (ibid. : 64). Epstein (2001) constate enfin que ces pratiques littéraciques familiales ont un impact non négligeable sur la réussite scolaire de l’enfant. En effet, ces pratiques littéraciques ont pour principal intérêt la motivation pour la lecture. Il semblerait que « le degré d’exposition et l’intérêt pour l’écrit sont déterminés par les adultes qui prennent soin des enfants durant les premières années de leur vie. Les attitudes, les croyances, le niveau d’habileté en lecture des adultes conditionnent le type d’expérience et la richesse des interactions avec l’écrit que les enfants auront la chance de vivre » (Burns, Espinosa, Snow 2003 : 77). De fait, le parent ne doit pas négliger l’impact de ses propres pratiques sur celles de son enfant. Mais pour qu’il y ait véritablement un impact, encore faut-il que les pratiques soient diversifiées.
Des pratiques diversifiées : entre spontanéité et intentionnalité
Il semblerait qu’il existe une grande diversité de pratiques littéraciques familiales, diversité induite notamment par le milieu socio-culturel dans lequel évoluent les familles (PurcellGates, 1996). Cependant, cette diversité des pratiques implique un impact variable sur le développement des habiletés en lecture. Il semblerait en effet que toutes les pratiques littéraciques familiales n’aient pas le même effet sur la réussite en lecture des enfants (Morrow, 2003). Ces pratiques – que ce soit l’écriture de lettres ou de cartes postales, l’élaboration de listes de courses, la rédaction de notes ou de petits mots, la lecture d’albums de jeunesse, de notice d’appareil, de programme de télévision ou de cinéma – peuvent se réaliser de deux manières : de façon consciente, avec un réel enjeu de communication autour de l’écrit avec l’enfant ou de manière plus spontanée, lors de pratiques quotidiennes ou courantes. En effet, certains parents semblent appréhender différemment ces pratiques littéraciques selon qu’ils « considèrent que l’initiation à l’écrit fait partie des loisirs familiaux ou qu’ils les restreignent à un certain nombre d’habiletés de base qu’ils doivent faire acquérir à leurs enfants » (Burns, Espinosa et Snow, 2003 : 77). Il semblerait que le premier type de pratiques « installe des conditions plus favorables au développement de la littératie » (ibid.). Mais la pratique littéracique qui selon nous participe le plus au développement du savoirlire est la lecture partagée.
Le cas des lectures partagées
Les lectures partagées sont « les lectures faites par des adultes ou des enfants lecteurs à des enfants non lecteurs » (Frier, 2011 : 12). Elles mettent ainsi en relation une personne maitrisant le savoir-lire – soit un parent ou même un membre de la fratrie – avec un enfant qui ne maitriserait pas encore le savoir-lire ou en tout cas pas suffisamment pour être autonome dans la lecture. Ces lectures, que nous pourrions considérer comme le geste par excellence de la médiation parentale autour du lire, s’inscrivent dans des pratiques diverses mais dans un contexte bien particulier.
La lecture partagée : un contexte particulier
Ces lectures partagées interviendraient selon Baudier, Fontaine et Pécheux (1997 : 230) « dès la deuxième année de vie, voire plus tôt » et fourniraient ainsi « très précocement des occasions particulièrement riches d’accéder à des représentations et des codes culturels ».
Toutefois, certaines études telles que celles menées par Adams (1990) et Grossmann (2001) mettent au jour des pratiques diverses. Bonnéry (2014 : 53) a étudié les différents types de lecture partagée qui existent dans les familles dites populaires. Il semblerait que deux manières de lire différentes s’affrontent : une première, basée sur l’oralisation stricte du contenu de l’album ou du livre qui est lu et une seconde, basée davantage sur l’interprétation du texte. Alors que les premiers « ne [prennent] quasiment pas d’indices dans l’imprimé pour expliciter des non-dits ou des sous-entendus du récit » et « échangent très peu sur le contenu et les formes de l’histoire », les seconds tendent à « privilégier le “sens” de ce qui doit être retenu, la moralité ou la réflexion sur l’expérience personnelle de l’enfant que l’histoire lue délivre explicitement » et « reformulent ce qui doit être “retenu” par l’enfant ». Toujours selon Bonnir (2014 : 54), les parents dit « cultivés » auraient une manière de lire différente des parents « populaires ». En effet, alors que les premiers tendent à valoriser la production d’inférence par l’enfant, les seconds, « de peur » peut-être « que les enfants ne comprennent pas les ouvrages […] “referment” le sens en “corrigeant” ou complétant la lecture par la formulation du sens auquel ils ont accès ». Ainsi, il semblerait que ces parents explicitent eux mêmes les passages réticents à leur enfant afin de lui éviter d’émettre de fausses hypothèses de lecture. Il nous semble plus judicieux de favoriser la production d’inférence et d’hypothèse par l’enfant lui-même et de ne pas lui délivrer immédiatement les clefs pour comprendre l’œuvre. En effet, favoriser des stratégies de lecture indépendantes pourrait être l’une des priorités des passeurs de lecture afin d’assurer une meilleure compréhension des écrits lors des futures lectures autonomes que feront les apprentis-lecteurs.
Une stratégie de lecture partagée : l’étayage
Mais avant de favoriser l’autonomie des enfants, les parents et plus particulièrement les mères semblent occuper une place prépondérante quant à l’acculturation littéraire (cf. notamment Lafranque, 2003). En effet, ces dernières lors des lectures partagées mettent en œuvre un ensemble de stratégies destinées à faciliter l’appréhension de l’écrit par leur enfant.
Parmi ces stratégies se trouve celle de l’étayage.
A l’origine de cette question de l’étayage se trouve une expérience liée à la pédagogie socioconstructiviste ayant pour objectif d’observer la nature « des processus de tutelle, soient les moyens par lesquels un adulte ou un “expert” aide quelqu’un de moins adulte ou moins expert » (notre traduction de Wood et al., 1976 : 89). Ainsi, l’étayage entre pleinement dans notre problématique d’acculturation littéraire puisque c’est grâce à un adulte considéré comme expert que l’enfant parvient à entrer en contact avec l’écrit et la littérature. L’étayage apparaitrait dès l’instant où les parents et plus particulièrement les mères mettent en place des « formats d’interactions prédictibles qui peuvent servir de microcosme pour communiquer et […] constituer une réalité partagée » (Lafranque, 2003 : 14). L’étayage prend ainsi principalement place dans la communication. Certaines études, telles que celle de Bruner (1983), décomposent l’étayage en six fonctions principales : l’enrôlement (soit le fait d’engager l’intérêt de l’enfant dans la tâche) ; la réduction des degrés de liberté (soit la diminution des actions requises pour atteindre la solution) ; le maintien de l’orientation (soit le fait de maintenir la concentration de l’enfant sur la tâche et lui éviter les distractions) ; la signalisation des caractéristiques déterminantes (soit le fait de signaler ce qui est pertinent pour la réalisation de la tâche) ; le contrôle de la frustration (éviter que les erreurs de l’enfant ne se transforment en sentiment d’échec persistant) ; et enfin, la démonstration (soit le fait de montrer les stratégies pour réussir l’exécution de la tâche). L’étayage désigne ainsi un dispositif de soutien de l’apprentissage qui doit progressivement amener l’autonomisation des processus (Dumortier, 2001 : 9). Ici, il s’agit de faire en sorte de guider l’enfant encore non lecteur afin de le familiariser avec l’écrit et en faciliter son appréhension. Plusieurs études semblent avoir été menées concernant l’étayage maternel en situation de lecture partagée.
Ainsi, Testud et Touquette (2006 : 22-23) distinguent un étayage touchant directement au langage – « débit plus lent, contours intonatifs accentués, ton plus aigu, pauses plus marquées, simplification lexicale et syntaxique, clarté de la construction du discours » – d’un étayage pragmatique – où « les énoncés maternels sont surtout des questions d’information et des requêtes en action » -. Baudier, Fontaine et Pécheux (1997 : 230) ont mené une étude sur l’étayage maternel lors d’une situation de lecture partagée. Les mères mettraient en place des stratégies afin que leur enfant « maintienne son attention du début à la fin de la tâche » (ibid. : 232), notamment la « manipulation du livre (taper, secouer, tourner plusieurs pages) » ou encore le « pointage ». Nous pensons que ces comportements sont importants puisqu’ils permettent d’inscrire l’enfant dans une situation d’échange particulière autour du livre, situation qui lui permet d’appréhender plus facilement encore la lecture.
Lectures partagées : quel intérêt ?
Grossmann (2001 : 136) revient sur les différentes fonctions que semblent revêtir ces lectures partagées : « rites d’avant-coucher […], moyen de transmettre des textes appartenant à l’héritage culturel, prétexte à discussions variées, moyen de familiariser l’enfant avec certaines caractéristiques de la langue à l’écrit, tant au plan linguistique que discursif, etc. ».
Ainsi, la situation de lecture partagée serait bénéfique pour l’enfant et ce, sur plusieurs plans.
En effet, dans un premier temps, les lectures partagées apporteraient de multiples bénéfices sur le plan langagier. Bonnery (2010 : 323) déclare d’ailleurs que les albums de littérature jeunesse sont écrits « en perspective des échanges qu’ils vont permettre et qui constitueront un vecteur potentiel de transmission, explicite ou tacite ». Ces lectures partagées n’endossent pas qu’un seul rôle mais englobent des pans divers de la relation à l’écrit : transmission de la culture, réflexion sur la langue écrite, etc. Cependant, la fonction qui nous semble fondamentale reste la question du « [rituel] d’avant-coucher ». Morais et Robillart (1998 : 138) postulent que la lecture partagée est « une activité autonome et irremplaçable par la nature même des liens qui se nouent entre parents et enfants et qui contribuent à l’investissement affectif de la lecture ». Le terme « affectif » semble ici important. En effet, grâce à la relation privilégiée, intime, qui s’instaure entre le parent et l’enfant lors de ce « rituel de lecture » qui a souvent lieu « le soir juste avant de dormir » (Saint-Pierre, 2012), ce qui serait ici favorisé par le parent médiateur ou passeur de lecture, c’est le plaisir de lire. Le terme de rituel semble pertinent puisqu’en général cette lecture « se met en place dans le déroulement de la vie familiale à la même heure tous les soirs » et dure en règle générale entre « 10 et 30 minutes » (ibid.).
La présomption d’une influence des parents sur le développement des habiletés de lecture de l’enfant est assumée par plusieurs chercheurs – notamment Sénéchal et Lefevre, 2002 -. André (2003 : 9-10) a d’ailleurs remarqué de réels bénéfices pour les enfants dont les parents s’investissaient et « soutenaient l’activité de lecture depuis plusieurs années (pendant leur scolarisation en classe maternelle et même avant) ». Lundberg (2002) considère que lorsqu’un adulte et plus particulièrement un parent fait la lecture à un enfant, il y a un impact non négligeable sur le savoir-lire. En effet, en étant exposé fréquemment à de l’écrit comme un conte ou un album de jeunesse, l’enfant parviendrait à développer des compétences particulières et nécessaires à une bonne maitrise de l’écrit : phonologiques (représentations phonologiques plus précises), textuelles (construction d’un récit), intellectuelles (connaissances encyclopédiques), lexicales (vocabulaire souvent plus soutenu et moins courant) et syntaxiques (tournures de phrases particulières à l’écrit). Ces lectures permettraient à l’enfant de développer sa compréhension des récits puisque « [p]our l’enfant qui ne sait pas lire, la voix du parent transforme les mots écrits inaccessibles en une réalité communicable. Plus encore par l’intonation toute particulière que mettent les parents dans le récit, l’enfant comprend qu’il s’agit d’un moment spécial. Les parents chuchotent certains passages particulièrement angoissants ou encore ils prennent une voix grave pour jouer les méchants. Ces variations dans la voix n’amusent pas seulement l’enfant, elles l’initient à la trame du récit et accentuent l’intensité dramatique de l’histoire partagée » (ibid.). Ainsi la lecture dramatisée permettrait à l’enfant de développer sa compréhension du texte et à apprécier davantage ce moment de lecture. Outre ce principe de lecture-plaisir ces lectures à voix hautes par les parents apporteraient d’autres bénéfices puisqu’elles permettraient par exemple à l’enfant de développer son lexique (Sénéchal et al. 1996).
Ainsi, les parents jouent un rôle primordial concernant l’exposition à la littérature et à l’écrit de l’enfant, mais ils ne sont pas les seuls à permettre cette acculturation. En effet, cette dernière doit en fait se réaliser conjointement. Lorsque les parents ne peuvent fournir à l’enfant une exposition à la littérature, la maternelle doit venir combler cette expérience lacunaire de l’écrit. Boulanger (2012 :11) insiste d’ailleurs sur ce point : « L’enfant qui arrive au CP sait en général beaucoup de choses surtout […] s’il grandit dans un milieu culturellement favorisé. L’école maternelle devrait donc compenser pour les autres ce que leur environnement ne leur offre pas ».
Éléments de définition des représentations sociales
Dans le cadre de notre mémoire nous avons dû, au fil de nos réflexions, nous pencher sur le concept de représentation sociale. Intéressons-nous un premier temps au concept même des représentations sociales.
Ancrage théorique de la représentation sociale
Une définition qui fait consensus
Ce concept de représentation sociale se situe au carrefour de différentes disciplines telles que la sociologie, l’anthropologie ou encore la psychologie sociale. Il existerait un consensus autour de la représentation sociale en tant que « forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1994 : 36). Pour Seca (2010), les représentations sociales sont « des programmes sociocognitifs et comportementaux agissant sur les groupes et leurs membres ». Il semblerait ainsi qu’une représentation sociale « recouvre l’ensemble des croyances, des opinions, des attitudes qui sont produites et partagées par les membres d’un groupe en direction d’un objet social donné. Il ne s’agit pas de tous les objets sociaux mais uniquement ceux autour desquels il y a des enjeux sociaux. » (Moscovici, 1989). Roussiau et Bonardi (2001 : 16) considèrent la représentation sociale comme étant « une grille de lecture de la réalité, socialement construite » par des « groupes forts différents » et ce en fonction de « leurs intérêts », ce qui explique qu’un même sujet puisse avoir des représentations complètement différentes en fonction des groupes qui les ont construites. Le problème des représentations sociales est de savoir « quelles sont leur limites, leurs contours, mais aussi l’étendue du champ social concerné, les référents culturels évoqués explicitement ou implicitement », etc. (Mannoni, 1998 : 4). Ces représentations peuvent aisément être étudiées puisqu’elles « circulent dans les discours, sont portées par les mots [et] véhiculées dans les messages et images médiatiques » (Jodelet, 1989 : 32).
Les caractéristiques des représentations sociales
Selon Moscovici (1961, cité par Roussiau et Bonardi, 2001 : 15), les représentations sociales sont ancrées sur différents piliers tels qu’ « une dimension structurale », soit la représentation sociale peut être considérée comme « un ensemble organisé » ; « une dimension attitudinale », soit une « position évaluative vis-à-vis de l’objet de représentation » sociale ; ainsi qu’un « niveau d’information détenu par l’individu à l’intérieur de son (ou ses) groupe(s) d’appartenance et à propos d’un objet donné », soit la base informative qui est à l’origine de la construction de cette représentation. Mais les représentations sociales semblent avoir d’autres caractéristiques. En effet, il semblerait que ces représentations se situent « au cœur des interactions sociales et suscitent le positionnement d’un groupe – et/ou d’un individu – par rapport à un objet précis » (Mugnier, 2006 : 115). Ainsi, les représentations sociales suscitent la prise de position par un groupe et par rapport à un groupe sur un objet donné. De plus, ces représentations ne sont pas statiques mais elles évoluent en permanence.
En ce sens, Abric (1984, cité par Mugnier, 2006 : 116) a mis au point la théorie dite « du noyau central et des éléments périphériques ». Alors que le noyau, « composant fondamental de la représentation » est admis par tous et assez stable pour résister au changement, les éléments périphériques situés autour de ce noyau sont caractérisés par une certaine instabilité et la possibilité de « variations individuelle ou collective » (ibid.). Enfin, les représentations sociales ne semblent pas se fonder à partir de données objectives ou exactes mais plutôt de sentiments d’évidence, de « connaissance naïve » comme le souligne Mugnier (2006 : 116).
Les représentations sociales autour du savoir-lire
La lecture étant une question socialement vive, les représentations sociales qui en découlent sont nombreuses. Petit (2008 : 9) déclare d’ailleurs que « l’idée que la lecture puisse contribuer au bien être est très ancienne, autant sans doute, que la croyance qu’elle puisse être dangereuse ou nuisible ». Il existe ainsi différentes représentations sociales du savoir-lire, représentations parfois antithétiques et que nous allons maintenant tenter de passer en revue.
Dichotomie lecture masculine / lecture féminine
Jozsa et Leenhardt (1999 : 5) font état d’une représentation sociale de la lecture basée sur le genre. Il existerait une lecture masculine et une lecture féminine. Alors que la première semble se définir par son caractère sérieux et savant et permettrait d’enseigner « aux hommes ce qui leur est nécessaire pour comprendre et diriger le monde comme système d’idées et de choses », la seconde se caractérise davantage par la notion de « divertissement et de plaisir ».
Cette lecture considérée comme « passionnelle » ne délivrerait aucun enseignement mais « occuperait un temps libre et surtout une “sensibilité inemployée” ». Nous retrouvons derrière ce type de représentations sociales des considérations plutôt discriminantes qu’il conviendrait de redéfinir. Plutôt que de considérer cette dichotomie en terme de genre, il nous semble plus judicieux de la reconsidérer en terme de fonction de la lecture et de laisser de côté toute distinction en terme de genre, même si « la notion de genre s’inscrit dans une définition sociopolitique qui souligne l’importance de la construction sociale du masculin et du féminin » et « définit des différences socialement, culturellement et politiquement construites et déterminées ». Ce dernier « apparaît donc comme un outil d’analyse qui ne se réfère pas à un en-soi féminin et masculin, mais qui permet d’étudier des interrelations, c’està-dire de repérer des rôles occupés ou assignés selon qu’on est un homme ou femme. » (Armogathe, 2009 :1).
Dichotomie lecture instrumentale / lecture plaisir
Si nous considérons cette représentation sociale par un autre prisme que celui du genre, nous parvenons à une distinction lecture instrumentale/lecture plaisir, soit une distinction entre les différentes fonctions de l’écrit, fonctions que nous avions déjà abordées dans la partie théorique de ce mémoire.
L’impact du milieu socio-économique sur les représentations des fonctions de la lecture
Prêteur et Carayon (1986 : 280), au terme d’une étude auprès d’enfants âgés de six à douze ans sont parvenus à distinguer différentes catégories de représentations sociales autour de la lecture en partant du principe que « sachant que les pratiques culturelles sont marquées par les conditions de vie sociale des différents milieux », il semble possible d’observer « une pratique et un goût variable de la lecture en tant que loisir ». Ainsi, il semblerait que les enfants issus de milieux favorisés associent la lecture tant à sa fonction instrumentale qu’à la notion de plaisir contrairement aux enfants issus de milieux dits défavorisés. Ces derniers associent davantage la lecture à sa fonction instrumentale. Nous sommes d’avis que cela pourrait provenir d’un certain manque d’exposition à l’écrit. En effet, nous avons vu précédemment le rôle du facteur social dans l’investissement de la lecture et abordé le fait que certaines recherches telles que celle menée par Duncan et Seymour (2000) montrent qu’une grande majorité des élèves qui ont des difficultés en lecture proviennent de milieux socio- économiques défavorisés. Or, ces différences de représentations sociales seraient à notre sens davantage du ressort de difficultés en lecture que du milieu social. Geneviève, de Geneve et Niederberger (1996 : 168) semblent aller dans ce sens puisque selon une de leur étude, « les enfants sans difficulté d’apprentissage de la lecture semblent […] avoir des représentations un peu plus précises que les enfants avec difficultés ». Il semblerait donc que ce soit à partir de cette conception en terme d’avec difficultés/sans difficultés que partent les différences de représentations sociales.
Les représentations sociales des fonctions de la lecture
Selon Bandura (1986), la représentation de l’utilité d’une activité semble liée au sentiment de compétence qu’éprouve l’individu à son égard, étant donné que cette perception tend à déterminer en partie la valeur de cette activité. Carayon (1991, cité par Ecalle et Magnan, 2002) définit plusieurs représentations sociales liées à ces notions de lecture instrumentale et lecture plaisir : l’idée de « plaisir, de technique à acquérir, de travail scolaire, de moyens d’accès à différents écrits, de moyen d’information, de moyen de relations avec des adultes qui racontent des histoires, de moyen de relations avec des adultes qui enseignent la lecture ». Ecale et Magnan (2002) ont réalisé une étude permettant de rendre compte des « items saillants de la représentation sociale de la lecture » chez des enfants de fin de CE1. Plusieurs réponses sont revenues telles que « éviter de redoubler », « apprendre avec le maitre », « avoir une bonne note », « apprendre plein de choses » ou encore « aimer lire ».
Nous pouvons également citer l’étude de MacArthur et al. (1995 ; cité par Beer-Toker et Gaudreau, 2006 : 351) qui permet de constater que « des élèves âgés de dix ans présentant des troubles d’apprentissage ont significativement amélioré leur performance en écriture quand on leur a présenté des tâches d’écriture dont ils percevaient l’utilité ». Ainsi il semblerait que le savoir-lire se pare de diverses représentations sociales sur ses fonctions et que plus cette fonction paraît utile, plus les performances en lecture peuvent être améliorées.
Les représentations sociales de la lecture des enfants eux-mêmes
Ces représentations sociales de la lecture sont également portées par les enfants eux mêmes et concernent tant ses finalités que les procédures qu’elle met en place.
L’existence de conceptions dominantes
Les représentations des enfants sur la lecture sont de nature diverse. Dans un premier temps, il semblerait qu’il existe une grande confusion entre l’écrit et l’oral (Chauveau, 1997). Pour certains enfants, lire, c’est dire. Nous sommes d’avis que cette conception tend à s’expliquer par la pratique scolaire de la lecture magistrale à l’école maternelle. Cette confusion écrit/oral va de pair avec l’un des trois pôles des conceptions de la lecture mises au jour par Bernardin (1997) chez des élèves entrant au cours préparatoire : lire c’est se remémorer une histoire lue et racontée par un pair. Ainsi, pour certains élèves, écouter une histoire et s’en souvenir serait partie prégnante de l’acte de lecture. Une autre confusion décelée chez ces élèves est le caractère presque naturel du savoir-lire. En effet, certains considèreraient que le fait de savoir-lire « résulte d’un développement normal : “quand on est grand, on sait” » (Barré-de Miniac, 2003 : 115). D’après ces représentations, le savoir-lire ne résulterait alors pas d’un apprentissage compliqué puisqu’il est presque inhérent au développement. Ces élèves considèrent qu’ils liront forcément. Enfin, une troisième conception de la lecture anime ces élèves puisque, à la question : « que faut-il faire pour apprendre à lire ? », certains semblent faire une « confusion entre lire et imaginer » (Barré de Miniac, 2003b : 115). Pour certains élèves, lire une histoire serait synonyme de se raconter une histoire “dans sa tête” en ne restant pas forcément fidèle au texte qui est lu. Nous sommes d’avis que cette confusion peut parfois être entretenue par le processus d’inférence que doivent mettre en place les lecteurs. Cependant, il faut bien faire prendre conscience aux élèves que pour comprendre une histoire, ils doivent « construire une représentation mentale de l’histoire racontée » (Cèbe et Goigoux, 2009 : 17), c’est-à-dire se « faire un film » de l’histoire mais en prenant uniquement appui sur ce qui est dit par le texte et donc vérifiable.
Le savoir-lire, la persistance de certains malentendus
Cèbe et Goigoux (2009 : 8) se sont également penchés sur ces représentations de la lecture et déclarent qu’il existe un certain nombre de « malentendus » sur la nature même de l’activité de lecture. Il semblerait selon eux que les élèves se méprennent « sur les attentes de l’école, sur la nature des tâches de lecture, sur les procédures requises et sur l’activité intellectuelle à mobiliser pour y faire face ». Ces malentendus concernent de fait tout à la fois les procédures de lecture mais également ses finalités. Ainsi, certains élèves pensent qu’il suffit de « décoder tous les mots d’un texte pour le comprendre » (Cèbe et Goigoux, 2009 : 8). La compréhension serait alors pour eux indissociable de l’identification des mots. Or, nous savons bien que ce n’est pas le cas : il ne suffit pas d’être bon décodeur pour être bon “compreneur”. Cette conception erronée est la source de procédures inadéquates telles que le fait de considérer chaque phrase comme des segments isolés et ne pas tenter de faire des liens entre-elles pour construire le sens global d’un texte. De même, la lecture est parfois vue par certains élèves comme une « simple recherche d’informations » (ibid.). Cette représentation est directement induite par les pratiques scolaires de questionnaire de lecture. Irwin (1986) déclare d’ailleurs que « très souvent l’enseignement de la compréhension est limité aux questions et le seul “feed-back” donné à l’élève est l’exactitude ou non de sa réponse ». En effet, après la lecture d’un texte, les élèves sont souvent invités à répondre à des questions de compréhension ponctuelles, où ils doivent pour ce faire s’appuyer sur une partie ou un extrait bien précis du texte. L’activité de lecture se résumerait ainsi ici à un simple repérage thématique ou à de la localisation d’informations qui ne sont pas utiles à la création d’une compréhension globale mais plutôt à une compréhension morcelée, sur des points très spécifiques. Nous soutenons que la compréhension implique de faire des liens entre les différentes informations véhiculées par le texte et non de comprendre isolément quelques bribes d’information.
L’effet des représentations sociales de la lecture sur l’enfant lecteur
Carayon (1991) à la suite d’une étude sur les représentations sociales de la lecture chez des enfants déjà lecteurs est parvenu à distinguer deux grands types de représentations sociales : les représentations dites défavorables et les représentations non défavorables. Les représentations non défavorables se scindent en deux groupes : les représentations ambivalentes et les représentations favorables. Alors que les représentations défavorables englobent les notions de nécessité sociale et des techniques à acquérir afin de pouvoir lire, les représentations ambivalentes font de la lecture une « source d’informations » ainsi qu’une activité scolaire qui participe à « la réussite sociale » (Ecalle et Magnan, 2002). Les représentations favorables enfin associent à la lecture la notion de plaisir et d’« activité intégrée à la vie quotidienne » (ibid.). Ce qui nous semble d’autant plus intéressant dans l’étude de Carayon (1991), c’est que ce dernier est arrivé à la conclusion que la représentation sociale que possède l’enfant sur la lecture a une influence sur ses performances. En effet, les enfants qui ont une représentation favorable de la lecture et l’associent à une activité plaisante ne rencontrent pas en règle générale de problèmes de lecture. Au contraire, les enfants qui possèdent une représentation défavorable de la lecture semblent être ceux qui rencontrent le plus de difficulté. Ainsi, nous sommes d’avis que c’est par la maitrise ou la non maitrise du savoir-lire que s’élaborent les représentations sociales de la lecture et ce, dès le plus jeune âge. Il faut donc agir très rapidement sur ces représentations et faire en sorte que le savoir-lire paraisse plaisant et utile à l’enfant.
|
Table des matières
Introduction
Chapitre 1 : Le savoir-lire : des prémisses aux mécanismes
I. Le développement informel du savoir-lire
II. Le développement formel du savoir-lire
III. Quel savoir-lire pour l’enfant sourd : la question de la langue première pour accéder à l’écrit
Conclusion du chapitre 1
Chapitre 2. Le rôle des « passeurs de lecture » dans l’acquisition du savoir-lire (Frier, 2011)
I. La question de l’école maternelle et de l’exposition à la littérature et à l’écrit : le rôle de l’enseignant dans l’acculturation littéraire
II. La question de l’espace familial et de l’exposition à la littérature et à l’écrit
Conclusion du chapitre 2
Conclusion de la partie théorique
Chapitre 3 : La question des représentations sociales autour du savoir-lire et de leur recueil
I. Éléments de définition des représentations sociales
II. Méthodologie et corpus
Conclusion du chapitre 3
Chapitre 4 : Représentations sociales du savoir-lire : Analyse des entretiens autour de la triade vouloir-lire, pouvoir-lire et devoir-lire
I. Du devoir-lire au pouvoir-lire : des attentes multiples et des réalités extraordinaires ?
II. L’investissement des parents dans le développement du savoir-lire de leur enfant : le passeur de lecture
III. La question du vouloir-lire : quel plaisir face à la lecture ?
Conclusion du chapitre 4
Conclusion de la partie 2
Conclusion générale
Glossaire
Bibliographie
Table des Figures
Table des matières
RÉSUMÉ
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet

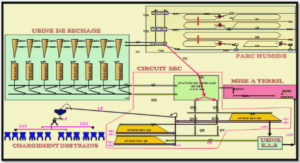





Bonjour qui est l’auteur de ce mémoire?